Définition de « central »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot central de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur central pour aider à enrichir la compréhension du mot Central et répondre à la question quelle est la définition de central ?
Une définition simple : (fr-accord-al|centr|s??t.?) central (m)
Expression : maison centrale chauffage central, se dit d’un système de chauffage dans lequel des radiateurs distribuent à travers les étages d’une maison ou les pièces d’un appartement la chaleur produite par une chaudière.
Approchant : centrale, centraliser, centralisation, centre, centrer
Définitions de « central »
Trésor de la Langue Française informatisé
CENTRAL, ALE, AUX, adj. et subst.
Wiktionnaire
Adjectif - français
central \s??.t?al\ masculin
- Qui est dans le centre, qui a rapport au centre.
- Point central.
- éclipse centrale.
- Le Plateau central.
- L'Afrique centrale.
- Je me logerai dans le quartier le plus central.
-
(Figuré) Principal.
- Administration centrale.
- Bureau central des Postes.
- école centrale des Arts et manufactures, où l'on forme des ingénieurs civils.
- Feu central, se dit du Feu que quelques philosophes ont cru être au centre de la terre.
Nom commun - français
Centrale \s??.t?al\
- Ellipse du nom de l'École centrale des arts et manufactures, fondée à Paris en 1829.
- (Renseignement) Surnom donné au siège d'un service de renseignement extérieur.
Nom commun - français
central \s??t.?al\ masculin
- (Par ellipse) (Téléphonie) Central téléphonique.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Qui est dans le centre, qui a rapport au centre. Point central. Éclipse centrale. Le Plateau central. L'Afrique centrale. Je me logerai dans le quartier le plus central. Il signifie aussi figurément Principal. Administration centrale. Bureau central des Postes. Maison centrale, Maison de détention. École centrale des Arts et Manufactures, où l'on forme des ingénieurs civils. Feu central, se dit du Feu que quelques philosophes ont cru être au centre de la terre. Chauffage central se dit d'un Système de chauffage dans lequel des radiateurs distribuent à travers les étages d'une maison ou les pièces d'un appartement la chaleur produite par une chaudière. Force centrale, en termes de Physique, Force par laquelle un corps qui se meut tend à s'éloigner ou à s'approcher d'un centre.
Littré
- 1Qui est au centre, qui a rapport au centre. Les points centraux. Feu central, feu ou du moins très forte chaleur qui existe au centre de la terre.
-
2 Par extension, province centrale, quartier central, qui est au c?ur du pays, de la ville.
Administration centrale, administration à laquelle tout aboutit.
Pouvoir central, par opposition à pouvoir local, pouvoir qui gouverne ou représente l'ensemble de la nation.
Écoles centrales, écoles qui, d'après un décret de la Convention du 3 brumaire an IV, devaient être et ont été en effet établies dans les chefs-lieux des départements. L'enseignement y comprenait le dessin, l'histoire naturelle, les langues anciennes, les mathématiques, la physique et la chimie, la grammaire générale, les belles-lettres, l'histoire et la législation. Les écoles centrales, plus belles en théorie que dans la pratique, ont été remplacées, à la création de l'Université impériale, par les lycées et les colléges. Aujourd'hui il n'y a plus d'école centrale proprement dite?; quand on emploie ce terme, on veut dire qu'on y a concentré tout ce qui se rapporte à tel ou tel enseignement, ou qu'elle est le centre où tout cet enseignement vient aboutir. Telle est l'école centrale des arts et manufactures.
- 3 Terme de mécanique. Force centrale, force dirigée vers un centre, ou émanant d'un centre, ou se rapportant à un centre.
- 4 Terme de géométrie ancienne. Règle centrale, règle d'après laquelle on se servait du cercle et de la parabole pour construire les racines des équations du 3e et du 4e degré.
Encyclopédie, 1re édition
CENTRAL, adj. (Méchanique.) se dit de ce qui a rapport à un centre. Voyez Centre.
C'est ainsi que nous disons éclipse centrale, feu central, force centrale, regle centrale, &c. Voyez les articles Feu, Éclipse, &c.
Forces centrales, sont les forces ou puissances par lesquelles un corps mû tend vers un centre de mouvement, ou s'en éloigne.
C'est une loi générale de la nature, que tout corps tend à se mouvoir en ligne droite ; par conséquent un corps qui se meut sur une ligne courbe, tend à chaque instant à s'échapper par la tangente de cette courbe : ainsi pour l'empêcher de s'échapper suivant cette tangente, il faut nécessairement une force qui l'en détourne & qui le retienne sur la courbe. Or c'est cette force qu'on appelle force centrale. Par exemple un corps A (fig. 24. Méchan.) qui se meut sur le cercle BEA, tend à se mouvoir au point A suivant la tangente AG, & il se mouvroit effectivement suivant cette tangente, s'il n'avoit pas une force centrale qui le pousse vers le point C, & qui lui feroit parcourir la ligne AM dans le même tems qu'il parcourroit AD ; de sorte qu'il décrit la petite portion de courbe AE.
Remarquez qu'il n'est pas nécessaire que la force centrale soit toûjours dirigée vers un même point : elle peut changer de direction à chaque instant ; il suffit que sa direction soit différente de celle de la tangente, pour qu'elle oblige le corps à décrire une courbe. Voyez Centre de mouvement ; voy. aussi Force.
Les forces centrales se divisent en deux especes, eu égard aux différentes manieres dont elles sont dirigées par rapport au centre, savoir en centripetes & en centrifuges. Voyez ces mots.
Lois des forces centrales. Le célebre M. Huyghens est le premier qui ait découvert ces lois. Mais outre qu'il les a données sans démonstration, il ne s'est appliqué qu'à déterminer les lois des forces centrales dans le cas où le corps décrit un cercle. Plusieurs auteurs ont démontré depuis les lois données par M. Huyghens, & le célebre M. Newton a étendu la théorie des forces centrales à toutes les courbes possibles.
Parmi les auteurs qui ont démontré les propositions de M. Huyghens, personne ne l'a fait plus clairement & d'une maniere plus simple, que le marquis de l'Hôpital dans les Mémoires de l'Académie de 1701. 1°. Il commence par enseigner la maniere de comparer la force centrale avec la pesanteur ; & il donne là-dessus la regle générale suivante, qui renferme toute la théorie des forces centrales.
Supposons qu'un corps d'un poids déterminé se meuve uniformément autour d'un centre avec une certaine vîtesse, il faudra trouver de quelle hauteur il devroit être tombé pour acquérir cette vîtesse ; après quoi on fera cette proportion : comme le rayon du cercle que le corps décrit est au double de cette hauteur, ainsi son poids est à sa force centrifuge. Il est visible que par cette proposition on peut toûjours trouver le rapport de la force centrale d'un corps à son poids ; & que par conséquent on pourra facilement comparer les forces centrales entre elles. Mais si on veut se contenter de comparer les forces centrales entre elles sans les comparer avec la pesanteur, on peut se servir de ce théorème, que les forces centrales de deux corps sont entre elles comme les produits de leurs masses, multipliés par les quarrés de leurs vîtesses, & divisés par les rayons ou par les diametres des cercles qu'ils décrivent. On peut démontrer cette proposition sans calcul, d'après M. Newton, de la maniere suivante. Imaginons les cercles que ces corps décrivent comme des polygones réguliers semblables, d'une infinité de côtés ; il est certain que les forces avec lesquelles chacun des corps frappe un des angles de ces polygones, sont comme les produits de leurs masses par leurs vîtesses. Or dans un même tems ils rencontrent d'autant plus d'angles qu'ils vont plus vîte, & que le cercle est d'un rayon plus petit : donc le nombre des coups dans un même tems, est comme la vîtesse divisée par le rayon ; donc le produit du nombre des coups par un seul coup, c'est-à-dire la force centrale, sera comme le produit de la masse multiplié par le quarré de la vîtesse, & divisé par le rayon.
Donc si deux corps M, m, décrivent les circonférences de cercles C, c avec des vîtesses V, u pendant les tems T, t, & que les forces centrales de ces corps soient F, f, & les rayons des cercles qu'ils décrivent R, r, on aura, ; de plus, on a, ; donc on aura encore .
2°. Il est aisé de conclurre de là, que si deux corps de poids égal décrivent des circonférences de cercles inégaux dans des tems égaux, leurs forces centrales seront comme les diametres AB & HL (Planc. de Mechan. fig. 24.) ; car si m = M & t = T, on aura ; & par conséquent si les forces centrales de deux corps qui décrivent des circonférences de deux cercles inégaux, sont comme leurs diametres, ces corps feront leurs révolutions dans des tems égaux.
3°. La force centrale d'un corps qui se meut dans une circonférence de cercle, est comme le quarré de l'arc infiniment petit AE, divisé par le diametre AB ; car cet arc infiniment petit décrit dans un instant, peut représenter la vîtesse, puisqu'il lui est proportionnel. Ainsi puisqu'un corps décrit dans des tems égaux, par un mouvement uniforme, des arcs égaux AE, la force centrale par laquelle le corps est poussé dans la circonférence du cercle, doit être constamment la même.
4°. Si deux corps décrivent par un mouvement uniforme différentes circonférences, leurs forces centrales seront en raison composée de la doublée de leur vîtesse, & de la réciproque de leur diametre ; d'où il s'ensuit que si les vîtesses sont égales, les forces centrales seront réciproquement comme les diametres ; & si les diametres AB & HL sont égaux, c'est-à-dire si les mobiles se meuvent dans la même circonférence, mais avec des vîtesses inégales, les forces centrales seront en raison doublée des vîtesses.
Si les forces centrales de deux corps qui se meuvent dans des circonférences différentes, sont égales, les diametres AB & HL seront en raison doublée des vîtesses.
5°. Si deux corps qui se meuvent dans des circonférences inégales sont animés par des forces centrales égales, le tems employé à parcourir la plus grande circonférence sera au tems employé à parcourir la plus petite, en raison soûdoublée du plus grand diametre AB, au moindre HL : c'est pourquoi on aura ; c'est-à-dire que les diametres des cercles dans les circonférences desquels ces corps sont emportés par une même force centrale, sont en raison doublée des tems.
Il s'ensuit aussi de là, que le tems que des corps poussés par des forces centrales égales employent à parcourir des circonférences inégales, sont proportionnels à leurs vîtesses.
Les forces centrales sont en raison composée de la directe des diametres & de la réciproque des quarrés des tems employés à parcourir les circonférences entieres.
6°. Si les tems dans lesquels les corps parcourent les circonférences entieres ou des arcs semblables, sont comme les diametres des cercles, les forces centrales seront alors réciproquement comme ces mêmes diametres.
7°. Si un corps se meut uniformément dans la circonférence d'un cercle avec la vîtesse qu'il acquiert en tombant de la hauteur AF, nous avons dit que la force centrale sera à la gravité comme le double de la hauteur AF est au rayon CA ; & par conséquent si on nomme G la gravité du corps, la force centrifuge sera . Par là on connoîtra quelle doit être la force centrifuge & la vîtesse d'un corps attaché à un fil, pour qu'il ne rompe point ce fil en circulant horisontalement : car supposons qu'un poids de trois livres, par exemple, rompe le fil, & que le poids du corps soit de deux livres, on aura G égal à deux livres, & devra être plus petit que trois livres, d'où l'on tire : ainsi la vîtesse que le corps doit avoir pour ne point rompre le fil, doit être plus petite que celle qu'il acquerroit en tombant d'une hauteur égale aux du rayon. Si le corps circuloit verticalement, il faudroit que fût < trois livres.
8°. Si un corps grave se meut uniformément dans la circonférence d'un cercle, & avec la vîtesse qu'il peut acquérir en tombant d'une hauteur égale à la moitié du rayon, la force centrale sera alors égale à la gravité ; réciproquement si la force centrale est égale à la gravité, le corps se mouvra dans la circonférence du cercle avec la même vîtesse qu'il auroit acquise en tombant d'une hauteur égale à la moitié du rayon.
9°. Si la force centrale est égale à la gravité, le tems qu'elle employera à faire parcourir la circonférence entiere, sera au tems dans lequel un corps grave tomberoit de la moitié du rayon, comme la circonférence est au rayon.
10°. Si deux corps se meuvent dans des circonférences inégales & avec des vîtesses inégales, de sorte que les vîtesses soient entr'elles en raison réciproque de la soûdoublée des diametres, les forces centrales seront en raison réciproque de la doublée des distances au centre des forces.
11°. Si deux corps se meuvent dans des circonférences inégales avec des vîtesses qui soient entre elles réciproquement comme les diametres, les forces centrales seront en raison inverse des cubes de leur distance au centre des forces.
12°. Si les vitesses de deux corps qui se meuvent dans des circonférences inégales, sont en raison inverse de la soûdoublée des diametres, les tems qu'ils employeront à faire leur révolution entiere ou à parcourir des arcs semblables, seront en raison inverse de la triplée des distances du centre des forces : c'est pourquoi si les forces centrales sont en raison inverse de la doublée des distances du centre, les tems que les corps employeront à faire leur révolution entiere ou à parcourir des arcs semblables, seront en raison inverse de la triplée des distances.
13°. Ces différentes lois sont aisées à déduire de la formule que nous avons donnée dans l'art. 1. pour la comparaison des forces centrales entre elles. Or pour comparer les forces centrales sur des courbes autres que des cercles, il faut prendre au lieu des rayons des cercles, les rayons de la développée de ces courbes qui changent à chaque point, & qu'on trouve par des méthodes géométriques : d'où l'on voit que quand un corps décrit une courbe autre qu'un cercle, la valeur de la force centrale change à chaque instant ; au lieu qu'elle est toûjours la même, quand le corps décrit un cercle. Il faudra de plus diviser la quantité trouvée par le rapport du sinus total au cosinus de l'angle que la direction de la force centrale fait avec la tangente.
14°. Si un corps tend à se mouvoir suivant AD (Fig. 25.), & qu'il soit en même tems sollicité par une force centripete vers un point fixe C, placé dans le même plan, il décrira alors une courbe dont la concavité sera tournée vers 6, & dont les différentes aires comprises entre deux rayons quelconques AC & CB, seront proportionnels aux tems employés à parcourir ces aires, c'est-à-dire à parvenir de l'extrémité d'un de ces rayons à l'extrémité de l'autre. Car sans la force centrale qui pousse suivant BF, le corps parcourroit dans des tems égaux BD=AB : mais à cause de la force centrale, il décrira la diagonale BE du parallelogramme FBDE dans le même tems qu'il a décrit AB. Or le triangle CBA=CBD, à cause de BD=AB ; & à cause des paralleles DE, FB, on a CBE=CBD. Donc CBE=CAB. Donc, &c.
15°. Quelque différentes que soient des forces centrales dans des cercles, on pourra toûjours les comparer ensemble : car elles seront toûjours en raison composée de celle des quantités de matiere que contiennent les mobiles, de celles de leur distance au centre, & enfin de l'inverse de la doublée des tems périodiques. Si l'on multiplie donc la quantité de matiere de chaque mobile par sa distance du centre, & qu'on divise le produit par le quarré du tems périodique, les quotiens qui résulteront de ces opérations seront entre eux dans la raison des forces centrales : c'est une suite de l'article 1.
16°. Si les quantités de matieres sont égales, il faudra diviser les distances par les quarrés des tems périodiques, pour déterminer le rapport des forces centrales.
17°. Lorsque la force par laquelle un corps est sollicité vers un point, n'est pas par-tout la même, mais qu'elle augmente ou diminue à proportion de la distance du centre ; cette nouvelle condition fait décrire alors au mobile différentes courbes plus ou moins composées. Si la force décroît en raison inverse des quarrés des distances à ce point, le mobile décrira alors une ellipse, qui est une courbe ovale, dans laquelle se trouvent deux points qu'on nomme foyers, dont l'un est alors occupé par le point T, vers lequel se dirige la force dont nous parlons ; de façon qu'à chaque révolution le corps s'approche une fois de ce point, & s'en éloigne une fois. Le cercle appartient aussi à cette espece de courbe ; de sorte que dans ce cas le mobile peut aussi décrire un cercle. Le mobile peut aussi, en lui supposant une plus grande vîtesse, décrire les deux autres sections coniques, la parabole, & l'hyperbole ; lesquelles ne retournent point sur elles-mêmes. Si la force croît en même tems que la distance, & en raison de la distance même, le corps décrira encore une ellipse : mais le point vers lequel se dirigera la force, sera alors le centre de l'ellipse, & le mobile à chaque révolution s'approchera deux fois & s'éloignera deux fois de ce point. Il peut arriver encore en ce cas, que le corps se meuve dans un cercle. Voyez Orbite, Planete, Trajectoire & Projectile. Voyez aussi les Principes mathém. de M. Newton, liv. I. & les Elémens de Méchan. de Wolf.
Les courbes peuvent être considérées, ou comme courbes rigoureuses, ou comme polygones infinis ; or l'expression de la force centrale est différente dans les deux cas : ce paradoxe singulier sera expliqué à l'article Courbe.
Regle centrale, c'est une regle ou une méthode qui a été découverte par Thomas Baker, géometre Anglois ; au moyen de laquelle on trouve le centre & le rayon du cercle qui peut couper une parabole donnée dans des points, dont les abscisses représentent les racines réelles d'une équation du troisieme ou du quatrieme degré qu'on se propose de construire. Voyez Construction.
La regle centrale est sur-tout fondée sur cette propriété de la parabole ; que si on tire dans cette courbe une perpendiculaire à un diametre quelconque, le rectangle formé des segmens de cette ligne, est égal au rectangle fait de la portion correspondante du diametre, & du parametre de l'axe.
La regle centrale est préférable, selon Baker, aux méthodes de Descartes pour construire les équations, en ce que dans cette derniere on a besoin de préparer l'équation, en lui ôtant le second terme ; au lieu que dans celle de Baker on n'a point cet embarras, puisqu'elle donne le moyen de construire, par l'intersection d'un cercle & d'une parabole, toute équation qui ne passe pas le quatrieme degré, sans en faire évanoüir ni changer aucun terme. Voy. Transactions Philosophiq. n°. 157. Mais il est très-facile, en suivant l'esprit de la méthode de Descartes, de construire par le moyen du cercle & de la parabole, toutes les équations du troisieme & du quatrieme degré, sans en faire évanoüir le second terme. Voyez la solution de ce problème dans l'article 386. des Sections coniques de M. de l'Hôpital. (O)
Étymologie de « central »
Centralis, de centrum, centre?; provenc. et espagn. central?; ital. centrale.
- Du latin centralis.
central au Scrabble
Le mot central vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot central - 7 lettres, 2 voyelles, 5 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot central au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
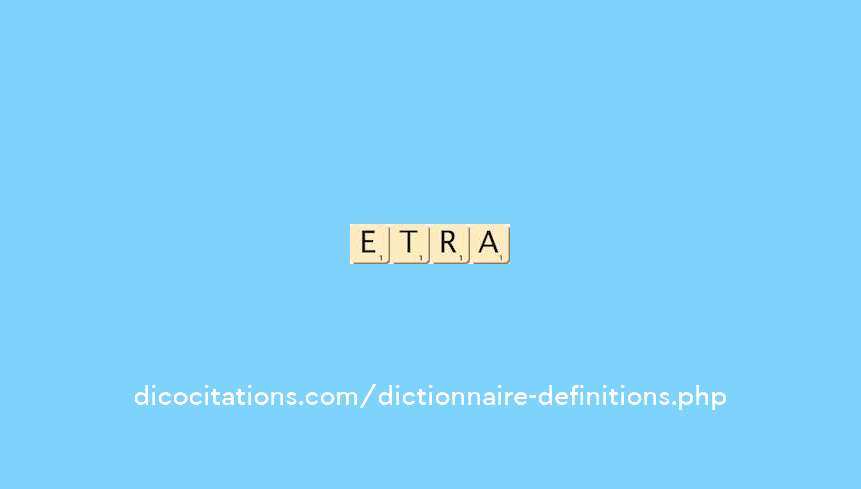
Les rimes de « central »
On recherche une rime en AL .
Les rimes de central peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en al
Rimes de épidural Rimes de totale Rimes de procédural Rimes de magistrale Rimes de fécal Rimes de scrotal Rimes de Ezemaal Rimes de artisanales Rimes de canal Rimes de gavial Rimes de carcérales Rimes de lustrales Rimes de installes Rimes de temporal Rimes de octogonale Rimes de official Rimes de viscéral Rimes de Sénégal Rimes de sororale Rimes de avales Rimes de centrales Rimes de moelles Rimes de vice-amiral Rimes de fanal Rimes de rivales Rimes de pleural Rimes de normal Rimes de structurales Rimes de sépale Rimes de cabales Rimes de patriarcales Rimes de centrales Rimes de thermale Rimes de Loverval Rimes de paranormales Rimes de latéral Rimes de fantomales Rimes de capital Rimes de neuronal Rimes de dialectal Rimes de cérébrale Rimes de diagonal Rimes de successoral Rimes de septentrional Rimes de rhomboïdal Rimes de dentale Rimes de successorale Rimes de primordiales Rimes de pâle Rimes de chialentMots du jour
épidural totale procédural magistrale fécal scrotal Ezemaal artisanales canal gavial carcérales lustrales installes temporal octogonale official viscéral Sénégal sororale avales centrales moelles vice-amiral fanal rivales pleural normal structurales sépale cabales patriarcales centrales thermale Loverval paranormales latéral fantomales capital neuronal dialectal cérébrale diagonal successoral septentrional rhomboïdal dentale successorale primordiales pâle chialent
Les citations sur « central »
- La première réforme devra être une intelligente décentralisation.Auteur : Jules Payot - Source : La Faillite de l'enseignement (1937)
- Par bonheur, il se révéla que la guerre civile n'avait guère occasionné de dégâts aux centrales pénitentiaires ni aux prisons. Il fallait seulement, c'était indispensable, abandonner ces vieux mots souillés. On les appela isolateurs politiques : cette locution reconnaissait que les membres des anciens partis révolutionnaires étaient des ennemis politiques; elle signalait non le caractère punitif des barreaux, mais la nécessité (sans doute provisoire) de tenir ces révolutionnaires vieux jeu à l'écart de la marche conquérante de la nouvelle société.
Auteur : Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne - Source : L'archipel du Goulag (1973)
- La division des hommes en acteurs et spectateurs est le fait central de notre temps.Auteur : Jim Morrison - Source : Seigneurs et Nouvelles Créatures (1976)
- La majeure partie du genre humain, surtout en Europe centrale, feint de travailler, joue continuellement la comédie du travail qui a aussi peu à voir avec le travail véritable que la véritable et réelle comédie avec la vraie vie réelle. Auteur : Thomas Bernhard - Source : Extinction (1986)
- Quand vous faites du présent, et non pas du passé ou du futur, le point central de votre vie, votre capacité à prendre plaisir à ce que vous faites augmente de façon spectaculaire, tout comme la qualité de votre vie. Auteur : Eckhart Tolle - Source : Le Pouvoir du moment présent (1997)
- Le motif végétal est un motif qui est central chez moi, l'arbre est là. Il est partout, il m'inquiète, il m'intrigue, il me nourrit.Auteur : Aimé Césaire - Source : Sans référence
- À cette époque, on faisait une distinction très nette entre administrer les choses et gouverner les gens. Et ils l'ont si bien faite que nous avons oublié que l'envie de dominer est aussi centrale dans les êtres humains que le désir de l'aide mutuelle, qu'il faut l'entretenir dans chaque individu, dans chaque nouvelle génération
.Auteur : Ursula Le Guin - Source : Les Dépossédés
- L'Occident proprement dit, c'est l'Europe occidentale et centrale, après quoi, vers l'Est, il y a dégradation par paliers: les fuseaux horaires divisent assez exactement le continent en bandes de civilisation.Auteur : André Siegfried - Source : L'Ame des peuples (1950)
- A l'ombre de vos centrales je crache mon cancer, je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose.Auteur : Hubert-Félix Thiéfaine - Source : Autorisation de délirer (1979), Alligators 427
- L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés.Auteur : Joseph Ki-Zerbo - Source : L'Education en Afrique
- La science-fiction est centrale dans tout ce que nous avons fait, et les gens qui se moquent des écrivains de science-fiction ne savent pas de quoi ils parlent.Auteur : Ray Bradbury - Source : Interview, Brown Daily Herald, mars 1995.
- Lucette était laide, timide, coiffée par une raie centrale et deux barrettes de pauvre, sa voix était rêche. (…)
Qui l'eût dit ? Qui eût dit au temps des boulettes de papier, des mains rougeaudes, qu'une femme allait surgir de cette désespérance ?Auteur : Yasmina Reza - Source : Hammerklavier (1997)
- Les centrales bandent plus roide, plus noir et sévère, la grave et lente agonie du bagne était, de l'abjection, un épanouissement plus parfait.Auteur : Jean Genet - Source : Journal du Voleur (1949)
- Même quand les phrases ont l'apparence d'une citation, elles ne doivent à aucun moment faire oublier qu'elles s'appliquent, pour moi du moins, à quelqu'un de particulier - et pour qu'elles me paraissent utilisables, il faut que l'idée centrale, forte et bien pesée, soit ce prétexte personnel, privé si l'on veut.Auteur : Peter Handke - Source : Le malheur indifférent (1972)
- Le point central de ma personnalité, en tant qu'artiste, c'est que je suis un poète dramatique.Auteur : Fernando Pessoa - Source : Lettre à Gaspar Simoens, 11 décembre 1931.
- Le poème nous ramène à notre centre, à notre souci central, à une question métaphysique.Auteur : Philippe Jaccottet - Source : La Semaison (1963)
- Un mort peut avoir été adoré ou haï ; il peut laisser un vide affreux derrière lui. Mais, dès qu'il est mort, il devient l'ornement central d'une des manifestations les plus complexes de la vie de société.Auteur : John Steinbeck - Source : Tortilla Flat (1935)
- Une autre salle, avec une auge centrale où les prisonniers peuvent nettoyer eux-mêmes leur linge, c'est le lavoir.Auteur : Gaston Leroux - Source : Rouletabille chez Krupp (1917)
- La décentralisation sera au coeur de l'expérience du gouvernement de la gauche... La République se sera enfin libérée de la monarchie.Auteur : Pierre Mauroy - Source : Héritiers de l'avenir (1977)
- Une autoroute centrale se ramifiant tout au long en échangeurs superposés, boucles et trèfles au dessin compliqué.Auteur : Régis Debray - Source : L'Indésirable (1975)
- Si un jour la délocalisation et la décentralisation réussissent à s'imposer, Rastignac devra s'en aller tenter sa chance en province.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Ah, vous pouvez le dire, les poêles Godin, il n'y a rien de tel, ça vaut le chauffage central. Ca ne s'éteint jamais. On les bourre le soir, le matin il n'y a qu'à vider les cendres.Auteur : Nathalie Sarraute - Source : Le Planétarium (1959)
- Le problème central pour l'Occident n'est pas le fondamentalisme islamique. C'est l'islam, civilisation différente dont les représentants sont convaincus de la supériorité de leur culture et obsédés par l'infériorité de leur puissance.Auteur : Samuel Phillips Huntington - Source : Le Choc des civilisations (1997)
- « On ne naît pas femme : on le devient. » C'était l'une des idées centrales du « Deuxième Sexe ». Trente ans après, maintenez-vous cette formule ?
_ Je la maintiens tout à fait. Tout ce que j'ai lu, vu, appris pendant ces trente années m'a complètement confirmé dans cette idéeAuteur : Simone de Beauvoir - Source : Entretien donné en janvier 1978 par la féministe, auteure du « Deuxième Sexe », à Pierre Viansson-Ponté, pour Le Monde - Le trottoir central, grande étendue où le repos des solitaires, sous les arbres que l'on sait chargés d'oiseaux qui dorment, met une apparence d'asile.Auteur : André Pieyre de Mandiargues - Source : La Marge (1967)
Les mots proches de « central »
Cénacle Cendal Cendraille Cendre Cendré, ée Cendrée Cendreuse Cendreux, euse Cendrier Cendrure Cène Cenelle Cénobite Cénobitique Cénobitisme Cens Censal Cense Censé, ée Censeur Censier Censive Censorial, ale Censuel, elle Censurable Censure Censurer Cent Centaine Centaure Centaurée Centenaire Centenier Centennal, ale Centième Centinode Centon Centration Centre Centrifuge Centripète Centuple Centuriateur Centurie Centuriés CenturionLes mots débutant par cen Les mots débutant par ce
Cénac Cénac-et-Saint-Julien cénacle cénacles Cenans cendraient cendrait Cendras cendre cendré cendré Cendre Cendrecourt cendrée cendrée cendrée cendrées cendrées cendrées cendres cendrés cendrés cendreuse cendreuses cendreux Cendrey cendrier cendriers Cendrieux cendrillon cendrillons cène Cénevières Cenne-Monestiés cénobite cénobites Cenon Cenon-sur-Vienne cénotaphe cens censé Censeau censée censées censément Censerey censés censeur censeurs censier
Les synonymes de « central»
Les synonymes de central :- 1. axial
2. orthogonal
synonymes de central
Fréquence et usage du mot central dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « central » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot central dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Central ?
Citations central Citation sur central Poèmes central Proverbes central Rime avec central Définition de central
Définition de central présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot central sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot central notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 7 lettres.










