Définition de « g »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot g de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur g pour aider à enrichir la compréhension du mot G et répondre à la question quelle est la définition de g ?
Une définition simple : (lettre|g|G|?e) g (m) (inv)
Définitions de « g »
Trésor de la Langue Française informatisé
G, g, subst. masc.
La septième lettre de l'alphabet. Un exemplaire de cette lettre. Le g ne se rencontre devant le g, le d et l'm que dans les mots de la langue savante; il se rencontre devant l'n, soit dans la langue vulgaire, soit dans la langue savante (ThurotPrononc. t. 2 1883, p. 344).G, g, subst. masc.
La septième lettre de l'alphabet. Un exemplaire de cette lettre. Le g ne se rencontre devant le g, le d et l'm que dans les mots de la langue savante; il se rencontre devant l'n, soit dans la langue vulgaire, soit dans la langue savante (ThurotPrononc. t. 2 1883, p. 344).Wiktionnaire
Nom commun - français
g \?e\ masculin invariable
- (Physique) (Métrologie) Unité de mesure de la gravité ou l'accélération, correspondant approximativement à la gravité terrestre moyenne, valant 9,80665 m/s².
- (Par extension) Accélération mesurée en cette unité.
-
(Métrologie, Sylviculture) Surface terrière d'un arbre.
- La surface terrière (notée g) d'un arbre correspond à la surface de la section transversale de cet arbre à hauteur d'homme. En clair, c'est la surface du tronc coupé à 1,30 m. ? (CRPF Lorraine-Alsace, La surface terrière : une mesure très terre à terre, in Floréal, n°100, mars 2015 ? lire en ligne)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
La septième lettre de l'alphabet. Elle représente une des consonnes. Un grand G. Un petit g. Il se prononce gue devant une consonne : Gros, Engloutir; devant a, o, u : Galant, Gosier, Auguste, et à la finale de quelques mots, tels que : Grog, zig-zag. Il se prononce j devant e, i, y : Geler, Agiter, Gymnastique. Il ne se prononce pas dans l'intérieur des mots : Doigt, Vingt; non plus qu'à la finale ng : Sang, Seing, Étang. Gn, dans l'intérieur des mots, représente une consonne mouillée : Digne, Signal, Agneau, sauf dans les mots dérivés du latin ou du grec où g garde le son gue : Stagnant, Diagnostic.
Littré
- La septième lettre de l'alphabet et la cinquième consonne.
Le son propre de cette lettre est guttural devant les voyelles fortes, a, o, u?: galerie, gosier, guttural, et il se conserve à la fin des mots quand on le prononce?: Agag, whig, et devant une autre consonne?: Bagdad, règle, aigrir. Outre ce son propre, le g a un son dérivé, chuintant, tel que celui du j devant les voyelles faibles e, i, y?: gîte, gésier, gynécée.
Quand il faut, devant l'e, l'i, l'y, que g ait le son qui lui est propre, on le fait suivre d'un u?: guider, guenon. Au contraire, quand on veut, devant a, o, u, lui donner le son chuintant, on le fait suivre d'un e muet?: geai, geôle, gageure, prononcés jai, jôle, gajure.
Gn a un son particulier qui ne peut-être figuré et qui doit être perçu par l'oreille?: magnanime, ignorant, etc.?; ce son est le même que pour le gn italien et le ñ espagnol?; bien qu'il soit figuré par deux caractères, c'est pourtant une articulation simple et qui pourrait être représentée par un seul caractère.
Gn, dans quelques mots venus du grec ou du latin, garde la prononciation qui appartient à chacune des deux lettres?: gnostique, igné.
G final, précédé d'une nasale, est muet?: long, rang?; mais, suivi d'un mot commençant par une voyelle ou une h muette, il devient sonore, et se prononce d'ordinaire comme un k?: de rang en rang, un long hiver?; non sans exception pourtant?; car g final est muet, même devant une voyelle, dans certains mots?: seing, étang.
G, en chimie, signifie glycinium.
Terme de musique. G-ré-sol, pour sol-si-ré-sol, indique le ton de sol, dans l'ancienne solmisation française. Il indique le sol dans la solmisation allemande et anglaise.
G, sur les anciennes monnaies de France, est la marque de la monnaie frappée à Poitiers.
HISTORIQUE
XIIIe s. Plus que nule letre que j'oie, Signifie G la goie [joie] Qui par feme revient au monde
, Senefiance de l'ABC, dans JUBINAL, t. II, p. 278.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
G. Ajoutez?:G est la marque des monnaies françaises frappées à Genève, de l'an VI à l'an XIII.
Encyclopédie, 1re édition
, s. m. (Gramm.) c'est la troisieme lettre de l'alphabet des Orientaux & des Grecs, & la septieme de l'alphabet latin que nous avons adopté.
Dans les langues orientales & dans la langue greque, elle représentoit uniquement l'articulation gue, telle que nous la faisons entendre à la fin de nos mots françois, digue, figue ; & c'est le nom qu'on auroit dû lui donner dans toutes ces langues : mais les anciens ont eu leurs irrégularités & leurs écarts comme les modernes. Cependant les divers noms que ce caractere a reçus dans les différentes langues anciennes, conservoient du-moins l'articulation dont il étoit le type : les Grecs l'appelloient gamma, les Hébreux & les Phéniciens gimel, prononcé comme guimauve ; les Syriens gomal, & les Arabes gum, prononcé de la même maniere.
On peut voir (article C & méth. de P. R.) l'origine du caractere g dans la langue latine ; & la preuve que les Latins ne lui donnoient que cette valeur, se tire du témoignage de Quintilien, qui dit que le g n'est qu'une diminution du c : or il est prouvé que le c se prononçoit en latin comme le kappa des Grecs, c'est-à-dire qu'il exprimoit l'articulation que, & conséquemment le g n'exprimoit que l'articulation gue. Ainsi les Latins prononçoient cette lettre dans la premiere syllabe de gygas comme dans la seconde ; & si nous prononçons autrement, c'est que nous avons transporté mal-à-propos aux mots latins les usages de la prononciation françoise.
Avant l'introduction de cette lettre dans l'alphabet romain, le c représentoit les deux articulations, la forte & la foible, que & gue ; & l'usage faisoit connoître à laquelle de ces deux valeurs il falloit s'en tenir : c'est à-peu-près ainsi que notre s exprime tantôt l'articulation forte, comme dans la premiere syllabe de Sion, & tantôt la foible, comme dans la seconde de vision. Sous ce point de vûe, la lettre qui désignoit l'articulation gue, étoit la troisieme de l'alphabet latin, comme de celui des Grecs & ces Orientaux. Mais les doutes que cette équivoque pouvoit jetter sur l'exacte prononciation, fit donner à chaque articulation un caractere particulier ; & comme ces deux articulations ont beaucoup d'affinité, on prit pour exprimer la foible le signe même de la forte C, en ajoûtant seulement sur sa pointe inférieure une petite ligne verticale G, pour avertir le lecteur d'en affoiblir l'expression.
Le rapport d'affinité qui est entre les deux articulations que & gue, est le principe de leur commutabilité, & de celle des deux lettres qui les représentent, du c & du g ; observation importante dans l'art étymologique, pour reconnoître les racines génératrices naturelles ou étrangeres de quantité de mots dérivés : ainsi notre mot françois Cadix vient du latin Gades, par le changement de l'articulation foible en forte ; & par le changement contraire de l'articulation forte en foible, nous avons tiré gras du latin crassus ; les Romains écrivoient & prononçoient indistinctement l'une ou l'autre articulation dans certains mots, vicesimus ou vigesimus, Cneius ou Gneius. Dans quelques mots de notre langue, nous retenons le caractere de l'articulation forte, pour conserver la trace de leur étymologie ; & nous prononçons la foible, pour obéir à notre usage, qui peut être a quelque conformité avec celui de la latine : ainsi nous écrivons Claude, cicogne, second, & nous prononçons Glaude, cigogne, segond. Quelquefois au contraire nous employons le caractere de l'articulation foible, & nous prononçons la forte ; ce qui arrive sur tout quand un mot finit par le caractere g, & qu'il est suivi d'un autre mot qui commence par une voyelle ou par un h non aspiré : nous écrivons sang épais, long hyver, & nous prononçons san-k-épais, lon-k-hyver.
Assez communément, la raison de ces irrégularités apparentes, de ces permutations, se tire de la conformation de l'organe ; on l'a vû au mot Fréquentatif, où nous avons montré comment ago & lego ont produit d'abord les supins agitum, legitum, & ensuite, à l'occasion de la syncope, actum, lectum.
L'euphonie, qui ne s'occupe que de la satisfaction de l'oreille, en combinant avec facilité les sons & les articulations, décide souverainement de la prononciation, & souvent de l'ortographe, qui en est ou doit en être l'image ; elle change non-seulement g en c, ou c en g ; elle va jusqu'à mettre g à la place de toute autre consonne dans la composition des mots ; c'est ainsi que l'on dit en latin aggredi pour adgredi, suggerere pour sub gerere, ignoscere pour in-noscere ; & les Grecs écrivoient ???????; ??????, ???????, quoiqu'ils prononçassent comme les Latins ont prononcé les mots angelus, ancora, Anchises, qu'ils en avoient tirés, & dans lesquels ils avoient d'abord conservé l'ortographe greque, aggelus, agcora, Agchises : ils avoient même porté cette pratique, au rapport de Varron, jusque dans des mots purement latins, & ils écrivoient aggulus, agceps, iggero, avant que décrire angulus, anceps, ingero : ceci donne lieu de soupçonner que le g chez les Grecs & chez les Latins dans le commencement, étoit le signe de la nasalité, & que ceux-ci y substituerent la lettre n, ou pour faciliter les liaisons de l'écriture, ou parce qu'ils jugerent que l'articulation qu'elle exprime étoit effectivement plus nasale. Il semble qu'ils ayent aussi fait quelque attention à cette nasalité dans la composition des mots quadringenti, quingenti, où ils ont employé le signe g de l'articulation foible gue, tandis qu'ils ont conservé la lettre c, signe de l'articulation forte que, dans les mots ducenti, sexcenti, ou la syllabe précédente n'est point nasale.
Il ne paroît pas que dans la langue italienne, dans l'espagnole, & dans la françoise, on ait beaucoup raisonné pour nommer ni pour employer la lettre G & sa correspondante C ; & ce défaut pourroit bien, malgré toutes les conjectures contraires, leur venir de la langue latine, qui est leur source commune. Dans les trois langues modernes, on employe ces lettres pour représenter différentes articulations ; & cela à-peu-près dans les mêmes circonstances : c'est un premier vice. Par un autre écart aussi peu raisonnable, on a donné à l'une & à l'autre une dénomination prise d'ailleurs, que de leur destination naturelle & primitive. On peut consulter les Grammaires italienne & espagnole : nous ne sortirons point ici des usages de notre langue.
Les deux lettres C & G y suivent jusqu'à certain point le même système, malgré les irrégularités de l'usage.
1°. Elles y conservent leur valeur naturelle devant les voyelles a, o, u, & devant les consonnes l, r : on dit, galon, gosier, Gustave, gloire, grace, comme on dit, cabanne, colombe, cuvette, clameur, crédit,
2°. Elles perdent l'une & l'autre leur valeur originelle devant les voyelles e, i ; celle qu'elles y prennent leur est étrangere, & a d'ailleurs son caractere propre : C représente alors l'articulation se, dont le caractere propre est s ; & l'on prononce cité, céleste, comme si l'on écrivoit sité, séleste : de même G représente dans ce cas l'articulation je, dont le caractere propre est j ; & l'on prononce génie, gibier, comme s'il y avoit jénie, jibier.
3°. On a inséré un e absolument muet & oiseux après les consonnes C & G, quand on a voulu les dépouiller de leur valeur naturelle devant a, o, u, & leur donner celle qu'elles ont devant e, i. Ainsi on a écrit commencea, perceons, conceu, pour faire prononcer comme s'il y avoit commensa, persons, consu ; & de même on a écrit mangea, forgeons, & l'on prononce manja, forjons. Cette pratique cependant n'est plus d'usage aujourd'hui pour la lettre c ; on a substitué la cédille à l'e muet, & l'on écrit commença, perçons, conçu.
4°. Pour donner au contraire leur valeur naturelle aux deux lettres C & G devant e, i, & leur ôter celle que l'usage y a attachée dans ces circonstances, on met après ces consonnes un u muet : comme dans cueuillir, guérir, guider, où l'on n'entend aucunement la voyelle u.
5°. La lettre double x, si elle se prononce fortement, réunit la valeur naturelle de c & l'articulation forte s, comme dans axiome, Alexandre, que l'on prononce acsiome, Alecsandre ; si la lettre x se prononce foiblement, elle réunit la valeur naturelle de G & l'articulation de ze, foible de se, comme dans exil, exemple, que l'on prononce egzil, egzemple.
6°. Les deux lettres C & G deviennent auxiliaires pour exprimer des articulations auxquelles l'usage à refusé des caracteres propres. C suivi de la lettre h est le type de l'articulation forte, dont la foible est exprimée naturellement par j : ainsi les deux mots Japon, chapon, ne different que parce que l'articulation initiale est plus forte dans le second que dans le premier. G suivi de la lettre n est le symbole de l'articulation que l'on appelle communément n mouillé, & que l'on entend à la fin des mots cocagne, regne, signe.
Pour finir ce qui concerne la lette G, nous ajoûterons une observation. On l'appelle aujourd'hui gé, parce qu'en effet elle exprime souvent l'articulation jé : celle-ci aura été substituée dans la prononciation à l'articulation gue sans aucun changement dans l'ortographe ; on peut le conjecturer par les mots jambe, jardin, &c. que l'on ne prononce encore gambe, gardin dans quelques provinces septentrionales de la France, que parce que c'étoit la maniere universelle de prononcer ; gambade même & gambader n'ont point de racine plus raisonnable que gambe ; de-là l'abus de l'épellation & de l'emploi de cette consonne.
G dans les inscriptions romaines avoit diverses significations. Seule, cette lettre signifioit ou gratis, ou gens, ou gaudium, ou tel autre mot que le sens du reste de l'inscription pouvoit indiquer : accompagnée, elle étoit sujette aux mêmes variations.
G. V. genio urbis, G. P. R. gloria populi romani ; Voyez les antiquaires, & particulierement le traité d'Aldus Manucius de veter. not. explanatione.
G chez les anciens a signifié quatre cents suivant ce vers.
& même quarante mille, mais alors elle étoit chargée
d'un tiret G.
G dans le comput ecclésiastique, est la septieme & la derniere lettre dominicale.
Dans les poids elle signifie un gros ; dans la Musique elle marque une des clés G-ré-sol ; & sur nos monnoies elle indique la ville de Poitiers. (E. R. M.)
* G, (Ecriture.) Le g dans l'écriture que nous
nommons italienne, est un c ferme par un j consonne.
Dans la coulée, c'est un composé de l'o & de l'j
consonne. Le grand a la même formation que le
petit ; il se fait par le mouvement mixte des doigts
& du poignet.
Étymologie de « g »
G latin, ?, gamma grec, qui vient du g phénicien, nommé gimel, proprement le cou du chameau?; ainsi dit de sa forme.
g au Scrabble
Le mot g vaut 2 points au Scrabble.
Informations sur le mot g - 1 lettres, 0 voyelles, 1 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot g au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
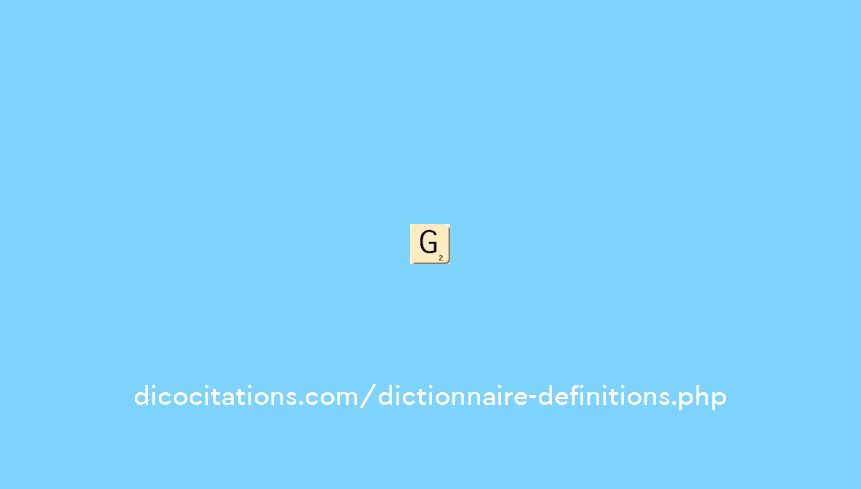
Les rimes de « g »
On recherche une rime en ZE .
Les rimes de g peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en Ze
Rimes de immortalisait Rimes de faisait Rimes de hypnotisé Rimes de factoriser Rimes de encagés Rimes de jais Rimes de submergée Rimes de terrorisées Rimes de transposer Rimes de juxtaposaient Rimes de décroisait Rimes de improvisé Rimes de changeaient Rimes de bergers Rimes de désavantager Rimes de construisaient Rimes de croiser Rimes de ravisais Rimes de familiarisait Rimes de défrisé Rimes de dégager Rimes de impatronisait Rimes de losangé Rimes de échanger Rimes de féminisé Rimes de pesai Rimes de affligé Rimes de usé Rimes de frangée Rimes de fertilisée Rimes de culpabiliser Rimes de coalisée Rimes de gagée Rimes de bronzées Rimes de adjugés Rimes de préconisez Rimes de engagée Rimes de rétrofusée Rimes de mitigé Rimes de familiarisée Rimes de franchiser Rimes de exciser Rimes de climatisée Rimes de égorgez Rimes de magnétisé Rimes de accusé Rimes de actualisée Rimes de préposées Rimes de usagers Rimes de étrangerMots du jour
immortalisait faisait hypnotisé factoriser encagés jais submergée terrorisées transposer juxtaposaient décroisait improvisé changeaient bergers désavantager construisaient croiser ravisais familiarisait défrisé dégager impatronisait losangé échanger féminisé pesai affligé usé frangée fertilisée culpabiliser coalisée gagée bronzées adjugés préconisez engagée rétrofusée mitigé familiarisée franchiser exciser climatisée égorgez magnétisé accusé actualisée préposées usagers étranger
Les citations sur « g »
- Mépriser son adversaire même petit et frêle est toujours une faute stratégique dans un combat.Auteur : Ahmadou Kourouma - Source : En attendant le vote des bêtes sauvages
- En deux temps, les laissés-pour-compte s'équipent, ferment le compteur à gaz, empochent la clef de l'appartement et hop!Auteur : Sidonie Gabrielle Colette - Source : Belles Saisons
- Dans le métavers d’Adrien Sterner, toutes les interactions financières entre les avatars étaient opérées en cleargold, la cryptomonnaie conçue par Heaven. Jusque-là, rien de bien compliqué. Mais la nuance survenait dans la phrase suivante. Pour s’en procurer, expliquait Wikipédia, les utilisateurs avaient le choix entre deux options : travailler ou investir.Auteur : Nathan Devers - Source : Les liens artificiels (2022)
- La pluie montre ses dents, exige la lumière
Mon envie de crier, comme un doigt qu'on déplie,
Tire, tire les fils du nez de la mercière
Qui maigrit mais qui tourne, embobinant la pluie.Auteur : Olivier Larronde - Source : Les Barricades mystérieuses (1990) - Un empoisonnement peut rester caché. Même à la rigueur un meutre commis à l'intérieur d'une famille ...Auteur : Louis Farigoule, dit Jules Romains - Source : Les Hommes de bonne volonté (1932-1946)
- Ce sont les mets les plus savoureux qui excitent le dégoût des mauvais estomacs.Auteur : Edmond Jaloux - Source : Le dernier jour de la Création (1935)
- Voter à droite, voter à gauche, cela revient exactement à choisir la 1re ou la 2e chaîne un soir où le programme est identique sur les deux.Auteur : Jean Gouyé, dit Jean Yanne - Source : J'me marre (2003)
- Les vagabonds qui, il y a une dizaine d'années, étaient presque tous illettrés, savent maintenant pour la plupart lire, écrire et compter. Quelques-uns semblent même avoir reçu une instruction supérieure. C'est un grand progrès.Auteur : Alfred Capus - Source : Sans référence
- A chaque époque, (la science) voudrait dévorer une vérité qui la gêne.Auteur : Joseph Arthur, comte de Gobineau - Source : Essai sur l'inégalité des races humaines
- Garde l'amour qui m'enivre,
L'amour qui nous fait rêver ;
Garde l'espoir qui fait vivre ;
Garde la foi qui délivre,
La foi qui nous doit sauver.Auteur : Charles-Nérée Beauchemin - Source : Les floraisons matutinales (1897), A celle que j'aime - Je ne sais pas moi-même comment un beau poème peut agir sur moi aussi profondément, Goethe surtout, à chaque fois que je suis émue ou ébranlée. C'est une réaction presque physiologique, comme si, les lèvres assoiffées, je buvais un liquide délicieux qui me rafraîchissait tout entière, guérissant et mon corps et mon âme.Auteur : Rosa Luxemburg - Source : Rosa, la vie : lettres de Rosa Luxemburg
- La méthode du carnet de notes est hautement recommandable. On y inscrit toute phrase, toute expression. On s'enrichit à l'épargne des vérités de quatre sous.Auteur : Georg Christoph Lichtenberg - Source : Le Miroir de l'âme (1773-1796)
- Tous les gens sont pareils: crevant de peur à la pensée de la mort et obsédés par le sexe.Auteur : Claude Mauriac - Source : Les Nouvelles Littéraires
- La flatterie n'émane pas des grandes âmes, elle est l'apanage des petits esprits qui réussissent à se rapetisser encore pour mieux entrer dans la sphère vitale de la personne autour de laquelle ils gravitent.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Eugénie Grandet (1833)
- Elle venait de comprendre, avec un mélange de tristesse et de mélancolie, qu’il valait mieux pleurer toutes les personnes merveilleuses qu’on perdait plutôt que de ne jamais les avoir connues. Auteur : Mélissa Da Costa - Source : Je revenais des autres (2021)
- Je pensais que déguster ta victime faisait aussi partie du plaisir.Auteur : Jérôme Touzalin - Source : Mentir y'a qu'ça d'vrai
- Les petites femmes qui se sentent jolies et qui ont de la naissance sont volontiers guindées sur des échasses et pas toujours faciles à vivre...Auteur : Vauban - Source : A son neveu Dupuy-Vauban, 2 Octobre 1704
- L'argent est la lampe d'Aladin.Auteur : George Gordon, lord Byron - Source : Don Juan (1819), XII, 12
- Il arrive aussitôt devant l'escalier, en face du soldat, qui, pour éviter la rencontre des deux corps dans le noir, tend les mains à l'aveuglette autour de lui.Auteur : Alain Robbe-Grillet - Source : Dans le labyrinthe (1959)
- La vie retrouve des contours et des contrastes. Elle n'est plus une masse informe de jours amalgamés, mais une succession de moments tissés ensemble dans l'étoffe du temps qui passe. Alors, vivre et vite!Auteur : Marianne Rubinstein - Source : Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel (2012)
- Le gamin, je le vois nettement. Il accuse, au minimum, cinq ans, puisque ce qui précède est frappé d'amnésie et, au maximum, sept, parce que c'est cette année-là que grand-père nous a quittés. Or, sa longue silhouette maigre se dresse dans mon souvenir.Auteur : Pierre Bergounioux - Source : Le Grand Sylvain (1993)
- Orgueilleux et insensé qu'il est, l'homme se croit quelque chose!Auteur : Alexandre Dumas - Source : Le Capitaine Paul (1838)
- Tu ignores qui est ton ami et qui est ton ennemi jusqu'à ce que la glace sous tes pieds se briseAuteur : Proverbes inuits - Source : Proverbe
- Et puis ce que l'on appelle un viol ne cible pas uniquement le corps. Les violences ne prennent pas toujours une forme visible. Les plaies ne font pas toujours couler du sang.Auteur : Haruki Murakami - Source : 1Q84 (2011), avril - juin
- Voir le piège n'empêche pas d'y tomber.Auteur : Anne Barratin - Source : De Vous à Moi (1892)
Les mots proches de « g »
G Gabaï Gabare Gabarier Gabarieur Gabarit Gabatine Gabattage Gabbro Gabegie Gabelant Gabelé, ée Gabeler Gabeleur Gabelle Gabelou Gaber Gabeur Gabion Gabionnade ou gabionnage Gabionner Gable Gabord Gâche Gâche Gachenet Gâcher Gachette Gâchette Gadille Gaffe Gage Gagé, ée Gager Gagerie Gageur, euse Gageure Gagiste Gagnable Gagnage Gagné, ée Gagne-denier Gagne-pain Gagne-petit Gagner Gagneur Gai, gaie Gaïac Gaiement ou gaîment Gaieté ou gaîtéLes mots débutant par g Les mots débutant par g
g G?rlingen G?rsdorf G?ulzin Gaas Gaasbeek gaba gabardine gabardines gabare gabariers gabarit gabarits Gabarnac gabarres Gabarret Gabaston Gabat gabbro gabe gabegie gabelle gabelou Gabian gabier gabiers Gabillou gabion gabions gable gables Gabon gabonais gabonais gabonaise Gabre Gabriac Gabriac Gabrias gabriel gabrielle Gacé gâcha gâchage gâchaient gâchais gâchait gâchant gâchât gâche
Les synonymes de « g»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot g dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « g » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot g dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de G ?
Citations g Citation sur g Poèmes g Proverbes g Rime avec g Définition de g
Définition de g présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot g sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot g notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 1 lettres.
