La définition de G du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
G
Nature : s. m.
Prononciation : jé
Etymologie : G latin, gamma grec, qui vient du g phénicien, nommé gimel, proprement le cou du chameau ; ainsi dit de sa forme.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de g de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec g pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de G ?
La définition de G
La septième lettre de l'alphabet et la cinquième consonne.
Toutes les définitions de « g »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
La septième lettre de l'alphabet. Elle représente une des consonnes. Un grand G. Un petit g. Il se prononce gue devant une consonne : Gros, Engloutir; devant a, o, u : Galant, Gosier, Auguste, et à la finale de quelques mots, tels que : Grog, zig-zag. Il se prononce j devant e, i, y : Geler, Agiter, Gymnastique. Il ne se prononce pas dans l'intérieur des mots : Doigt, Vingt; non plus qu'à la finale ng : Sang, Seing, Étang. Gn, dans l'intérieur des mots, représente une consonne mouillée : Digne, Signal, Agneau, sauf dans les mots dérivés du latin ou du grec où g garde le son gue : Stagnant, Diagnostic.
Littré
- La septième lettre de l'alphabet et la cinquième consonne.
Le son propre de cette lettre est guttural devant les voyelles fortes, a, o, u?: galerie, gosier, guttural, et il se conserve à la fin des mots quand on le prononce?: Agag, whig, et devant une autre consonne?: Bagdad, règle, aigrir. Outre ce son propre, le g a un son dérivé, chuintant, tel que celui du j devant les voyelles faibles e, i, y?: gîte, gésier, gynécée.
Quand il faut, devant l'e, l'i, l'y, que g ait le son qui lui est propre, on le fait suivre d'un u?: guider, guenon. Au contraire, quand on veut, devant a, o, u, lui donner le son chuintant, on le fait suivre d'un e muet?: geai, geôle, gageure, prononcés jai, jôle, gajure.
Gn a un son particulier qui ne peut-être figuré et qui doit être perçu par l'oreille?: magnanime, ignorant, etc.?; ce son est le même que pour le gn italien et le ñ espagnol?; bien qu'il soit figuré par deux caractères, c'est pourtant une articulation simple et qui pourrait être représentée par un seul caractère.
Gn, dans quelques mots venus du grec ou du latin, garde la prononciation qui appartient à chacune des deux lettres?: gnostique, igné.
G final, précédé d'une nasale, est muet?: long, rang?; mais, suivi d'un mot commençant par une voyelle ou une h muette, il devient sonore, et se prononce d'ordinaire comme un k?: de rang en rang, un long hiver?; non sans exception pourtant?; car g final est muet, même devant une voyelle, dans certains mots?: seing, étang.
G, en chimie, signifie glycinium.
Terme de musique. G-ré-sol, pour sol-si-ré-sol, indique le ton de sol, dans l'ancienne solmisation française. Il indique le sol dans la solmisation allemande et anglaise.
G, sur les anciennes monnaies de France, est la marque de la monnaie frappée à Poitiers.
HISTORIQUE
XIIIe s. Plus que nule letre que j'oie, Signifie G la goie [joie] Qui par feme revient au monde
, Senefiance de l'ABC, dans JUBINAL, t. II, p. 278.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
G. Ajoutez?:G est la marque des monnaies françaises frappées à Genève, de l'an VI à l'an XIII.
Encyclopédie, 1re édition
, s. m. (Gramm.) c'est la troisieme lettre de l'alphabet des Orientaux & des Grecs, & la septieme de l'alphabet latin que nous avons adopté.
Dans les langues orientales & dans la langue greque, elle représentoit uniquement l'articulation gue, telle que nous la faisons entendre à la fin de nos mots françois, digue, figue ; & c'est le nom qu'on auroit dû lui donner dans toutes ces langues : mais les anciens ont eu leurs irrégularités & leurs écarts comme les modernes. Cependant les divers noms que ce caractere a reçus dans les différentes langues anciennes, conservoient du-moins l'articulation dont il étoit le type : les Grecs l'appelloient gamma, les Hébreux & les Phéniciens gimel, prononcé comme guimauve ; les Syriens gomal, & les Arabes gum, prononcé de la même maniere.
On peut voir (article C & méth. de P. R.) l'origine du caractere g dans la langue latine ; & la preuve que les Latins ne lui donnoient que cette valeur, se tire du témoignage de Quintilien, qui dit que le g n'est qu'une diminution du c : or il est prouvé que le c se prononçoit en latin comme le kappa des Grecs, c'est-à-dire qu'il exprimoit l'articulation que, & conséquemment le g n'exprimoit que l'articulation gue. Ainsi les Latins prononçoient cette lettre dans la premiere syllabe de gygas comme dans la seconde ; & si nous prononçons autrement, c'est que nous avons transporté mal-à-propos aux mots latins les usages de la prononciation françoise.
Avant l'introduction de cette lettre dans l'alphabet romain, le c représentoit les deux articulations, la forte & la foible, que & gue ; & l'usage faisoit connoître à laquelle de ces deux valeurs il falloit s'en tenir : c'est à-peu-près ainsi que notre s exprime tantôt l'articulation forte, comme dans la premiere syllabe de Sion, & tantôt la foible, comme dans la seconde de vision. Sous ce point de vûe, la lettre qui désignoit l'articulation gue, étoit la troisieme de l'alphabet latin, comme de celui des Grecs & ces Orientaux. Mais les doutes que cette équivoque pouvoit jetter sur l'exacte prononciation, fit donner à chaque articulation un caractere particulier ; & comme ces deux articulations ont beaucoup d'affinité, on prit pour exprimer la foible le signe même de la forte C, en ajoûtant seulement sur sa pointe inférieure une petite ligne verticale G, pour avertir le lecteur d'en affoiblir l'expression.
Le rapport d'affinité qui est entre les deux articulations que & gue, est le principe de leur commutabilité, & de celle des deux lettres qui les représentent, du c & du g ; observation importante dans l'art étymologique, pour reconnoître les racines génératrices naturelles ou étrangeres de quantité de mots dérivés : ainsi notre mot françois Cadix vient du latin Gades, par le changement de l'articulation foible en forte ; & par le changement contraire de l'articulation forte en foible, nous avons tiré gras du latin crassus ; les Romains écrivoient & prononçoient indistinctement l'une ou l'autre articulation dans certains mots, vicesimus ou vigesimus, Cneius ou Gneius. Dans quelques mots de notre langue, nous retenons le caractere de l'articulation forte, pour conserver la trace de leur étymologie ; & nous prononçons la foible, pour obéir à notre usage, qui peut être a quelque conformité avec celui de la latine : ainsi nous écrivons Claude, cicogne, second, & nous prononçons Glaude, cigogne, segond. Quelquefois au contraire nous employons le caractere de l'articulation foible, & nous prononçons la forte ; ce qui arrive sur tout quand un mot finit par le caractere g, & qu'il est suivi d'un autre mot qui commence par une voyelle ou par un h non aspiré : nous écrivons sang épais, long hyver, & nous prononçons san-k-épais, lon-k-hyver.
Assez communément, la raison de ces irrégularités apparentes, de ces permutations, se tire de la conformation de l'organe ; on l'a vû au mot Fréquentatif, où nous avons montré comment ago & lego ont produit d'abord les supins agitum, legitum, & ensuite, à l'occasion de la syncope, actum, lectum.
L'euphonie, qui ne s'occupe que de la satisfaction de l'oreille, en combinant avec facilité les sons & les articulations, décide souverainement de la prononciation, & souvent de l'ortographe, qui en est ou doit en être l'image ; elle change non-seulement g en c, ou c en g ; elle va jusqu'à mettre g à la place de toute autre consonne dans la composition des mots ; c'est ainsi que l'on dit en latin aggredi pour adgredi, suggerere pour sub gerere, ignoscere pour in-noscere ; & les Grecs écrivoient ???????; ??????, ???????, quoiqu'ils prononçassent comme les Latins ont prononcé les mots angelus, ancora, Anchises, qu'ils en avoient tirés, & dans lesquels ils avoient d'abord conservé l'ortographe greque, aggelus, agcora, Agchises : ils avoient même porté cette pratique, au rapport de Varron, jusque dans des mots purement latins, & ils écrivoient aggulus, agceps, iggero, avant que décrire angulus, anceps, ingero : ceci donne lieu de soupçonner que le g chez les Grecs & chez les Latins dans le commencement, étoit le signe de la nasalité, & que ceux-ci y substituerent la lettre n, ou pour faciliter les liaisons de l'écriture, ou parce qu'ils jugerent que l'articulation qu'elle exprime étoit effectivement plus nasale. Il semble qu'ils ayent aussi fait quelque attention à cette nasalité dans la composition des mots quadringenti, quingenti, où ils ont employé le signe g de l'articulation foible gue, tandis qu'ils ont conservé la lettre c, signe de l'articulation forte que, dans les mots ducenti, sexcenti, ou la syllabe précédente n'est point nasale.
Il ne paroît pas que dans la langue italienne, dans l'espagnole, & dans la françoise, on ait beaucoup raisonné pour nommer ni pour employer la lettre G & sa correspondante C ; & ce défaut pourroit bien, malgré toutes les conjectures contraires, leur venir de la langue latine, qui est leur source commune. Dans les trois langues modernes, on employe ces lettres pour représenter différentes articulations ; & cela à-peu-près dans les mêmes circonstances : c'est un premier vice. Par un autre écart aussi peu raisonnable, on a donné à l'une & à l'autre une dénomination prise d'ailleurs, que de leur destination naturelle & primitive. On peut consulter les Grammaires italienne & espagnole : nous ne sortirons point ici des usages de notre langue.
Les deux lettres C & G y suivent jusqu'à certain point le même système, malgré les irrégularités de l'usage.
1°. Elles y conservent leur valeur naturelle devant les voyelles a, o, u, & devant les consonnes l, r : on dit, galon, gosier, Gustave, gloire, grace, comme on dit, cabanne, colombe, cuvette, clameur, crédit,
2°. Elles perdent l'une & l'autre leur valeur originelle devant les voyelles e, i ; celle qu'elles y prennent leur est étrangere, & a d'ailleurs son caractere propre : C représente alors l'articulation se, dont le caractere propre est s ; & l'on prononce cité, céleste, comme si l'on écrivoit sité, séleste : de même G représente dans ce cas l'articulation je, dont le caractere propre est j ; & l'on prononce génie, gibier, comme s'il y avoit jénie, jibier.
3°. On a inséré un e absolument muet & oiseux après les consonnes C & G, quand on a voulu les dépouiller de leur valeur naturelle devant a, o, u, & leur donner celle qu'elles ont devant e, i. Ainsi on a écrit commencea, perceons, conceu, pour faire prononcer comme s'il y avoit commensa, persons, consu ; & de même on a écrit mangea, forgeons, & l'on prononce manja, forjons. Cette pratique cependant n'est plus d'usage aujourd'hui pour la lettre c ; on a substitué la cédille à l'e muet, & l'on écrit commença, perçons, conçu.
4°. Pour donner au contraire leur valeur naturelle aux deux lettres C & G devant e, i, & leur ôter celle que l'usage y a attachée dans ces circonstances, on met après ces consonnes un u muet : comme dans cueuillir, guérir, guider, où l'on n'entend aucunement la voyelle u.
5°. La lettre double x, si elle se prononce fortement, réunit la valeur naturelle de c & l'articulation forte s, comme dans axiome, Alexandre, que l'on prononce acsiome, Alecsandre ; si la lettre x se prononce foiblement, elle réunit la valeur naturelle de G & l'articulation de ze, foible de se, comme dans exil, exemple, que l'on prononce egzil, egzemple.
6°. Les deux lettres C & G deviennent auxiliaires pour exprimer des articulations auxquelles l'usage à refusé des caracteres propres. C suivi de la lettre h est le type de l'articulation forte, dont la foible est exprimée naturellement par j : ainsi les deux mots Japon, chapon, ne different que parce que l'articulation initiale est plus forte dans le second que dans le premier. G suivi de la lettre n est le symbole de l'articulation que l'on appelle communément n mouillé, & que l'on entend à la fin des mots cocagne, regne, signe.
Pour finir ce qui concerne la lette G, nous ajoûterons une observation. On l'appelle aujourd'hui gé, parce qu'en effet elle exprime souvent l'articulation jé : celle-ci aura été substituée dans la prononciation à l'articulation gue sans aucun changement dans l'ortographe ; on peut le conjecturer par les mots jambe, jardin, &c. que l'on ne prononce encore gambe, gardin dans quelques provinces septentrionales de la France, que parce que c'étoit la maniere universelle de prononcer ; gambade même & gambader n'ont point de racine plus raisonnable que gambe ; de-là l'abus de l'épellation & de l'emploi de cette consonne.
G dans les inscriptions romaines avoit diverses significations. Seule, cette lettre signifioit ou gratis, ou gens, ou gaudium, ou tel autre mot que le sens du reste de l'inscription pouvoit indiquer : accompagnée, elle étoit sujette aux mêmes variations.
G. V. genio urbis, G. P. R. gloria populi romani ; Voyez les antiquaires, & particulierement le traité d'Aldus Manucius de veter. not. explanatione.
G chez les anciens a signifié quatre cents suivant ce vers.
& même quarante mille, mais alors elle étoit chargée
d'un tiret G.
G dans le comput ecclésiastique, est la septieme & la derniere lettre dominicale.
Dans les poids elle signifie un gros ; dans la Musique elle marque une des clés G-ré-sol ; & sur nos monnoies elle indique la ville de Poitiers. (E. R. M.)
* G, (Ecriture.) Le g dans l'écriture que nous
nommons italienne, est un c ferme par un j consonne.
Dans la coulée, c'est un composé de l'o & de l'j
consonne. Le grand a la même formation que le
petit ; il se fait par le mouvement mixte des doigts
& du poignet.
Wiktionnaire
Nom commun - français
g \?e\ masculin invariable
- (Physique) (Métrologie) Unité de mesure de la gravité ou l'accélération, correspondant approximativement à la gravité terrestre moyenne, valant 9,80665 m/s².
- (Par extension) Accélération mesurée en cette unité.
-
(Métrologie, Sylviculture) Surface terrière d'un arbre.
- La surface terrière (notée g) d'un arbre correspond à la surface de la section transversale de cet arbre à hauteur d'homme. En clair, c'est la surface du tronc coupé à 1,30 m. ? (CRPF Lorraine-Alsace, La surface terrière : une mesure très terre à terre, in Floréal, n°100, mars 2015 ? lire en ligne)
Trésor de la Langue Française informatisé
G, g, subst. masc.
La septième lettre de l'alphabet. Un exemplaire de cette lettre. Le g ne se rencontre devant le g, le d et l'm que dans les mots de la langue savante; il se rencontre devant l'n, soit dans la langue vulgaire, soit dans la langue savante (ThurotPrononc. t. 2 1883, p. 344).G, g, subst. masc.
La septième lettre de l'alphabet. Un exemplaire de cette lettre. Le g ne se rencontre devant le g, le d et l'm que dans les mots de la langue savante; il se rencontre devant l'n, soit dans la langue vulgaire, soit dans la langue savante (ThurotPrononc. t. 2 1883, p. 344).G au Scrabble
Le mot g vaut 2 points au Scrabble.
Informations sur le mot g - 1 lettres, 0 voyelles, 1 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot g au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
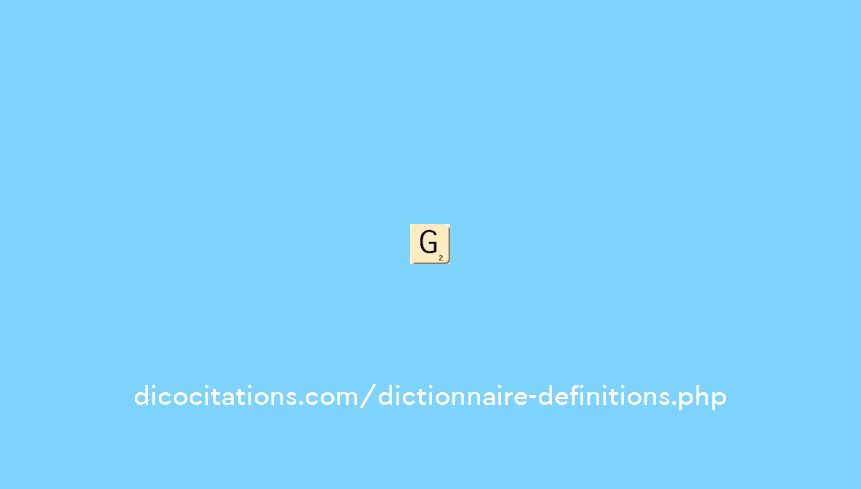
Les mots proches de G
G Gabaï Gabare Gabarier Gabarieur Gabarit Gabatine Gabattage Gabbro Gabegie Gabelant Gabelé, ée Gabeler Gabeleur Gabelle Gabelou Gaber Gabeur Gabion Gabionnade ou gabionnage Gabionner Gable Gabord Gâche Gâche Gachenet Gâcher Gachette Gâchette Gadille Gaffe Gage Gagé, ée Gager Gagerie Gageur, euse Gageure Gagiste Gagnable Gagnage Gagné, ée Gagne-denier Gagne-pain Gagne-petit Gagner Gagneur Gai, gaie Gaïac Gaiement ou gaîment Gaieté ou gaîté g G?rlingen G?rsdorf G?ulzin Gaas Gaasbeek gaba gabardine gabardines gabare gabariers gabarit gabarits Gabarnac gabarres Gabarret Gabaston Gabat gabbro gabe gabegie gabelle gabelou Gabian gabier gabiers Gabillou gabion gabions gable gables Gabon gabonais gabonais gabonaise Gabre Gabriac Gabriac Gabrias gabriel gabrielle Gacé gâcha gâchage gâchaient gâchais gâchait gâchant gâchât gâcheMots du jour
Macle Béton Indéfendable Abhorré, ée Sépulture Frouée Empeignement Encapuchonné, ée Marbreur Juge
Les citations avec le mot G
- O Rose, te voilà malade!
L'insecte invisible
Qui vole dans la nuit
Parmi la hurlante tempête
A découvert ton lit
De splendeur cramoisie;
Son amour obscur et secret
Ronge ta vie.Auteur : William Blake - Source : Les Chants d'Expérience (1794), La rose malade - Demandez à un géomètre la mesure de la terre, mais ne lui demandez pas celle de son nez.Auteur : Paul Masson - Source : Les Pensées d'un Yoghi (1896)
- Quelqu'un qui prend une arme pour défendre une cause, quelle qu'elle soit, me paraît essentiellement méprisable. J'ai une grande admiration pour les Thaïs qui ont évité de se mêler de toutes les guerres qui les entouraient. Auteur : Michel Houellebecq - Source : Propos recueillis par Didier Sénécal, paru Lire, septembre 2001.
- De mon premier coup de fusil, j'abats un grand vautour, perché tout au sommet d'un arbre mort.Auteur : André Gide - Source : Voyage au Congo (1926)
- Mieux vaut une heure de communion dans une grande pensée avec un peuple qui ressucite, que toute une existence dans la solitude d'un trône menacé par les uns et méprisé par les autres.Auteur : Giuseppe Mazzini - Source : République et Royauté en Italie, I
- Sur chaque visage parut une grimace, tous les poings sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre.Auteur : Victor Hugo - Source : Le Dernier Jour d'un condamné (1829)
- Le but d'un chef doit être moins de montrer du courage que d'en inspirer.Auteur : Paul-Louis Courier - Source : Les aventures d'un écrivain
- La tentation la plus dangereuse: ne ressembler à rien.Auteur : Albert Camus - Source : Carnets
- Fille et verre sont toujours en danger.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- L'écrivain observe, entend, écoute, enregistre. Puis il raconte une histoire, mêlant son imagination à son expérience. Et elle porte nécessairement les cicatrices de son âme.Auteur : John Le Carré - Source : Les Grands Entretiens de « Lire », Entretien avec Pierre Assouline, Mai 1986
- Madame, dit-il à ma tante, qui l'accompagnait avec moi, je vous remercie encore une fois d'un intérêt qui ne s'est pas démenti pendant quatre années.Auteur : Eugène Fromentin - Source : Dominique (1862)
- Cette persécution qui a assombri toute mon adolescence n'a eu pour résultat que d'attrister mon caractère sans le mûrir, et de l'aigrir un peu.Auteur : Valéry Larbaud - Source : Journal, février 1935
- Il ne s'agit pas d'assassiner le public avec les préoccupations cosmiques transcendantes.Auteur : Antonin Artaud - Source : Le Théâtre et son double (1938)
- La vertu ne nous coûte que par notre faute, et si nous voulions être toujours sages, rarement aurions-nous besoin d'être vertueux.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Les Confessions (édition posthume 1782-1789)
- Le gros lot à la loterie de la Vie: gagner la paix intérieure.Auteur : Daniel Desbiens - Source : Maximes d'Aujourd'hui
- On peut séparer la religion de la morale, mais la morale et la politique sont inséparables.Auteur : Gustave Le Bon - Source : Aphorismes du temps présent (1913)
- Tu dois vivre ta vie comme si quelqu'un te regardait tout le temps. Comporte-toi d'une façon qui ne te fera jamais honte. Auteur : Linwood Barclay - Source : Celle qui en savait trop (2015)
- Il leur persuada de s'armer les cuisses et jambes de bons cuissots et bonnes grefves.Auteur : Jacques Amyot - Source : Philopoemen, 13
- Cheveux longs, esprit court.Auteur : Proverbes russes - Source : Proverbe
- Sentiments anormaux peut-être mais l'adolescence n'est-elle pas une merveilleuse crise de folie qu'il ne faut pas laisser passer sans trancher dans le vif de ses sensations ce qui me faisait douter de revoir un jour Viana car l'amertume plongée dans cette crise ne la ferait pas revivre aussi désintéressée et comment pourrions-nous nous retrouver avec nos coeurs purs et impurs après cette épreuve?Auteur : Dominique Blondeau - Source : Que mon désir soit ta demeure (1975)
- Elle dépouilla nécessairement ce décorum que toute femme, même la plus naturelle, garde en ses paroles, dans ses regards, dans son maintien quand elle est en présence du monde ou de sa famille, et qui n'est plus de mise en déshabillé.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Le Lys dans la vallée
- On rit peu de la gaieté d'autrui, quand on a de l'humeur pour son propre compte.Auteur : Pierre Augustin Caron de Beaumarchais - Source : Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de Séville
- J'ai souvent pensé, avec tristesse, qu'une âme vraiment belle n'obtiendrait pas la gloire, parce qu'elle ne la désirerait pas. Cette idée, qui m'a désabusé de la gloire, m'a désabusé du génie. J'ai souvent pensé que le génie n'est qu'une éloquence particulière, un don bruyant d'exprimer.Auteur : Marguerite Yourcenar - Source : Alexis ou le Traité du vain combat (1929)
- Rien n'est plus sexy que le cerveau d'une fille avec de l'humour dedans. Les seins, les fesses, la bouche sont des amuse-gueules délicieux, mais le partenaire des longues aventures, c'est l'humour. Auteur : Mathias Malzieu - Source : Une sirène à Paris (2019)
- Les gens réagissent à la colère comme des miroirs. Ce sont leurs neurones miroirs qui parlent. Ces structures de la reconnaissance qui permet l'apprentissage par imitation. De la même façon qu'un enfant mime les réactions faciales de ses parents. Si un gosse pleure dans une classe de maternelle, tous les autres pleurent avec lui sans savoir pourquoi. La colère contamine la foule. Auteur : Patrick Bauwen - Source : L'heure du diable (2020)
Les citations du Littré sur G
- Rien n'est plus contradictoire que de prétendre représenter compétemment la nation, tandis qu'une grande partie de cette nation soutient qu'elle ne peut être représentée que dans une assemblée générale de ses trois ordresAuteur : MIRABEAU - Source : Collection, t. I, p. 37
- Les connaisseurs crurent trouver, sous ce langage barbare [des Maximes des saints], un pur quiétisme, délié, affinéAuteur : S.-SIM. - Source : 45, 14
- Les petits courtisans se relâchent sur ces devoirs, font les familiers, et vivent comme gens qui n'ont d'exemple à donner à personneAuteur : LA BRUY. - Source : VIII
- Quelle gehenne ne souffrent les femmes, guindées et cenglées, à tout de grosses coches sur les costez ?Auteur : MONT. - Source : I, 308
- Une partie de nous est tellement brute, qu'elle n'a rien au-dessus des bêtes ; l'autre est si haute et si relevée, qu'elle semble nous égaler aux intelligencesAuteur : BOSSUET - Source : Sermons, Pour une profession, Sur la virginité, 1
- C'est l'apanage de la créature d'être sujette au changementAuteur : BOSSUET - Source : Lettres abb. 72
- Là se montrent ingénument la grossièreté et la franchiseAuteur : LA BRUY. - Source : IX.
- Notre aveuglement sera sans remède, si nous ne déracinons ces deux maux extrêmes qui nous empêchent de voir : la préoccupation dans l'esprit, et une crainte secrète dans la volonté qui nous fait appréhender la lumièreAuteur : BOSSUET - Source : 1er sermon, Quinquagés. Préambule.
- On m'a souvent fait une question à la cour, quel était celui de mes poëmes que j'estimais le plus, et j'ai trouvé ceux qui me l'ont faite si prévenus en faveur de Cinna, ou du Cid, que je n'ai jamais osé déclarer toute la tendresse que j'ai toujours eue pour celui-ci, à qui j'aurais volontiers donné mon suffrageAuteur : Corneille - Source : Rodog. Examen.
- M. Gaston Planté envoie une note intéressante sur la foudre globulaireAuteur : H. DE PARVILLE - Source : Journ. offic. 3 août 1876, p. 5879, 3e col.
- Ces grands édifices que l'effort d'une main ennemie ou le poids des années ont portés par terreAuteur : BOSSUET - Source : 3e sermon, Pâques, 3
- Faut passer aux sinapismes, aux phoenigmes, c'est à dire, medicamens rubricatifs et physigenes, c'est à dire vesicatoires, ou qui excitent des vessiesAuteur : PARÉ - Source : VI, 12
- Folle ambition, laquelle l'avoit tant aveuglé qu'il ne se pouvoit contenter de preceder tant de millions d'hommesAuteur : AMYOT - Source : Crass. 52
- Il [le roi d'Angleterre] a parlé à ses milords, donné liberté aux moins affectionnés, et renouvelé l'attachement des plus fidèlesAuteur : Madame de Sévigné - Source : 13 oct. 1688
- Les remises pour les carrosses seront de dix pieds de hauteur, huit de largeur, et vingt de profondeur quand on veut mettre le timon à couvert.... les remises au nord sont les seules bonnes ; au midi, tout sècheAuteur : GENLIS - Source : Maison rust. t. I, p. 160, dans POUGENS
- Je ne di mie que nous affoiblissions ni amendrissions l'heritage de monseigneur de FlandreAuteur : Jean Froissard - Source : Discours de Jean Lyon, II, II, 53
- Il vit une dixaine de compagnons des plus determinez qui enfonçoient le chapeau selon leur coutume ordinaire quand on les regardoit en faceAuteur : D'AUB. - Source : Vie, LXXIV
- Par la mort bieu, voilà Clement, Prenez-le, il a mangé le lardAuteur : MAROT - Source : II, 128
- Les Romains, qui faisaient des lois pour tout l'univers, en avaient de très humaines sur les naufragesAuteur : Montesquieu - Source : Esp. XXI, 17
- Bacchus tant feut des Indiens desprisé qu'ilz ne daignarent luy aller encontre.... en cestuy despriz, Bacchus tousjours guaignoyt paysAuteur : François Rabelais - Source : Pant. V, 39
- Mme de Bouillon nous pria instamment d'aller voir toute la parentelle nombreuse et grotesque [de Crozat]Auteur : SAINT-SIMON - Source : 172, 43
- Coupe Nole, clerc des eschevins, qui estoit chaussetier, ayant grand credit avec le peupleAuteur : COMM. - Source : VI, 7
- Le pape Clément VIII, du nom d'Aldobrandin, originaire d'une famille de négociants de Florence, osa prétexter que la grand' mère de César d'Este n'était pas assez nobleAuteur : Voltaire - Source : Pol. et lég. Les droits des hommes, Ferrare.
- L'orgueilleux obélisque au loin couché sur l'herbeAuteur : DELILLE - Source : Jardins, IV
- Et ton coeur sacrilége aux corbeaux exposéAuteur : ROTR. - Source : St-Genest, III, 2
Les mots débutant par G Les mots débutant par G
Une suggestion ou précision pour la définition de G ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 16h59

- Gendarme - Generosite - Genie - Génie - Gentillesse - Gentleman - Geographie - Gloire - Golf - Goût - Gout - Gouvernement - Grâce - Grammaire - Grandeur - Grandir - Gratitude - Gratuit - Gravite - Gregaire - Guerre
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur g
Poèmes g
Proverbes g
La définition du mot G est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot G sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification G présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
