La définition de Légion du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Légion
Nature : s. f.
Prononciation : lé-ji-on
Etymologie : Provenç. legio ; espagn. legion ; ital. legione ; du lat. legionem, de legere, choisir, lever (voy. ). Legio veut dire primitivement levée militaire.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de légion de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec légion pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Légion ?
La définition de Légion
Terme d'antiquité romaine. Corps de gens de guerre, composé d'infanterie et de cavalerie.
Toutes les définitions de « légion »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. d'Antiquité romaine. Corps d'infanterie composé d'un nombre variable de soldats romains, auquel était rattaché quelquefois un corps de cavalerie formé d'étrangers, de gens de guerre composé d'infanterie et de cavalerie. La légion était la base de l'organisation militaire des Romains. Chaque légion était divisée en dix cohortes. Il s'est dit autrefois, en France, de Certains corps d'infanterie et se dit encore aujourd'hui des Régiments composés principalement d'étrangers qui s'engagent ou se sont engagés au service de la France. Il a brillamment servi à la légion étrangère. La Légion polonaise de la Grande Guerre. Il s'est dit aussi des Corps de garde nationale divisés par arrondissements. La première, la seconde, la troisième légion. Le colonel d'une légion. Il se dit encore aujourd'hui des Régiments de gendarmerie. Légion d'honneur, Ordre militaire et civil institué en France par Bonaparte pour récompenser les services et les talents distingués. Grand chancelier, grand-croix, grand officier, commandeur, officier, chevalier de la Légion d'honneur. Il a obtenu, il a reçu, il porte la décoration de la Légion d'honneur. Nomination, promotion dans la Légion d'honneur. Être rayé des cadres de la Légion d'honneur. Il signifie figurément et familièrement Un grand nombre de personnes. Une légion de parents, de cousins l'attendaient à la gare. Mes neveux sont légion. En termes d'Écriture sainte, Des légions d'anges. Des légions de démons. S'appeler légion, Expression figurée, empruntée de l'Évangile, par laquelle on indique qu'un individu en représente un grand nombre d'autres. Dans l'Évangile, Jésus demande au démon quel est son nom, le démon répond : Je m'appelle légion.
Littré
-
1 Terme d'antiquité romaine. Corps de gens de guerre, composé d'infanterie et de cavalerie.
Tu sais que, quand l'aigle romaine Vit choir ses légions aux bords du Trasimène
, Corneille, Nicom. I, 5.Vous dont j'ai pu laisser vieillir l'ambition Dans les honneurs obscurs de quelque légion
, Racine, Brit. I, 2.Les Romains ne levaient jamais que quatre légions dont chacune était environ de quatre mille hommes et de trois cents chevaux
, Rollin, Hist. anc. ?uv. t. I, p. 431, dans POUGENS.La légion se divisait en trois corps, qui étaient hastati, les hastaires?; principes, les princes?; triarii, les triaires
, Rollin, ib. 1re part. p. 333.Polybe, avec son bon sens ordinaire, compare l'ordonnance des Romains avec celle des Macédoniens? il fait voir les avantages et les inconvénients de la phalange et de la légion?; il donne la préférence à l'ordonnance romaine?; et il y a apparence qu'il a raison, si l'on en juge par tous les événenents de ces temps-là
, Montesquieu, Rom. 5.Les officiers [de l'armée républicaine anglaise] voulaient l'égalité et la liberté, avec la fortune, les honneurs et le pouvoir absolu?; c'est ainsi que sous la tente, depuis les légions romaines jusqu'aux mamelouks, on a toujours compris la république
, Chateaubriand, Stuarts, la République. - 2En France, sous François 1er, nom de certains corps d'infanterie.
- 3Dans les premiers temps de la Restauration, nom des régiments de ligne. Chaque légion portait le nom d'un des départements de la France.
- 4Il se dit des régiments de la garde nationale et de ceux de la gendarmerie. La première, la seconde, la troisième légion.
-
5 Au plur. Légions se dit, dans le style relevé et poétique, des armées. Déjà ses légions traversaient les Alpes.
[M. de Termes, du haut du ciel] ? Voit comme fourmis marcher nos légions Dans ce petit amas de poussière et de boue, Dont notre vanité fait tant de régions
, Racan, Consolation. - 6Légion d'honneur, ordre institué par Napoléon 1er pour récompenser les services, les vertus, les talents distingués, les actions d'éclat de toute nature. Chevalier, membre de la Légion d'honneur. La décoration de la Légion d'honneur.
-
7 Fig. et familièrement. Un grand nombre de personnes. Ils étaient une légion.
Tant qu'une légion de pédants novateurs Imprimera l'ennui pour le vendre aux lecteurs
, Gilbert, Mon apologie. -
8Dans le style de l'Écriture. Des légions d'anges, des légions de démons, des multitudes d'anges, de démons.
Jésus lui demanda?: quel est ton nom?? il lui dit?: je m'appelle Légion, parce que plusieurs démons étaient entrés dans cet homme
, Sacy, Bible, Évang. St Luc, VIII, 30.Un solitaire paresseux et sans emploi se trouvait souvent, comme ce misérable de l'Évangile, possédé d'une légion entière
, Bourdaloue, Dim. de la Septuag. dominic. t. I, p. 369.S'appeler légion, expression figurée par laquelle on indique qu'un individu en représente un grand nombre.
Fig.
C'est une légion de diables enfermés dans un seul pourpoint
, Beaumarchais, Mère coup. II, 21.
HISTORIQUE
XIIe s. Li permanables jugieres [le juge éternel] aparrat paürosement, et les legions des angeles seront presens à cest spectacle
, Job, p. 491. Dont [il] prist une aultre legion De nobles hommes, de vassaulx, Heaumes laciés, à bons chevaulx
, Brut, f° 94, dans LACURNE.
XIIIe s. Gent [il] apparaille an grant estour, Ki jà sunt assemblé mult tost?; Si en font il mult plentif ost?; Set legiuns i sunt numbrées, Ben de cumbatre aparaillées
, Édouard le confesseur, V. 4220.
XVIe s. Ces trouppes furent appellées legions, pour autant qu'elles estoient composées d'hommes esleuz et choisis entre les autres pour combattre
, Amyot, Rom. 19. Le grand roy François, desirant fortiffier et asseurer son royaume par tous moyens praticables, s'avisa d'establir des legions pour avoir toujours des gens prests, quand le besoin surviendroit, sans estre contraint d'aller mendier l'aide des estrangers
, Lanoue, 325.
Encyclopédie, 1re édition
LÉGION, s. f. (Art milit. des Romains.) on formoit chez les Romains avec des soldats qui n'avoient que leurs bras pour tout bien, selon l'expression de Valere-Maxime, les corps de troupes appellés légions, du mot latin legere, choisir ; parce que quand on levoit des légions, on faisoit un choix, dit Végece, de la jeunesse la plus propre à porter les armes ; ce qui s'appelloit delectum facere, au rapport de Varron.
Dans les commencemens de la république, les seuls citoyens romains inscrits au rôle des tributs, soit qu'ils habitassent Rome, ou qu'ils demeurassent à la campagne, formerent ces légions invincibles, qui rendirent ce peuple les maîtres du monde.
Les légions étoient composées d'infanterie & de cavalerie, dont le nombre a varié sans cesse ; de sorte qu'on ne doit pas être surpris, si les auteurs qui en ont parlé, paroissent se contredire, puisque leurs contradictions ne viennent que de la différence des tems.
D'abord, sous Romulus instituteur de ce corps, la légion n'étoit que de trois mille hommes d'infanterie, & de trois cens chevaux. Sous les consuls, elle fut long-tems de quatre mille, ou de quatre mille deux cens fantassins, & de trois cens chevaux. Vers l'an de Rome 412, elle étoit de cinq mille hommes d'infanterie. Pendant la guerre que Jules-César fit dans les Gaules, ses légions se trouverent encore à-peu-près composées du même nombre d'hommes. Sous Auguste, les légions avoient six mille cent fantassins, & sept cens vingt-six chevaux. A la mort de ce prince, elles n'étoient plus que de cinq mille hommes d'infanterie, & de six cens chevaux. Sous Tibere, elles revinrent à six mille hommes de pié, & six cens cavaliers. Comme Septime Severe imagina de former, à l'imitation des Macédoniens, une phalange ou bataillon quarré de trente mille hommes, composé de six légions, nous apprenons de ce trait d'histoire, que la légion étoit alors de cinq mille hommes. Sous les empereurs suivans, elle reprit l'ancien état qu'elle avoit sous Auguste.
Il résulte évidemment de ce détail, que pour connoître la force des armées romaines dans les différens tems, il faut être au fait du nombre des légions que Rome levoit, & du nombre d'hommes qui composoient chaque légion. Les variations ont été fort fréquentes sur ce dernier point ; elles l'ont été de même par rapport au premier, du-moins sous les empereurs ; car du tems de la république, le nombre des légions fut long-tems limité à quatre légions romaines, dont chaque consul commandoit deux, avec autant des alliés.
Quand Annibal se fut emparé de la citadelle de Cannes, on fit à Rome, dit Polybe, ce qui ne s'étoit pas encore fait ; on composa l'armée de huit légions chacune de cinq mille hommes, sans les alliés. C'étoient alors des légions soumises à l'état ; mais quand le luxe eut fait des progrès immenses dans Rome, & qu'il eut consumé le bien des particuliers, le magistrat comme le simple citoyen, l'officier, & le soldat, porterent leur servitude où ils crurent trouver leur intérêt.
Les légions de la république non-seulement augmenterent en nombre, mais devinrent les légions des grands & des chefs de parti ; & pour attacher le soldat à leur fortune, ils dissimulerent ses brigandages, & négligerent la discipline militaire, à laquelle leurs ancêtres devoient leurs conquêtes & la gloire de Rome.
Ajoutons que les légions ne furent composées de citoyens de la ville de Rome, que jusqu'à la destruction de Carthage ; car après la guerre des alliés, le droit de bourgeoisie romaine ayant été accordé à soutes les villes d'Italie, on rejetta sur elles la levée des troupes légionaires, & très-peu sur Rome.
Ces troupes néanmoins s'appellerent romaines, parce que les alliés participant aux mêmes priviléges que les citoyens de Rome, étoient incorporés dans la république.
Mais l'empire s'étant aggrandi de toutes parts, les villes d'Italie ne purent fournir le nombre d'hommes nécessaire à la multiplicité des légions que les empereurs établirent. Ils les formerent alors des troupes de toutes les provinces, & les distribuerent sur les frontieres, où on leur assigna des camps, castra, dont quelques-uns sont devenus des villes par succession de tems ; de-là tant de noms géographiques, où le mot castra se trouve inséré.
Il nous faut présentement indiquer les différentes parties & les différentes sortes de soldats, dont la légion romaine étoit composée.
Romulus à qui Rome doit cet établissement, la divisa en dix corps, qu'on nommoit manipules, du nom de l'enseigne qui étoit à la tête de ces corps, & qui consistoit en une botte d'herbes, attachée au bout d'une gaule. Ces corps devinrent plus forts, à mesure que la légion le devint ; & toutefois lorsqu'on eut pris d'autres enseignes, ils ne laisserent pas de retenir ce premier nom de manipule.
On fit avec le tems une nouvelle division de la légion qui néanmoins fut toujours de dix parties, mais qu'on appella cohortes, dont chacune étoit commandée par un tribun : chaque cohorte étoit composée de trois manipules, forts à proportion de la légion.
On attribue cette nouvelle division à Marius. Elle continua depuis d'être toujours la même, tant sous la république, que sous les empereurs. La légion étoit donc composée de trente manipules & de dix cohortes ou régimens, pour parler suivant nos usages, plus ou moins nombreuses, selon que la légion l'étoit.
Mais il faut remarquer que la premiere cohorte étoit plus forte du double, & qu'on y plaçoit les plus grands hommes ; les neuf autres cohortes étoient égales en nombre de soldats. Ces dix cohortes formoient dix bataillons, qui se rangeoient sur trois lignes. Si la légion étoit de six mille hommes, la manipule étoit de deux cens hommes ou deux centuries.
Une légion étoit composée indépendamment des cavaliers, de quatre sortes de soldats, qui tous quatre avoient différent âge, différentes armes, & différens noms. On les appelloit vélites, hastaires, princes & triaires ; voyez Velites, Hastaires, Princes & Triaires, car ils méritent des articles séparés.
Les légions sous la république, étoient commandées par un des consuls & par leurs lieutenans. Sous les empereurs, elles étoient commandées par un officier général qu'on nommoit préfet, præfectus exercituum. Les tribuns militaires commandoient chacun deux cohortes, & portoient par distinction l'anneau d'or comme les chevaliers. Chaque manipule avoit pour capitaine un officier, qu'on appelloit ducentaire, quand la légion fut parvenue à six mille hommes d'infanterie : de même qu'on nommoit centurion, celui qui commandoit une centurie. Les tribuns militaires élisoient les centurions, & ceux-ci élisoient leur lieutenant, qu'on nommoit succenturion, & qu'on appella dans la suite option. Voyez Option.
Quant aux légions que les alliés fournissoient, ceux qui les commandoient étoient appellés préfets du tems de la république, mais ils étoient à la nomination des consuls ou des généraux d'armées.
Chaque légion avoit pour enseigne générale une aigle les aîles déployées, tenant un foudre dans ses serres. Elle étoit postée sur un petit pié-destal de même métal, au haut d'une pique ; cette figure étoit d'or ou d'argent, de la grosseur d'un pigeon. Celui qui la portoit, s'appelloit le porte-aigle, & sa garde ainsi que sa défense, étoit commise au premier centurion de la légion.
Ce fut Marius, selon Pline, liv. X. c. iv. qui choisit l'aigle seule pour l'enseigne générale des légions romaines ; car outre l'aigle, chaque cohorte avoit ses propres enseignes faites en forme de petites bannieres, d'une étoffe de pourpre, où il y avoit des dragons peints. Chaque manipule & chaque centurie avoit aussi ses enseignes particulieres de même couleur, sur lesquelles étoient des lettres pour désigner la légion, la cohorte & la centurie.
On distinguoit les légions par l'ordre de leur levée, comme premiere, deuxieme, troisieme, ou par les noms des empereurs auteurs de leur fondation ; comme legio Augusta, Claudia, Flavia, Trajana, Ulpia, Gordiana, &c. Elles furent encore distinguées dans la suite par des épithetes qu'elles avoient méritées pour quelque belle action, comme celle qui fit surnommer une légion la foudroyante, une autre la victorieuse ; ou même pour quelque défaut qui lui étoit propre, comme la paillarde. Enfin elles retinrent quelquefois le nom des provinces où elles servoient, comme l'illyrienne, la macédonienne, la parthique, la gauloise, &c.
Il nous reste à parler de la cavalerie qui composoit chaque légion. On lui donnoit le nom d'aîle, parce qu'on la plaçoit ordinairement de maniere, qu'en couvrant les flancs elle en formoit les aîles. On la divisoit en dix parties ou brigades, autant qu'il y avoit de cohortes ; & chaque brigade étoit forte, à proportion du total de la cavalerie de la légion. Si elle passoit six cens chevaux, chaque aîle ou brigade étoit de deux turmes ou compagnies de trente-trois chevaux chacune. La turme se subdivisoit en trois décuries ou dixaines, qui avoient chacune un décurion à leur tête, dont le premier commandoit à toute la turme, & en son absence le second. On prenoit toujours un de ces premiers décurions, pour commander chaque aîle ou brigade, & en cette qualité il étoit appellé préfet de cavalerie ; il avoit rang au-dessus du petit tribun, ou comme nous dirions du colonel d'infanterie.
Toute la cavalerie romaine qu'établit Romulus dans les légions qu'il institua, ne consistoit qu'en trois cens jeunes hommes, qu'il choisit parmi les meilleures familles, & qu'on nommoit celeres ; c'est là l'origine des chevaliers romains. Servius Tullius porta ce nombre à dix-huit cens cavaliers, & en forma dix-huit centuries. Ils avoient un cheval fourni & entretenu aux dépens de l'état. Cependant cette cavalerie n'étant pas suffisante, on l'augmenta en faisant les levées pour les légions ; mais on observa de la tirer d'entre les plébéïens aisés, parce qu'on les obligea de se fournir de monture à leurs dépens. Ils n'avoient encore point d'autres armes défensives qu'un mauvais bouclier de cuir de b?uf, & pour armes offensives, qu'un foible javelot.
Mais comme on éprouva les desavantages de cette armure, on les arma à la grecque, c'est-à-dire de toutes pieces ; leurs chevaux même étoient bardés au poitrail & aux flancs. Le cavalier avoit un casque ouvert, sur lequel étoit un grand panache de plumes, ou un ornement relevé qui en tenoit lieu. Une cotte de mailles ou à écailles le couvroit jusqu'au coude & descendoit jusqu'aux genoux, avec des gantelets ou un épais bouclier.
Les armes offensives étoient une grosse javeline ferrée par les deux bouts, & une épée beaucoup plus longue que celle de l'infanterie ; c'est ainsi que Polybe, l. VI. c. jv. nous décrit l'armure de la cavalerie des légions romaines.
Elle ne se servoit point d'étriers, & n'avoit que des selles rases. Les cavaliers pour monter à cheval étoient obligés de se lancer dessus tout armés, & ils apprenoient à faire cet exercice à droite comme à gauche ; il n'étoit pas non plus d'usage de ferrer leurs chevaux, quoiqu'on le pratiquât pour les mules.
Parmi les légionaires romains il n'y avoit point de cavalerie légere, elle n'étoit connue que dans leurs troupes auxiliaires ; mais les empereurs en établirent sous le nom d'archers, lesquels pour être plus agiles, ne portoient aucune armure, & n'avoient que le carquois plein de fleches, l'arc & l'épée. Quant aux étendarts & cornettes de la cavalerie, on les distinguoit de celles de l'infanterie, par la couleur qui étoit bleue, & parce qu'elles étoient taillées en banderolles.
On mettoit sous la garde du premier capitaine les étendarts & cornettes de la cavalerie dans un asyle assuré, ainsi que les aigles ou drapeaux de l'infanterie étoient sous la garde du porte-aigle. Les cavaliers & les soldats des légions portoient leur argent en dépôt dans ces deux endroits. Végece, c. xx. l. II. nous apprend qu'on y déposoit encore la moitié des gratifications qu'on faisoit aux troupes, de peur qu'elles ne dissipassent tout en débauches & en folles dépenses.
Ce furent les empereurs qui imaginerent l'usage de faire aux légions des donatifs, pour me servir des mêmes termes des auteurs. On partageoit ces donatifs en dix portions, une pour chaque cohorte, sur quoi toute la légion mettoit quelque chose à part dans un onzieme sac, pour la sépulture commune ; quand un soldat mouroit, on tiroit de ce sac dequoi faire ses funérailles.
Enfin, lorsque les légions avoient remporté quelque victoire, on ornoit de lauriers les aigles romaines, les étendarts de la cavalerie, les enseignes où étoit le portrait de l'empereur, & on faisoit brûler des parfums devant elles.
Voilà les particularités les plus importantes sur cette matiere ; je les ai receuillies avec quelque soin de Tite-Live, de Denys d'Halicarnasse, de César, de Polybe, de Végece, de Frontin, & d'autres auteurs ; en y mettant de l'ordre, j'ai pris pour guide des gens du métier. (D. J.)
Légion fulminante, (Hist. rom.) étoit une légion de l'armée romaine, & composée de soldats chrétiens qui, dans l'expédition de l'empereur Marc-Aurele contre les Sarmates, Quades & Marcomans, sauverent toute l'armée prête à périr de soif, & qui obtinrent par leurs prieres une pluie abondante pour l'armée romaine, tandis que l'ennemi essuyoit de l'autre côté une grêle furieuse, accompagnée de foudres & d'éclairs épouvantables.
C'est ainsi que les historiens ecclésiastiques rapportent ordinairement ce fait, & toute cette histoire est sculptée en bas-relief sur la colonne Antonine. C'est de-là qu'est venu le nom de fulminant, quoiqu'il y en ait qui prétendent que la légion composée de ces chrétiens, s'appelloit déja auparavant la légion fulminante. Voyez Légion.
Légion Thébéenne, (Hist. eccl.) nom donné par quelques auteurs à une légion des armées romaines, qui résolue de ne point sacrifier aux idoles, souffrit le martyre sous les empereurs Dioclétien & Maximilien, vers l'an de J. C. 297.
Maximilien, disent ces auteurs, se trouvant à Octodurum, bourg des Alpes cottiennes dans le bas Vallais, aujourd'hui nommé Martinach, voulut obliger son armée de sacrifier aux fausses divinités. Les soldats de la légion thébéenne pour s'en dispenser, s'en allerent à huit milles de là à Agaunum, qu'on appelle à présent Saint-Maurice, du nom du chef de cette légion. L'empereur leur envoya dire de venir sacrifier, ils le refuserent nettement, & l'on les décima sans qu'ils fissent aucune résistance. Ensuite Maximien répéta le même ordre aux soldats qui restoient ; même refus de leur part. On les massacra ; & tout armés qu'ils étoient & en état de résister, ils se présenterent à leurs persécuteurs la gorge nue, sans se prévaloir de leur nombre, & de la facilité qu'ils avoient de défendre leur vie à la pointe de leur épée. Comme leur ame n'étoit occupée que de la gloire de confesser le nom de celui qui avoit été mené à la boucherie sans ouvrir la bouche non plus qu'un agneau, ils se laisserent déchirer à des loups furieux.
Cependant toute la relation attendrissante du martyre de la légion thébéenne n'est qu'une pure fable. Le plaisir de grossir le nombre des martyrs, dit l'auteur moderne de l'Histoire universelle, a fait ajoûter des persécutions fausses & incroyables à celles qui n'ont été que trop réelles. Quand même il y auroit eû une légion thébéenne ou thébaine, ce qui est fort douteux, puisqu'elle n'est nommée dans aucun historien, comment Maximien Hercule auroit-il détruit une légion qu'il faisoit venir d'Orient dans les Gaules, pour y appaiser une sédition ? Pourquoi se seroit-il privé par un massacre horrible de six mille six cens soixante & six braves soldats dont il avoit besoin pour réprimer une grande révolte ? Comment cette légion se trouva-t-elle toute composée de chrétiens martyrs, sans qu'il y en ait eu un seul, qui pour sauver sa vie, n'ait fait l'acte extérieur du sacrifice qu'on exigeoit ? A quel propos cette boucherie dans un tems où l'on ne persécutoit aucun chrétien, dans l'époque de la plus grande tranquilité de l'Eglise ? La profonde paix, & la liberté dont nous jouissions, dit Eusebe, nous jetta dans le relâchement. Cette profonde paix, cette entiere liberté s'accorde-t-elle avec le massacre de six mille six cens soixante-six soldats ? Si ce récit incroyable pouvoit être vrai, Eusebe l'eût-il passé sous silence ? Tant de martyrs ont scellé l'Evangile de leur sang, qu'on ne doit point faire partager leur gloire à ceux qui n'ont pas partagé leurs souffrances.
Il est certain que Dioclétien, dans les dernieres années de son empire, & Galerius ensuite, persécuterent violemment les chrétiens de l'Asie mineure & des contrées voisines ; mais dans les Gaules, dans les Espagnes & dans l'Angleterre, qui étoient alors le partage ou de Severe, ou de Constance Chlore, loin d'être poursuivis, ils virent leur religion dominante.
J'ajoûte à ces réflexions, que la premiere relation du martyre de la légion thébéenne, attribuée à saint Eucher évêque de Lyon, est une piece supposée. Pour prouver que ce petit livre qu'on donne à ce bon évêque, n'est point de lui, il suffit d'observer que saint Eucher finit ses jours en 454 ; & que dans son prétendu livre il y est fait mention de Sigismond roi de Bourgogne, comme mort depuis plusieurs années : or l'on sait que ce prince fut jetté dans un puits près d'Orléans, où il périt misérablement vers l'an 523.
On a démontré que les actes du concile d'Agaunum que Pierre François Chifflet a publié dans son édition de Paulin, sont aussi fictifs que ceux qu'ont suivi Surius & Baronius.
Les premiers écrivains qui ont parlé du martyre de la légion Thébéenne, sont Grégoire de Tours & Vénance Fortunat, qui liés d'une étroite amitié, vivoient tous deux sur la fin du vj. siecle. Mais, comme le cardinal Baronius en convient lui-même, il faut donner ces choses & plusieurs autres, d'une part à la crédulité de l'auteur des miracles de la vie des saints, & de l'autre à la simplicité de l'auteur du poëme de la vie de saint Martin.
S'il est encore quelqu'un qui desire une réfutation plus complette du roman de la legion thébéenne, nous le renverrons pour se convaincre à la fameuse dissertation de Dod well, de paucitate martyrum, qui est la onzieme des dissertationes cyprianicæ, imprimées à part ; & à la fin de l'édition de saint Cyprien, publiée par Jean Fell évêque d'Oxford. Que si ce quelqu'un crédule & amateur du merveilleux, n'entend pas le latin, nous pouvons pour lever ses doutes, lui recommander la lecture du savant petit ouvrage de M. du Bourdieu sur le martyre de la légion thébéenne. Cet écrit vit d'abord le jour en anglois en 1696, & a paru depuis traduit en françois en 1705. (D. J.)
Légion, (Art numismat.) nom de certaines médailles.
Une légion, en terme de médaillistes, est une médaille qui a au revers deux signes ou étendarts militaires, une aigle romaine au milieu, & pour inscription le nom de la légion, LEGIO I. II. X. XV. &c. Par exemple, ANT. AVG. III. VIR RPC, un navire ; au revers deux signes appellés pila, & une aigle romaine au milieu, LEG. II. ou XV, &c. & une autre LEG. XVII CLASSICÆ. Antoine est le premier, & Carausius le dernier, sur les médailles desquelles on trouve des légions. Il y a jusqu'à la xxive. légion sur les médailles que nous possédons, mais pas au-delà. Voyez les recueils de Mezzabarba & du P. Banduri. Trévoux, Chambers.
Légion, (Géog. anc.) ville de la Palestine, au pié du mont-Carmel, à 15 milles de Nazareth. Elle est célebre dans les écrits d'Eusebe & de S. Jérôme : c'est apparemment le même lieu qui est encore aujourd'hui nommé Légune. Les Romains y entretenoient une légion de soldats, pour garder le passage de Ptolomaïde à Césarée de Palestine ; c'étoit pour ainsi dire la clé du pays de ce côté-là. Il s'est donné plusieurs combats aux environs de cet endroit. (D. J.)
Wiktionnaire
Nom commun - français
légion \le.?j??\ féminin
-
(Antiquité, Militaire) Corps d'infanterie romaine ayant varié de quatre mille soldats sous la République romaine à six mille sous le Haut-Empire et environ mille au Bas-Empire, commandé par un légat de rang sénatorial.
- Il semble donc que la création du port ello-rhénan soit le fait de l'armée romaine. C'est plus particulièrement la VIIIe légion qui avait pris en charge son aménagement. ? (Jean-Jacques Hatt, Argentorate - Strasbourg, Presses Universitaires Lyon, 1993, page 86)
- Et là-bas, sous le pont, adossé contre une arche, - Hannibal écoutait, pensif et triomphant, - Le piétinement sourd des légions en marche.? (José Maria de Heredia, Les Trophées - La Trebbia, 1893.)
-
(Militaire) Par ellipse, armée ou formation militaire, au sens large.
- Certains gouvernements, quand ils envoient leurs légions d'un pôle à l'autre, parlent encore de la défense de leurs foyers; on dirait qu'ils appellent leurs foyers tous les endroits où ils ont mis le feu.? (Benjamin Constant, De l'esprit de conquête et de l'usurpation, 1814)
- La légion italienne que Garibaldi commande endosse la chemise rouge, vêtement à l'origine destiné aux ouvriers des abattoirs argentins. ? (Garibaldi, article Wikipédia.)
-
(Militaire) En France, corps militaire, régiment composés principalement d'étrangers qui s'engagent ou se sont engagés au service de la France.
- Il a brillamment servi à la légion étrangère.
- La légion polonaise de la Grande Guerre.
- La légion étrangère avait tourné l'ennemi et terrible, impétueuse comme un ouragan, culbutait tout sur son passage. ? (Antoine Camus, La légion étrangère, 1864.)
-
(Militaire) Corps de garde nationale divisés par arrondissements.
- La première, la seconde, la troisième légion.
- Le colonel d'une légion. Il se dit encore aujourd'hui des régiments de gendarmerie.
-
(Militaire) Légion d'honneur, Ordre militaire et civil institué en France par Bonaparte pour récompenser les services et les talents distingués.
- Grand chancelier, grand-croix, grand officier, commandeur, officier, chevalier de la légion d'honneur.
- Il a obtenu, il a reçu, il porte la décoration de la légion d'honneur.
- Nomination, promotion dans la légion d'honneur.
- Être rayé des cadres de la légion d'honneur.
-
(Figuré) (Familier) Un grand nombre de personnes ou de choses.
- Urbanistes et architectes le savent : autour de ces sujets, le terrain est miné, et les malentendus sont légion. ? (Jessica Gourdon, La place des femmes dans la ville, nouveau sujet des écoles d'architecture, Le Monde. Mis en ligne le 16 octobre 2018)
- Au plafond de ma chambre pendait un attrape-mouches. Elles étaient légion, les mouches ! Des milliers à vibrionner dans la tringle du store. ? (Christian Cogné, Requiem pour un émeutier: La naissance d'un tiers monde de l'éducation, Actes Sud Littérature, 2013, chap. 5)
- Les distributeurs automatiques de billets sont légion au Japon mais la plupart refusent les cartes étrangères. ? (Japon - Nord de Honshu (Tohoku), Lonely Planet, 2016)
- Chose qui n'arrange rien, le monde du jeu vidéo fait rêver, et cette attractivité est le premier ennemi des salariés en place, régulièrement mis en concurrence avec des légions de jeunes diplômés prêts à de nombreux sacrifices. ? (William Audureau, La difficile question de la charge de travail dans l'industrie du jeu vidéo, Le Monde. Mis en ligne le 18 octobre 2018)
- J'avais tenté de trouver quelques études indépendantes sur le sujet, elles ne sont pas légion car dépendant trop souvent du lobby thermaliste. ? (Thierry Lecoquierre, Dr Coq: Essai d'auscultation de la médecine générale, Éditions Librinova, 2018)
-
(Écriture sainte) Définition manquante ou à compléter. (Ajouter)
- Des légions d'anges.
- Des légions de démons.
- S'appeler légion, Expression figurée, empruntée de l'évangile, par laquelle on indique qu'un individu en représente un grand nombre d'autres.
- Dans l'évangile, Jésus demande au démon quel est son nom, le démon répond : Je m'appelle légion.
Trésor de la Langue Française informatisé
LÉGION, subst. fém.
Légion au Scrabble
Le mot légion vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot legion - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot légion au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
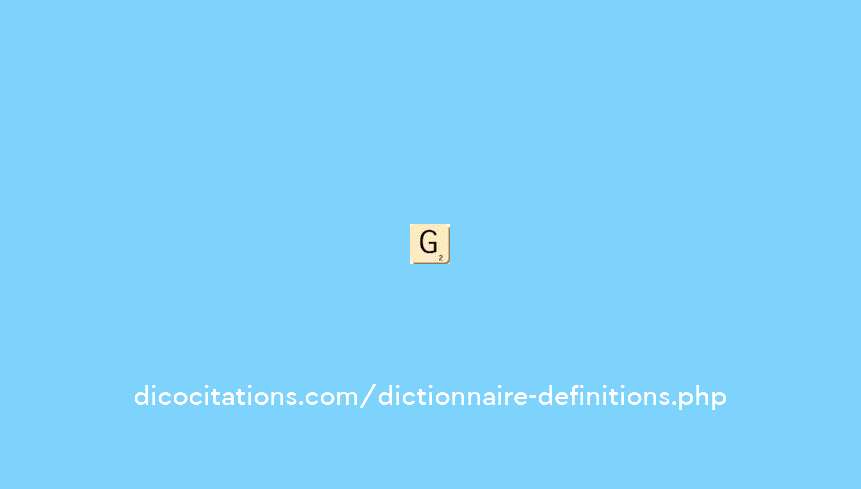
Les mots proches de Légion
Légal, ale Légalement Légalisé, ée Légaliser Légalité Légat Légataire Légation Légendaire Légende Léger, ère Légèrement Légèreté Légion Légionnaire Législater Législateur, trice Législatif, ive Législation Légiste Légitimation Légitime Légitime Légitimé, ée Légitimement Légitimer Légitimité Legs Léguer Légumage Légume Légumier, ière légal légale légalement légales légalisant légalisation légalise légalisé légalisé légalisée légalisée légaliser légalisez légaliste légalistes légalité légat légataire légataires légation légations legato légats légaux Lège Legé Lège-Cap-Ferret légendaire légendaires légende légendée légendée légender légendes léger légère légèrement légères légèreté légèretés légers Légéville-et-Bonfays leggins leghorns légiférait légifère légiféré légiférer légion légionelloseMots du jour
-
camouflet aéropathie nyctalope prophétisant ébouillantée bijouterie proclamés baisotant almohades consolatrices
Les citations avec le mot Légion
- Je sais que vous gardez une place au Poète
Dans les rangs bienheureux des saintes Légions,
Et que vou l'invitez à l'éternelle fête
Des Trônes, des Vertus, des Dominations.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Les Fleurs du Mal (1857), I - Bénédiction - Et là-bas, sous le pont, adossé contre une arche, - Hannibal écoutait, pensif et triomphant, - Le piétinement sourd des légions en marche.Auteur : José Maria de Heredia - Source : Les Trophées (1893), La Trebbia
- Et je les ai priés qu'ils voulussent bien, leur - Légion d'honneur, se la carrer dans le train.Auteur : Marcel Aymé - Source : Sans référence
- Notre valeur n'est pas non plus cette mystique dénuée de spiritualité, au travers de laquelle nous prétendons commander aux puissances occultes. Sans chercher à nous conformer aux principes supérieurs et universels qui régissent la vie. Notre grandeur viendra de ce que nous saurons engendrer des êtres libres. Qu'ils se tiennent debout, qu'ils ne récitent leur longue généalogie que pour mieux regarder devant. Qu'ils disent : je suis parce que j'existe. Je récuse l'obscur et réfute la démence comme unique horizon. Et après qu'ils auront dit combien l'Afrique vaut mieux que ce qu'elle pense d'elle-même, des légions leur emboîteront le pas. Auteur : Léonora Miano - Source : Contours du jour qui vient (2006)
- Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Légion répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui.Auteur : La Bible - Source : Luc, VIII, 30
- Voici ce que Rico Danon, dans Seule la mer, pense du mystérieux homme vivant dans l'Himalaya : L'enfant né d'une femme porte ses parents sur ses épaules. Non, pas sur ses épaules.En lui. toute sa vie, il sera condamné à les porter, eux et les légions de leurs parents,
les parents de leurs parents, une poupée russe, grosse jusqu'à la dernière génération. Où qu'il aille, il porte ses parents, il les porte en se couchant, en se levant, s'il vagabonde au loin ou s'il reste en place. Nuit après nuit, il partage son lit avec son père et sa couche avec sa mère jusqu'à ce que son heure arrive.
— Ne demandez pas si ce sont des faits réels. Si c'est ce qui se passe dans la vie de l'auteur. Posez-vous la question. sur vous-même. Quant à la réponse, gardez-la pour vous.Auteur : Amos Oz - Source : Une histoire d'amour et de ténèbres , 2002
- La légion d'honneur, c'est comme les hémorroïdes, n'importe quel cul peut l'avoir.Auteur : Jean Gouyé, dit Jean Yanne - Source : Sans référence
- Certains gouvernements, quand ils envoient leurs légions d'un pôle à l'autre, parlent encore de la défense de leurs foyers on dirait qu'ils appellent leurs foyers tous les endroits où ils ont mis le feu.Auteur : Benjamin Constant - Source : Cours de politique constitutionnelle (1818-1820)
- L'homme vraiment fort, équilibré, calme, boit tranquillement au bar; il n'a pas besoin d'essayer de se prouver à lui-même qu'il n'a pas peur en s'engageant dans la Légion étrangère.Auteur : Christopher Isherwood - Source : Sans référence
- Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs.Auteur : La Bible - Source : Marc, V, 9
- C'est à Elchingen que, pour la première fois, l'Empereur, détachant de sa poitrine sa croix de la Légion d'honneur, en décora un soldat.Auteur : Louis Madelin - Source : Histoire du Consulat et de l'Empire (1937-1953)
- Le tout, disait mon vieux Satie, n'est pas de refuser la Légion d'honneur. Encore faut-il ne pas l'avoir méritée.Auteur : Jean Cocteau - Source : Journal (1942-1945), 5 avril 1942
- Leur courage, comme leur dévouement, pouvaient se comparer au courage et au dévouement des légionnaires sous le feu, eu milieu d'une nature hostile jusqu'à la cruauté.Auteur : Pierre Dumarchey, dit Pierre Mac Orlan - Source : La Bandera (1931)
- La vie civile n'est pas clémente pour les anciens légionnaires.Auteur : Pierre Dumarchey, dit Pierre Mac Orlan - Source : La Bandera (1931)
- Il ne suffit pas de refuser la Légion d'Honneur; encore faut-il ne pas la mériter!Auteur : Erik Satie - Source : Sans référence
- Ma carrière n'a démarré qu'à 50 ans. C'est en France que j'ai d'abord connu le succès. Mon meilleur souvenir, ce sont mes trois Olympia ; la salle bondée et enthousiaste, en juin 1993. Et puis la Légion d'honneur remise par le président Chirac. Cette double reconnaissance du public et des autorités françaises, c'était comme une consécration.Auteur : Cesária Évora - Source : Interview de Cesaria Evora, La Vie par Emmanuel Gabey et Yves Hardy, novembre 2011
- Recette pour changer un vil géranium - En Légion d'honneur: on ôte trois pétales!Auteur : Edmond Rostand - Source : L'Aiglon (1900)
- Sans partager intégralement les phobies de sa fille et de son gendre, elle était tout de même d'accord avec eux pour reconnaître que nous étions une espèce en voie d'extinction. Nous avions peur et nos peurs étaient aussi multiples et insidieuses que les menaces elles-mêmes. Nous avions peur des nouvelles technologies, du réchauffement climatique, de l'électrosmog, des parabènes, des sulfates, du contrôle numérique, de la salade en sachet, de la concentration de mercure dans les océans, du gluten, des sels d'aluminium, de la pollution des nappes phréatiques, du glyphosate, de la déforestation, des produits laitiers, de la grippe aviaire, du diesel, des pesticides, du sucre raffiné, des perturbateurs endocriniens, des arbovirus, des compteurs Linky, et j'en passe. Quant à moi, sans bien comprendre encore qui voulait nous faire la peau, je savais que son nom était légion et que nous étions contaminés. J'endossais des hantises qui n'étaient pas les miennes mais qui frayaient sans peine avec mes propres terreurs enfantines. Sans Arcady, nous serions morts à plus ou moins brève échéance, parce que l'angoisse excédait notre capacité à l'éprouver. Il nous a offert une miraculeuse alternative à la maladie, à la folie, au suicide. Il nous a mis à l'abri. Il nous a dit : « N'ayez pas peur. »Auteur : Emmanuelle Bayamack-Tam - Source : Arcadie (2018)
- La Légion d'honneur c'est l'hémorroïde du vaniteux.Auteur : Patrick Sébastien - Source : Carnet de notes (2001)
- C'est vers le ciel que se tourne tout ce qui gémit, tout ce qui espère, tout ce qui chante. Et les bluets de l'azur sont faits des légions de regards levés.Auteur : Pierre Aguétant - Source : Le coeur secret (1921)
- Il jeta sur son lit son grand manteau réglementaire, moitié djellaba, moitié manteau de paysan andalou écussonné sur la poitrine aux armes de la Légion.Auteur : Pierre Dumarchey, dit Pierre Mac Orlan - Source : La Bandera (1931)
- Je jure que si demain on parlait de liquider en France, par des moyens doux, cinquante à quatre-vingt mille malades mentaux et arriérés, des millions de gens trouveraient ça très bien, et l'on parlerait à coup sûr d'une œuvre humanitaire, et il y en a qui seraient décorés pour ça, la légion d'honneur et le reste. Auteur : Roger Gentis - Source : Les murs de l'asile (1988)
- Les légionnaires descendirent des camions, par grappes, les jambes molles, le corps lourd.Auteur : Pierre Dumarchey, dit Pierre Mac Orlan - Source : La Bandera (1931)
- Aime-moi, non comme le pigeon ébouriffé
Les cimes des arbres, ni comme la légion
Des mouettes la lèvre des vagues.
Aime-moi et soulève ton masque.Auteur : Dylan Thomas - Source : Vision et prière et autres poèmes de Dylan Thomas - Il avait ces trois marques de l'impersonnalité: un menton fuyant, la Légion d'honneur, une alliance.Auteur : Natalie Clifford Barney - Source : Eparpillements (1910)
Les citations du Littré sur Légion
- L'aigle des légions que je retiens encore Demande à s'envoler vers les mers du BosphoreAuteur : Voltaire - Source : M. de César, I, 1
- [M. de Termes, du haut du ciel] .... Voit comme fourmis marcher nos légions Dans ce petit amas de poussière et de boue, Dont notre vanité fait tant de régionsAuteur : RACAN - Source : Consolation.
- Dans une extrême disette d'eau que Marc Aurèle souffrit en Germanie, une légion chrétienne obtint une pluie capable d'étancher la soif de son arméeAuteur : BOSSUET - Source : Hist. I, 10
- Il faut entrevoir pendant ces cinq siècles [de saint Benoît à saint Bernard] les efforts surhumains tentés par ces légions de moines sans cesse renaissantes, pour dompter, pacifier, discipliner, purifier vingt peuples barbares successivement transformés en nations chrétiennesAuteur : MONTALEMBERT - Source : Moines d'Occident, t. I, p. V
- Que dis-je ? en quel état croyez-vous la surprendre [Rome] ? Vide de légions qui la puissent défendreAuteur : Jean Racine - Source : Mithr. III, 1
- Vous dont j'ai pu laisser vieillir l'ambition Dans les honneurs obscurs de quelque légionAuteur : Jean Racine - Source : Brit. I, 2
- À peine ces préparatifs [du printemps] sont-ils achevés, qu'on voit paraître les légions émaillées [les poissons voyageurs]Auteur : Chateaubriand - Source : Génie, I, V, 4
- Il passa en Asie avec une seule legion qu'il leva de nouveau [pour la 1re fois] à RomeAuteur : AMYOT - Source : Lucul. 13
- Ils prétendaient obliger le jeune César, qui ne leur était pas moins suspect, de licencier ses légionsAuteur : VERTOT - Source : Rév. rom. XIV, 336
- La mort de Néron causa une révolution dans l'État ; l'élection passa aux légions, et la constitution devint militaireAuteur : CHATEAUBR. - Source : Études hist. I, 1
- À ses legions mutines Cesar opposoit seulement la fierté de ses parolesAuteur : MONT. - Source : I, 351
- Les Machedoniens, les Grecs et les Dardeniens orent, en leu de legions, eschelles [bataillons] que il appeloient phalengesAuteur : J. DE MEUNG - Source : Végèce, II, 2
- Mes secours en Judée achevèrent l'ouvrage, Qu'avait des légions ébauché le suffrageAuteur : Corneille - Source : Tit. et Bér. III, 5
- Tu sais que, quand l'aigle romaine Vit choir ses légions aux bords du TrasimèneAuteur : Corneille - Source : Nicom. I, 5
- Legions par lesquelx Romain fesoient leurs batailles, si come sont aujourd'hui servans ou brigans ; quar comunement Romain se combatent plus à pié que à chevalAuteur : BERCHEURE - Source : f° 1, verso
- Et les etrusques legions n'ont mie reculéAuteur : BERCHEURE - Source : f° 44, recto.
- Enfin des légions l'entière obéissance Ayant de votre empire affermi la puissance....Auteur : Jean Racine - Source : Brit. IV, 2
- Lorsqu'il [Juvénal] dit que ce peuple qui distribuait autrefois les royaumes, les dignités et les légions, ne demandait plus autre chose que du pain et des spectaclesAuteur : BERNARDI - Source : Instit. Mém. inscr. et belles-lettr. t. VIII, p. 314
- Il voit deux légions nouvelles Qui pour l'environner développent leurs ailesAuteur : SAURIN - Source : Spartac. V, 9
- Je lui faisais [à Marius] une guerre de réputation, plus cruelle cent fois que celle que mes légions faisaient au roi barbareAuteur : Montesquieu - Source : Sylla et Eucrate.
- Je me souviens qu'il nous ravissait en nous racontant comme en Catalogne, dans les lieux où ce fameux capitaine [César], par l'avantage des postes, contraignit cinq légions romaines et deux chefs expérimentés à poser les armes sans combats, lui-même il avait été reconnaître les rivières et les montagnes qui servirent à ce grand desseinAuteur : BOSSUET - Source : Louis de Bourbon.
- Tant qu'une légion de pédants novateurs Imprimera l'ennui pour le vendre aux lecteursAuteur : GILBERT - Source : Mon apologie.
- Il ne faut que frapper du pied en terre, pour en faire sortir les legions arméesAuteur : LANOUE - Source : 262
- Le roy François le grand leur donna ce nom de legionnaires ; car ils s'appeloient au temps passé francs-archiers, et, en Bretaigne, francs-taupinsAuteur : CARLOIX - Source : VII, 3
- Et là où les legions entrerent en la ville, ne cuidiez pas que il y eust brayt, clamour, ne telmouteAuteur : BERCHEURE - Source : f° 17
Les mots débutant par Leg Les mots débutant par Le
Une suggestion ou précision pour la définition de Légion ? -
Mise à jour le vendredi 6 février 2026 à 23h26

- Lache - Lacheté - Lâcheté - Laideur - Langage - Langue - Lapsus - Larme - Leçon - Lecture - Lettre - Liaison - Liberalite - Liberte - Liberté - Limitation - Linguistique - Lire - Littérature - Litterature - Livre - Logement - Logiciel - Logique - Loi - Loisirs - Louange - Loyauté - Lucidite - Lumiere - Lune - Lunettes - Luxe - Luxure
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur légion
Poèmes légion
Proverbes légion
La définition du mot Légion est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Légion sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Légion présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
