La définition de Mendiant, Ante du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Mendiant, ante
Nature : adj.
Prononciation : man-di-an, an-t'
Etymologie : Participe présent de mendier, pris adjectivement. L'ancienne langue avait mendis, dérivé directement du latin mendicus (i long) : XIIe siècle.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de mendiant, ante de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec mendiant, ante pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Mendiant, Ante ?
La définition de Mendiant, Ante
Qui mendie. La population mendiante.
Toutes les définitions de « mendiant, ante »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Celui, celle qui fait profession de mendier. Cette ville est pleine de mendiants. Il y a toujours plusieurs mendiants à la porte de cette église. Faire l'aumône à un mendiant. Une vieille mendiante. Par apposition, Religieux mendiants, moines mendiants, Ceux qui vivent de quête, d'aumône. Les Capucins, les Franciscains sont des moines mendiants. Par extension, Ordres mendiants. Les quatre mendiants se disait autrefois des Quatre ordres religieux : les Jacobins, les Franciscains, les Augustins et les Carmes. Fig., Les quatre mendiants se dit de Quatre sortes de fruits secs, qui sont les figues, les noisettes, les raisins et les amandes, et dont on fait des assiettes de dessert. Une assiette des quatre mendiants, ou, plus souvent, Une assiette de mendiants.
Littré
-
1Qui mendie. La population mendiante.
Religieux mendiants, moines mendiants, ceux qui vivent de quête et d'aumône.
-
2 S. m. et f. Un mendiant, une mendiante, celui, celle qui fait profession de mendier.
On voyait [à Paris] des troupes errantes de mendiants, sans religion et sans discipline, demander avec plus d'obstination que d'humilité, voler souvent ce qu'ils ne pouvaient obtenir?
, Fléchier, Aiguillon.Les gens qui n'ont absolument rien, comme les mendiants, ont beaucoup d'enfants
, Montesquieu, Esp. XXIII, 11.Si le cardinal [de Richelieu] lui [à Mainard] avait fait du bien, ce ministre eût été un dieu pour lui?; il n'est un tyran que parce qu'il ne lui donne rien?; c'est trop ressembler à ces mendiants qui appellent les passants monseigneur, et qui les maudissent s'ils n'en reçoivent pas d'aumône
, Voltaire, Louis XIV, Écrivains, Mainard.On a donné des édits pour extirper l'infâme profession de mendiants, profession si réelle et qui se soutient malgré les lois, au point que l'on compte deux cent mille mendiants vagabonds dans le royaume
, Voltaire, Lett. Roubaud, 1er juill. 1769.Adrien IV, l'un des plus grands papes, fils d'un mendiant, avait été mendiant lui-même
, Voltaire, M?urs, 184.À ne regarder l'état de mendiant que comme un métier, loin qu'on en ait rien à craindre, on n'y trouve que de quoi nourrir en nous les sentiments d'intérêt et d'humanité qui devraient unir tous les hommes
, Rousseau, Hél. V, 2.Mendiant espagnol, mendiant très fier.
À la vue de Prosper râpé, mais glorieux comme un mendiant espagnol
, Ch. de Bernard, Un homme sérieux, § V.Les quatre mendiants, les jacobins, les franciscains, les augustins et les carmes.
Les pauvres de l'Hôtel-Dieu, et les quatre mendiants de cette ville de Paris? sont exempts des 4 sous 2 deniers,
Arrêt de la cour des aides, 14 oct. 1615.On surcharge les villes en multipliant les monastères des mendiants
, Fevret, De l'abus, II, 1, dans RICHELET. - 3Les quatre mendiants se dit de quatre sortes de fruits secs qui sont les figues, les avelines, les raisins secs et les amandes, et dont on fait des assiettes de dessert?; cette dénomination, qui tient certainement aux quatre ordres mendiants, sans qu'on sache exactement pourquoi, est plus ancienne que le P. André, qui en donnait une explication allégorique en prêchant devant Louis XIII.
HISTORIQUE
XIIIe s. Quant tu vois aucun mendiant Qui de vieillesce va tranlant
, Fl. et Bl. 761. Après si sont li mendiant, Qui par la ville vont criant?: Donez, por Dieu, du pain aus freres
, Rutebeuf, 219.
XIVe s. Riche d'amour et mendians d'amie, Povres d'espoir et garnis de desir
, Machaut, p. 59.
XVIe s. Deux mendians à un huis, l'un a le blanc, l'autre le bis
, Leroux de Lincy, Prov. t. II, p. 175. Certains religieux,? non pas de ces gros bedons ventrés depuis le menton jusques au genouil, ny de ceste nouvelle ordure de jesuistes, mais de ces bons et venerables mendiants, car à telles personnes qui ne mangent pas toujours leur saoul, l'esprit est prompt, et souvent se communique
, Régnier de la Planche, Livre des march. éd. du Panthéon, p. 424.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
MENDIANT. Ajoutez?: - REM. L'origine de la dénomination des quatre mendiants, fruits secs, est ainsi donnée?: " Un jour, à la table d'un grand seigneur, les quatre fruits secs, raisins, noisettes, amandes et figues, étaient servis, un convive s'écria?: voilà les mendiants à table, retrouvant dans la figue la robe grise du franciscain, dans l'amande la robe écrue du dominicain, dans la noisette la robe brune du carme, et dans le raisin la robe sombre de l'augustin?; les dominicains, les franciscains, les carmes et les augustins formaient les quatre ordres mendiants, " Journal de Lyon, 13 déc. 1873, 3e page, 1re col. Malheureusement aucun texte n'appuie ce dire.
Encyclopédie, 1re édition
MENDIANT, s. m. (Econom. politiq.) gueux ou vagabond de profession, qui demande l'aumône par oisiveté & par fainéantise, au lieu de gagner sa vie par le travail.
Les législateurs des nations ont toujours eu soin de publier des lois pour prévenir l'indigence, & pour exercer les devoirs de l'humanité envers ceux qui se trouveroient malheureusement affligés par des embrasemens, par des inondations, par la stérilité, ou par les ravages de la guerre ; mais convaincus que l'oisiveté conduit à la misere plus fréquemment & plus inévitablement que toute autre chose, ils l'assujettirent à des peines rigoureuses. Les Egyptiens, dit Hérodote, ne souffroient ni mendians ni fainéans sous aucun prétexte. Amasis avoit établi des juges de police dans chaque canton, par-devant lesquels tous les habitans du pays étoient obligés de comparoître de tems en tems, pour leur rendre compte de leur profession, de l'état de leur famille, & de la maniere dont ils l'entretenoient ; & ceux qui se trouvoient convaincus de fainéantise, étoient condamnés comme des sujets nuisibles à l'état. Afin d'ôter tout prétexte d'oisiveté, les intendans des provinces étoient chargés d'entretenir, chacun dans leur district, des ouvrages publics, où ceux qui n'avoient point d'occupation, étoient obligés de travailler. Vous êtes des gens de loisir, disoient leurs commissaires aux Israélites, en les contraignant de fournir chaque jour un certain nombre de briques ; & les fameuses pyramides sont en partie le fruit des travaux de ces ouvriers qui seroient demeurés sans cela dans l'inaction & dans la misere.
Le même esprit regnoit chez les Grecs. Lycurgue ne souffroit point de sujets inutiles ; il régla les obligations de chaque particulier conformément à ses forces & à son industrie. Il n'y aura point dans notre état de mendiant ni de vagabond, dit Platon ; & si quelqu'un prend ce métier, les gouverneurs des provinces le feront sortir du pays. Les anciens Romains attachés au bien public, établirent pour une premiere fonction de leurs censeurs, de veiller sur les mendians & les vagabonds, & de faire rendre compte aux citoyens de leur tems. Cavebant ne quis otiosus in urbe oberraret. Ceux qu'ils trouvoient en faute, étoient condamnés aux mines ou autres ouvrages publics. Ils se persuaderent que c'étoit mal placer sa libéralité, que de l'exercer envers des mendians capables de gagner leur vie. C'est Plaute lui-même qui débite cette sentence sur le théatre. De mendico malè meretur qui dat ei quod edat aut bibat ; nam & illud quod dat perdit, & producit illi vitam ad miseriam. En effet, il ne faut pas que dans une société policée, des hommes pauvres, sans industrie, sans travail, se trouvent vêtus & nourris ; les autres s'imagineroient bientôt qu'il est heureux de ne rien faire, & resteroient dans l'oisiveté.
Ce n'est donc pas par dureté de c?ur que les anciens punissoient ce vice, c'étoit par un principe d'équité naturelle ; ils portoient la plus grande humanité envers leurs véritables pauvres qui tomboient dans l'indigence ou par la vieillesse, ou par des infirmités, ou par des évenemens malheureux. Chaque famille veilloit avec attention sur ceux de leurs parens ou de leurs alliés qui étoient dans le besoin, & ils ne négligeoient rien pour les empêcher de s'abandonner à la mendicité qui leur paroissoit pire que la mort : malim mori quàm mendicare, dit l'un d'eux. Chez les Athéniens, les pauvres invalides recevoient tous les jours du trésor public deux oboles pour leur entretien. Dans la plûpart des sacrifices il y avoit une portion de la victime qui leur étoit réservée ; & dans ceux qui s'offroient tous les mois à la déesse Hécate par les personnes riches, on y joignoit un certain nombre de pains & de provisions ; mais ces sortes de charités ne regardoient que les pauvres invalides, & nullement ceux qui pouvoient gagner leur vie. Quand Ulysse, dans l'équipage de mendiant, se présente à Eurimaque, ce prince le voyant fort & robuste, lui offre du travail, & de le payer ; sinon, dit-il, je t'abandonne à ta mauvaise fortune. Ce principe étoit si bien gravé dans l'esprit des Romains, que leurs lois portoient qu'il valoit mieux laisser périr de faim les vagabonds, que de les entretenir dans leur fainéantise. Potius expedit, dit la loi, inertes fame perire, quàm in ignaviâ fovere.
Constantin fit un grand tort à l'état, en publiant des édits pour l'entretien de tous les chrétiens qui avoient été condamnés à l'esclavage, aux mines, ou dans les prisons, & en leur faisant bâtir des hôpitaux spatieux, où tout le monde fût reçu. Plusieurs d'entre eux aimerent mieux courir le pays sous différens prétextes, & offrant aux yeux les stigmates de leurs chaînes, ils trouverent le moyen de se faire une profession lucrative de la mendicité, qui auparavant étoit punie par les lois. Enfin les fainéans & les libertins embrasserent cette profession avec tant de licence, que les empereurs des siecles suivans furent contraints d'autoriser par leurs lois les particuliers à arrêter tous les mendians valides, pour se les approprier en qualité d'esclaves ou de serfs perpétuels. Charlemagne interdit aussi la mendicité vagabonde, avec défense de nourrir aucun mendiant valide qui refuseroit de travailler.
Des édits semblables contre les mendians & les vagabonds, ont été cent fois renouvellés en France, & aussi inutilement qu'ils le seront toujours, tant qu'on n'y remédiera pas d'une autre maniere, & tant que des maisons de travail ne seront pas établies dans chaque province, pour arrêter efficacement les progrès du mal. Tel est l'effet de l'habitude d'une grande misere, que l'état de mendiant & de vagabond attache les hommes qui ont eu la lâcheté de l'embrasser ; c'est par cette raison que ce métier, école du vol, se multiplie & se perpétue de pere en fils. Le châtiment devient d'autant plus nécessaire à leur égard, que leur exemple est contagieux. La loi les punit par cela seul qu'ils sont vagabonds & sans aveu ; pourquoi attendre qu'ils soient encore voleurs, & se mettre dans la nécessité de les faire périr par les supplices ? Pourquoi n'en pas faire de bonne heure des travailleurs utiles au public ? Faut-il attendre que les hommes soient criminels, pour connoître de leurs actions ? Combien de forfaits épargnés à la société, si les premiers déréglemens eussent été réprimés par la crainte d'être renfermés pour travailler, comme cela se pratique dans les pays voisins !
Je sai que la peine des galeres est établie dans ce royaume contre les mendians & les vagabonds ; mais cette loi n'est point exécutée, & n'a point les avantages qu'on trouveroit à joindre des maisons de travail à chaque hôpital, comme l'a démontré l'auteur des considérations sur les finances.
Nous n'avons de peines intermédiaires entre les amendes & les supplices, que la prison. Cette derniere est à charge au prince & au public, comme aux coupables ; elle ne peut être que très-courte, si la nature de la faute est civile. Le genre d'hommes qui s'y exposent, la méprisent, elle sort promptement de leur mémoire ; & cette espece d'impunité pour eux éternise l'habitude du vice, ou l'enhardit au crime.
En 1614 l'excessive pauvreté de nos campagnes, & le luxe de la capitale y attirerent une foule de mendians ; on défendit de leur donner l'aumône, & ils furent renfermés dans un hôpital fondé à ce dessein. Il ne manquoit à cette vûe, que de perfectionner l'établissement, en y fondant un travail ; & c'est ce qu'on n'a point fait. Ces hommes que l'on resserre seront-ils moins à charge à la société, lorsqu'ils seront nourris par des terres à la culture desquelles ils ne travaillent point ? La mendicité est plus à charge au public par l'oisiveté & par l'exemple, que par elle-même.
On n'a besoin d'hôpitaux fondés que pour les malades & pour les personnes que l'âge rend incapables de tout travail. Ces hôpitaux sont précisément les moins rentés, le nécessaire y manque quelquefois ; & tandis que des milliers d'hommes sont richement vêtus & nourris dans l'oisiveté, un ouvrier se voit forcé de consommer dans une maladie tout ce qu'il possede, ou de se faire transporter dans un lit commun avec d'autres malades, dont les maux se compliquent au sien. Que l'on calcule le nombre des malades qui entrent dans le cours d'une année dans les hôtels-dieu du royaume, & le nombre des morts, on verra si dans une ville composée du même nombre d'habitans, la peste feroit plus de ravage.
N'y auroit-il pas moyen de verser aux hôpitaux des malades la majeure partie des fonds destinés aux mendians ? & seroit-il impossible, pour la subsistance de ceux-ci, d'affermer leur travail à un entrepreneur dans chaque lieu ? Les bâtimens sont construits, & la dépense d'en convertir une partie en atteliers, seroit assez médiocre. Il ne s'agiroit que d'encourager les premiers établissemens. Dans un hôpital bien gouverné, la nourriture d'un homme ne doit pas coûter plus de cinq sols par jour. Depuis l'âge de dix ans les personnes de tout sexe peuvent les gagner ; & si l'on a l'attention de leur laisser bien exactement le sixieme de leur travail, lorsqu'il excédera les cinq sols, on en verra monter le produit beaucoup plus haut. Quant aux vagabonds de profession, on a des travaux utiles dans les colonies, où l'on peut employer leurs bras à bon marché. (D. J.)
Mendiant, s. m. (Hist. ecclésiast.) mot consacré aux religieux qui vivent d'aumônes, & qui vont quêter de porte en porte. Les quatre ordres mendians qui sont les plus anciens, sont les Carmes, les Jacobins, les Cordeliers & les Augustins. Les religieux mendians plus modernes, sont les Capucins, Récolets, Minimes, & plusieurs autres, dont vous trouverez l'histoire dans le pere Héliot, & quelques détails généraux au mot Ordre religieux. (D. J.)
Wiktionnaire
Nom commun - français
mendiant \m??.dj??\ masculin (pour une femme, on dit : mendiante)
- Personne qui sollicite des dons pour survivre, qui vit de mendicité.
- D'un geste auguste, il jetait le chat aux pieds de mam'zelle Geneviève [?] et aussitôt, se mettait à le dépecer, gardant la viande pour les mendiants, faisant sécher, au bout d'un bâton, la peau qu'elle vendait aux Auvergnats. ? (Octave Mirbeau, Contes cruels : Mon oncle)
- Elle aimait les mendiants, comme les crapauds, les limaces, et les cimetières, avec une certaine horreur. ? (Marcel Schwob, Le Livre de Monelle, Mercure de France, 1895)
- Des mendiants, parmi lesquels on remarque un assez grand nombre de lépreux, reconnaissables à leurs visages voilés et ombragés d'immenses chapeaux en feuilles de palmier nain, bordent la route, et le Sultan leur fait faire l'aumône. ? (Frédéric Weisgerber, Trois mois de campagne au Maroc : étude géographique de la région parcourue, Paris : Ernest Leroux, 1904, page 153)
- ? Tu veux me faire pleurer ?? Et quand je pense à l'argent, à nos « moyens d'existence » !? Il faudra apprendre à mendier. Je nous vois mendiant à Lyon. C'est la dernière ville au monde où je voudrais être mendiant ! ? (Elsa Triolet, Le premier accroc coûte deux cents francs, 1944, réédition Cercle du Bibliophile, page 110)
-
(Religion) Ordre mendiant, personne choisissant de mendier pour des raisons religieuses.
- Les quatre mendiants, se disait autrefois des Jacobins, des Franciscains, des Augustins et des Carmes.
-
(Figuré) Quatre sortes de fruits secs, qui sont les figues, les noisettes, les raisins et les amandes, et dont on fait des assiettes de dessert.
- Les quatre mendiants.
- Une assiette de mendiants.
-
(Pâtisserie) Petit gâteau sec recouvert de chocolat sur lequel se trouvent des petits morceaux de fruits secs.
-
Et elle sort de son cabas une aumônière de papier de soie crème.
J'entreprends d'en dénouer le ruban de velours bleu. À l'intérieur, des mendiants au chocolat noir scintillent comme diamants ténébreux. ? (Muriel Barbery, L'élégance du hérisson, 2006, collection Folio, pages 182-183)
-
Et elle sort de son cabas une aumônière de papier de soie crème.
Adjectif - français
mendiant \m??.dj??\
- Qui mendie.
- Religieux mendiants, moines mendiants.
- Les Capucins, les Franciscains sont des moines mendiants.
- Ordres mendiants.
Trésor de la Langue Française informatisé
MENDIANT, -ANTE, subst. et adj.
Mendiant, Ante au Scrabble
Le mot mendiant, ante vaut 14 points au Scrabble.
Informations sur le mot mendiant--ante - 12 lettres, 5 voyelles, 7 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot mendiant, ante au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
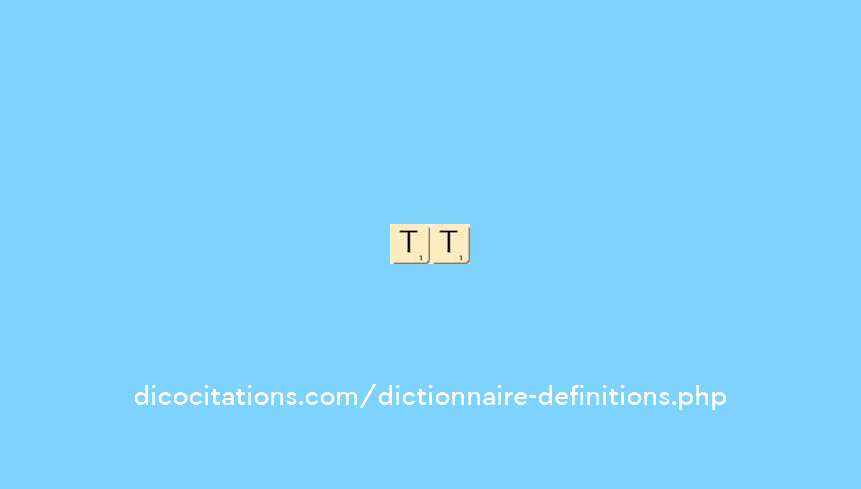
Les mots proches de Mendiant, Ante
Menable Menaçant, ante Menace Menacé, ée Menacer Menaceur Ménade Ménage Ménagé, ée Ménageable Ménagement Ménager Ménager, ère Ménagerie Ménageur, euse Mendiant, ante Mendicité Mendier Mené, ée Menée Mener Menestre Ménestrel Ménétrier Meneur Ménie ou, par altération, mégn Ménilite Ménillette Menin Meninage Méninge Ménisque Menon Menotte Menottes Mense Mensonge Mensonger, ère Mensongèrement Menstrue Menstruel, elle Menstrues Mensualité Mensurable Mensuration Mentagre Mental, ale Mentalement Menterie Menteur, euse mena menaça menaçaient menaçais menaçait menaçant menaçant menaçante menaçantes menaçants menaçât menace menace menacé menacé menacée menacée menacées menacées menacent menacer menacera menaceraient menacerait menaceras menacèrent menaceriez menaceront menaces menaces menacés menacés menacez menaciez menacions menaçons ménade ménades Menades ménage ménage ménagé ménagea ménageaient ménageais ménageait ménageant ménageât ménagée ménagéesMots du jour
Galérien Léthé Minceur Colleter Soubredent Toiser Répercussion Pendeur Ininflammabilité Soubresaut
Les citations avec le mot Mendiant, Ante
Les citations du Littré sur Mendiant, Ante
Les mots débutant par Men Les mots débutant par Me
Une suggestion ou précision pour la définition de Mendiant, Ante ? -
Mise à jour le vendredi 6 février 2026 à 20h35

- Machiavelisme - Magie - Main - Maison - Maitre - Maître - Maitresse - Maîtresse - Maitrise - Mal - Malade - Maladie - Male - Malheur - Malheureux - Malveillance - Maman - Maman Enfant - Maman Fille - Maman Fils - Maman - Management - Manger - Manie - Manque - Marcher - Mari - Mariage - Mariage amour - Mariage heureux - Marseillais - Masturbation - Materialisme - Mathematique - Matiere - Maux - Maxime - Mechancete - Méchanceté - Méchant - Medaille - Medecin - Médecin - Medecine - Medias - Mediocrite - Medisance - Méfiance - Mefiance - Meilleur - Melancolie - Melomane - Memoire - Mémoire - Mensonge - Menteur - Mentir - Mepris - Mere - Mère_enfant - Mère_fils - Mère_fille - Mériter - Metaphysique - Methode - Metier - Métier - Meurtre - Militaire - Miracle - Miroir - Misère - Misere - Misogyne - Mode - Moderation - Moderne - Modestie - Moeurs - Mondanite - Monde - Mondialisation - Monogamie - Montagne - Monture - Moquerie - Moquerie - Morale - Mort - Mot - Mots d'amour - Motivation - Mourir - Mouvement - Moyens - Musique - Mystere - Mysticisme - Mythe - Mythologie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur mendiant, ante
Poèmes mendiant, ante
Proverbes mendiant, ante
La définition du mot Mendiant, Ante est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Mendiant, Ante sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Mendiant, Ante présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
