La définition de Comté du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Comté
Nature : s. m.
Prononciation : kon-té
Etymologie : Provenç. comtat, contat, m. et f. ; espagn. condado ; ital. contado ; du latin comitatus, de comes, comte.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de comté de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec comté pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Comté ?
La définition de Comté
Titre en vertu duquel le possesseur de certaines terres prenait la qualité de comte.
Toutes les définitions de « comté »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Titre de noblesse qui vient au-dessous de celui de Marquis. Couronne de comte. Il prend la qualité de comte. Monsieur le comte de... Il désignait autrefois le Possesseur d'une terre seigneuriale dite Comté. Comte de Toulouse, d'Artois, etc.
Encyclopédie, 1re édition
* COMTE, s. m. (Hist. anc.) les uns font remonter ce titre jusqu'au tems d'Auguste ; d'autres jusqu'au tems d'Adrien. Les premiers prétendent qu'Auguste prit plusieurs sénateurs pour l'accompagner dans ses voyages, & lui servir de conseil dans la décision des affaires ; ils ajoûtent que Galien supprima ces comites ou comtes, défendit aux sénateurs d'aller à l'armée, & que ses successeurs ne reprirent point de comites ou comtes. Les seconds disent que les comtes furent des officiers du palais, qui ne s'éloignoient jamais de la personne de l'empereur, & qu'on en distinguoit du premier, du second, & du troisieme ordre, selon le degré de considération & de faveur qu'ils avoient auprès du prince.
Il y a apparence qu'en dérivant le nom de comte du comes des Latins, comme il est vraissemblable qu'il en vient, ce titre est beaucoup plus ancien qu'on ne le fait. Au tems de la république on appelloit comites, les tribuns, les préfets, les écrivains, &c. qui accompagnoient les proconsuls, les propréteurs, &c. dans les provinces qui leur étoient départies, & ils étoient leurs vice-gérens & leurs députés dans les occasions où ces premiers magistrats en avoient besoin.
Sous quelques empereurs, le nom de comte fut plûtôt une marque de domesticité, qu'un titre de dignité. Ce ne fut que sous Constantin qu'on commença à désigner par le nom de comte une personne constituée en dignité : Eusebe dit que ce prince en fit trois classes, dont la premiere fut des illustres, la seconde des clarissimes ou considérés, & la troisieme des très parfaits : ces derniers avoient des priviléges particuliers ; mais il n'y avoit que les premiers & les seconds qui composassent le sénat.
Mais à peine le nom de comte fut-il un titre, qu'il fut ambitionné par une infinité de particuliers, & qu'il devint très-commun, & par conséquent peu honorable. Il y eut des comtes pour le service de terre, pour le service de mer, pour les affaires civiles, pour celles de la religion, pour la jurisprudence, &c. Nous allons exposer en peu de mots les titres & les fonctions des principaux officiers qui ont porté le nom de comte, selon l'acception antérieure à celle qu'il a aujourd'hui dans l'Europe.
On nomma, comes Egypti, un ministre chargé de la caisse des impôts sur la soie, les perles, les aromates, & autres marchandises précieuses : son pouvoir étoit grand ; il ne rendoit compte qu'à l'empereur ; le gouvernement d'Egypte étoit attaché à sa dignité ; on le désignoit aussi quelquefois par comes rationalis summarum. Comes ararii, ou comes largitionum, une espece d'intendant des finances, le garde de leurs revenus, & le distributeur de leurs largesses. Comes Africa, ou dux limitaneus, un gouverneur en Afrique des forteresses & places frontieres ; il commandoit à seize sous-gouverneurs. Comes Alanus, le chef d'une compagnie de soldats Alains ; il étoit subordonné au magister militum. Comes annona, un officier chargé par l'empereur de l'approvisionnement & de la subsistance générale de Constantinople. Comes archiatrorum sacri palatii, un chef des archiatres du sacré palais, ou le premier medecin de l'empereur, il fut du premier, du second, ou du troisieme ordre, selon le plus ou le moins de crédit qu'il eut auprès du prince. Comes Argentoratensis, un commandant de la garnison de Strasbourg. Comes auri, un garde de la vaisselle d'or & d'argent de l'empereur, ou un officier chargé de mettre en or l'argent des coffres de l'empereur ; on l'appelloit aussi, le directeur scrinii aureæ massæ, ou un inspecteur général des mines. Comes Britanniæ, celui qui commandoit sur les côtes de cette province pour les Romains ; il s'appelloit aussi comes maritimi tractus, comes littoris, comes littoris Saxonici per Britanniam. Comes buccinatorum, un chef des trompettes, un inspecteur & juge de cette troupe. Comes castrensis, un chef des officiers de cuisine ou un pourvoyeur général du camp ; ou dans des tems plus reculés, un seigneur d'un château fortifié. Comes cataphractarius, un chef de cuirassiers. Comes civitatis, le premier magistrat d'une ville. Comes clibanarius, le même que cataphractarius. Comes commerciorum, un inspecteur général du commerce ; il avoit sous lui les intendans du commerce de l'Orient, de l'Egypte, de la Mésie, de la Scythie, du Pont, & de l'Illyrie ; ils veilloient tous aux importations, exportations, &c. & ils étoient soûtenus dans leurs fonctions par une milice particuliere. Comes sacri consistorii, un officier de confiance de l'empereur, il assistoit à la réception des ambassadeurs, il avoit place au conseil, lors même qu'on y délibéroit des affaires les plus secrettes : ce comte fut du premier ordre. Comes contariorum, un chef des piquiers. Comes dispositionum, un ministre de la guerre ; il avoit sa caisse, dont il étoit appellé princeps sui scrinii, in capite constitutus, prior in scrinio. Comes domesticorum, un chef des gardes de l'empereur ; sa fonction en paix & en guerre étoit de veiller à la personne de l'empereur, sans s'en éloigner : il abusa quelquefois de sa place. Il y avoit des gardes domestiques à pié & à cheval ; on appelloit ceux-ci protectores, & on les comprenoit tous sous le nom de prætoriani. Comes domorum, un inspecteur des bâtimens royaux ; il portoit en Cappadoce le nom de comes domûs divina. Comes equorum regiorum, un grand écuyer de l'empereur. Comes excubitorum, un chef des gardes de nuit. Comes exercitus, comes rei militaris, un général d'armée. Comes fæderatorum, un chef des soldats étrangers & des soûdoyes. Comes formarum, un inspecteur des aqueducs ; on l'appelloit aussi ædilis, ou curator formarum. Forma signifioit une charpente destinée à soûtenir un canal de brique ou de pierre. Cet inspecteur étoit subordonné au præfectus urbis. Comes gildoniaci, un inspecteur des domaines que Gildo possédoit en Espagne, & qu'il perdit avec la vie ; il étoit subordonné au comes ærerum privatarum. Comes horreorum, un inspecteur des greniers. Comes Italiæ, le gouverneur des frontieres de l'Italie. Comes Italicianus ou Gallicanus, le thrésorier de la chambre des domaines des Gaules & de l'Italie ; on l'appella quelquefois comes largitionum, quand son district fut borné à un diocese. Comes largitionum comitatensium, un thrésorier de l'empereur, & un distributeur de ses bienfaits privés ; il suivoit en voyages ; ses commis s'appelloient largitionales comitatenses, de largitionibus, de privatis, de sacris, de comitatensibus, &c. synonymes entr'eux, comme largitio, araæium, fiscus, &c. Comes largitionum privatarum, un contrôleur des revenus personnels & propres de l'empereur, & dont il ne devoit aucun compte à l'état ; ses subalternes s'appelloient rationales rei privatæ ; leur chef portoit le nom de præfectus ou procurator rei privatæ ; il veilloit aux bona caduca, vaga municipia, &c. Comes largitionum sacrarum, un contrôleur des finances destinées aux charges de l'état, comme les honoraires des magistrats, la paye des militaires, &c. on l'appelloit quelquefois comes sacrarum, comes largitionum, comes sacrarum remunerationum. Il régloit les affaires du fisc ; il en faisoit exécuter les débiteurs ; il fournissoit à l'entretien des édifices publics ; il avoit un district très-étendu ; il jugeoit à mort ; il connoissoit des thrésors trouvés, des impôts, des péages, du change, des réparations, des confiscations, &c. Comes legum, un professeur en droit. Comes limitis ou limitaneus, un gouverneur des forteresses limitrophes. Comes marcarum, le même que limitaneus. Comes maritima, un gouverneur de côtes ; ses subalternes s'appelloient vice-comites maritimæ. Comes matronæ, un officier chargé d'accompagner une femme ou une fille : c'étoit une imprudence que de n'en avoir point. Comes metallorum per Illyricum, un inspecteur des mines de ce pays ; il étoit soûmis au comes largitionum sacrarum. Comes notariorum, un chef des gens de robe, autrefois un chancelier. Comes numeri cohortis, un chef d'une troupe de six compagnies de soldats qu'on appelloit numerus. Comes obsequii, un maréchal des logis de l'empereur en voyage. Comes officiorum, le chef de tous les officiers servans au palais de l'empereur. Comes Orientis, un vice-gérent du præfectus prætorii Orientis ; il s'appelloit aussi præfes Orientis. Comes pagi, un baillif d'un village. Comes portuum, un inspecteur des ports, surtout de Rome & de Ravennes. Comes palatinus, ou comes à latere, un juge de toutes les affaires qui concernoient l'empereur, ses officiers, son palais, sa maison : c'est de-là que descendent les princes palatins d'aujourd'hui, & les comtes palatins. Il y avoit quatre princes palatins, un en Baviere, un en Suabe, un en Franconie, & un en Saxe : il n'en reste que deux, qui ont conservé le vicariat de l'empire. Voyez ci-après Comtes Palatins & à Palatins l'article Princes Palatins. Comes patrimonii sacri, contrôleur des revenus propres de l'empire ; il étoit subordonné au comes privatarum domûs divinæ. Comes præsens, un chef des gardes de service. Comes provinciæ, ou rector provinciæ, un gouverneur de province ; il étoit comte du premier ordre ; il commandoit les troupes en guerre ; il jugeoit à mort pendant la paix : les Landgraves de l'Allemagne y font remonter leur origine. Comes rei militaris seu exercitus ou militum, un général chargé de la conservation d'une province menacée de guerre. Comes rei privatæ, ou rerum privatarum, ou largitionum, voyez plus haut. Comes remunerationum sacrarum, voyez plus haut. Comes riparum & alvei, ou plus anciennement curator alvei, un inspecteur du Tibre ; il étoit subordonné au préfet de la ville. Comes sagittarius, un chef d'archers : ces archers faisoient partie de la garde à cheval de l'empereur. Comes scholæ, un chef de classe : les officiers du palais étoient distribués en classes ; il y avoit celles des cutariorum, des vexillariorum, des silentiariorum, des exceptorum, des chartulariorum, &c. Ceux qui composoient ces classes se nommoient scholares ; & leurs chefs, comites scholarum. Ils étoient subordonnés au magister officiorum. Comes vacans, un officier vétéran. Comes vestiarii, un garde du linge de l'empereur ; il s'appelloit aussi lineæ vestis magister : il étoit sous le comes largitionum privatarum.
Tous ces comtes jettent beaucoup d'obscurité & d'embarras dans les auteurs du droit Romain, qui en ont fait mention. On honora de ce titre, outre les officiers dont nous venons de parler, ceux qui avoient bien mérité de l'état ; comme des professeurs en droit qui avoient vingt ans d'exercice. Dans le bas empire, le premier comte s'appella protocomes.
* Comte, (Hist. mod.) la qualité de comte differe beaucoup aujourd'hui de ce qu'elle étoit anciennement : elle n'est ni aussi importante qu'au tems des premiers comtes de la nation, ni aussi commune qu'au tems des derniers comtes de l'empire.
Le comte que les Latins appelloient comes à commeando, ou à comitando, que les Allemands appellent graaf, que les anciens Saxons ont appellé eolderman, que les Danois nomment earlus, & les Anglois earl, est parmi nous un homme noble qui possede une terre érigée en comté, & qui a droit de porter dans ses armes une couronne perlée, ou un bandeau circulaire orné de trois pierres précieuses, & surmonté ou de trois grosses perles, ou d'un rang de perles qui se doublent ou se triplent vers le milieu & le bord supérieur du bandeau, & sont plus élevées que les autres.
Ce titre d'honneur ou degré de noblesse, est immédiatement au-dessus de celui de vicomte, & au-dessous de celui de marquis.
Les empereurs firent des premiers comtes de leurs palais, des généraux d'armées, & des gouverneurs de provinces. Ceux qui avoient été vraiment comtes de l'empereur avant que de passer à d'autres dignités, retinrent ce titre : d'où il arriva que ceux qui leur succéderent dans ces dignités, se firent appeller comtes, quoiqu'ils ne l'eussent point été réellement. Les anciens comtes du palais, sous les empereurs, s'appelloient d'abord comites & magistri ; ils supprimerent dans la suite le magistri. Dans ces tems les ducs n'étoient distingués des comtes que par la nature de leurs fonctions. Les comtes étoient pour les affaires de la paix ; les ducs pour celles de la guerre. La grande distinction qui existe maintenant entre ces dignités, n'est pas fort ancienne.
Les François, les Allemands, &c. en se répandant dans les Gaules, n'abolirent point la forme du gouvernement Romain, & conserverent les titres de comtes & de ducs que portoient les gouverneurs de provinces & de villes. Sous Charlemagne, les comtes étoient gouverneurs & juges des villes & des provinces. Les comtes qui jugeoient & gouvernoient des provinces, supérieurs des comtes qui ne jugeoient & ne gouvernoient que des villes, étoient les égaux des ducs qui ne jugeoient & gouvernoient des provinces que comme eux, & qui étoient pareillement amovibles.
Ce fut sous les derniers de nos rois de la seconde race, que ces seigneurs rendirent leurs dignités héréditaires ; ils en usurperent même la souveraineté, lorsque Hugues Capet, qui en avoit fait autant lui-même pour le duché de France & le comté de Paris, parvint à la couronne. Son autorité ne fut pas d'abord assez affermie pour s'opposer à ces usurpations ; & c'est de-là qu'est venu le privilége qu'ils ont encore de porter une couronne dans leurs armes. Peu-à-peu les comtés sont revenus à la couronne, & le titre de comte n'a plus été qu'un titre accordé par le Roi, en érigeant en comté une terre où il se réserve jurisdiction & souveraineté.
D'abord la clause de réversion du comté à la couronne au défaut d'enfans mâles, ne fut point mise dans les lettres patentes d'érection ; mais pour obvier à la fréquence de ces titres, Charles IX. l'ordonna en 1564. Cette réversion ne regarde que le titre, & non le domaine, qui passe toûjours à ceux à qui il doit aller selon les lois, mais sans attribution de la dignité.
Il y a eu entre les marquis & les comtes des contestations pour la préséance. On alléguoit en faveur des comtes qu'il y avoit des comtes pairs, & non des marquis ; cependant la chose a été décidée pour les marquis ; ils précedent les comtes, quoique leur titre soit très-moderne en France ; il ne remonte pas aude-là de Louis XII. qui créa marquis de Trans un seigneur de l'illustre & ancienne maison de Villeneuve. Le titre de marquis est originaire d'Italie.
Comme on donnoit anciennement le nom de comte aux gouverneurs de villes & de provinces, dont une des fonctions étoit de conduire la noblesse à l'armée, & que quelques capitaines prirent le même titre, sans y être autorisés par un gouvernement de ville ou de province, on fit dans la suite du nom de comte celui de comite, qui est resté à ceux qui commandent les forçats sur nos galeres ; on fit aussi celui de vicomte, qui de même que les anciens comtes étoient juges dans leurs villes ou provinces, sont restés juges dans quelques-unes de la Normandie, & ailleurs ; à Paris même, le prevôt de la ville délégué par le comte, est encore juge dans le vicomté de Paris.
Nos ambassadeurs & plénipotentiaires sont dans l'usage de prendre le titre de comte, quoiqu'ils n'ayent point de comtés ; ils croyent ce relief nécessaire pour avoir dans les cours de leur négociation, un degré de considération proportionné à l'importance de leurs fonctions.
En Angleterre, on appelle comtes les fils des ducs, & vicomtes les fils des comtes. Le titre de comte s'éteignoit originairement avec celui qui le portoit ; Guillaume le Conquérant le rendit héréditaire, en récompensa quelques grands de sa cour, l'annexa à plusieurs provinces, & accorda au comte pour soûtenir son rang, la troisieme partie des deniers des plaidoyeries, amendes, confiscations, & autres revenus propres du prince, dans toute l'étendue de son comté. Cette somme se payoit par l'échevin de la province. Aujourd'hui les comtes sont créés par chartre ; ils n'ont ni autorité, ni revenus dans les comtés dont ils portent les noms : le titre de comte ne leur vaut qu'une pension honoraire sur l'échiquier. Le nombre des comtes étant devenu plus grand que celui des comtés proprement dits ; il y en a dont le comté est désigné par le nom d'une portion distinguée d'une province ou d'un autre comté, par celui d'une ville, d'un village, d'un bourg, d'un château, d'un parc. Il y a même deux comtes sans nom de terre ; le comte de Rivers, & le comte Poulet. Il y a une charge qui donne le titre de comte-maréchal. Voyez ci-après Comte-maréchal.
La cérémonie de création de comte se fait en Angleterre par le roi, en ceignant l'épée, mettant le manteau sur l'épaule, le bonnet & la couronne sur la tête, & la lettre patente à la main, à celui qui est créé, que le roi nomme consanguineus noster, mon cousin, & à qui il donne le titre de très-haut & très noble seigneur. Les perles de la couronne du comte Anglois sont placées sur des pointes & extrémités de feuillages. On y fait moins de façon en France. Lorsque la terre est érigée en comté par lettres patentes, le titulaire & sa postérité légitime prennent le titre de comte sans autre cérémonie, que les enregistremens requis des lettres d'érection.
* Comte-maréchal, (Hist. mod.) c'est en Angleterre un officier de la couronne. Il avoit anciennement plusieurs tribunaux, tels que la cour de chevalerie, presque ensevelie dans l'oubli, & la cour d'honneur qu'on a rétablie depuis peu. Il juge, à la cour de la maréchaussée, les criminels pris dans les lieux privilégiés. L'officier, immédiatement sous le comte-maréchal, s'appelle chevalier-maréchal. Le collége des hérauts-d'armes est sous la jurisdiction du comte. Cette dignité est héréditaire dans la famille de Howard. La branche principale en est maintenant revêtue ; mais des raisons d'état n'en permettent l'exercice que par députés.
* Comtes de Lyon, de Brioude, de saint Pierre de Macon, &c. ce sont des chanoines décorés de ce titre ; parce qu'anciennement ils étoient seigneurs temporels des villes où leurs chapitres sont situés. Nos rois ont retiré la plûpart de ces seigneuries, & n'ont laissé que le nom de comtes aux chapitres. Il n'y a plus que quelques prélats, comme les comtes & pairs, à qui il reste, avec le titre des droits seigneuriaux, mais subordonnés à ceux de la souveraineté.
Comtes Palatins, (Jurisp. & Hist.) Il y a dans l'empire un titre de palatin qui n'a rien de commun avec celui de princes palatins du Rhin ; c'est une dignité dont l'empereur décore quelquefois des gens de lettres : on les appelle comtes palatins ; & selon le pouvoir que leur donnent les lettres patentes de l'empereur, ils peuvent donner le degré de docteur, créer des notaires, legitimer des bâtards, donner des couronnes de laurier aux poëtes, annoblir des roturiers, donner des armoiries, autoriser des adoptions & des émancipations, accorder des lettres de bénéfice d'âge, &c. mais cette dignité de comte est venale & s'accorde facilement ; on fait aussi peu de cas de ce qui est émané de ces comtes. Les papes font aussi de ces comtes palatins. Jean Navar, chevalier & comte palatin, fut condamné par arrêt du parlement de Toulouse, prononcé le 25 Mai 1462, à faire amende honorable & demander pardon au Roi pour les abus par lui commis, en octroyant en France des lettres de légitimation, de notariat, & autres choses dont il avoit puissance du pape ; ce qui étant contraire à l'autorité du Roi, le tout fut déclaré nul & abusif. Voyez le tableau de l'empire Germanique, pag. 107. & les arréts de Papon, pag. 248. (A)
Wiktionnaire
Nom commun - français
comte \k??t\ masculin (pour une femme, on dit : comtesse)
-
(Antiquité) Dignitaire des derniers temps de l'empire romain et du bas-empire.
- Comte du sacré palais.
- (Spécialement) Commandant militaire.
-
Fonctionnaire gouvernant une division du territoire sous l'autorité du roi ; en échange de ce service, les comtes reçoivent le droit de percevoir les revenus de propriétés publiques ou des droits régaliens, le bénéfice.
- Un comte francien. ? Charlemagne convoquait aux assemblées les évêques et les comtes.
- Les rois [?] s'endormaient sur le trône, et, me servant sans honte, laissaient le sceptre aux mains ou d'un maire ou d'un comte. ? (Nicolas Boileau-Despréaux, Lutr. II. ? cité par Littré)
-
Souverain d'une seigneurie du premier degré, dans le régime féodal.
- Des comtes et des palatins embrassent la vie cénobitique. Or, cette vie exige une austérité décourageante. ? (Abbé Paul Buysse, Vers la Foi catholique : L'Église de Jésus, 1926, page 148)
- Le relâchement du lien vassalitique est une des causes de la défaite finale du Midi et de son suzerain, le comte de Toulouse. ? (Paul Gachon, Histoire du Languedoc, Boivin & Cie, 1941, p.89)
- Comme tous les édifices de cette époque, le château des comtes de Montgommery ne présentait aucune régularité. ? (Alexandre Dumas, Les Deux Diane, 1847, chap.1)
-
(Noblesse) Titre de noblesse, qui désigne le dignitaire d'un rang au-dessus des vicomtes et un au-dessous de celui de marquis.
- Son mari est de l'extrême droite. Être comte de Blancmauger et n'être pas de l'extrême droite, cela n'aurait ni queue ni tête, et les Blancmanger se piquent d'avoir tête et queue, bec et ongles, de père en fils, depuis le déluge... et même avant. ? (Quatrelles, « In extremis », dans La Vie parisienne du 7 juin 1873, p. 358)
- Des impôts considérables accablaient les vilains, écrasait les pauvres gens, épargnant les princes et les ducs, les comtes et les marquis. ? (Alfred Barbou, Les Trois Républiques françaises, A. Duquesne, 1879)
- La société enrichie la veille par des spéculations, honnêtes ou non, joignait à ses richesses des titres nobiliaires ; chacun s'improvisait comte, marquis ou baron. ? (Général Ambert, Récits militaires : L'invasion (1870), page 240, Bloud & Barral, 1883)
- (Héraldique) Couronne de comte.
Nom commun - français
comtesse \k??.t?s\ féminin
-
(Noblesse) Épouse ou veuve d'un comte.
- Quoique la comtesse aspirât à régner sur Paris et qu'elle essayât de marcher de pair avec mesdames les duchesses de Maufrigneuse, de Chaulieu, les marquises d'Espard et d'Aiglemont, les comtesses Féraud, de Montcornet, de Restaud, madame de Camps et mademoiselle Des Touches, elle ne céda point à l'amour du jeune vicomte de Portenduère qui fit d'elle son idole. ? (Honoré de Balzac, Le Bal de Sceaux, 1830)
-
Je connais des époux assortis :
Quand « Monsieur » court le guilledou
« Madame » court la prétantaine
Et Madame gagne toujours d'une longueur.
Voilà, comtesse, des steeples-chases autrement divertissants, avouez-le, que ceux de la Marche ou de Vincennes. ? (Émile Villars, Les oeufs de Pâques de M. le Baron, dans Le roman de la Parisienne, Paris : librairie centrale, 1866, page 48)
-
(Noblesse) Femme possédant un comté.
- En 1214, il fit hommage du sénéchalat de Champagne à la comtesse Blanche et à son fils Thibaut, mineur, qu'il jura de défendre, comme étant son homme lige, contre les fils du comte Henri et contre toute créature morte ou vivante. ? (Paulin Paris, « Essai sur la généalogie des sires de Joinville », chap. 10 de la Notice sur les manuscrits du sire de Joinville, dans Histoire de Saint Louis, par Jehan Sire de Joinville, Paris : chez Firmin Didot frères, fils & Cie, 1859, p. cxxxiii)
- L'abbaye, dit-on, doit son origine à une comtesse Cuniga, une sorte de Barbe-Bleue en jupons, qui avait empoisonné ses sept maris et terrifiait toute la contrée par ses crimes. ? (Maurice Grandjean, À travers les Alpes autrichiennes, page 147, A. Mame, 1893)
- [?], la comtesse fit incarcérer le meurtrier et, après jugement, celui-ci fut pendu. L'exécution eut lieu le jour de Pourim. ? (Léon Berman, Histoire des Juifs de France des origines à nos jours, 1937)
Trésor de la Langue Française informatisé
COMTE, COMTESSE, subst.
Comté au Scrabble
Le mot comté vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot comte - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot comté au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
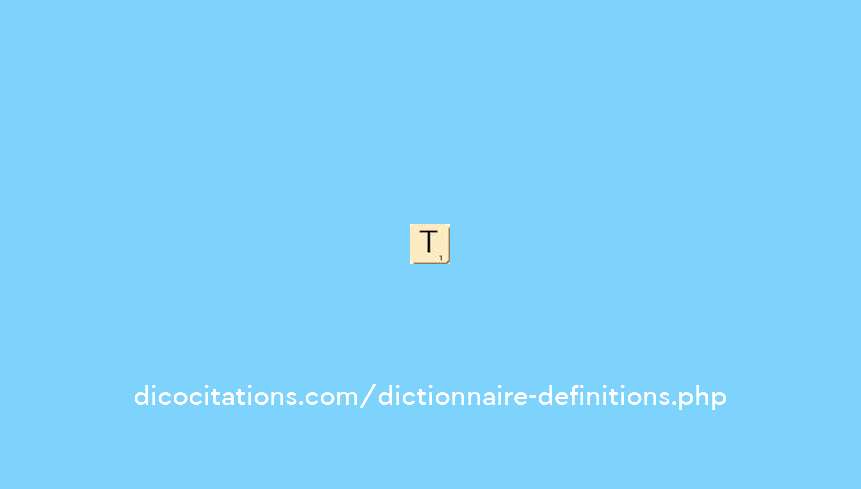
Les mots proches de Comté
Combat Combattable Combattant Combattre Combe Combien Combinable Combinaison Combinateur Combination Combiner Comble Comble Comble Comblé, ée Combler Comblète Combourgeois, eoise Combourgeoisie Comburant, ante Combustible Combustion Comédie Comédien, ienne Comessation Comestible Cométaire Comète Comices Comique Comiquement Comite Comitial, ale Comma Command Commandant, ante Commande Commandement Commander Commanderie Commandeur Commanditaire Commandite Comme Commémoration Commençant, ante Commencé, ée Commencement Commencer Commenceur com coma comac comacs comanche comandant comas comateuse comateuse comateux Combaillaux Combas combat combat combatif combatifs combative combativité combats combats combattaient combattais combattait combattant combattant combattant combattante combattante combattantes combattantes combattants combattants combatte combattent combattes combattez combattiez combattions combattirent combattît combattit combattons combattra combattrai combattraient combattrais combattrait combattras combattre combattrezMots du jour
Déchargement Syriaque Herminé, ée Ganté, ée Vinée Soleil Profusion Suffisance Ânerie Motionnaire
Les citations avec le mot Comté
- L'accueil si contradictoire et si disparate fait au comte de Neuilly et au duc de Surrey.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Sans référence
- Comte, sois de mon prince à présent gouverneur:
Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur;
Et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne,
Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne.Auteur : Pierre Corneille - Source : Le Cid (1636), I, 4, Don Diègue - Il faut, pour gouverner les Français, une main de fer recouverte d'un gant de velours. - Cette appréciation, devenue proverbiale, fut émise pour la première fois, selon Beugnot, par Bernadotte, dans une conférence avec le comte d'Artois.Auteur : Etienne Lorédan Larchey - Source : L'Esprit de tout le monde - Riposteurs (1893)
- Regarde cette femme ! n'est-ce pas abominable de penser que ce bijou, que cette perle née pour être belle, admirée, fêtée et adorée, a passé onze ans de sa vie à donner des héritiers au comte de Mascaret ?Auteur : Guy de Maupassant - Source : Mouche (1890)
- Il y a vingt ans, l'Egypte était une terre française. M. de Lesseps était prophète, et quand on avait dit: «Monsieur le Comte», on avait tout dit.Auteur : Louis Hubert Gonzalve Lyautey - Source : Lettres du Tonkin et de Madagascar: 1894-1899 (1920), 20 octobre 1894
- Viens, suis-moi, va combattre et montrer à ton roi - Que ce qu'il perd au comte, il le retrouve en toi.Auteur : Pierre Corneille - Source : Le Cid (1636), III, 6
- Il s'irritait peu à peu contre la comtesse, n'admettait point qu'elle osât le soupçonner d'une pareille vilenie.Auteur : Guy de Maupassant - Source : Fort comme la mort (1889)
- Involontairement je comparais entre elles ces deux existences, celle du comte, tout action, tout agitation, tout émotion; celle de la comtese, tout passivité, tout inactivité, tout immobilité.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Honorine (1844)
- Mon héritier, vous le connaissez, je n’ai pas le choix, c’est celui que la Providence m’impose, puisqu’elle a décrété que la branche aînée des Bourbons devait s’éteindre avec moi… Les princes d’Orléans sont mes fils! Sachez que, moi mort, M. le comte de Paris eût-il méconnu l’héritage, est quand même l’héritier. La légitimité l’enserrera et il sera aussi légitime que moi. Auteur : Comte de Chambord - Source : Interview La Liberté de Paris le 1 mars 1872
- Ce petit maraud, en arrivant à Paris, est entré en qualité de décrotteur bel esprit chez un comte de Lautrec, qui avait des procès.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre à Voltaire, 26 décembre 1772
- Ci-gît - Antoine, Comte de Rivarol, - La paresse nous l'avait ravi - Avant la mort.Auteur : Antoine Rivaroli, dit Rivarol - Source : Maximes et Pensées
- Le comte, qui, après nous avoir servi avec empressement le potage, s'en donna une très ample assiettée et l'expédia merveilleusement vite.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Le Message
- La Comtesse: Vous leur dites que vous les aimez d'amour, à vos maîtresses? - Le Comte: Il faut bien. Les femmes sont tellement formalistes.Auteur : Jean Anouilh - Source : La répétition
- Si la nature humaine était telle que la conçoit M. Comte, toues les belles âmes convoleraient au suicide.Auteur : Ernest Renan - Source : L'Avenir de la science, Pensées de 1848 (1890)
- Selon le philosophe André Comte Sponville : Le sage n'a plus rien à attendre ni à espérer. Parce qu'il est pleinement heureux rien ne lui manque. Et parce que rien ne lui manque, il est pleinement heureux.Auteur : Matthieu Ricard - Source : Plaidoyer pour le bonheur (2004)
- Entre les fenêtres, le bureau de la comtesse, meuble coquet du siècle dernier, sur lequel elle écrivait les réponses aux questions pressées apportées pendant les réceptions.Auteur : Guy de Maupassant - Source : Fort comme la mort (1889)
- Pendant que le comte-duc peut tout encore, et que tu possèdes ses bonnes grâces, profite du temps, hâte-toi de t'enrichir; car ce ministre, à ce qu'on m'a dit, branle dans le manche.Auteur : Alain René Lesage - Source : Histoire de Gil Blas de Santillane (1724)
- La vicomtesse de Trédern a chanté Eve de son mieux. Ce mieux est l'ennemi du bien.Auteur : Sidonie Gabrielle Colette - Source : Au concert (1903)
- Le comte est riche. Il peut vivre grandement partout. Pourquoi ne pas filer avec cette belle diablesse (en fait de diablesse, je croyais à celle-là) qui, pour le mieux crocheter, a préféré vivre dans la maison de son amant ...Auteur : Jules Amédée Barbey d'Aurevilly - Source : Les Diaboliques (1874), Le bonheur dans le crime
- Vous avez froidement, sous vos baisers infâmes,
Terni, flétri, souillé, déshonoré, brisé
Diane de Poitiers, comtesse de Brézé!Auteur : Victor Hugo - Source : Le Roi s'amuse (1832), I, 5 - (La Comtesse à son amant) - ... vous avez réussi cette chose extraordinaire de rendre le péché plus ennuyeux que la vertu.Auteur : Jean Anouilh - Source : La répétition
- Le comte d'Argenson - Ce lieutenant de police admonestait le pamphlétaire Desfontaines qui s'excusait d'écrits condamnables: - - Mais, Monseigneur, il faut bien que je vive. - - Je n'en vois pas la nécessité.Auteur : Etienne Lorédan Larchey - Source : L'Esprit de tout le monde - Joueurs de mots (1891)
- Le Comte: - Qui t'a donné une philosophie aussi gaie? - Figaro: - L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.Auteur : Pierre Augustin Caron de Beaumarchais - Source : Le Barbier de Séville (1775), I, 2
- Dans le moment qu'il développait cela, il arrive que Mme de Bricoule prit conscience que son nez luisait. Cette luisance qui venait facilement à son nez était un des soucis de la comtesse. D'abord elle l'éteignait en passant sur lui une feuille de papier à cigarettes, ensuite elle le poudrait. Elle n'osa pas, devant l'abbé, user du papier à cigarettes, mais elle se poudra le nez sans vergogne, avec sa poudre Rêve de Mignon. Ce faisant, elle aperçut dans la petite glace du poudrier les deux rides qui descendaient de son nez, et, du pouce et du médius, elle les tira ; ce fut plus fort qu'elle. Ensuite elle épousseta, avec humeur, la poudre qui, comme d'habitude, était tombée sur son jabot. M. de Pradts vit les trois gestes, et méprisa.Auteur : Henry de Montherlant - Source : Les Garçons (1969)
- Mais comme je tendais l'oreille j'entendis du bas de la vallée le hurlement d'une meute de loups. Les yeux du Comte s'allumèrent comme des braises et il dit : Ecoutez-les donc, ces enfants de la nuit. N'est-ce pas la plus belle des musiques... ?Auteur : Abraham Stoker, dit Bram Stoker - Source : Dracula (1897)
Les citations du Littré sur Comté
- George.... Qu'un million comptant, par ses fourbes acquis, De clerc, jadis laquais, a fait comte et marquisAuteur : BOILEAU - Source : Sat. I
- Et eut là certains articles de traités faits, jetés et accordés entre le roi d'Angleterre et le jeune comteAuteur : Jean Froissard - Source : I, I, 311
- L'Espagnol, tournant la teste à ses gens, dit (l'oyant le comte) : voici un grand heretique ; mais cela fut enduit à la sauce d'un riz et embrassadeAuteur : D'AUB. - Source : Hist. I, 256
- Là estoit le comte [de Flandre] qui les prioit et admonestoit de bien faire et de prendre la vengeance de ces enragés de GandAuteur : Jean Froissard - Source : II, II, 94
- Le comte n'eut que des promesses captieuses, comme de n'estre mis en autres mains que celles du roiAuteur : D'AUB. - Source : Hist. II, 126
- Comme les comtes menaient les hommes libres à la guerre, les leudes y menaient aussi leurs vassaux ou arrière-vassaux ; et les évêques, abbés, ou leurs avoués y menaient les leursAuteur : Montesquieu - Source : ib. XXX, 17
- L'accusation et l'emprisonnement sont de 1309, mais on a retrouvé des lettres de Philippe le Bel au comte de Flandre, datées de Melun 1306, par lesquelles il le priait de se joindre à lui pour extirper les templiersAuteur : Voltaire - Source : ib.
- Quant aux munitions de guerre, La Rochelle en aida, mais chichement ; en partie pour ce qu'il couroit un bruit que le comte de Montgommeri en avoit jouéAuteur : D'AUB. - Source : ib. II, 295
- Pourra la comtesse de Roucy haier et faire haies pour la chasse desdits boisAuteur : PEIGNÉ DE LA COURT - Source : Chasse à la haie, p. 15
- Je suis la pauvre comtesse Almaviva, la triste femme délaissée que vous n'aimez plusAuteur : BEAUMARCHAIS - Source : Mar. de Fig. II, 19
- Le comte de Mansfeld avait partagé ses reistres en autant de relez qu'il y avoit de trouppesAuteur : D'AUB. - Source : Hist. I, 323
- Le roy Henri ayant commandé le comte de Mont-Gommeri de rompre un bois contre luyAuteur : D'AUB. - Source : Hist. I, 85
- Je lui ai ouï dire [au comte de Belle-Isle], que, pendant trente-quatre ans, il n'avait dormi que quatre heures par nuitAuteur : DUCLOS - Source : Oeuv. t. VI, p. 152
- Le pape [Grégoire VII] était alors dans la forteresse de Canosse sur l'Apennin avec la comtesse Mathilde, propre cousine de l'empereurAuteur : Voltaire - Source : Ann. Emp. Henri IV, 1077
- Le valeureux comte de Fontaines, qu'on voyait [à Rocroy] porté dans sa chaise, et, malgré ses infirmités, montrer qu'une âme guerrière est maîtresse du corps qu'elle animeAuteur : BOSSUET - Source : Louis de Bourbon
- En son païs porte li cuens [le comte] sa proie [la dame enlevée]Auteur : AUDEFR. LE BAST. - Source : Romancero, p. 31
- Item s'en suivent ceux qui porterent les bannieres de la biere et du tournoy [funérailles du comte de Flandre]Auteur : Jean Froissard - Source : II, II, 217
- Le dit comte marcha tout d'une boutée, sans donner aleyne à ses archiersAuteur : COMM. - Source : I, 3
- Et [le comte de Foix] prend sur chacun feu par an deux francs, et le fort porte le foibleAuteur : Jean Froissard - Source : II, III, 9
- De nombreux vides et des vagues considérables s'y rencontrent presque partout [dans les forêts du comté de Nice]Auteur : L. GUIOT - Source : Mémoires de la Société centrale d'agriculture, 1874, p 142
- La maladie de Mme la comtesse de Montrevel, qui lui prit le lendemain qu'elle arrivaAuteur : Madame de Sévigné - Source : à Ménage, 19 août 1652
- Il n'en est pas de même dans la littérature française, dit Corinne, en s'adressant au comte d'Erfeuil, vos prosateurs sont souvent plus éloquents et même plus poétiques que vos poëtesAuteur : STAËL - Source : Corinne, VII, 1
- Le comte de Tessin.... après avoir été comblé d'honneurs pendant le cours d'une longue vie et avoir paru le plus heureux des hommes, a ordonné qu'on mît sur sa tombe : Tandem felixAuteur : DUCLOS - Source : Oeuv. t. x, p. 247
- L'en avoit ordenné que le Temple [les chevaliers du Temple] feroit l'avant-garde, et le comte d'Artois auroit la seconde bataille après le TempleAuteur : JOINV. - Source : 224
- On exempte ces terres de toutes les charges qu'exigeaient sur elles les comtes et autres officiers du roi ; et comme on énumère en particulier toutes ces charges, et qu'il n'y est point question de tributs, il est visible qu'on n'en levait pasAuteur : Montesquieu - Source : Esp. XXX, 13
Les mots débutant par Com Les mots débutant par Co
Une suggestion ou précision pour la définition de Comté ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 00h32
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur comté
Poèmes comté
Proverbes comté
La définition du mot Comté est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Comté sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Comté présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
