La définition de U du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
U
Nature : s. m.
Prononciation :
Etymologie : U latin.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de u de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec u pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de U ?
La définition de U
La cinquième des voyelles et la vingt et unième lettre de l'alphabet. Un grand U. Un petit u.
Toutes les définitions de « u »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
La vingt et unième lettre de l'alphabet. Elle représente une des voyelles. Un grand U. Un petit u. U, placé après un a, un e, un o, se combine avec lui pour former un son particulier : au, eu, ou. On met un tréma sur l'ü, lorsqu'on veut indiquer qu'il ne se lie pas avec la voyelle précédente : Ésaü, Saül. Il se place toujours après la consonne Q quand elle commence une syllabe. Querelle. Requérir. Remarque. Dans ce cas, il ne se prononce généralement pas, sauf dans un certain nombre de mots d'origine savante : alors il se prononce normalement devant e et i, comme dans Questeur, Quintuple, Équiangle; et il se prononce ou devant a et o, comme dans Quadrupède, Aquatique, Équateur. Il se met également après le G, quand on veut conserver à cette consonne devant e et i sa prononciation particulière et éviter qu'on ne la prononce comme un j : Guenon, Guéable Guide, Guitare. Dans ce cas, il ne se prononce pas, sauf dans quelques mots comme Arguer, Aiguë, Aiguille, Ciguë, etc.
Littré
-
1La cinquième des voyelles et la vingt et unième lettre de l'alphabet. Un grand U. Un petit u.
M. Jourdain?: Et toi, sais-tu bien comme il faut faire pour dire un u?? - Nicole?: Comment?? - M. Jourdain?: Oui?; qu'est-ce que tu fais quand tu dis u?? - Nicole?: Quoi?? - M. Jourdain?: Dis un peu u, pour voir. - Nicole?: Eh bien?! u. - M. Jourdain?: Qu'est-ce que tu fais?? - Nicole?: Je dis u. - M. Jourdain?: Oui?; mais quand tu dis u, qu'est-ce que tu fais??? tu allonges les lèvres en dehors, et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas?: u, vois-tu?? je fais la moue, u
, Molière, Bourg. gent. III, 3. - 2On distinguait autrefois deux sortes d'u, l'u voyelle et l'u consonne qui est le v.
- 3Il se met après le g quand on veut donner au g un son dur devant e et i?: guenon, guide.
- 4On met un tréma sur l'u quand on veut indiquer qu'il se prononce séparément de la voyelle qui le précède?: Ésaü, Saül.
-
5Membre d'U?; les treillageurs nomment ainsi les parties de leurs ouvrages d'une forme longue et étroite, comme les larmiers, les bandeaux, etc. lesquels sont remplis par des compartiments disposés en chevrons frisés en forme d'U, ou pour mieux dire de V.
L'usine de la Franche-Comté fabrique les nouveaux fers spéciaux dits fers à U, etc. dont l'usage est encore peu répandu
, Ch. Garnier, Monit. univ. 6 sept. 1867, p. 1481, 3e col.
HISTORIQUE
XVIe s. Je voy toutes les nations de l'Europe incliner en ceste opinion, et qu'il n'y a que nostre France où l'on prononce l'u comme nous faisons
, Pasquier, Lettres, t. I, p. 147.
Encyclopédie, 1re édition
U, Subst. masc. (Gram.) c'est la vingtieme lettre de l'alphabet latin ; elle avoit chez les Romains deux différentes significations, & étoit quelquefois voyelle, & quelquefois consonne.
I. La lettre U étoit voyelle, & alors elle représentoit le son ou, tel que nous le faisons entendre dans fou, loup, nous, vous, qui est un son simple, & qui, dans notre alphabet devroit avoir un caractere propre, plutôt que d'être représenté par la fausse diphtongue ou.
De-là vient que nous avons changé en ou la voyelle u de plusieurs mots que nous avons empruntés des Latins, peignant à la françoise la prononciation latine que nous avons conservée : sourd, de surdus ; court, de curtus ; couteau, de culter ; four, de furnus ; doux, de dulcis ; bouche, de bucca ; sous, & anciennement soub, de sub ; genou, de genu ; bouillir, & anciennement boullir, de bullire, &c.
II. La même lettre étoit encore consonne chez les Latins, & elle représentoit l'articulation sémilabiale foible, dont la forte est F ; le digamma I, que l'empereur Claude voulut introduire dans l'alphabet romain, pour être le signe non équivoque de cette articulation, est une preuve de l'analogie qu'il y avoit entre celle là & celle qui est représentée par F. (Voyez I.) Une autre preuve que cette articulation est en effet de l'ordre des labiales, c'est que l'on trouve quelquefois V pour B ; velli pour belli ; Danuvius, pour Danubius.
En prenant l'alphabet latin, nos peres n'y trouverent que la lettre U pour voyelle & pour consonne ; & cette équivoque a subsisté long-tems dans notre écriture : la révolution qui a amené la distinction entre la voyelle U ou u, & la consonne V ou v, est si peu ancienne, que nos dictionnaires mettent encore ensemble les mots qui commencent par U & par V, ou dont la différence commence par l'une de ces deux lettres ; ainsi l'on trouve de suite dans nos vocabulaires, utilité, vue, uvée, vuide, ou bien augment avant le mot avide ; celui-ci avant aulique, aulique avant le mot avocat, &c. C'est un reste d'abus dont je me suis déjà plaint en parlant de la lettre I, & contre lequel je me déclare ici, autant qu'il est possible, en traitant séparément de la voyelle U, & de la consonne V.
U, s. m. c'est la vingt-uniéme lettre de l'alphabet françois, & la cinquieme voyelle. La valeur propre de ce caractere est de représenter ce son sourd & constant qui exige le rapprochement des lévres & leur projection en-dehors, & que les Grecs appelloient upsilon.
Communément nous ne représentons en françois le son u que par cette voyelle, excepté dans quelques mots, comme j'ai eu, tu eus, que vous eussiez, ils eurent, Eustache : heureux se prononçoit hureux il n'y a pas long-tems, puisque l'abbé Régnier & le pere Buffier le disent expressément dans leurs grammaires françoises ; & le dictionnaire de l'académie françoise l'a indiqué de même dans ses premieres éditions : l'usage présent est de prononcer le même son dans les deux syllabes heu-reux.
Nous employons quelquefois u sans le prononcer après les consonnes c & g, quand nous voulons leur donner une valeur gutturale ; comme dans cueuillir, que plusieurs écrivent cueillir, & que tout le monde prononce keuillir ; figue, prodigue, qui se prononcent bien autrement que fige, prodige, par la seule raison de l'u, qui du reste est absolument muet.
Il est aussi presque toujours muet après la lettre q ; comme dans qualité, querelle, marqué, marquis, quolibet, queue, &c. que l'on prononce kalité, kerelle, marké, markis, kolibet, keue.
Dans quelques mots qui nous viennent du latin, u est le signe du son que nous représentons ailleurs par ou ; comme dans équateur, aquatique, quadrature, quadragésime, que l'on prononce ékouateur, akouatike, kouadrature, kouadragésime, conformément à la prononciation que nous donnons aux mots latins æquator, aqua, quadrum, quadragesimus. Cependant lorsque la voyelle i vient après qu, l'u reprend sa valeur naturelle dans les mots de pareille origine, & nous disons, par exemple,kuinkouagésime pour quinquagésime, de même que nous disons kuinkouagesimus pour quinquagesimus.
La lettre u est encore muette dans vuide & ses composés, où l'on prononce vide : hors ces mots, elle fait diphtongue avec l'i qui suit, comme dans lui, cuit, muid, &c.
V, s. m. c'est la vingt-deuxieme lettre, & la dix-septieme consonne de notre alphabet. Elle représente, comme je l'ai déjà dit, l'articulation sémilabiale foible, dont la forte est F ; (voyez F.) & de-là vient qu'elles se prennent aisément l'une pour l'autre : neuf devant un nom qui commence par une voyelle, se prononce neuv, & l'on dit neuv hommes, neuv articles, pour neuf hommes, neuf articles : les adjectifs terminés par f, changent f en ve pour le féminin ; bref, m. breve, f. vif, m. vive, f. veuf, m. veuve, f.
Déjà avertis par la Grammaire générale de P. R. de nommer les consonnes par l'e muet, nos peres n'en ont rien fait à l'égard de celle-ci quand l'usage s'en introduisit ; & on l'appelle plus communément vé, que ve.
Il paroît que c'étoit le principal caractere ancien pour représenter la voyelle & la consonne. Il servoit à la numération romaine, où V. vaut cinq ; IV. vaut cinq moins un, ou quatre ; VI, VII, VIII, valent cinq plus un, plus deux, plus trois, ou six, sept, huit : .
Celles de nos monnoies qui portent la lettre V simple, ont été frappées à Troyes : celles qui sont marquées du double W, viennent de Lille. (B. E. R. M.)
Trésor de la Langue Française informatisé
U, u, lettre
La vingt-et-unième lettre de l'alphabet; un exemplaire de cette lettre.U, u, lettre
La vingt-et-unième lettre de l'alphabet; un exemplaire de cette lettre.U au Scrabble
Le mot u vaut 1 points au Scrabble.
Informations sur le mot u - 1 lettres, 1 voyelles, 0 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot u au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
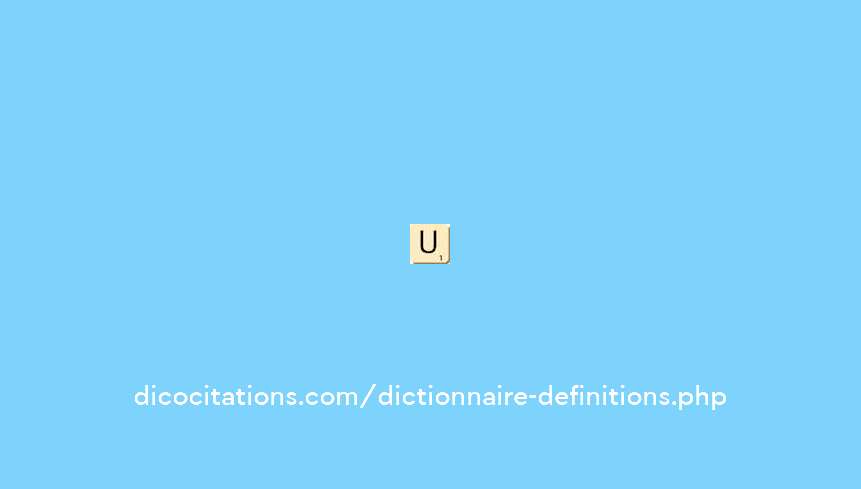
Les mots proches de U
U Ubéreux, euse Ubiquiste Ubiquitaire Ubiquité Ulcératif, ive Ulcération Ulcère Ulcéré, ée Ulcérer Ulcéreux, euse Ulé Uligineux, euse Ulster Ultérieur, eure Ultime Ultra Ultra-cavalier, ière Ultracisme Ultra-lyrique Ultra-microscopique Ultra-mondain, aine Ultramontain, aine Ultramontaniser Ultra-rouge Ultra-royaliste Ultra-terrestre Ultra-zodiacal, ale Ululation Ululement Umbo Un, une Unanime Unanimement Unanimité Undécennal, ale Uni, ie Uniate Unicité Unicorne Uniface Unifier Uniflore Uniforme Uniformément Uniformisation Uniformiser Uniformité Unilatéral, ale Uniloculaire u ubac Ubaye Uberach Ubexy ubique ubiquiste ubiquiste ubiquitaire ubiquité Ubraye ubuesque Ucciani Ucciani Uccle Ucel Uchacq-et-Parentis Uchaud Uchaux Uchentein Uchizy Uchon Ucimont Uckange Ueberkumen Ueberstrass Uffheim Uffholtz ufologie Ugine Uglas Ugnouas Ugny Ugny-l'Équipée Ugny-le-Gay Ugny-sur-Meuse Uhart-Cize Uhart-Mixe uhlan uhlans Uhlwiller Uhrwiller uht Uikhoven Uitbergen Uitkerke ukase ukases Ukkel UkraineMots du jour
Jaspé, ée Bursal, ale Stratus Nickeler Paysannerie Puberté Claveté, ée Dévolutif, ive Semi-ton Indéfectibilité
Les citations avec le mot U
- Même un tyran ne bénéficie pas de la liberté d'opinion.Auteur : Stanislaw Jerzy Lec - Source : Nouvelles pensées échevelées (2000)
- Sûr de moi, donc aveugle.Auteur : François Taillandier - Source : Anielka (1999)
- Ce qui perd le monde, ce ne sont pas les criminels ou les incendies, mais la haine, l'inimitié, les menus désagréments de chaque jour.Auteur : Anton Tchekhov - Source : Oncle Vania (1899-1900)
- Où deux se querellent,
Un troisième peut seul y voir clair.Auteur : Proverbes flamands - Source : Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels ... (1856) - Charles Cahier - La fiction, imaginée pour amuser, doit, le plus possible, se rapprocher de la vérité.Auteur : Horace - Source : Art poétique
- Mais vous êtes un jean-foutre ! Vous provoquez des éruptions volcaniques avec 2 500 années de retard, le jour de votre choix, et vous n'êtes même pas fichu de me dire si j'existe encore le 9 mai 1995 !Auteur : Amélie Nothomb - Source : Péplum (1996)
- A la Sainte-Barbe, - Soleil peu arde.Auteur : Dictons - Source : 4 décembre
- Que si le créateur trouve une joie si parfaite à mourir pour sa créature, quel contentement doit éprouver la créature de mourir pour son créateur!Auteur : Jacques Bénigne Bossuet - Source : Panégyriques (1652-1659)
- Qu'aimable est la vertu que la grâce environne!Auteur : André Chénier - Source : L'Aveugle
- Aimons-nous des être réels ou bien l'opinion que nous nous faisons d'eux ?Auteur : Alexandre Jardin - Source : Chaque femme est un roman (2008)
- La terre est devenue une serpillère.Auteur : Nicolas Hulot - Source : A mes risques et plaisirs (1998)
- Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!Auteur : Charles Baudelaire - Source : Les Fleurs du Mal (1857)
- Il y a une odeur de réfectoire, que l'on retrouve la même dans tous les réfectoires. Que ce soient des Chartreux qui y mangent, ou des séminaristes, ou des lycéens, ou de tendres jeunes filles, un réfectoire a toujours son odeur de réfectoire.Auteur : Emile-Auguste Chartier, dit Alain - Source : Propos, 11 octobre 1907, Odeur de réfectoire
- Ce qui entre par une oreille, sort par l'autre.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Il eut un moment d'effusion et me serra chaleureusement les deux mains.Auteur : Alphonse Daudet - Source : Le Petit Chose (1868)
- On m'a assuré, ce qui pourrait bien être, que l'archevêque de Paris avait fait consulter un savant canoniste, pour lui demander si Voltaire n'était pas dans le cas de l'exhumation, et que le canoniste avait répondu qu'on s'en gardât bien.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre au roi de Prusse, 1er juillet 1778
- Le couple, celà signifie un homme qui vit une femme, et une femme qui vit un homme.Auteur : Romain Gary - Source : Clair de femme (1977)
- La pensée est la clé de tous les trésors.Auteur : Honoré de Balzac - Source : La Peau de chagrin (1831)
- Il faut qu'une phrase soit si claire, qu'elle fasse plaisir au premier coup, et pourtant qu'on la relise à cause du plaisir qu'elle a fait.Auteur : Jules Renard - Source : Journal, 16 mai 1903
- Cette chose plus compliquée et plus confondante que l'harmonnie des sphères: un couple.Auteur : Julien Gracq - Source : Un beau ténébreux (1945)
- Je vous ai compris ! Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.Auteur : Charles de Gaulle - Source : Discours à Alger, 4 juin 1958.
- Seuls les faibles mettent des années à s'affranchir d'une émotion. Celui qui est maître de soi peut étouffer un chagrin aussi aisément qu'inventer un plaisir.Auteur : Oscar Wilde - Source : Le Portrait de Dorian Gray (1891)
- La gloire est comme un cercle dans l'onde qui va toujours s'élargissant, jusqu'à ce qu'à force de s'étendre, il finisse par disparaître.Auteur : William Shakespeare - Source : Henry VI
- Les caresses sont la salle d'attente de l'amour. Comblé ou non, tout désir dépérit.Auteur : Robert Sabatier - Source : Le livre de la déraison souriante (1991)
- Tu es là, tu existes, parce qu'un moment de toi c'est déjà immense. Hier est passé, demain n'existe pas encore, c'est aujourd'hui qui compte, c'est le présent.Auteur : Marc Lévy - Source : Et si c'était vrai... (2000)
Les citations du Littré sur U
- Si l'ay fait par franchise et fiance de sa loyautéAuteur : MONT. - Source : I, 26
- Et ces noms, ces respects, ces applaudissements Deviennent pour Titus autant d'engagementsAuteur : Jean Racine - Source : Bérén. v, 2
- La vraie cause nous demeure voilée ; et toutes nos théories de causes ne sont jamais que des théories d'effetsAuteur : BONNET - Source : Oeuv. t. X, p 383, dans POUGENS
- Dante, pourquoi dis-tu qu'il n'est pire misère Qu'un souvenir heureux dans les jours de douleurs ?... Est-ce bien toi, grande âme immortellement triste, Est-ce toi qui l'as dit ?Auteur : A. DE MUSSET - Source : Poésies nouv. Souvenir.
- Certes, nennil, vostre vie est trop brune [mauvaise]Auteur : E. DESCH. - Source : Poésies mss. f° 357, col. 3, dans LACURNE SAINTE-PALAYE.
- Ce fut là qu'ayant eu part au mariage de la princesse de Parme avec Philippe V, il [Alberoni] prit le vol qui l'éleva si hautAuteur : DUCLOS - Source : Oeuv. t. V, p. 236
- Les Italiens donnent le nom de sinfonia, symphonie, aux ouvertures de leurs opérasAuteur : FÉTIS - Source : Dict. de musique, symphonie.
- Dieu veut être aimé ; Il venge tôt ou tard son saint nom blasphéméAuteur : Jean Racine - Source : Ath. II, 7
- Distiller, c'est un art et moyen par lequel la liqueur ou humidité d'aucunes choses, par la vertu et force du feu, ou de chaleur semblable, est extraite et tirée, estant premierement subtilisée en vapeur, puis resserrée et espaissie par froideur ; aucuns appellent cest art sublimer. - On peut distiller sans chaleur [filtrer], comme nous voyons es choses qui sont distillées en forme de collaturesAuteur : PARÉ - Source : XXVI, 1
- Et sur ces cercles getent piaus de mouton conrées [corroyées] en alunAuteur : JOINV. - Source : 230
- Ce poëte orgueilleux [Ronsard] trébuché de si hautAuteur : BOILEAU - Source : Art p. I
- Un chausse-piedAuteur : D'AUB. - Source : Faen. III, 3
- Caton le censeur ne s'était point lassé de représenter dans le sénat les suites funestes du luxe qui commençait de son temps à s'introduire dans la républiqueAuteur : ROLLIN - Source : Traité des Ét. 3e partie, 4e morceau, 2e ch.
- Ils sont si grands farceurs que, s'ils savent que j'ai esté malade, ils ne me feront que farcerAuteur : LOUIS XI - Source : Nouv. LIX.
- Vous devez bien quelque chose à ma belle ; D'un cachemire elle attend le cadeauAuteur : BÉRANG. - Source : Mon tombeau.
- Et tant d'écrits savants entassés dans nos murs Ont chargé mon esprit de leurs dogmes obscursAuteur : DELAV. - Source : Paria, II, 2
- Pour Confucius, c'est un bon prédicateur ; il est si verbeux qu'on n'y peut tenirAuteur : Voltaire - Source : Mél. litt. Lett. chin. 3
- ....à filler la fillace Esteindras-tu la gloire de ta race ?Auteur : AMYOT - Source : Comment lire les poëtes, 52
- Écrire par jeu, par oisiveté, et comme Tityre siffle ou joue de la flûteAuteur : LA BRUY. - Source : XII
- La constriction du prepuce est nommée paraphymosis, quand il est retiré contre mont, qui fait le glan descouvertAuteur : PARÉ - Source : XV, 33
- À Jehan d'Abeville, potier d'estaing et hacheur en orfavrerieAuteur : DE LABORDE - Source : Émaux, p. 337
- Ô hommes, enfants de la vanité ! votre modestie est orgueil ; la plus pure est celle qui est la moins corrompue par la secrète complaisance du coeurAuteur : Voltaire - Source : Panég. de St Louis.
- Nom donné à un phénomène optique, dans lequel des objets éloignés, vus à l'horizon, paraissent simplement suspendus en l'air, à la différence du mirage où il y a de plus une image renversée ; le fait est que dans la suspension la seconde image existe, mais elle est extrêmement aplatie et réduite à une dimension infiniment petite, ce qui empêche de la voirAuteur : BIOT - Source : Instit. Mém. scienc. 1809, p. 8
- Il eut en grande admiration son bon sens et sa hardiesseAuteur : AMYOT - Source : Thém. 51
- Les avocats et juges ont beau quereller et sentencierAuteur : MONT. - Source : I, 99
Les mots débutant par U Les mots débutant par U
Une suggestion ou précision pour la définition de U ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 02h30
- Uniforme - Union - Unique - Univers - Utilite - Utopie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur u
Poèmes u
Proverbes u
La définition du mot U est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot U sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification U présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.

