Définition de « aboyer »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot aboyer de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur aboyer pour aider à enrichir la compréhension du mot Aboyer et répondre à la question quelle est la définition de aboyer ?
Une définition simple :
Définitions de « aboyer »
Trésor de la Langue Française informatisé
ABOYER, verbe intrans.
Wiktionnaire
Verbe - français
aboyer \a.bwa.je\ intransitif ou transitif 1er groupe (voir la conjugaison)
-
Faire entendre son cri, en parlant d'un chien.
- Aussi la plupart des chiens se contentent de l'aboyer et ne se soucient pas de le saisir [?]. ? (Georges-Louis Leclerc de Buffon, Histoire naturelle des animaux, « Le Hérisson », in ?uvres, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, page 809.)
- À l'instant un chien aboie dans le lointain ; il approche, il redouble ses cris, il arrive, il hurle de joie à nos pieds ; [?] ? (François-René de Chateaubriand, Atala, ou Les Amours de deux sauvages dans le désert)
- Il revint au chalet, où les chiens des Pyrénées aboyèrent tellement après lui qu'il ne put s'adonner au plaisir de contempler les fenêtres de Modeste. ? (Honoré de Balzac, Modeste Mignon, 1844)
- Quant à mon guide, [?], il courait, pour se réchauffer, à quatre pattes avec le chien, et le faisait aboyer en lui tirant la queue. ? (Alexandre Dumas, Impressions de voyage, La Revue des Deux Mondes T.1, 1833)
-
[?] l'ouverture donnait sur la loge de Gaby Million où la vedette avait laissé ses chiens. Les bêtes se mirent à aboyer.
? Naturellement c'est plein de cabots, crut devoir déclarer spirituellement Mr. Morgan. ? (Francis Carco, L'Homme de minuit, Éditions Albin Michel, Paris, 1938)
-
(Figuré) Poursuivre de cris importuns, d'injures.
- Tous ses créanciers aboient après lui.
- Il aboyait des insultes.
-
(Figuré) (Péjoratif) Crier d'un ton sec et inhumain, comme aboie un chien.
- « Alignez-vous au centre de la cour! » aboya un gardien. ? (Pierre Bordage, Wang ? I. Les portes d'Occident, « J'ai Lu », 1997, page 162)
- Ils nous aboyaient pour qu'on apprenne un dialecte d'ailleurs, eux-mêmes baragouinaient des idiomes aux r roulés, qu'on se cachait sous l'eau. On entravait tchi. ? (Magyd Cherfi, « Conte des noms d'oiseaux », dans Livret de famille, Éditions Actes Sud, 2011)
-
(Figuré) Dire du mal, avec acharnement, d'une personne ou d'une chose.
- Certains journaux aboient après ce ministre, après ce décret.
- On peut imaginer, maintenant, le singulier spectacle que le salon jaune des Rougon offrait chaque soir. Toutes les opinions se coudoyaient et aboyaient à la fois contre la République. On s'entendait dans la haine. ? (Émile Zola, La Fortune des Rougon, G. Charpentier, Paris, 1871, ch. III ; réédition 1879, p. 94)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Il se dit du Chien qui fait entendre son cri. Un chien qui aboie à la lune, qui aboie aux voleurs. Un chien qui aboie après tous les passants. Prov. et fig., Tous les chiens qui aboient ne mordent pas, Les gens qui menacent ne sont pas toujours redoutables. Prov. et fig., Aboyer à la lune, se dit en parlant d'un Homme qui crie inutilement contre quelqu'un. Il signifie figurément Poursuivre de cris importuns, d'injures; Dire du mal, avec acharnement, d'une personne ou d'une chose. Tous ses créanciers aboient après lui. Certains journaux aboient après ce ministre, après ce décret.
Littré
Ma fortune? Qui n'abaye et n'aspire après l'or du Pérou, Régnier, Sat. III.
Ou toutes ces grandeurs après qui l'on abaye, Régnier, ib. XVI. )
-
1 V. n. Se dit du cri du chien et de quelques autres animaux du même genre?; le renard par exemple. Le chien aboie. Le chien du garde aboie au voleur, après le voleur, contre le voleur. Quoi?! mes chiens même aboient après moi.
Quand avons-nous manqué d'aboyer au larron??
Racine, Plaid. III, 3.Tu étais, Caton, comme un chien qui aboie contre tous les passants
, Fénelon, t. XIX, p. 285.Quoique toujours, sous son empire, L'usurpateur nous ait chassés, Nous avons laissé, sans mot dire, Aboyer tous les plus pressés
, Béranger, Requête. -
2 Fig. Crier contre quelqu'un, invectiver, faire des réclamations.
Nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous
, Molière, Scap. I, 7.Lorsque je vois ce moderne Sisyphe Nous aboyer, je trouve qu'il fait bien
, Rousseau J.-B. liv. I, ép. IX.Jean-Jacques? En nouveau Diogène aboie à nos beautés
, Voltaire, Ép. XCIV.Il se mit à aboyer contre Brancas sur le jansénisme
, Sévigné, 344. - 3Aboyer après, poursuivre ardemment. Aboyer après une place. Cet ambitieux aboie après les grandeurs.
-
4 V. a. Les chiens aboyaient le renard.
La plupart des chiens se contentent de l'aboyer [le hérisson] et ne se soucient pas de le saisir
, Buffon, Hérisson. Aboyer quelqu'un, invectiver contre lui. Aboyer une place, la poursuivre avec passion. Dans cette phrase de Diderot?:Moi je ne tue pas un chien qui m'aboie
, Diderot, Essai sur Cl. Aboyer peut être transitif direct ou indirect?: il aboie moi ou il aboie à moi. -
5S'aboyer, v. réfl.
Si vous voyez deux chiens qui s'aboient?
, La Bruyère, 12. C'est ou aboyer soi ou aboyer à soi. -
6Proverbes. Tous les chiens qui aboient ne mordent pas, c'est-à-dire tous les gens qui menacent ne sont pas à craindre.
Aboyer à la lune, crier inutilement.
Jamais bon chien n'aboie à faux, un homme sage ne se fâche pas sans raison.
SYNONYME
ABOYER, JAPPER. Le premier se dit du cri des gros chiens, le second de celui des petits. Cependant on dit souvent d'un petit chien, il aboie, et d'un gros, il jappe. C'est qu'alors celui-là est en colère, et que celui-ci n'est animé contre aucun objet.
HISTORIQUE
XIIe s. Comment, Sire, je suis vils come chiens à ceus de Juda, come cil ki est chef des fols ki abaient vers David
, Rois, 129.
XIIIe s. A si grand chose, com à l'empire de Constantinople, poés [vous pouvez] croire que mout i en avoit aboans et envians
, Villehardouin, 109. Par foi, tant en a chien qui nage?; Quand est arrivés, il aboie
, la Rose, 15101.
XIVe s. Comme les chiens, quand il oent [entendent] heurter, il abaient tantost sans atendre que il aient conoissance se celui qui heurte est ami ou non
, Oresme, Eth. 205. Desormais travailler [il] n'ose, Abayer ne mot sonner?; On lui doit bien pardonner?; Un vieillart peut peu de chose
, Orléans, Rondeau. Qui ne peut mordre, si abaye
, Villon, Baill. et Mal. Aussi l'avocat qui plaidye Les causes, raisons et moyens, Pourvu qu'il ait la main garnye, Sera pour les deux aboyans
, Coquillart, Simple et rusée. Je te pry, sans plus m'abayer, Que tu penses de me payer
, Patelin.
XVIe s. Ces compagnies ne le firent qu'abaier entre Longuive et le faubourg, à l'entrée du quel Mortemar chargea et le mesla
, D'Aubigné, Hist. II, 128. Le chien veut mal à celui à qui il abbaye
, Amyot, Cimon, 33. Il lui fut advis qu'une lyce asprement courroucée abbayoit contre lui, et que parmi son abboi elle jettoit une parole humaine
, Amyot, ib. Nous nous courrouceons contre les chiens qui nous abayent et contre les asnes qui nous regibbent
, Amyot, Comm. refr. la col. 30. Il delibera de contenter un jeune homme pauvra, son fidele ami, aboyant après les richesses
, Montaigne, II, 317. En certain abbayer du chien le cheval cognoist qu'il y a de la cholere
, Montaigne, II, 158. Ce chien se meit à abbayer contre lui tant qu'il put
, Montaigne, II, 192. Les autres, en abbayant leur parchemin jour et nuit, et barbotant leur breviaire, vendent leurs coquilles au peuple
, Calvin, Inst. 708.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
ABOYER. Ajoutez?: - REM. Aboyer à la lune est une locution née de l'observation du chien qui, blessé par l'éclat de la lune, aboie contre elle.
Étymologie de « aboyer »
Berry, abayer?; de ad, à, et baubari, aboyer?; grec ????????; allem. bellen. Le simple baier était aussi usité dans l'ancien français. Parce que li quien s'engressent [s'irritent] de baier, Beaumanoir, XXXIX, 46.
- De l'ancien français abaier (XIIe siècle), du latin populaire *abbaudiare, du latin baubari (baubare, « japper »), qui élimina le classique latrare.
aboyer au Scrabble
Le mot aboyer vaut 17 points au Scrabble.
Informations sur le mot aboyer - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot aboyer au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
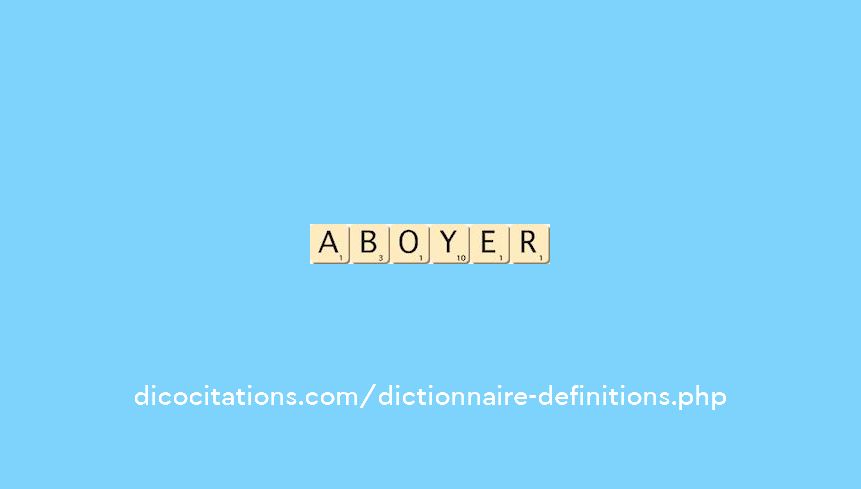
Les rimes de « aboyer »
On recherche une rime en JE .
Les rimes de aboyer peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en je
Rimes de charretiers Rimes de palier Rimes de supportiez Rimes de briseriez Rimes de disqualifié Rimes de chatouillaient Rimes de écrabouillées Rimes de refassiez Rimes de nier Rimes de fortifiaient Rimes de effrayé Rimes de osiers Rimes de octroyaient Rimes de choyé Rimes de maquillais Rimes de excommuniée Rimes de noyé Rimes de décidiez Rimes de justifié Rimes de communiquiez Rimes de remédiait Rimes de portiez Rimes de suppliciée Rimes de revivifié Rimes de patrouillaient Rimes de assaillaient Rimes de étudié Rimes de appuyé Rimes de briller Rimes de endeuillée Rimes de exécutiez Rimes de occupiez Rimes de aide-jardinier Rimes de donniez Rimes de liriez Rimes de compreniez Rimes de aboutissiez Rimes de pliée Rimes de payé Rimes de débrouillées Rimes de statufié Rimes de gargotiers Rimes de simplifiée Rimes de licencié Rimes de appréciés Rimes de procureriez Rimes de sommiers Rimes de parveniez Rimes de résistiez Rimes de asseyiezMots du jour
charretiers palier supportiez briseriez disqualifié chatouillaient écrabouillées refassiez nier fortifiaient effrayé osiers octroyaient choyé maquillais excommuniée noyé décidiez justifié communiquiez remédiait portiez suppliciée revivifié patrouillaient assaillaient étudié appuyé briller endeuillée exécutiez occupiez aide-jardinier donniez liriez compreniez aboutissiez pliée payé débrouillées statufié gargotiers simplifiée licencié appréciés procureriez sommiers parveniez résistiez asseyiez
Les citations sur « aboyer »
- Si tu cours dans une meute, même si tu ne peux pas aboyer, remue la queue.Auteur : Anton Tchekhov - Source : La Cerisaie (1904)
- Au loin, des canons continuaient à aboyer sourdement.Auteur : Roger Martin du Gard - Source : Les Thibault
- Quoi! je nourris un chien pour aboyer moi-même!Auteur : Proverbes anglais - Source : Proverbe
- En 1965, à l’Opéra de Paris, dans Norma, on ne voyait que Maria Callas. Je l’ai rencontrée onze ans plus tard, lors d’un dîner mondain. Nous ne nous sommes pas dit grand-chose, mais sa voix, tout à fait douce, un peu essoufflée, un peu perdue, m’a marquée. Son humilité était loin de la rumeur qui la faisait aboyer. Auteur : Marie Laforêt - Source : Interview VSD, Laurence Durieu, le 02/09/2008
- Il faut hurler avec les loups et aboyer avec les chiens.Auteur : Proverbes belges - Source : Proverbe
- J'ai honte d'avoir ces années d'avance. Je ne veux pas être un patron chien, aboyer sur les ouvriers et cumuler comme ça les années d'avance sans les partager avec les masses laborieuses. Auteur : Armand Patrick Gbaka-Brédé , dit Gauz - Source : Camarade Papa
- Il est naturel qu'un chien toujours couché avec la tête sur un lexique grec en vienne à détester d'aboyer ou de mordre qu'il finisse par préférer le silence du chat à l'exubérance de ses congénères et la sympathie humaine à toute autre.Auteur : Virginia Woolf - Source : Flush : une biographie (1935)
- Si l'on vous importune, point de vacarme, point de ruades et point de postillons. Restez de glace. Et laissez aboyer les chiens. Il finissent généralement par se mordre entre eux.Auteur : Lydie Salvayre - Source : La Conférence de Cintegabelle (1999)
- Aboyer, n'est pas mordre.Auteur : Proverbes flamands - Source : Quelque six mille proverbes et aphorismes usuels ... (1856) - Charles Cahier
- Passe pour aboyer, mais que je ne sois pas mordu.Auteur : Proverbes espagnols - Source : Proverbe
- Lorsque la colère se répand dans ta poitrine, garde ta langue d’aboyer vainement.Auteur : Sapho - Source : Odes et fragments, Sappho (trad. Yves Battistini), éd. Gallimard, coll. « Poésie », 2005
- Snob: homme qui envoie son chien apprendre à aboyer à Londres.Auteur : Philippe Jullian - Source : Dictionnaire du snobisme (1958)
- Quand les Hollandais essuient un coup de vent en haute mer, ils se retirent dans l'intérieur du navire, ferment les écoutilles et boivent du punch, laissant un chien sur le pont pour aboyer à la tempête.Auteur : François-René de Chateaubriand - Source : Mémoires d'outre-tombe (1848), Partie 1, Livre 9, Chapitre 14
- Ecoutez-les aboyer, ces vieux chevaux de retour.Auteur : Jack Lang - Source : Formule de Jack Lang à propos des leaders de la droite
- Les chiens ont la conviction qu'ils doivent absolument être à côté de vous dans la voiture, pour que, en cas de besoin, ils puissent aboyer furieusement et pour rien à votre oreille.Auteur : Dave Barry - Source : Chroniques déjantées d'Internet... et autres cyberdélires (1998)
Les mots proches de « aboyer »
Aboi Aboli, ie Abolir Abolissement Abolitif, ive Abolition Abominable Abomination Abominer Abondamment Abondance Abondant, ante Abonde Abonder Abonné, ée Abonnement Abonner Abonnir Abord Abordage Abordé, ée Abordée (d') Aborder Abordeur Abortif, ive Abouché, ée Abouchement Aboucher Aboukorn About Aboutir Aboutissant, ante Aboutissement Aboyant, ante Aboyé, ée Aboyer AboyeurLes mots débutant par abo Les mots débutant par ab
Aboën aboi aboie aboiement aboiements aboient aboiera aboierait aboieront aboies abois Abolens aboli aboli abolie abolie abolies abolies abolir abolira abolirait aboliras abolis abolis abolissaient abolissais abolissait abolissant abolissent abolissions abolissons abolit abolition abolitionniste abolitionniste abolitionnistes abolitionnistes abominable abominablement abominables abominaient abomination abominations abomine abominer Aboncourt Aboncourt Aboncourt-Gesincourt Aboncourt-sur-Seille abonda
Les synonymes de « aboyer»
Les synonymes de aboyer :- 1. crier
2. gueuler
3. hurler
4. glapir
5. brailler
6. rugir
7. vociférer
8. bramer
9. beugler
10. japper
synonymes de aboyer
Fréquence et usage du mot aboyer dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « aboyer » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot aboyer dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Aboyer ?
Citations aboyer Citation sur aboyer Poèmes aboyer Proverbes aboyer Rime avec aboyer Définition de aboyer
Définition de aboyer présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot aboyer sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot aboyer notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
