La définition de Fermé, ée du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Fermé, ée
Nature : part. passé.
Prononciation : fèr-mé, mée
Etymologie : Fermer.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de fermé, ée de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec fermé, ée pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Fermé, ée ?
La définition de Fermé, ée
Rendu ferme, fixe (ce qui est le sens propre).
Toutes les définitions de « fermé, ée »
Wiktionnaire
Adverbe - français
ferme \f??m\ invariable
- D'une manière ferme, fermement, fortement.
- Et les lascars mal tenus se mirent à dézébrer ferme. ? (Alphone Allais, À se tordre, 1891)
- Y a repos l'après-midi, alors on chauffera ferme, et si le doublard de semaine ferme les yeux, on laissera ta porte ouverte, tu pourras toujours jaspiner, et puis tu auras chaud. ? (Arnold Zweig, Le Cas du sergent Grischa, 1927, traduit de l'allemand par Maurice Rémon, 1930, page 252)
- Les rouges étaient aux cent coups. Ils s'étaient réunis en comité restreint dans la cuisine du cafetier. Autour de la toile cirée, le bureau de la Libre-Pensée cogitait ferme. ? (Arlette Aguillon, Le puits aux frelons, Éditions de l'Archipel, 2009, chap. 20)
- Tenir quelque chose bien ferme. Frapper ferme.
-
Faire ferme : S'arrêter dans une retraite, et tenir tête à l'ennemi.
- Le général Stenau fit ferme avec deux régiments. ? (Voltaire, Charles XII, 2)
- [Il] Fit ferme quelque temps et puis se démentit. ? (Tristan, M. de Chrispe, I, 3)
- Il faut faire ici ferme et montrer du courage. ? (Pierre Corneille, ?dipe, V, 4)
-
Parler ferme à quelqu'un : Lui parler avec force, et de manière à lui en imposer.
- Vous me parlez bien ferme, et cette suffisance? ? (Molière, Le Misanthrope, I, 2)
- Se dit aussi de la solidité d'un terrain.
- ? vous trouverez de la consistance au milieu de l'inconstance des choses humaines [?] Vous demeurerez immuables, comme si tout faisait ferme sous vos pieds, et vous sortirez victorieux. ? (Jacques-Bénigne Bossuet, Panégyrique de Saint Benoît, 2)
-
(Justice) Sans sursis, à propos d'une condamnation.
- La justice me condamnera à dix-huit mois, dont six mois ferme. J'irai en prison, purger ma peine de six mois ferme. ? (Franz Bartelt, Le Jardin du bossu, Gallimard, 2004)
Adjectif - français
ferme \f??m\ masculin et féminin identiques
- Qui a de la consistance, de la dureté.
- Un terrain ferme.
- Un gâteau de pâte ferme.
- Ce poisson a la chair ferme.
- Les c?urs se font eux-mêmes des n?uds plus serrés ; et comme les os se rendent plus fermes dans les endroits des ruptures, à cause du secours extraordinaire que la nature donne aux parties blessées ; de même les amis qui se réunissent envoient pour ainsi dire tant d'affection pour renouer l'amitié rompue, qu'elle en demeure à jamais mieux consolidée. ? (Jacques-Bénigne Bossuet, Sermon pour le temps du jubilé sur la pénitence, 1772, I)
- Elle l'observait en train de s'étirer ; sa belle culotte d'un rouge bordeaux profond mettait en valeur ses fesses fermes.
- Qui tient fixement.
- Ce plancher est ferme.
-
Et, de la majesté des lois
Appuyant les pouvoirs suprêmes,
Fait demeurer les diadèmes
Fermes sur la tête des rois. ? (François de Malherbe, Poésies : Livre premier : Odes : VII : À la Reine [Marie de Médicis], sur les heureux succès de sa régence, 1610) - La mer est donc dans un état ferme d'équilibre ; et, si, comme il est difficile d'en douter, elle a recouvert autrefois des continents aujourd'hui fort élevés au-dessus de son niveau, il faut en chercher la cause ailleurs que dans le défaut de stabilité de son équilibre. ? (Laplace, Exposition du système du monde, IV, 12)
-
(Figuré) Dont les propriétés sont stables.
- Je ne sais s'il y a moyen de donner des règles fermes pour accorder les discours à l'inconstance de nos caprices. ? (Blaise Pascal, Pensées, I, 3)
- Pour m'attacher à vous par de plus fermes n?uds. ? (Thomas Corneille, Ariane, II, 4)
- Il [Épaminondas] insista principalement sur la nécessité qu'il y avait de fonder la paix sur l'égalité et sur la justice, parce qu'il ne pouvait y avoir de paix ferme et durable que celle où toutes les parties trouvaient un avantage égal. ? (Charles Rollin, Histoire ancienne, livre XII (Suite de l'histoire des Perses et des Grecs depuis la paix d'Antalcide jusqu'à la mort d'Artaxerxe-Mnémon), chapitre I, IV)
- La justice, plus exactement rendue sous le règne d'Élisabeth que sous aucun de ses prédécesseurs, fut un des fermes appuis de son administration. ? (Voltaire, Essai sur les m?urs et l'esprit des nations, CLXVIII : De la reine Élisabeth)
- Orbassan de nos lois est le plus ferme appui. ? (Voltaire, Tancrède, I, 1)
- Qui se tient sans chanceler.
- Être ferme sur ses pieds, à cheval.
- Être ferme sur ses étriers : Se tenir d'aplomb à cheval.
-
Vigoureux, fort, en bonne santé
- Et par là il a fallu que l'artère, qui devait avoir un battement si continuel et si ferme, fût d'une consistance plus solide et plus dure que la veine. ? (Jacques-Bénigne Bossuet, De la connaissance de Dieu et de soi-même, II, 8)
- Malgré une constitution très-ferme et une vie toujours très-réglée d'un bout à l'autre, Mery se sentit presque tout-d'un-coup abandonné de ses jambes vers l'âge de soixante-quinze ans, sans avoir nulle autre incommodité. ? (Bernard le Bouyer de Fontenelle, Éloge de Mery)
- Le baron, embrassant M. de Forlis : Votre santé, monsieur ? - M. de Forlis : Assez ferme. Et la tienne, Baron ? ? (Boissy, Les Dehors trompeurs, II, 10)
-
(Art, Littérature) Qui a le caractère de la vigueur, désigne une manière d'exécuter vigoureuse et hardie.
- Ce dessinateur a une touche très ferme.
- Il a un coup d'archet très ferme.
-
(Figuré) Qui a de la solidité morale, qui ne se laisse ni changer ni détourner ; constant, invariable, inébranlable.
-
Courage, Reine sans pareille :
L'esprit sacré qui te conseille
Est ferme en ce qu'il a promis. ? (François de Malherbe, Poésies, LVIII) - Vous paraissiez plus ferme en vos intentions. ? (Pierre Corneille, Cinna ou la clémence d'Auguste, III, 2)
-
Oui, je lui dois assez, seigneur, quoi qu'il en soit,
Pour vous payer pour lui de l'amour qu'il vous doit ;
Et je vous le promets, entier, ferme et sincère. ? (Pierre Corneille, Héraclius empereur d'Orient, V, 3) -
Il [Annibal] m'a surtout laissé ferme en ce point
D'estimer beaucoup Rome et ne la craindre point. ? (Pierre Corneille, Nicomède, II, 3) - Je l'ai toujours connu ferme dans son devoir. ? (Pierre Corneille, ?dipe, III, 4)
-
Le plus ferme souvent manque à ce qu'il propose ;
Et la force au besoin m'obtiendra toute chose. ? (Jean de Rotrou, Hercule mourant, I, 6) - Et on l'a cru avec tant de certitude, que les philosophes en ont fait un des grands principes de leur science, et le fondement de leurs traités du vide : on le dicte tous les jours dans les classes et dans tous les lieux du monde, et depuis tous les temps dont on a des écrits, tous les hommes ensemble ont été fermes dans cette pensée, sans que jamais personne y ait contredit jusqu'à ce temps. ? (Blaise Pascal, De la pesanteur de l'air, Conclusion des deux précédens traités)
- [Un c?ur?] noble pour s'élever au-dessus des passions et des intérêts, tendre pour assister les malheureux, ferme pour résister à l'iniquité. ? (Esprit Fléchier, Oraison funèbre de monsieur le premier président de Lamoignon)
- Je demeure ferme dans le dessein de quitter? ? (Marquise de Maintenon, Lettre à l'abbé Gobelin, 6 août 1674)
- Avec une âme juste et ferme, j'ai désiré que mon enfant eût un esprit droit, éclairé, étendu. ? (Denis Diderot, Mélanges de littérature et de philosophie : Lettre à la comtesse de Forbach, sur l'Éducation des enfants)
- Le ladre a été ferme à toutes les attaques. ? (Molière, L'Avare, II, 6)
-
Courage, Reine sans pareille :
-
(En particulier) Qui ne se laisse point abattre par l'adversité, intimider par le péril.
- Une âme ferme.
- L'ébranlement sied bien aux plus fermes courages. ? (Pierre Corneille, Horace, I, 1)
- Il [Valentinien] était chaste, libéral, humain, ferme dans la mauvaise fortune, et modéré dans la bonne. ? (Esprit Fléchier, Histoire de Théodose le Grand, IV, 34)
- Je vous crois fort au-dessus des revers que vous avez essuyés. Toutes les âmes nobles sont fermes. ? (Voltaire, Lettre à M. de la Borde, banquier de la cour, À Ferney, 16 avril 1770)
- Se dit des choses en un sens analogue, de la volonté, l'espérance, la foi?
- La vertu la plus ferme évite les hasards. ? (Pierre Corneille, Polyeucte martyr, II, 4)
- C'est peut-être un dessein mal ferme que le sien. ? (Pierre Corneille, Sertorius, IV, 1)
- Louis XIV, après huit ans de désastres dans la guerre de la succession d'Espagne, prit la résolution ferme d'aller combattre lui-même à la tête de ce qui lui restait de troupes, quoique à l'âge de soixante-dix années. ? (Voltaire, Essai sur les m?urs et l'esprit des nations : Fragmens sur l'Histoire, article XVIII : Défense de Louis XIV)
- Des actions fermes, et des paroles simples, voilà le vrai caractère des anciens Romains. ? (Voltaire, Commentaires sur Corneille : Remarques sur Pompée, acte IV, scène III)
- Qui révèle de la fermeté, qui est assuré
- Ce ton ferme et résolu déconcerta l'adversaire.
- Voilà Ulysse lui-même ; voilà ses yeux pleins de feu et dont le regard était si ferme. ? (François de Salignac de La Mothe-Fénelon, Les Aventures de Télémaque, IX, 1699)
Interjection - français
ferme \f??m\ invariable
-
(Vieilli) S'emploie pour exciter, encourager.
- Allons, ferme ! Poussez, mes bons amis de cour. ? (Molière, Le Misanthrope, II, 5)
- Ferme ! Continuez à ne vous pas entendre. ? (Lachaussée, Préjugé à la mode, I, 4)
Nom commun - ancien français
ferme \Prononciation ?\ masculin et féminin identiques
- Ferme (solide, robuste).
Nom commun 1 - français
ferme \f??m\ féminin
-
(Droit) Convention par laquelle un propriétaire abandonne à quelqu'un, pour un temps déterminé, la jouissance d'un domaine agricole ou d'un droit, moyennant une redevance.
- Un rapport et avis d'experts porte qu'il sera planté des bornes, pour limiter les fonds de Catherine Lambert et ceux des pères Jésuites. Il existe en date du 8 octobre de la même année, une quittance de 18 livres de la susdite aux RR.PP. pour payement de la ferme du broteau des balmes. ? (Paul Saint-Olive, Notice sur le territoire de la Tête-d'Or, Aimé Vingtrinier, Lyon, 1860, page 17)
- Un de leurs successeurs, le sieur d'Ourches, l'obtint [ce droit] en ferme de Charles III, en 1565, avec diverses autres redevances [?]. ? (Pierre Boyé, Les Hautes-Chaumes des Vosges, Rencontres transvosgiennes, 2019, ISBN 978-2-9568226-0-8)
- (Par extension) Exploitation agricole donnée à ferme.
-
(Par extension) Exploitation agricole, de tout mode de faire-valoir.
- Dans les états agricoles du Middle-West, les fermiers, voyant les prix des terres monter sans arrêt, empruntaient à 8 à 10 % pour agrandir leurs fermes. ? (André Maurois, Chantiers américains, 1933)
- Mais cela peut même aller jusqu'à la désertification lorsque les familles ont pu à leur tour migrer : la montagne kabyle ou libanaise est ainsi constellée de fermes abandonnées. ? (Christian Pradeau & Jean-François Malterre, Migrations et territoires, dans Les cahiers d'Outre-Mer n° 234/volume 59, Presses Universitaires de Bordeaux, 2006)
-
(Par extension) Exploitation destinée à l'élevage d'animaux.
- Il existe là-bas une ferme d'éléphants, dirigée par un Anglais original? ? (Georges Simenon, Le Blanc à lunettes, ch. I, Gallimard, 1937)
- Pour autant, poissons et crustacés pêchés ou engraissés dans des fermes constituent un secteur économique considérable, qui s'élève à environ 179 millions de tonnes et dont les ventes sont estimées à 401 milliards de dollars (356 milliards d'euros). ? (Martine Valo, Les exportations de poissons pèsent plus que la viande, le tabac, le riz et le sucre réunis, Le Monde. Mis en ligne le 10 juin 2020)
-
(Par extension) Exploitation d'énergie, éolienne, hydrolienne, solaire, etc.
- Quatre fermes pilotes d'éoliennes flottantes doivent cependant voir le jour d'ici à 2020, en Méditerranée et au large de la Bretagne, et des études de sites doivent être lancées, pour des hydroliennes, dans le passage du Fromveur (Finistère) et le raz Blanchard (Manche). ? (Pierre Le Hir, La France peut-elle rattraper son retard dans les énergies renouvelables ?, Le Monde. Mis en ligne le 8 février 2018)
-
(Histoire) Système de perception des impôts dans lequel le fonctionnaire (fermier) payait d'avance une somme forfaitaire au roi, pour ensuite se payer en percevant les sommes dues, la différence formant son salaire.
- La ferme des gabelles, la ferme générale.
-
(Zoologie) Type particulier de parc animalier, ouvert à la visite du public, spécialement dans un zoo.
- La ferme du zoo présente toutefois une alternative intéressante avec la présentation des animaux domestiques en liberté. ? (Dominique Desforges, Guide des parcs de loisirs français et étrangers 1990, Hatier - Rageot, Paris, 1990, page 229)
- Le type de dispositif qu'on retrouve systématiquement est fondé sur un regard, clairement orienté depuis un centre qui s'affiche peu en représentation (Europe puis Amérique du Nord), parce qu'il est essentiellement le même et le quotidien pour les spectateurs : ainsi pas de chats ou d'animaux familiers, et présentation des vaches ou des moutons dans la ferme du zoo (c'est-à-dire hors des collections normales). ? (Jean Estebanez, « Le zoo comme dispositif spatial : mise en scène du monde et de la juste distance entre l'humain et l'animal », L'Espace géographique, volume 39, n° 2, Belin, Paris, 2010, page 175)
Littré
-
1Qui a de la consistance, de la dureté, par opposition à mou. Un terrain ferme. Un gâteau de pâte ferme. Ce poisson a la chair ferme.
Comme les os se rendent plus fermes dans les endroits des ruptures
, Bossuet, Sermons, jubilé, Pénitence, I.La terre ferme, le continent, ce qui n'est pas entouré d'eau, par opposition aux îles.
Les vaisseaux s'abordaient par la proue?; on abaissait de part et d'autre des ponts-levis, et on se battait comme en terre ferme
, Voltaire, M?urs, 75.Particulièrement. Terre ferme, la partie des États de Venise qui était située sur le continent, par opposition à Venise et aux îles. Les nobles de terre ferme.
-
2Qui tient fixement. Ce plancher est ferme.
[La paix]? Et de la majesté des lois Appuyant les pouvoirs suprêmes, Fait demeurer les diadèmes Fermes sur la tête des rois
, Malherbe, III, 2.La mer est dans un état ferme d'équilibre?; et, si, comme il est difficile d'en douter, elle a recouvert autrefois des continents aujourd'hui fort élevés au-dessus de son niveau, il faut en chercher la cause ailleurs que dans le défaut de stabilité de son équilibre
, Laplace, Exp. IV, 12.Fig.
Je ne sais s'il y a moyen de donner des règles fermes pour accorder les discours à l'inconstance de nos caprices
, Pascal, Pensées, I, 3.Pour m'attacher à vous par de plus fermes n?uds
, Th. Corneille, Ariane, II, 4.Il ne pouvait y avoir de paix ferme et durable que celle où toutes les parties trouvaient un avantage égal
, Rollin, Hist. anc. ?uvres, t. v, p. 381, dans POUGENS.La justice, plus exactement rendue sous le règne d'Élisabeth que sous aucun de ses prédécesseurs, fut un des fermes appuis de son administration
, Voltaire, M?urs, 168.Orbassan de nos lois est le plus ferme appui
, Voltaire, Tancr. I, 1. -
3Qui se tient sans chanceler. Être ferme sur ses pieds, à cheval.
Être ferme sur ses étriers, se tenir d'aplomb à cheval.
Fig. Défendre son sentiment, être immuable dans sa résolution.
De pied ferme, loc. adv. Sans reculer. Attendre de pied ferme l'ennemi. Combattre de pied ferme.
Contre nous de pied ferme ils tirent leurs alfanges
, Corneille, Cid, IV, 3.En un sens particulier. Sans bouger d'un lieu. Il y a deux heures que je vous attends ici de pied ferme.
Dans les man?uvres militaires, conversion de pied ferme, conversion dont le pivot est fixe.
Fig. et familièrement. Attendre quelqu'un de pied ferme, l'attendre avec la résolution de lui résister, témoigner qu'on ne le craint pas.
Terme de droit coutumier. Pied ferme. héritage affermé à longues années.
Un pas ferme, un pas dans lequel le pied se pose avec solidité sur le sol.
Fig.
Avide de travaux, insensible aux délices, Il marchait d'un pas ferme au bord des précipices
, Voltaire, Henr. IX.Terme de manége. Un cheval saute de ferme à ferme, il saute dans la même place.
-
4Vigoureux, fort. Avoir la main ferme, les reins fermes.
L'artère, qui devait avoir un battement si continuel et si ferme
, Bossuet, Connaiss. II, 8.À la paume, avoir le coup ferme, pousser vigoureusement la balle.
Avoir la main ferme, signifie aussi avoir une main qui ne tremble pas. Cet enfant, lorsqu'il écrit, n'a pas la main ferme.
Fig. Tracer d'une main ferme le tableau d'une époque, le portrait d'un personnage, etc. raconter ces événements, faire ce portrait, etc. dans un style ferme.
Il se dit dans un sens analogue de la santé.
Malgré une constitution très ferme et une vie toujours très réglée, M. Méry se sentit tout d'un coup abandonné de ses jambes vers l'âge de soixante-quinze ans
, Fontenelle, Méry.Le baron?: Votre santé, monsieur?? - Forlis?: Assez ferme?; et la tienne??
Boissy, Dehors tromp. II, 10. -
5Termes d'arts et de littérature. Qui a le caractère de la vigueur. Un burin ferme. Manière, exécution ferme. Le jeu de ce musicien est ferme.
Style ferme, style qui a de la concision et de la force.
-
6 Fig. Qui a de la solidité morale, qui ne se laisse ni changer ni détourner.
L'esprit sacré qui te conseille Est ferme en ce qu'il a promis
, Malherbe, VI, 2.Vous paraissiez plus ferme en vos intentions
, Corneille, Cinna, III, 2.Oui, je lui dois assez, seigneur, quoi qu'il en soit, Pour vous payer pour lui de l'amour qu'il vous doit?; Et je vous le promets, entier, ferme et sincère
, Corneille, Héracl. v, 3.Il [Annibal] m'a surtout laissé ferme en ce point D'estimer beaucoup Rome et ne la craindre point
, Corneille, Nicom. II, 3.Je l'ai toujours connu ferme dans son devoir
, Corneille, ?dipe, III, 4.Le plus ferme souvent manque à ce qu'il propose
, Rotrou, Herc. mour. I, 6.Sitôt qu'il crut son fils ferme dans son devoir
, La Fontaine, Oies.Tous les hommes ensemble ont été fermes dans cette pensée, sans que jamais personne y ait contredit jusqu'à ce temps
, Pascal, Pesant. de l'air, Conclusion.Un c?ur?noble pour s'élever au-dessus des passions et des intérêts, tendre pour assister les malheureux, ferme pour résister à l'iniquité
, Fléchier, Lamoignon.Crois-tu que, toujours ferme au bord du précipice, Elle [la femme] marche toujours sans que le pied lui glisse??
Boileau, Sat. X.Je demeure ferme dans le dessein de quitter?
, Maintenon, Lett. à l'abbé Gobelin, 6 août 1674.Louis avait le c?ur ferme et l'esprit timide
, Duclos, Hist. Louis XI, ?uv. t. III, p. 358, dans POUGENS.Avec une âme juste et ferme, j'ai désiré que mon enfant eût un esprit droit, éclairé, étendu
, Diderot, Lett. à la comtesse de Coerbach, ?uv. t. III, p. 446, dans POUGENS.Deux cents de nos guerriers, amis fermes et sûrs
, Delavigne, Vêpr. sicil. III, 6.Rester ferme, ne pas changer d'opinion.
Mon bon homme, qui avait tant d'envie de voir le roi, resta ferme?: je crains les monopoleurs, dit-il
, Voltaire, Polit. et législation, Diatribe à l'auteur des éphém.En un sens péjoratif.
Le ladre a été ferme à toutes les attaques
, Molière, l'Av. II, 6. -
7 Particulièrement. Qui ne se laisse point abattre par l'adversité, intimider par le péril. Une âme ferme.
L'ébranlement sied bien aux plus fermes courages
, Corneille, Hor. I, 1.Il [Valentinien] était chaste, libéral, humain, ferme dans la mauvaise fortune, et modéré dans la bonne
, Fléchier, Hist. de Théod. IV, 34.Je vous crois fort au-dessus des revers que vous avez essuyés?; toutes les âmes nobles sont fermes
, Voltaire, Lett. de la Borde, 16 avr. 1770. -
8Il se dit des choses en un sens analogue. Une volonté ferme. Une ferme espérance. Une foi ferme.
La vertu la plus ferme évite les hasards
, Corneille, Poly. II, 4.C'est peut-être un dessein mal ferme que le sien
, Corneille, Sertor. IV, 1.Louis XIV, après huit ans de désastres dans la guerre de la succession d'Espagne, prit la résolution ferme d'aller combattre lui-même à la tête de ce qui lui restait de troupes, quoique à l'âge de soixante-dix années
, Voltaire, M?urs, Fragm. sur l'hist. art. XVIII.Des actions fermes et des paroles simples, voilà le vrai caractère des anciens Romains
, Voltaire, Comm. sur Corn. Rem. Pompée.Avoir le jugement ferme, l'esprit ferme, la tête ferme, avoir l'esprit solide et droit.
Qui révèle de la fermeté. Regard, contenance, voix ferme.
Voilà Ulysse lui-même?; voilà ses yeux pleins de feu et dont le regard était si ferme
, Fénelon, Tél. IX. -
9 Terme de commerce et de bourse. Marché, achat, vente ferme, marché, achat, vente qui emporte obligation de faire ou de prendre livraison.
Ferme contre prime, ou opération ferme contre prime, vente ferme et achat à prime.
Terme d'administration. Marché à prix ferme, marché passé par les ministres avec les fournisseurs pour les approvisionnements de l'armée, etc.
-
10Ferme, adv. D'une manière ferme, fortement. Tenir quelque chose bien ferme. Frapper ferme.
Se tenir ferme, se tenir solidement.
Polyclète, se penchant trop sur ses chevaux, ne put se tenir ferme dans une secousse, il tomba
, Fénelon, Tél. v.Nous nous tenions ferme, de peur que, dans cette violente secousse [des vagues], le mât qui était notre unique espérance ne nous échappât
, Fénelon, ib. VI.Faire ferme, s'arrêter dans une retraite, et tenir tête à l'ennemi.
Le général Stenau fit ferme avec deux régiments
, Voltaire, Charles XII, 2.Fig.
[Il] Fit ferme quelque temps et puis se démentit
, Tristan, M. de Chrispe, I, 3.Il faut faire ici ferme et montrer du courage
, Corneille, ?dipe, v, 4.Il se dit aussi de la solidité d'un terrain.
Vous trouverez de la consistance au milieu de l'inconstance des choses humaines? vous demeurerez immuables comme si tout faisait ferme sous vos pieds
, Bossuet, Panég. St Benoît, 2.Tenir ferme, opposer une résistance vigoureuse.
Toutefois il tient ferme et nous montre visage
, Du Ryer, Scévole, I, 3.Tantôt, sur les rives de la Loire, suivi d'un petit nombre d'officiers et de domestiques, il court à la défense d'un pont, et tient ferme contre une armée
, Fléchier, Turenne.Il tient ferme pourtant et ne perd point courage
, Racine, Théb. v, 3.Fig. Il tint ferme contre la critique.
En tout cas, je suis très assuré que vous tiendrez ferme au milieu des ruines publiques
, Guez de Balzac, liv. I, lett. 3.Qu'il tienne ferme pour faire observer les lois
, Fénelon, Tél. XI.Tenir ferme, ne pas renoncer à, ne pas abandonner.
Tenons ferme dans l'espérance
, Bossuet, Sermons, Ascension. 1.Parler ferme à quelqu'un, lui parler avec force, et de manière à lui en imposer.
Vous me parlez bien ferme, et cette suffisance?
, Molière, Mis. I, 2.Fort et ferme, avec force, avec ardeur, avec appétit, etc.
On disputera fort et ferme de part et d'autre
, Molière, Critique, 8.Comme il sentait une grande faim à son réveil, il mangea fort et ferme
, Hamilton, Gramm. 9.Ferme, loc. interj. qui s'emploie pour exciter, encourager.
Allons, ferme?! poussez, mes bons amis de cour
, Molière, Mis. II, 5.Ferme?! continuez à ne vous pas entendre
, Lachaussée, Préjugé à la mode, I, 4.
HISTORIQUE
XIIe s. Tant ai en li [elle] ferm assis mon corage, Qu'aillors [je] ne pense?
, Couci, XI.
XIIIe s. Il lit le bref, car il rest [est] clers [clerc], Et de bien lire et haus et fers
, Partonop. v. 2741. L'on li amaine un bon ceval? Bien afernés [garni de frein] et aaisiés, Et fers et en dos et en piés
, ib. v. 9634. Quant ferme fut la pais et la guerre fenie
, Audefroi le Bastard, Romancero, p. 12. La covenance [la promesse] est moult grans, ne je ne puis maintenant veoir ne penser comment elle puisse estre ferme
, Villehardouin, LXXXVI. De peine et de travail [elle] dort si ferm et si dur
, Berte, XLI. À Socrates seras semblables, Qui tant fu fers et tant estables, Qu'il n'ert liés [gai] en prosperités, Ne tristes en aversités
, la Rose, 5872.
XIVe s. Dieu doint à nostre duc faire tele aiance De gens fermes, entiers, et de si grant puissance, Que des anemis puissent prendre entiere vengeance, Complainte sur la bat. de Poitiers
, Bibl. des chartes, 3e série, t. II, p. 263. Vertu est une ferme qualité de l'ame, par laquelle qualité nous sommes enclins à eslire le moyen entre excès et deffaute
, Oresme, Eth. 46.
XVIe s. S'estant fichez la vue ferme l'un contre l'aultre
, Montaigne, I, 102. Il fault avoir les reins fermes pour entreprendre de?
, Montaigne, I, 55. Je marche plus seur et plus ferme à mont qu'aval
, Montaigne, I, 161. Une viande massive et ferme [une nourriture solide]
, Montaigne, I, 189. J'avois une santé ferme et entiere
, Montaigne, I, 195. Il le nioit fort et ferme
, Montaigne, I, 323. Les dogmatistes les plus fermes sont contraincts, en cet endroict, de?
, Montaigne, II, 304. Ce n'est point une isle, ains terre ferme et continente avecques?
, Montaigne, I, 232. Quand ce venoit à choquer de près à pied ferme, les ennemis avoient avantage sur eulx
, Amyot, Philop. 13. Il les rendit encore plus fermes en l'alliance des Romains
, Amyot, Flam. 30. Il fut contraint à faire quelque ferme, et là prit prisonniers de ceux qui le pressoient
, D'Aubigné, Hist. III, 232.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. FERME.Vendeur ferme, celui qui vend effectivement, par opposition à celui qui vend la marchandise sans l'avoir, et qui n'est que commissionnaire.
Fig. et par application du terme de bourse à la politique. Il y en a deux [propositions]?: l'une, celle de la commission, qui consent à la prorogation des pouvoirs, avec une condition suspensive?; l'autre, qui vous demande la prorogation ferme, toujours avec la perspective des lois constitutionnelles?; mais cette condition n'altérera pas le caractère définitif de la prorogation des pouvoirs
, Journ. offic. 19 nov. 1873, p. 7040, 2e col. ? et qu'il vous demande de le proroger dès à présent, d'une manière ferme, qu'il advienne ou qu'il n'advienne pas de constitution
, J. Grévy, Journ. offic. 20 nov. 1873, p. 7082, 2e col.
Les fouilles faites à l'extérieur de la première tour furent poussées à quatre mètres de profondeur pour atteindre le ferme, Rev. d'anthr. t. IV, p. 507.
Encyclopédie, 1re édition
FERME, adj. (Physiq.) On appelle corps ferme, celui dont les parties ne se déplacent pas par le toucher. Les corps de cette espece sont opposés aux corps fluides, dont les parties cedent à la moindre pression ; & aux corps mous, dont les parties se déplacent aisément par une force très-médiocre. Voy. Fluide. Les corps fermes sont appellés plus ordinairement corps solides ; cependant ce mot solide ne me paroît pas exprimer aussi précisément la propriété dont il s'agit, pour plusieurs raisons : 1°. parce que le mot solide se prend encore en d'autres acceptions ; soit pour désigner les corps géométriques, c'est-à-dire l'étendue considérée avec ses trois dimensions ; soit pour désigner l'impénétrabilité des corps, & pour les distinguer de l'étendue pure & simple, auquel cas solide peut se dire également des corps fluides : 2°. parce que le mot solide se dit en général de tout corps qui n'est pas fluide ; soit que ce corps soit mou, soit qu'il soit dur ; & en ce sens on peut dire de la cire, de la glaise, qu'elle est corps solide, mais on ne dira pas qu'elle est un corps ferme. Le mot ferme me paroît donc devoir être préféré dans l'acception présente ; cependant l'usage a prévalu.
La fermeté des corps n'est proprement qu'une dureté plus ou moins grande ; & par conséquent la cause en est aussi inconnue que celle de la dureté. Voyez Dureté. Il faut distinguer la fermeté des corps durs proprement dits, de celle des corps élastiques. Les premiers gardent constamment leur figure, quelque choc qu'ils éprouvent ; les seconds la changent par le choc, mais la reprennent aussi-tôt. Voyez Elastique, Ressort, Percussion, &c. (O)
Ferme, s. m. (Jurispr.) dans la basse latinité firma, est un domaine à la campagne, qui est ordinairement composé d'une certaine quantité de terres labourables, & quelquefois aussi de quelques prés, vignes, bois, & autres héritages que l'on donne à ferme ou loyer pour un certain tems, avec un logement pour le fermier, & autres bâtimens nécessaires pour l'exploitation des héritages qui en dépendent.
Quelquefois le terme de ferme est pris pour la location du domaine ; c'est en ce sens que l'on dit donner un bien à ferme, prendre un héritage ou quelque droit à ferme ; car on peut donner & prendre à ferme non-seulement des héritages, mais aussi toutes sortes de droits produisant des fruits, comme dixmes, champarts, & autres droits seigneuriaux, des amendes, un bac, un péage, &c.
Quelquefois aussi par le terme de ferme. on entend seulement l'enclos de bâtimens destinés pour le logement du fermier & l'exploitation des héritages.
Les uns pensent que ce terme ferme vient de firma, qui dans la basse latinité signifie un lieu clos ou fermé : c'est pourquoi M. Ménage observe que dans quelques provinces on appelle enclos, clôture, ou closerie, ce que dans d'autres pays on appelle ferme.
D'autres tiennent que donner à ferme, locare ad firmam, signifioit assûrer au locataire la joüissance d'un domaine pendant quelque tems, à la différence d'un simple possesseur précaire, qui n'en joüit qu'autant qu'il plaît au propriétaire. On disoit aussi donner à main-ferme, dare ad manum firmam ; parce que le pacte firmabatur manu donatorum, c'est-à-dire des bailleurs : mais la main ferme attribuoit aux preneurs un droit plus étendu que la simple ferme, ou ferme muable. La main-ferme étoit à-peu-près la même chose que le bail à cens, ou bail emphitéotique. Voyez Main-Ferme & Fief-Ferme.
Spelman & Skinner dérivent le mot ferme du saxon fearme ou feorme, c'est-à-dire victus ou provisions ; parce que les fermiers & autres habitans de la campagne payoient anciennement leurs redevances en vivres & autres denrées ou provisions. Ce ne fut que par la suite qu'elles furent converties en argent ; d'où est venue la distinction qui est encore usitée en Normandie, des simples fermes d'avec les fermes blanches. Les premieres sont celles dont la redevance se paye en denrées : les autres, celles qui se payent en monnoie blanche ou argent.
Spelman fait voir que le mot fitma signifioit autrefois non-seulement ce que nous appellons ferme, mais aussi un repas ou entretien de bouche que le fermier fournissoit à son seigneur ou propriétaire pendant un certain tems & à un certain prix, en considération des terres & autres héritages qu'il tenoit de lui.
Ainsi M. Lambard traduit le mot fearm qui se trouve dans les lois du roi Canut par victus, & ces expressions reddere firmam unius noctis, & reddebat unum diem de firma, signifient des provisions pour un jour & une nuit. Dans le tems de la conquête de l'Angleterre par le roi Guillaume, toutes les redevances qu'on se reservoit étoient des provisions. On prétend que ce fut sous le regne d'Henri premier que cette coûtume commença à changer.
Une ferme peut être loüée verbalement ou par écrit, soit sous seing privé, ou devant notaire. Il y a aussi certaines fermes qui s'adjugent en justice, comme les baux judiciaires & les fermes du roi.
L'acte par lequel une ferme est donnée à loüage, s'appelle communément bail à ferme. Ce bail ne peut être fait pour plus de neuf années ; mais on peut le renouveller quelque tems avant l'expiration d'icelui. Voyez Bail.
Celui qui loue sa ferme s'appelle bailleur, propriétaire, ou maître ; & celui qui la prend à loyer, le preneur ou fermier. La redevance que paye le fermier s'appelle fermage, pour la distinguer des loyers qui se payent pour les autres biens.
Les gentilshommes laïcs peuvent sans déroger se rendre adjudicataires ou cautions des fermes du roi. Voyez ci-après Fermes du Roi. Ils peuvent aussi tenir à ferme les terres & seigneuries appartenantes aux princes & princesses du sang.
Mais il est défendu aux gentilshommes & à ceux qui servent dans les troupes du roi, de tenir aucune ferme, à peine de dérogeance pour ceux qui sont nobles, & d'être imposés à la taille.
Les ecclésiastiques ne peuvent aussi sans déroger à leurs priviléges, tenir aucune ferme, si ce n'est celle des dixmes, lorsqu'ils ont déjà quelque droit aux dixmes, parce qu'en ce cas on présume qu'ils n'ont pris la ferme du surplus des dixmes, que pour prévenir les difficultés qui arrivent souvent entre les co-décimateurs & leurs fermiers. Voyez Dixmes.
En Droit, le propriétaire des fermes des champs n'a point de privilége sur les meubles de son fermier appellés invecta & illata, à cause que les fruits lui servent de gage.
Mais la coûtume de Paris, article 171, & quelques autres coûtumes semblables, donnent au propriétaire un privilége sur les meubles pour les fermes comme pour les maisons.
Le privilége du propriétaire sur les fruits provenant de sa ferme, a lieu non-seulement pour l'année courante, mais aussi pour les arrérages précédens : néanmoins il n'est préféré aux collecteurs que pour une année.
L'héritier du propriétaire ou autre successeur à titre universel, est obligé d'entretenir le bail à ferme passé par son auteur ; le fermier, son héritier ou légataire universel, la veuve du fermier comme commune, sont aussi obligés d'entretenir le bail de leur part : ainsi le vieux proverbe françois qui dit que mort & mariage rompent tout loüage, est absolument faux.
La vente de l'héritage affermé rompt le bail à ferme, à moins que l'acquéreur ne se soit obligé de laisser joüir le fermier, ou qu'il n'ait approuvé tacitement le bail ; mais en cas de dépossession du fermier, il a son recours contre le propriétaire pour ses dommages & intérêts.
La contrainte par corps peut être stipulée pour les fermes des champs, mais elle ne se supplée point si elle n'y est pas exprimée ; & les femmes veuves ou filles ne peuvent point s'obliger par corps, même dans ces sortes de baux.
Un fermier n'est pas reçû à faire cession de biens, parce que c'est une espece de larcin de sa part, de consumer les fruits qui naissent sur le fonds sans payer le propriétaire.
On peut faire résilier le bail quand le fermier est deux ans sans payer : il dépend néanmoins de la prudence du juge de donner encore quelque tems. Le fermier peut aussi être expulsé, lorsqu'il dégrade les lieux & les héritages : mais le propriétaire ne peut pas expulser le fermier pour faire valoir sa ferme par ses mains ; comme il peut expulser un locataire de maison pour occuper en personne.
Le fermier doit joüir en bon pere de famille, cultiver les terres dans les tems & saisons convenables, les fumer & ensemencer, ne les point dessoler, & les entretenir en bon état, chacune selon la nature dont elles sont ; il doit pareillement faire les réparations portées par son bail.
Il ne peut pas demander de diminution sur le prix du bail, sous prétexte que la récolte n'a pas été si abondante que les autres, quand même les fruits ne suffiroient pas pour payer tout le prix du bail ; car comme il profite seul des fertilités extraordinaires, sans que le propriétaire puisse demander aucune augmentation sur le prix du bail, il doit aussi supporter les années stériles.
Il supporte pareillement seul la perte qui peut survenir sur les fruits après qu'ils ont été recueillis.
Mais si les fruits qui sont encore sur pié sont entierement perdus par une force majeure, ou que la terre en ait produit si peu qu'ils n'excedent pas la valeur des labours & semences ; en ce cas le fermier peut demander pour cette année une diminution sur le prix de son bail, à moins que la perte qu'il souffre cette année ne puisse être compensée par l'abondance des précédentes ; ou bien, s'il reste encore plusieurs années à écouler du bail, on peut en attendre l'évenement pour voir si les fruits de ces dernieres années ne le dédommageront pas de la stérilité précédente ; & en ce cas on peut suspendre le payement du prix de l'année stérile, ou du moins d'une partie, ce qui dépend de la prudence du juge & des circonstances.
S'il étoit dit par le bail que le fermier ne pourra prétendre aucune diminution pour quelque cause que ce soit, cela n'empêcheroit pas qu'il ne pût en demander pour raison des vimaires ou forces majeures ; parce qu'on présume que ce cas n'a pas été prévû par les parties : mais si le bail portoit expressément que le fermier ne pourra prétendre aucune diminution, même pour force majeure & autres cas prévûs ou non-prévûs, alors il faudroit suivre la clause du bail.
Dans les baux à moison, c'est-à-dire où le fermier au lieu d'argent rend une certaine portion des fruits, comme la moitié ou le tiers, il ne peut prétendre de diminution sous prétexte de stérilité, n'étant tenu de donner des fruits qu'à proportion de ce qu'il en a recueilli : mais s'il étoit obligé de fournir une certaine quantité fixe de fruits, & qu'il n'en eût pas recueilli suffisamment pour acquitter la redevance, alors il pourroit obtenir une diminution, en observant néanmoins les mêmes regles que l'on a expliquées ci-devant par rapport aux baux en argent.
Suivant l'article 142 de l'ordonnance de 1629, les fermiers ne peuvent être recherchés pour le prix de leur ferme cinq années après le bail échû : mais cette loi est peu observée, sur-tout au parlement de Paris ; & il paroît plus naturel de s'en tenir au principe général, que l'action personnelle résultante d'un bail à ferme dure 30 ans.
La tacite reconduction pour les baux à ferme, est ordinairement de trois ans, afin que le fermier ait le tems de recueillir de chaque espece de fruits que doit porter chaque sole ou saison des terres ; ce qui dépend néanmoins de l'usage du pays pour la distribution des terres des fermes.
Le premier bail à ferme étant fini, la caution ne demeure point obligée, soit au nouveau bail fait au même fermier, soit pour la tacite reconduction s'il continue de joüir à ce titre. Perezius, ad cod. de loc. cond. n. 14. Voyez au ff. le titre locati conducti, & au code celui de locato conducto ; les instit. d'Argou, tom. II. liv. III. ch. xxvij. les maximes journalieres, au mot Fermier. (A)
Ferme, dans quelques coûtumes, signifie l'affirmation ou serment que le demandeur fait en justic
Trésor de la Langue Française informatisé
FERME1, adj., adv. et interj.
FERME2, subst. fém.
FERME3, subst. fém.
CONSTR. Assemblage de pièces de bois ou de métal destinées à porter le faîtage d'un toit. Un comble composé de fermes de tôle (Viollet-Le-Duc, Archit.,1872, p. 40).Fermé, ée au Scrabble
Le mot fermé, ée vaut 11 points au Scrabble.
Informations sur le mot ferme--ee - 7 lettres, 4 voyelles, 3 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot fermé, ée au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
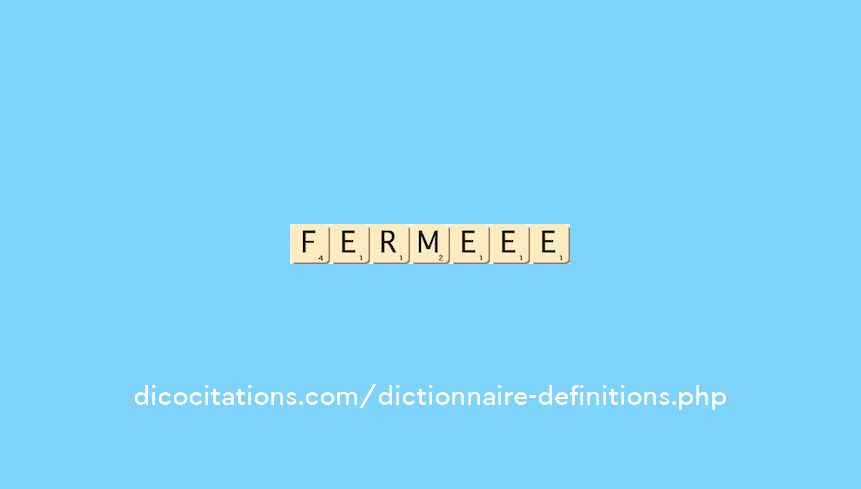
Les mots proches de Fermé, ée
Fer Féra Féret Fériable Férial, ale Férie Férir Ferler Fermail Fermant, ante Ferme Ferme Ferme Fermé, ée Fermement Ferment Fermentable Fermentation Fermenter Fermentescible Fermer Fermeté Fermette Fermeture Fermier, ière Fermoir Fermure Féroce Férocement Férocité Ferouer Ferrade Ferrage Ferraille Ferrailler Ferrandaise Ferré, ée Ferrement Ferre-mule Ferrer Ferret Ferreur Ferron Ferronnerie Ferrugineux, euse Ferruginosité Ferrure Fertile Fertilement Fertilisation fer fer-blanc fera féra ferai feraient ferais ferait feras féras ferblanterie ferblantier ferblantiers Fercé Fercé-sur-Sarthe ferdinand Ferdrupt fère Fère Fère-Champenoise Fère-en-Tardenois Fèrebrianges Férée Férel ferez Ferfay feria féria ferias férias Féricy férié fériés feriez Férin ferions férir ferlage ferlée ferlez ferma fermage fermages fermai fermaient fermais fermait fermant fermant FermanvilleMots du jour
Généalogie Pannequet Plaqueur Mélodramatiser Écorage Salve Chyle Crieur, euse Fanatique Désassaisonner
Les citations avec le mot Fermé, ée
Les citations du Littré sur Fermé, ée
Les mots débutant par Fer Les mots débutant par Fe
Une suggestion ou précision pour la définition de Fermé, ée ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 05h26

- Facilite - Faible - Faiblesse - Faim - Faire - Fait - Famille - Fanatique - Fatalite - Fatigue - Faute - Faveur - Felicitations - Femme - Femme_homme - Ferocite - Fete - Fête des mamans - Fête des papas - Fête des mères - Fête des pères - Fidele - Fidèle - Fidelite - Fidélité - Fierte - Fille - Fils - Finalite - Finance - Flamme - Flatter - Flatterie - Fleur - Foi - Folie - Fonctionnaire - Foot - Football - Force - Fortune - Fou - Foule - Français - Française - France - Franchise - Fraternite - Frustation - Fuir - Futur
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur fermé, ée
Poèmes fermé, ée
Proverbes fermé, ée
La définition du mot Fermé, ée est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Fermé, ée sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Fermé, ée présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
