La définition de Car du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Car
Nature : conj.
Prononciation : kar
Etymologie : Picard (Ponthieu), gar ; provenç. quar, qar, car ; anc. catal. quar ; anc. espagn. car ; anc. ital. quare ; du latin quare, c'est pourquoi, mot à mot qua re, par laquelle chose, pour laquelle chose ; étymologie qui explique l'emploi de car dans l'ancienne langue ; soit qu'il signifie donc, comme dans ce vers : Compeing Roland, car sonnez vostre cor, c'est-à-dire, compagnon Roland, sonnez donc votre cor ; soit qu'il signifie pourquoi : et la cause est car telles choses ne sont pas....
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de car de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec car pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Car ?
La définition de Car
qui marque qu'on va donner la raison d'une proposition énoncée.
Toutes les définitions de « car »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
qui sert à marquer que l'on va donner la raison d'une proposition énoncée, ou l'énoncé d'un fait. Il ne faut pas faire telle chose, car Dieu le défend. Vous ne le trouverez pas chez lui, car je viens de le voir dans la rue.
Littré
- qui marque qu'on va donner la raison d'une proposition énoncée.
Vos pareils y sont misérables? Car, quoi?! rien d'assuré?! point de franche lippée?!
La Fontaine, Fabl. I, 5.Et tous deux vous paierez l'amende?: Car toi, loup, tu te plains quoiqu'on ne t'ait rien pris
, La Fontaine, ib. II, 3.C'est donc quelqu'un des tiens, Car vous ne m'épargnez guère
, La Fontaine, ib. I, 10.J'ai plus gagné que perdu?; Car d'hymen point de nouvelles
, La Fontaine, ib. I, 17.Les vieillards déploraient ces sévères destins?; Les animaux périr?! car encor les humains [passe encore pour les hommes qui avaient mérité de périr]
, La Fontaine, Philémon et Bauc.Non, je ne reviens pas, car je n'ai pas été?; Je ne vais pas aussi, car je suis arrêté?; Je ne demeure point, car tout de ce pas même Je prétends m'en aller
, Molière, Dépit, I, 4.Car [il avait été question parmi les puristes de supprimer car comme mot vieilli] étant d'une si grande considération dans notre langue, j'approuve extrêmement le ressentiment que vous avez du tort qu'on lui veut faire?; et je ne puis bien espérer de l'Académie dont vous me parlez, voyant qu'elle se veut établir par une grande violence?; en un temps où la fortune joue des tragédies par tous les endroits de l'Europe, je ne vois rien si digne de pitié que quand je vois que l'on est prêt de chasser et faire le procès à un mot qui a si utilement servi cette monarchie et qui, dans toutes les brouilleries du royaume, s'est toujours montré bon français?; pour moi, je ne puis comprendre quelles raisons ils pourront alléguer contre une diction qui marche toujours à la tête de la raison et qui n'a point d'autre charge que de l'introduire?; je ne sais pour quel intérêt ils tâchent d'ôter à car ce qui lui appartient, pour le donner à pour ce que, ni pourquoi ils veulent dire avec trois mots ce qu'ils peuvent dire avec trois lettres
, Voiture, Lett. 53.Gomberville?: Que ferons-nous, messieurs, de car et de pourquoi?? Desmarets?: Que deviendrait sans car l'autorité du roi?? Gomberville?: Le roi sera toujours ce que le roi doit être, Et ce n'est pas un mot qui le rend notre maître. Gombaud?: Beau titre que le car au suprême pouvoir, Pour prescrire aux sujets la règle et le devoir. Desmarets?: Je vous connais, Gombaud, vous êtes hérétique, Et partisan secret de toute république. Gombaud?: Je suis fort bon sujet et le serai toujours, Près de mourir pour car après un tel discours. Desmarets?: De car viennent les lois, sans car point d'ordonnance, Et ce ne serait plus que désordre et licence
, la Comédie des Académiciens, III, 3, dans RICHELET.Substantivement.
Les si, les car, les contrats sont la porte Par où la noise entra dans l'univers
, La Fontaine, Belphég.
HISTORIQUE
Xe s. Car ço videbant per spiritum prophete
, Frag. de Valenc. p. 468.
XIe s. Car, puisque serement li est jugied?
, L. de Guill. 25. Franc chevalier, car m'eslisez baron
, Ch. de Rol. XI. Emprès lui dient?: Sire, car nous menez
, ib. XXVI.
XIIe s. Ne poit durer que Charlles ne le tienne?; Car il n'a homme?
, Roncisv. 1. Alez seoir, car je vous en semon
, ib. 12. Compeing Rolant, car sonez vostre cor
, ib. 45. Car joie a courte durée Qui avient par tel folor
, Couci, I. Diex?! car la peüsse tenir Un seul jour à ma volenté?!
ib. III.
XIIIe s. Sire, voici l'ost? quar leur criez merci que il aient de toi pité
, Villehardouin, XLII. Car nus [nul] ne vient à vie [qui] ne conviene finer
, Berte, III. Et car me secourez, mere Dieu beneoite
, ib. XXIX.
XIVe s. À plusieurs gens sont aucunes choses delettables qui sont contraires l'une à l'autre, et la cause est car [que] telles choses ne sont pas naturellement delettables
, Oresme, Eth. 19. Et la cause pour quoy nous ne conseillons pas des choses dessus dites est car [que] nule de elles n'est faite par nous
, Oresme, ib. 66.
XVIe s. À quoy Indathyrses, car ainsi se nommoit-il?
, Montaigne, I, 49. Il parla tout haut de servir le roi sans si et sans car, et puis d'aller au conseil pour mettre la main à la besongne
, D'Aubigné, Hist. III, 187. Les deux commissions furent scellées extraordinairement, car en [car elles le furent dans] la chambre de M. le chancelier, n'estant encores M. de Humieres mort
, Carloix, VI, 10.
Wiktionnaire
Conjonction - ancien français
car \Prononciation ?\
- Car, parce que.
Conjonction de coordination - français
car \ka?\ invariable
- Introduit une explication, une raison, une cause à une proposition.
- Vous ne le trouverez pas chez lui, car je viens de le voir dans la rue.
- [...]?et tout l'appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin. ? (Gustave Flaubert, Trois Contes, 1877)
- Encore fallait-il savoir quand, où, et comment, nous prenions le risque de contrevenir aux lois de l'Église, notre mère fouettarde. Car en cas de flagrant délit, on nous promettait la géhenne, on imaginait de vertigineuses oubliettes où seraient jetés les coupables. ? (Jérome Garçin, « Confesser ses péchés », dans Les huit péchés capitaux, présentation de Jérome Garçin, Editions Complexe, 1991, p. 9)
Nom commun 2 - français
car \ka?\ masculin
-
(Programmation) La première partie du doublet en LISP, qui est le premier élément dans une liste.
- Il nous faut donc être capable de s'electionner tous les cars et tous les cdrs d'un ensemble de listes : [?] ? (Jean-Jacques Girardot, Introduction à la programmation fonctionnelle par Scheme, L'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, 1993)
-
[?] principe de base :
? chaque élément de la liste est représenté dans un doublet ;
? le car du doublet contient l'élément lui-même ;
? le cdr du doublet pointe sur le doublet suivant dans la liste ;
? le cdr du dernier doublet signale la fin de la liste par le marqueur de fin de liste,'(). ? (Laurent Bloch et Jacques Arsac, Initiation à la programmation avec Scheme, 2000, page 84)
Nom commun 1 - français
car \ka?\ masculin
- (Transport) Grand véhicule automobile utilisé pour le transport en commun de voyageurs, en particulier pour les transports interurbains ou les transports exceptionnels (pour les lignes régulières urbaines, on préfère généralement employer le mot bus ou autobus).
Trésor de la Langue Française informatisé
CAR1, conj. de coordination.
Conj. de coordination introduisant une prop. qui explique ou justifie ce qui vient d'être énoncé.CAR2, subst. masc.
Car au Scrabble
Le mot car vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot car - 3 lettres, 1 voyelles, 2 consonnes, 3 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot car au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
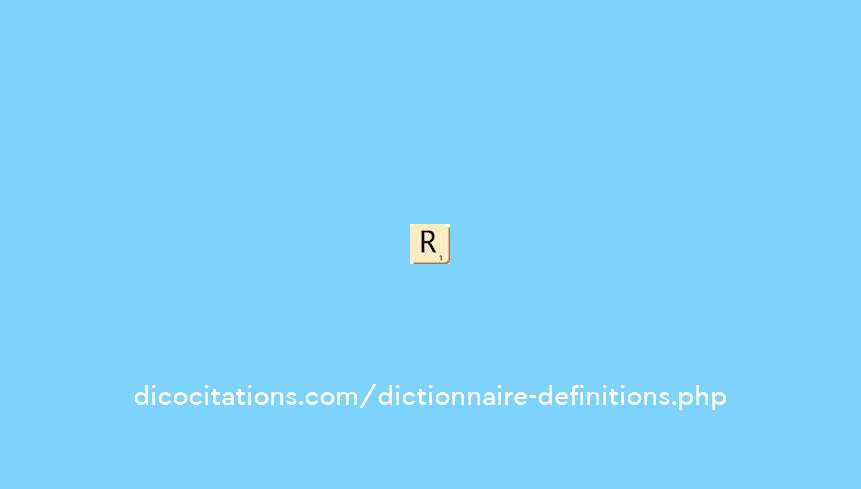
Les mots proches de Car
Car Carabas Carabé Carabin Carabinade Carabine Carabiné, ée Carabinier Caraco Caracole Caracoler Caracore Caractère Caractérisant, ante Caractérisé, ée Caractériser Caractéristique Caragueuse Caramel Caramélique Caramélisation Carapa Caraque Carasson Carat Caravane Caravanier Caravansérai ou caravansérail Caravelle Carbo-azotine Carbogène Carbonatation Carcajou Carcan Carcan Carcasse Carcinome Cardamome Carde Carder Cardeur, euse Cardeuse Cardiaque Cardinal, ale Cardinal Cardinalat Cardinaliser Cardon Carême Carême-prenant car car carabas carabe carabes carabin carabine carabiné carabinée carabines carabinés carabinier carabiniers carabins carabosse caracal caraco caracola caracolade caracolait caracolant caracolant caracole caracole caracolent caracoler caracolerez caracos caractère caractères caractériel caractérielle caractérielle caractérielles caractériels caractérisait caractérisant caractérisant caractérisation caractérise caractérisé caractérisé caractérisée caractérisée caractérisées caractérisent caractériser caractériserais caractériserait caractérisésMots du jour
-
pervenche maquereaux boudinées courtisais chorégraphiques fléchissions sauvageries débiterai dits plantions
Les citations avec le mot Car
- Les barbares descocherent en si grande fureur, qu'ilz escarterent ceux qui besoignoient aux trenchées.Auteur : Jacques Amyot - Source : Sylla, 46
- Ils apprirent comment on clarifie le sucre et les différentes sortes de cuites, le grand et le petit perlé, le soufflé, le boulé, le morve et le caramel.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Bouvard et Pécuchet (1881)
- J'aborde aussi le problème du temps car, malheureusement, nous vivons dans une société où le temps est compté. Le temps pour la communication, le temps pour vivre, pour s'amuser... Le temps en prison est un temps qui passe très vite. Auteur : Massimo Carlotto - Source : Interview Massimo Carlotto - Propos recueillis par Héloïse Padovani et Mikaël Demets pour Evene.fr - Avril 2006
- Personne ne sait parler de la mort, et c'est peut-être la définition la plus exacte que l'on puisse en donner. Elle échappe aux mots, car elle signe précisément la fin de la parole. Celle de celui qui part, mais aussi celle de ceux qui lui survivent et qui, dans leur sidération, feront toujours de la langue un mauvais usage. Auteur : Delphine Horvilleur - Source : Vivre avec nos morts (2021)
- Pendant sa carrière militaire, il a souvent eut des couilles au cul... - Mais il faut bien avouer que ce n'était pas toujours les siennes!...Auteur : Georges Clemenceau - Source : Sans référence
- Ce fut une lutte puissante et une victoire misérable; car, à force de mépriser tout ce qui est, je conçus le mépris de moi-même, sotte et vaine créature, qui ne savais jouir de rien à force de vouloir jouir splendidement de toutes choses.Auteur : George Sand - Source : Lélia (1833)
- Avant la guerre, elle travaillait dans une fabrique de cartonnages, qui faisait des emboîtages pour des livres d'art, en carton fort recouvert de soie, de cuir ou de suédine, avec des titres frappés à froid.Auteur : Georges Perec - Source : La Vie mode d'emploi (1978)
- La vie, c'est comme un château de cartes. On met un temps infini à le construire, on essaie de poser des bases solides, on monte un étage après l'autre, et puis, un jour, tout s'effondre et quelqu'un les range dans une boîte. A quoi bon, vous pouvez me dire ? Auteur : Virginie Grimaldi - Source : Tu comprendras quand tu seras plus grande (2017)
- La situation se résume en trois lettres qui viennent la gifler. RSA. Un sigle abstrait qui s'incarne brutalement. Auteur : Laetitia Colombani - Source : Les victorieuses (2019)
- Le masque de la souffrance est le plus beau, car il est le plus vrai.Auteur : Roland Jaccard - Source : L'Ame est un vaste pays (1983)
- L'histoire se répète de manière caricaturale. Avant de me dire que c'est peut-être la répétition qui fait l'histoire. Auteur : Grégoire Bouillier - Source : Rapport sur moi (2002)
- Je regardais la mer qui, à cette heure, se soulevait à peine d’un mouvement épuisé et je rassasiais les deux soifs qu’on ne peut tromper longtemps sans que l’être se dessèche, je veux dire aimer et admirer.Car il y a seulement de la malchance à n’être pas aimé : il y a du malheur à ne point aimer. Nous tous, aujourd’hui, mourons de ce malheur. C’est que le sang, les haines décharnent le cœur lui-même ; la longue revendication de la justice épuise l’amour qui pourtant lui a donné naissance. Dans la clameur où nous vivons, l’amour est impossible et la justice ne suffit pas. C’est pourquoi l’Europe hait le jour et ne sait qu’opposer l’injustice à elle-même. Mais pour empêcher que la justice se racornisse, beau fruit orange qui ne contient qu’une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipasa qu’il fallait garder intactes en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l’injustice, et retourner au combat avec cette lumière conquise. Auteur : Albert Camus - Source : L’été, « Retour à Tipasa » (1952)
- J'ai compris que les hommes ne peuvent se satisfaire de rêves réalisés, car il reste toujours l'idée que tout peut être refait, en mieux.Auteur : John Michael Green - Source : Nos étoiles contraires (2013)
- Dans la baraque 35, j'ai constaté que les carreaux étaient cassés autant intérieurement qu'extérieurement.Auteur : Jean Louis Marcel Charles, dit Jean-Charles - Source : La Foire aux cancres continue (1962)
- Ayant ouvert une anthologie de textes religieux, je tombe d'emblée sur ce mot du Bouddha : Aucun objet ne vaut qu'on le désire. - j'ai fermé aussitôt le livre, car, après, que lire encore ?Auteur : Emil Cioran - Source : Aveux et anathèmes (1987)
- Quiconque n'a pas de caractère n'est pas un homme: c'est une chose.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Maximes et Pensées, Caractères et Anecdotes (1795)
- Car pour les pin-up - Il faut des pick-up.Auteur : Serge Gainsbourg - Source : La femme des uns sous le corps des autres
- Droit: Se dit d'un homme qui se contente du minimum, car un homme droit est un homme qui n'a pas d'évier.Auteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Car une fois choisie la seule action raisonnable, savoir s'enfuir au bout du monde, tout le problème était de s'en tenir là, de ne plus bouger, de ne plus agir, de ne pas accomplir autrement qu'en pensée le mouvement inverse.Auteur : Emmanuel Carrère - Source : La Moustache (1986)
- La louange fait rougir mais ne forge pas. Tout éloge nous surprend en flagrant délit d'immodestie car ce que nous en retenons est encore trop.Auteur : Robert Sabatier - Source : Le livre de la déraison souriante (1991)
- Vous seul au monde avez vu ce que je suis; car vous m'avez vue sous le coup d'un amour bien vrai et bien profond, puisqu'il est sans espoir; et qui n'a pas vu une femme amoureuse ne peut pas dire ce qu'elle est.Auteur : Théophile Gautier - Source : Mademoiselle de Maupin (1835)
- ... si tu veux absolument te marier, épouse un imbécile; car les hommes sensés savent trop bien quels monstres vous faites d'eux.Auteur : William Shakespeare - Source : Hamlet (1601)
- Je ne résiste jamais à la tentation car j'ai découvert que ce qui est mauvais pour moi ne me tente pas.Auteur : George Bernard Shaw - Source : Sans référence
- De Caroline, il restait des photos, des souvenirs de rien. Mais ce qui restait gravé, c'était le sentiment, l'os du sentiment que chacun éprouvait pour elle. Une chose indéfinissable et abstraite... Ce qui reste gravé, c'est le lien. Une chose physique.Auteur : Olivier Adam - Source : La Messe anniversaire (2003)
- Monsieur
Je souhaitrais vous rencontrer car j'ai l'impression que Nicolas me cache des devoirs et leçons
Salutations distinguées.Auteur : Patrice Romain - Source : Mots d'excuse - Les parents écrivent aux enseignants (2010), Les demandes diverses
Les citations du Littré sur Car
- Ah ! quel plaisir je vais prendre à faire sur son corps [un corps à disséquer] une incision cruciale et à lui ouvrir le ventre depuis le cartilage xiphoïde jusqu'aux os pubis !Auteur : HAUTEROCHE - Source : Crispin médecin, II, 4
- La souris ne sort de son trou que pour chercher à vivre ; elle ne s'en écarte guère, y rentre à la première alerte....Auteur : BUFF. - Source : Souris.
- Le dit messire Geffroy de Chargny s'en descouvrit bien secretement à aucuns chevaliers de Picardie qui tous furent de son accordAuteur : Jean Froissard - Source : I, I, 326
- Il [saint Paul] fist avuigler un mague, car il avoit le maligne esperit dou deableAuteur : BRUN. LATINI - Source : Trésor, p. 73
- On entendait par quadrille non-seulement quatre, mais six, huit et jusqu'à douze danseurs vêtus uniformément ou même de caractères différents, qui formaient des troupes particulières, lesquelles se succédaient et faisaient aussi succéder le cours de l'actionAuteur : CAHUSAC - Source : Dans. anc. et mod. 2e part. I, 3
- Ce style figuré dont on fait vanité Sort du bon caractère et de la véritéAuteur : Molière - Source : Mis. I, 2
- J'ai vengé le droit des rois et de toutes les puissances souveraines ; car elles sont toutes également attaquéesAuteur : BOSSUET - Source : 5e avert. 49
- Cela lui fit du bien à elle-même [Mme de Warens], en faisant diversion aux projets, et tenant écartés les projeteursAuteur : J. J. ROUSSEAU - Source : Conf. v.
- Les ordres que j'ai reçus m'ont obligé de partir si précipitamment que j'eus à peine le temps de porter chez vous ma carteAuteur : P. L. COUR. - Source : Lett. I, 257
- Il faut nous flatter et nous caresser comme des enfants, pour nous tenir en bonne humeurAuteur : NICOLE - Source : dans BOUHOURS, Rem.
- Des actes de protestation et de nullité contre la future promotion des cardinaux, si elle n'était pour les couronnesAuteur : PELLISSON - Source : Lett. hist. t. II, p. 236
- Il les marqua sur le front d'un caractère de réprobationAuteur : MASS. - Source : Car. Médis.
- Une lucarne mal vitrée, Près d'une gouttière livrée à d'interminables sabbats, Où l'université des chats, à minuit, en robe fourrée, Vient tenir ses bruyants étatsAuteur : GRESS. - Source : Chartr.
- Les inondations du Nil durent, pendant des siècles, écarter tous les colons d'une terre submergée quatre mois de l'annéeAuteur : Voltaire - Source : Moeurs, Introd.
- M. le Grand trouva jointure à mettre le prince Camille à la place de CarlingfordAuteur : SAINT-SIMON - Source : 104, 113
- Son caractère particulier était de concilier les intérêts opposésAuteur : BOSSUET - Source : Anne de Gonz.
- L'imitateur arrive à sa fin, ou par le discours seul, ou par la gesticulation (car il faut que je me serve de ce mot), ou par le chantAuteur : GODEAU - Source : Disc. sur Malherbe.
- Ce monsieur n'aime pas la compagnie ; car il m'a sanglé cinq ou six coups de fouet sur les épaules, et il m'a prié brusquement de me retirerAuteur : DANCOURT - Source : l'Opéra de village, sc. 15
- Car quel malheur qu'il fût si dépravé.... Et qu'il portât, sous un si beau plumage, La fière humeur d'un escroc achevéAuteur : GRESSET - Source : Vert-Vert, IV
- Por ce que moult seroit longue cose et carquans as homes qui font les jugemensAuteur : BEAUMANOIR - Source : 33
- Toutes ces paroles que l'empereur venait de prodiguer ne prouvaient que son désappointement et qu'une grande hésitation le ressaisissait ; car en lui le bonheur était moins communicatif, et la décision moins verbeuseAuteur : SÉGUR - Source : Hist. de Nap. VI, 5
- Si Descartes ne s'était pas écarté, dans ses inventions, de son guide, la géométrie, si Malebranche avait su s'arrêter dans son vol....Auteur : Voltaire - Source : Lett. Faugères, 3 mai 1776
- Un chascun d'eulx [des trois ordres] son droit estat maintiengne ; Car l'exceder est monstre et droicte ensaigneDe pis avoir pour le peuple et l'EgliseAuteur : E. DESCH. - Source : Souffr. du peuple.
- Aussi n'a faict Belleau aucune difficulté d'en user, quand, parlant d'un enfançon (car il use de ce diminutif), il dit : Tant que sa levre mignotte à petits soupirs suçotteAuteur : H. EST. - Source : Préc. du lang. franç. éd. FEUGÈRE, p. 102
- L'on a ôté mal à propos le nom de raison à l'amour.... c'est une précipitation de pensées qui se porte d'un côté sans bien examiner tout, mais c'est toujours une raison ; et l'on ne doit et on ne peut pas souhaiter que ce soit autrement, car nous serions des machines très désagréablesAuteur : PASCAL - Source : Amour.
Les mots débutant par Car Les mots débutant par Ca
Une suggestion ou précision pour la définition de Car ? -
Mise à jour le vendredi 6 février 2026 à 21h43
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur car
Poèmes car
Proverbes car
La définition du mot Car est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Car sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Car présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
