La définition de Carotte du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Carotte
Nature : s. f.
Prononciation : ka-ro-t'
Etymologie : Génev. carotte, betterave (comme dans plusieurs provinces où le nom de la carotte est pris pour celui de la betterave) ; ital. carota ; du latin carota. Au lieu de tirer une carotte, l'italien dit : planter ou ficher des carottes (piantar, ficcar carote, qui signifie attraper et qui a aussi un autre sens fort grossier).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de carotte de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec carotte pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Carotte ?
La définition de Carotte
Plante potagère de la famille des ombellifères, à racine pivotante et charnue, douce, sucrée, comestible.
Toutes les définitions de « carotte »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Plante potagère de la famille des Ombellifères dont la racine, pivotante et charnue, a le même nom et s'emploie comme aliment. Par analogie, Carotte de tabac, Assemblage de feuilles de tabac roulées les unes sur les autres en forme de carotte.
Littré
-
1Plante potagère de la famille des ombellifères, à racine pivotante et charnue, douce, sucrée, comestible.
La racine même.
Fig. et familièrement. Ne vivre que de carottes, vivre mesquinement.
- 2Carotte de tabac, rouleau de feuilles de tabac.
-
3 Fig. et populairement. Jouer la carotte, jouer chichement et en ne hasardant que le moins possible.
Tour par lequel on subtilise de l'argent à quelqu'un. Quelle carotte?! J'ai compris la carotte. C'est une carotte. Tirer une carotte à quelqu'un, en obtenir quelque chose par adresse ou par ruse.
HISTORIQUE
XIVe s. Garroites sont racines rouges que l'en vent es halles par pougnées
, Ménagier, II, 5. Jehan Roussel dist au suppliant?: Larron, tu as retourné carotte [tu as tourné casaque], et le frappa d'un pel [pieu] d'une haye
, Du Cange, caravira.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
CAROTTE. Ajoutez?: - REM. On a dit que la locution populaire tirer une carotte vient de ceci?: à Carmagnole, le gouverneur savoyard avait frappé chaque botte de carottes, mise en vente au marché, d'un impôt équivalent à un demi-liard de notre ancienne monnaie?; mais il admettait qu'on le payât en nature, c'est-à-dire que les estafiers tiraient à son profit deux carottes par botte, Extrait de la Chronique du Derby, dans la Patrie, 11 avr. 1868. On ne donne aucun texte à l'appui de ce dire.
Encyclopédie, 1re édition
CAROTTE, s. f. (Hist. nat.) daucus, genre de plante à fleur en rose & en ombelle, composée de plusieurs pétales inégaux faits en forme de c?ur, disposés en rond, & soûtenus par le calice qui devient un fruit arrondi, composé de deux semences garnies & entourées de poils disposés en maniere de sourcil. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
La carotte légumineuse est une plante qui pousse de grandes feuilles velues, d'une odeur & d'un goût assez agréable : sa tige qui s'éleve de trois piés, est chargée dans sa sommité de parasols qui portent de petites fleurs blanches à cinq feuilles, disposées en fleur-de-lis : sa racine charnue, jaune ou blanche, d'un goût douçâtre, est employée dans les cuisines.
Elle ne se multiplie que de graines qui se sement au mois d'Avril ou Mai sur planches : quand elles sont trop drues on les éclaircit ; & pour les avancer, il faut à la mi-Août couper tous les montans à un demi-pié de terre. (K)
La carotte appellée daucus vulgaris, Tourn. Inst. 307. est d'usage en Medecine ; sa semence infusée dans le vin blanc est diurétique, bonne pour prévenir le calcul, & en diminuer la violence des accès ; elle chasse le gravier, provoque les regles & l'urine, & fait beaucoup de bien dans les maladies de la matrice, & dans les affections hystériques.
Van-Helmont assûre qu'un jurisconsulte fut exempt pendant plusieurs années des douleurs du calcul, en bûvant d'une infusion de la graine de daucus dans de la bierre. (N)
Wiktionnaire
Adjectif - français
carotte \ka.??t\ invariable
- Couleur rouge tirant sur le roux, orange. #F4661B
- En tout cas, dit Pauline d'un air pincé, elle est joliment laide, celle-là, avec ses cheveux carotte. ? (Émile Zola, Au Bonheur des Dames, 1883)
Nom commun - français
carotte \ka.??t\ féminin
-
(Agriculture, Botanique) Plante potagère de la famille des apiacées (ombellifères), à racine pivotante et charnue, douce, sucrée, comestible.
- Parmi d'anciens potagers envahis par les ronces, un seul était à peu près émondé et des plants d'épinards et de carottes y alternaient avec les vasques givrées des choux. ? (Joris-Karl Huysmans, La Cathédrale, Plon-Nourrit, 1915)
- La carotte vient dans les sols les plus divers, mais les terres fraîches, argilo-siliceuses ou argilocalcaires, profondément ameublies, sont celles qui lui conviennent le mieux. ? (O. Bussard, Cultures légumières, 1943)
-
(Cuisine) Le légume-racine de la plante même, utilisée comme aliment.
- Jérôme Crainquebille, marchand des quatre-saisons, allait par la ville, poussant sa petite voiture et criant : Des choux, des navets, des carottes ! ? (Anatole France, L'Affaire Crainquebille)
- Piquez votre foie de veau de gros lard assaisonné; foncez une braisière de bardes de lard; mettez-y le foie avec des carottes, un bouquet garni, des oignons, [?]. ? (Alexandre Dumas, Grand dictionnaire de cuisine, Paris : Alphonse Lemerre, 1873, page 565)
- Ayez une marmite de la contenance de cinq litres, deux livres de b?uf, deux moyennes carottes, un navet, trois poireaux. ? (F. Delahaye, La cuisine des petits ménages, 1882)
- On entendait, sur le pavé, le craquement des roues des hautes charrettes chargées de choux, de navets, de poireaux, de carottes [?]. ? (Francis Carco, Messieurs les vrais de vrai, Les Éditions de France, Paris, 1927)
- Tour par lequel on subtilise de l'argent à quelqu'un.
-
(Familier) Appât, par analogie avec ce que l'on montre à l'âne pour le faire avancer.
- Il travaille depuis un an avec comme carotte la promesse d'un contrat à longue durée.
-
Prélèvement de forme cylindrique.
- Avec une sonde on prend une « carotte » de tourbe, on la débite en rondelles et on peut étudier la nature des grains de pollen qui se trouvent à chaque niveau de la tourbe. ? (Henri Gaussen, Géographie des Plantes, Armand Colin, 1933, page 61)
- C'est le géologue H. Heinrich, de Hambourg, qui, scrutant au binoculaire les carottes forées dans les sédiments de l'Atlantique nord, a montré dans les années 1990 que les couches formées d'éléments plus grossiers interstratifiés dans les dépôts plus fins devaient provenir des débris arrachés par les glaciers au substrat rocheux des inlandsis. ? (Bernard Francou & ?Christian Vincent, Les glaciers à l'épreuve du climat, IRD Éditions, 2007, éd. revue en 2010, page 39)
- Les deux carottes collectées sont désormais dans des tubes scellés et conservés à l'intérieur de la sonde. Elles font environ 6 cm de long chacune. ? (AFP, Les échantillons de roche prélevés sur Mars sont probablement volcaniques, ici.radio-canada.ca, 10 septembre 2021)
-
(Par extension) Trou formé par ce prélèvement.
- Forer des carottes dans le roc, en analyser les teneurs, placer des bâtons de cheddite au fond de la galerie, les faire sauter, faire sauter toute la montagne ... ? (Michel Goeldlin, Panne de cerveau, Éditions Alban, 2004, page 220)
- (Par analogie) Objet ayant la forme allongée d'une carotte.
- (Musique) (Argot) Saxophone soprano, qui peut ne pas être coudé.
-
Paquet de tabac à priser ou à chiquer ayant une forme bi-conique.
- Monck, tout aussi affamé que ses gens, mais affectant la plus parfaite indifférence pour ce mouton absent, coupa un fragment de tabac, long d'un demi-pouce, à la carotte d'un sergent qui faisait partie de sa suite, et commença à mastiquer le susdit fragment. ? (Alexandre Dumas, Le Vicomte de Bragelonne, Chapitre XXIII)
-
(Par extension) (France) Enseigne rouge de forme fuselée signalant un bureau de tabac.
 Ancienne carotte signalant un débit de tabac. (sens 10)
Ancienne carotte signalant un débit de tabac. (sens 10)-
Et j'vous dis pas la thune non plus
Qu'j'ai laissée à ces enfoirés
Ces dealers au coin de la rue
Avec leurs carottes pour m'faire marcher ? (Renaud, Arrêter la clope !, Rouge Sang, Virgin Music, 2006) - La carotte devenue en 1906 l'enseigne obligatoire des débitants de tabac, était l'assemblage de huit tronçons de rôle agglomérés ensemble sous pression dans un moule puis enveloppé dans une bande de toile. ? (Le tabac en France de 1940 à nos jours, Eric Godeau, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, Paris 2008)
- Depuis quelques mois, afin de prévenir toute tentative de vol, Pichet leur interdisait d'entrer à plusieurs dans son épicerie-bar-tabac. Lucile proposa une intervention punitive, Barthélémy en élabora le plan. Il s'agissait de kidnapper la grosse carotte métallique qui, pour tous les tabacs de l'époque, faisait figure d'enseigne. ? (Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, J.-C. Lattès, 2011)
- Des bataillons de VRP lancés dans tout le pays à l'assaut des bars-tabacs, des tabacs-presse, des civettes repérables de loin grâce à leur célèbre carotte rouge. ? (Marc Lomazzi, Comment la mafia du tabac nous manipule: Des cadres repentis brisent l'omerta, éd. Flammarion, 2015, chapitre 10)
-
Et j'vous dis pas la thune non plus
- (Argot) Arnaque à l'achat.
- Jeu d'enfants.
- Un de ses camarades, dis-je, qui jouait à la carotte ? lançant son couteau d'un geste bref pour le planter dans le bois d'une table ? avait atteint malencontreusement mon frère dont la main s'était, par hasard, trouvée sur la trajectoire. ? (Michel Leiris, L'âge d'homme, 1939, collection Folio, page 118.)
- Ce sable frais nous engageait à jouer à « la carotte ». On ferme la main gauche et, successivement, on place la pointe de son couteau de poche tenu verticalement par l'index droit à la jointure des principales phalanges de chaque doigt. Un coup sec vers le bas, le couteau libéré décrit une portion de cercle, la lame doit se planter droit dans le sable. La réussite n'est pas toujours là. Alors on recommence. Il y avait toujours un roudoudou à gagner ! ? (Édouard Bled, J'avais un an en 1900, Fayard, 1987, Le Livre de Poche, page 20)
-
(Figuré) Récompense ; motivation.
- Du côté des élus locaux, la carotte est la promesse d'emplois. ? (François de Mazières, « Les élus nationaux et locaux sont confrontés à un changement profond de vision de l'urbanisme », Le Monde. Mis en ligne le 19 novembre 2019)
-
Pour bien des gens en Amérique du Nord, c'était le jour de la marmotte hier. Mais au Québec, c'était plutôt le jour de la carotte.
Une journée de récompense pour les citoyens de six régions, après des mois d'efforts. Une journée où le premier ministre François Legault n'avait pas vraiment le choix d'honorer le contrat moral qu'il a pris avec sa population. ? (Sébastien Bovet, Le jour de la carotte, radio-canada.ca, 3 février 2021)
-
(Figuré) Surplus de matière plastique restant attaché à la pièce qui vient d'être démoulée.
- Busard, d'un coup de pince, trancha au centre des carrosses jumelés qu'il tenait entre les mains, une saillie, une sorte de bavure, qu'on appelle carotte. C'est le reste du cordon ombilical de matière plastique qui, durant le refroidissement, relie la matrice au cylindre, au travers du conduit injecteur. ? (Roger Vailland, 325.000 francs, 1954, réédition Le Livre de Poche, page 98)
- Il arrivait que la carotte cassât à l'intérieur du conduit injecteur et l'obstruât ; la matière en fusion ne passait plus ; le ventre s'ouvrait et l'on trouvait la matrice vide ; la portion de carotte demeurée dans le conduit s'appelle téton ; on dégage le conduit avec une tige de bronze dénommée chasse-téton. ? (Roger Vailland, 325.000 francs, 1954, réédition Le Livre de Poche, page 101)
Trésor de la Langue Française informatisé
CAROTTE, subst. fém.
Carotte au Scrabble
Le mot carotte vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot carotte - 7 lettres, 3 voyelles, 4 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot carotte au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
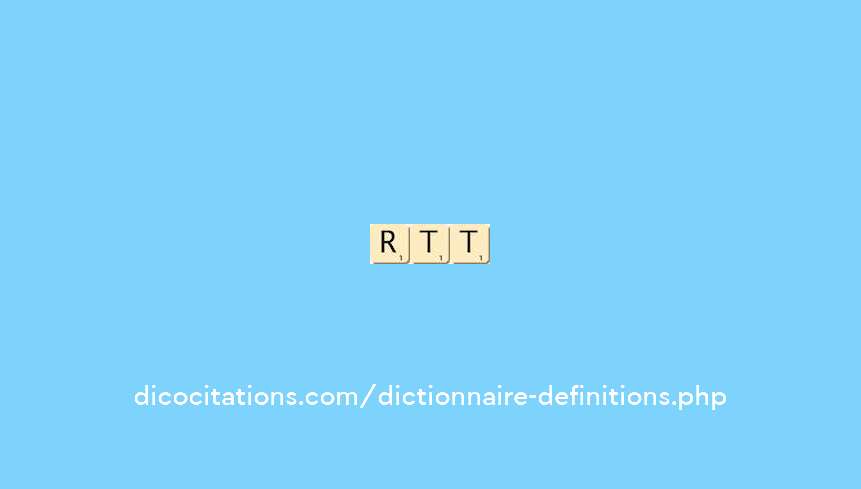
Les mots proches de Carotte
Car Carabas Carabé Carabin Carabinade Carabine Carabiné, ée Carabinier Caraco Caracole Caracoler Caracore Caractère Caractérisant, ante Caractérisé, ée Caractériser Caractéristique Caragueuse Caramel Caramélique Caramélisation Carapa Caraque Carasson Carat Caravane Caravanier Caravansérai ou caravansérail Caravelle Carbo-azotine Carbogène Carbonatation Carcajou Carcan Carcan Carcasse Carcinome Cardamome Carde Carder Cardeur, euse Cardeuse Cardiaque Cardinal, ale Cardinal Cardinalat Cardinaliser Cardon Carême Carême-prenant car car carabas carabe carabes carabin carabine carabiné carabinée carabines carabinés carabinier carabiniers carabins carabosse caracal caraco caracola caracolade caracolait caracolant caracolant caracole caracole caracolent caracoler caracolerez caracos caractère caractères caractériel caractérielle caractérielle caractérielles caractériels caractérisait caractérisant caractérisant caractérisation caractérise caractérisé caractérisé caractérisée caractérisée caractérisées caractérisent caractériser caractériserais caractériserait caractérisésMots du jour
-
bacillaires commémoratives incirconcis conjugués décalant raccompagnant déréalisaient décompressions critiqueras renégate
Les citations avec le mot Carotte
- Maman elle, va s'écrouler sur la rampe... Elle se revomit complètement... Il lui est remonté une carotte... un morceau de gras... et la queue entière d'un rouget...Auteur : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline - Source : Mort à crédit (1936)
- Le jardinier peut décider de ce qui convient aux carottes, mais nul ne peut choisir le bien des autres à leur place.Auteur : Jean-Paul Sartre - Source : Le Diable et le Bon Dieu (1951)
- Au présent: Je carotte, tu asperges, il mache, nous oignons, vous chicorée, ils ou elles les tue. A l'imparfait: je panais. Au passé composé: ils ont rit. A l'impératif: ail.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Pierre Grassou (1839)
- Finissez vos carottes. N'oubliez pas qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Europe.Auteur : Julie Otsuka - Source : Quand l' empereur était un dieu (2004)
- Peut-on servir des carottes Vichy en plat de résistance ?Auteur : Régis Mailhot - Source : RTL, A la Bonne Heure ! , 24 novembre 2015.
- Quand on me parle d'une femme cultivée, je l'imagine avec des carottes dans les oreilles et du cerfeuil entre les doigts de pied.Auteur : Sacha Guitry - Source : Sans référence
- Z'ont leur petit spectre dans leur culotte,
Leur petit périscope sous la flotte,
Z'ont le bâton ou la carotte,
Les z'hommes,
Et au nom de ce bout de bidoche
Qui leur pendouille sous la brioche,
Ils font des guerres, ils font des mioches,
Les z'hommes...Auteur : Henri Tachan - Source : Les z'hommes (1975) - Toute notre éducation est fondée sur le chantage affectif et la double contrainte, la carotte et le bâton, et l'apprentissage sans intelligence des préjugés les plus stupides.Auteur : Joseph Messinger - Source : Ces gestes qui manipulent & ces mots qui influencent (2003)
- On peut se demander si le manque d'appétence des électeurs pour les urnes ne résulte pas de la publication des sondages annonçant que les carottes sont cuites plusieurs semaines avant qu'on passe à table.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Poil de Carotte, va fermer les poules! Elle donne ce petit nom d'amour à son dernier né, parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachée.Auteur : Jules Renard - Source : Poil de carotte (1893), Les Poules
- Les carottes prouvent qu'il ne suffit pas de faire l'autruche pour échapper à l'appétit de l'homme.Auteur : Sylvain Tesson - Source : Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008)
- Il a bien tenté, la première année, de me tirer quelques carottes... il m'écrivait des histoires romanesques pour m'attendrir.Auteur : Eugène Labiche - Source : Les Petits Oiseaux (1862)
- Soudain, au moment où il s'y attend le moins, (c'est toujours à ce moment précis que les malheurs arrivent), Poil De Carotte reçoit un coup de pioche en plein front.Auteur : Jules Renard - Source : Poil de carotte (1893), La Pioche
- Faute de pommes, contente-toi d'une carotte.Auteur : Proverbes russes - Source : Proverbe
- Il cuit dans ce joli court-bouillon qui chante et dans lequel j'ai jeté, avec une poignée de foin, des gousses d'ail, des ronds de carottes, des oignons, de la muscade, du laurier et du thym.Auteur : Joris-Karl Huysmans - Source : Là-bas (1891)
- Ficelons nos phrases, serrons les comme des andouilles et des carottes de tabac. Masturbons le vieil art jusque dans le plus profond de ses jointures. Il faut que tout en pète, Monsieur.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance, à Ernest Feydau, 3 décembre 1858
- - Le tazou? De la semoule avec des carottes, des piments, des choux, des fèves, des poivrons, des aubergines, des courgettes... - De quoi vous emporter la gueule, quoi!Auteur : Michel Tournier - Source : La Goutte d'Or (1985)
- J'ai suivi les conseils qu'il y a dans le livre de Rika Zaraï : « Le masque pour la nuit. » Tu te mets des carottes, des olives, des œufs, des champignons. Et, au réveil, t'as une pizza. Auteur : Coluche - Source : Coluche, l'intégrale des sketchs (2011)
- - Tu as tort de mentir. C'est un vilain défaut, et c'est inutile, car toujours tout se sait. - - Oui, répond Poil de carotte, mais on gagne du temps.Auteur : Jules Renard - Source : Poil de carotte (1893)
- Jouissez sans entraves, vivez sans temps morts, baisez sans carotte.Auteur : Slogan de mai 68 - Source : Slogan de mai 1968.
- Il avait gagné comme ça, mon dabe, en une seule séance, à Enghien, d'un coup six cents francs sur «Carotte» et puis encore sur «Célimène» deux cent cinquante à Chantilly... Ca l'avait grisé... Il allait risquer davantage...Auteur : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline - Source : Mort à crédit (1936)
- Dieu n'a pas inventé le couteau pour que l'homme s'entretue mais pour couper les carottes en jolies rondelles, non?Auteur : Lewis Trondheim - Source : Les Formidables Aventures de Lapinot, 5, Walter
- Poil de Carotte, mon ami, renonce au bonheur. Je te préviens, tu ne seras jamais plus heureux que maintenant, jamais, jamais.Auteur : Jules Renard - Source : Poil de carotte (1893)
- Février, bon mois, - Pour semer carottes et pois.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- A peine y fut-elle, qu'elle se transforma et devint une merveilleuse demoiselle; la carotte était une carrosse, et les six petites souris de magnifiques chevaux.Auteur : les frères Grimm - Source : Contes, Les trois plumes
Les citations du Littré sur Carotte
- Jehan Roussel dist au suppliant : Larron, tu as retourné carotte [tu as tourné casaque], et le frappa d'un pel [pieu] d'une hayeAuteur : DU CANGE - Source : caravira.
- L'une voudra que tu plantes des choux ; L'autre voudra que ce soient des carottesAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Mazet.
- Le rossolis du roi [Louis XIV], breuvage composé d'eau-de-vie faite avec du vin d'Espagne, dans laquelle on faisait infuser des semences d'anis, de fenouil, d'anet, de chervis, de carotte et de coriandre, à quoi l'on ajoutait du sucre candi, dissous dans l'eau de camomille et cuit en consistance de siropAuteur : SAINTE-BEUVE - Source : Nouveaux lundis, t. II, Journal de la santé de Louis XIV.
- L'origine de cette façon de parler, c'est que, dans un sol meuble et doux, image de la crédulité, la carotte acquiert un développement admirable ; l'expression italienne s'arrête à l'intention du semeur de carottes ; le français considère le procédé qui les récolteAuteur : GÉNIN - Source : Récréat. t. I, p. 319
Les mots débutant par Car Les mots débutant par Ca
Une suggestion ou précision pour la définition de Carotte ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 01h51
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur carotte
Poèmes carotte
Proverbes carotte
La définition du mot Carotte est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Carotte sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Carotte présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.

