Définition de « d »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot d de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur d pour aider à enrichir la compréhension du mot D et répondre à la question quelle est la définition de d ?
Une définition simple : (lettre|d|D|de) d (m) (inv)
Définitions de « d »
Trésor de la Langue Française informatisé
D, d, lettre
D, d, lettre
Wiktionnaire
Nom commun - français
d \de\ masculin
-
(Jeux) Dé, en particulier dans le domaine du jeu de rôle.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
La quatrième lettre de l'alphabet. Elle représente une des consonnes. On la nomme Dé. Un D majuscule. Un petit d. Le D est une des consonnes qu'on appelle dentales. Il est muet à la fin d'un mot, sauf à la fin de certains noms d'origine étrangère : David, Port-Saïd; et de quelques locutions latines : Ad patres, ad hoc. En liaison, il se prononce T. Grand homme. Pied-à-terre.
Littré
- La quatrième lettre de l'alphabet et la troisième des consonnes. Le d appartient aux consonnes nommées dentales.
Dans la plupart des livres que l'on imprime aujourd'hui [XVIIe siècle], on ôte le d de tous les mots où il ne doit point se faire sentir?; ainsi, comme on trouve écrit avenir, avis, ajourner, ajuger, ajuster, on ne saurait point se tromper à la prononciation de ces mots?; plusieurs font encore sentir le d dans adversité, mais tout le monde prononce aversaire
, Vaugelas, Rem. notes Th. Corn. t. II, p. 746, dans POUGENS. La prononciation a changé?; voy. ces mots.À la fin des mots et après une nasale, il est ordinairement muet?: grand, il rend?; et s'il sonne sur la voyelle suivante, il sonne comme un t?: grand homme, prononcez granit homme.
Dans la musique, D ou D-la-ré (pour ré-fa-la-ré) indique le ton de ré. D écrit au-dessus de la portée signifie doux (dolce). Quelquefois, en tête d'une partie, il marque que c'est celle du dessus.
En chiffres romains, D signifie 500, et, quand il est surmonté d'un trait, 5000.
D, Sur les anciennes monnaies de France, indique qu'elles ont été frappées à Lyon.
D M P après une signature signifie docteur en médecine de la faculté de Paris.
D est l'abréviation de don, titre donné aux seigneurs italiens et espagnols?: D. Pedro. Il est aussi l'abréviation de dom, titre donné aux moines bénédictins?: D. Rainard.
N. D. signifie Notre-Dame, la vierge Marie.
D. O. M. est dans les inscriptions, l'abréviation de Deo optimo maximo [à Dieu très bon, très grand].
Dans l'ancien alphabet chimique, D indiquait le sulfate de fer.
HISTORIQUE
XIIIe s. D [D signifie ici Dieu] jeta ceux de l'aigre feu Qui touz tems fussent en enfer?; D fu en fust, D fu en fer?; D eut au C [croix] angoisse et soif, Senefiance de l'A B C
, Jubinal, t. II, p. 276.
Encyclopédie, 1re édition
* D, s. m. (Ecriture.) la quatrieme lettre de notre alphabet. La partie intérieure du D italique se forme de l'O italique entier ; & sa partie supérieure ou sa queue des septieme & huitieme parties du même O. Le d coulé & le d rond n'ont pas une autre formation ; il faut seulement le rapporter à l'o coulé & à l'o rond. Ces trois sortes de d demandent de la part de la main un mouvement mixte des doigts & du poignet, pour la description de leur portion inférieure ; les doigts agissent seuls dans la description de la queue ou de leur partie supérieure.
D, (Gramm. &c.) Il nous importe peu de savoir d'où nous vient la figure de cette lettre ; il doit nous suffire d'en bien connoître la valeur & l'usage. Cependant nous pouvons remarquer en passant que les Grammairiens observent que le D majeur des Latins, & par conséquent le nôtre, vient du ? delta des Grecs arrondi de deux côtés, & que notre d mineur vient aussi de ? delta mineur. Le nom que les maîtres habiles donnent aujourd'hui à cette lettre, selon la remarque de la grammaire générale de P. R. ce nom, dis-je, est de plûtôt que dé, ce qui facilite la syllabisation aux enfans. Voyez la grammaire raisonnée de P. R. chap. vj. Cette pratique a été adoptée par tous les bons maîtres modernes.
Le d est souvent une lettre euphonique : par exemple, on dit prosum, profui, &c. sans interposer aucune lettre entre pro & sum ; mais quand ce verbe commence par une voyelle on ajoûte le d après pro. Ainsi on dit, pro-d-es, pro-d-ero, pro-d-esse : c'est le méchanisme des organes de la parole qui fait ajoûter ces lettres euphoniques, sans quoi il y auroit un bâillement ou hiatus, à cause de la rencontre de la voyelle qui finit le mot avec celle qui commence le mot suivant. De-là vient que l'on trouve dans les auteurs mederga, qu'on devroit écrire me-d-ergà, c'est-à-dire erga me. C'est ce qui fait croire à Muret que dans ce vers d'Horace,
Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.
Horace avoit écrit, tibid iluxisse, d'où on a fait dans la suite diluxisse.
Le d & le t se forment dans la bouche par un mouvement à-peu-près semblable de la langue vers les dents : le d est la foible du t, & le t la forte du d ; ce qui fait que ces lettres se trouvent souvent l'une pour l'autre, & que lorsqu'un mot finit par un d, si le suivant commence par une voyelle, le d se change en t, parce qu'on appuie pour le joindre au mot suivant ; ainsi on prononce gran-t-homme, le froi-t-est rude, ren-t-il, de fon-t-en comble, quoiqu'on écrive grand homme, le froid est rude, rend-il, de fond en comble.
Mais si le mot qui suit le d est féminin, alors le d étant suivi du mouvement foible qui forme l'e muet, & qui est le signe du genre féminin, il arrive que le d est prononcé dans le tems même que l'e muet va se perdre dans la voyelle qui le suit ; ainsi on dit, grand'ardeur, gran-d'ame, &c.
C'est en conséquence du rapport qu'il y a entre le d & le t, que l'on trouve souvent dans les anciens & dans les inscriptions, quit pour quid, at pour ad, set pour sed, haut pour haud, adque pour atque, &c.
Nos peres prononçoient advis, advocat, addition, &c. ainsi ils écrivoient avec raison advis, advocat, addition, &c. Nous prononçons aujourd'hui avis, avocat, adition ; nous aurions donc tort d'écrire ces mots avec un d. Quand la raison de la loi cesse, disent les jurisconsultes, la loi cesse aussi : cessante ratione legis, cessat lex.
D numéral. Le D en chiffre romain signifie cinq cents. Pour entendre cette destination du D, il faut observer que le M étant la premiere lettre du mot mille, les Romains ont pris d'abord cette lettre pour signifier par abréviation le nombre de mille. Or ils avoient une espece de M qu'ils faisoient ainsi CI?, en joignant la pointe inférieure de chaque C à la tête de l'I. En Hollande communément les Imprimeurs marquent mille ainsi CI?, & cinq cents par I?, qui est la moitié de CI?. Nos Imprimeurs ont trouvé plus commode de prendre tout d'un coup un D qui est le C rapproché de l'I. Mais quelle que puisse être l'origine de cette pratique, qu'importe, dit un auteur, pourvû que votre calcul soit exact & juste ? non multum resert, modo recte & juste numeres. Martinius.
D abréviation. Le D mis seul, quand on parle de seigneurs Espagnols ou de certains religieux, signifie don ou dom.
Le dictionnaire de Trévoux observe que ces deux lettres N. D. signifient Notre-Dame.
On trouve souvent à la tête des inscriptions & des épîtres dédicatoires ces trois lettres D. V. C. elles signifient dicat, vovet, consecrat.
Le D sur nos pieces de monnoie est la marque de la ville de Lyon. (F)
D, (Antiquaire.) Hist. anc. Dans les inscriptions & les médailles antiques signifie divus ; joint à la lettre M, comme DM, il exprime diis manibus, mais seulement dans les épitaphes romaines : en d'autres occasions, c'est deo magno ou diis magnis ; & joint à N, il signifie dominus noster, nom que les Romains donnerent à leurs empereurs, & sur-tout aux derniers.
Cette lettre a encore beaucoup d'autres sens dans les inscriptions latines. Alde Manuce en rapporte une cinquantaine, quand elle est seule, autant quand elle doublée, & plus de trente quand elle est triplée sans parler de beaucoup d'autres qu'elle reçoit, lorsque dans les anciens monumens elle est accompagnée de quelques autres lettres. Voyez l'ouvrage de ce savant littérateur italien ; ouvrage nécessaire à ceux qui veulent étudier avec fruit l'Histoire & les Antiquités. Son titre est, de veterum notarum explanatione quæ in antiquis monumentis occurrunt, Aldi Manutii Pauli F. commentarius : in-8° Venetiis, 1566 ; il est ordinairement accompagné du traité du même auteur, orthographiæ ratio in-8°. Venetiis, 1566. (a)
D, (Musique.) D-la-ré, D-sol-ré, ou simplement D. Caractere ou terme de Musique qui indique la note que nous appellons ré. Voyez Gamme. (S)
D, (Comm.) cette lettre est employée dans les journaux ou registres des marchands banquiers & teneurs de livres, pour abréger certains termes qu'il faudroit répéter trop souvent. Ainsi d° se met pour dito ou dit ; den. pour denier ou gros. Souvent on ne met plus qu'un grand D ou un petit pour denier tournois & dit. Dal. ou Dre pour daldre, duc. ou Dd pour ducat. V. Abréviation. Dict. du Com. & Chamb. (G)
Étymologie de « d »
D de l'alphabet latin, qui est le delta de l'alphabet grec, lequel, à son tour, est le daleth de l'alphabet phénicien.
- (Nom commun) Abréviation du mot dé.
d au Scrabble
Le mot d vaut 2 points au Scrabble.
Informations sur le mot d - 1 lettres, 0 voyelles, 1 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot d au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
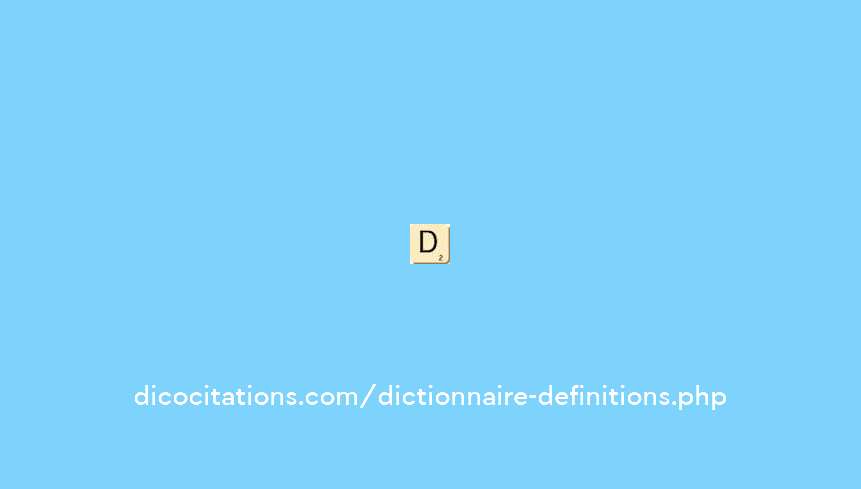
Les rimes de « d »
On recherche une rime en DE .
Les rimes de d peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en de
Rimes de validée Rimes de lamedé Rimes de bondait Rimes de réentendais Rimes de acagnardé Rimes de attardé Rimes de chaparder Rimes de scindé Rimes de retendait Rimes de minaudait Rimes de rôdez Rimes de farfadet Rimes de soldait Rimes de tondait Rimes de soudée Rimes de demandé Rimes de évadé Rimes de rebrodée Rimes de précédaient Rimes de vidai Rimes de demandai Rimes de bombardées Rimes de évadée Rimes de tailladez Rimes de accéder Rimes de chapardée Rimes de résidé Rimes de répandaient Rimes de sondait Rimes de re-blinder Rimes de décommandez Rimes de échaudé Rimes de lourdée Rimes de enguirlandé Rimes de trucider Rimes de cavalcader Rimes de bardait Rimes de possédée Rimes de bazardait Rimes de décodée Rimes de soldée Rimes de marchandez Rimes de emmerdée Rimes de recommandai Rimes de baladé Rimes de débander Rimes de brodez Rimes de bondé Rimes de grondé Rimes de cocarderMots du jour
validée lamedé bondait réentendais acagnardé attardé chaparder scindé retendait minaudait rôdez farfadet soldait tondait soudée demandé évadé rebrodée précédaient vidai demandai bombardées évadée tailladez accéder chapardée résidé répandaient sondait re-blinder décommandez échaudé lourdée enguirlandé trucider cavalcader bardait possédée bazardait décodée soldée marchandez emmerdée recommandai baladé débander brodez bondé grondé cocarder
Les citations sur « d »
- Manager seulement pour le profit revient à jouer au tennis en regardant le tableau des résultats plutôt que la balle.Auteur : Ivan Lendl - Source : Sans référence
- C'est un abus singulier de la prérogative d'une supériorité naturelle, que de la faire servir à s'affranchir des liens les plus sacrés, tandis que la vraie supériorité consiste dans la force de l'âme; et la force de l'âme c'est la vertu.Auteur : Madame de Staël - Source : De l'Allemagne (1810)
- Internet est à présent une poubelle, une succession d’usages parfaitement débiles, un enfermement des sens. Auteur : Pierre Ducrozet - Source : L'invention des corps (2017)
- Seigneur, excusez notre pauvreté; nous n'avons, pour parfumer nos hôtes suivant l'usage de l'Inde, ni ambre gris ni bois d'aloès ...Auteur : Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre - Source : La chaumière indienne (1790)
- J'ai toujours essayé de traiter du corps d'un point de vue romanesque, de la même façon qu'il existe dans la vie de chacun de nous : votre corps n'est pas au centre de vos préoccupations, vous n'y pensez pas tous les jours, mais une grande souffrance ou un grand plaisir physique vous rappelle régulièrement son existence.Auteur : Philip Roth - Source : « Entretien », Philip Roth (propos recueillis par Nathalie Crom), Télérama, nº 3017, semaine du 10 au 16 novembre 2007, p. 22
- Il n'est pas d'ombres dans le noir. Les ombres sont les servantes de la lumière, les filles du feu. Plus vive est la flamme, plus sombres sont les ombres qu'elle projette.Auteur : George Raymond Richard Martin - Source : L'Ombre maléfique (1999)
- L'hectoathlon est la combinaison de cent épreuves sportives. Avec 302 épreuves sportives aux jeux olympiques, on est en mesure d'organiser un hectoathlon, mais on peine à recruter les équipes !Auteur : Didier Hallépée - Source : Nombres en Folie - les divagations du mathématicien fou (2013)
- Ce n'est pas seulement un être, une mère, même unique, ou bien une époque une mère, c'est une présence que ni l'érosion du temps ni les défaillances de la mémoire ne peuvent altérer.Auteur : Mohammed Moulessehoul, dit Yasmina Khadra - Source : Ce que le jour doit à la nuit (2008)
- En peinture on peut tout essayer. On a le droit, même. A condition de ne jamais recommencer.Auteur : Pablo Picasso - Source : Cité par Jean Leymarie dans Picasso, métamorphoses et unité.
- La beauté des mères dépasse infiniment la gloire de la nature.Auteur : Christian Bobin - Source : Le Très-Bas
- L'homme porte en lui la semence de tout bonheur et de tout malheur.Auteur : Sophocle - Source : Sans référence
- Celui qui ne craint pas d'agir ne craint pas de parler.Auteur : Sophocle - Source : Sans référence
- Etre libre, quand ce ne serait que pour changer sans cesse d'esclavages.Auteur : Natalie Clifford Barney - Source : Eparpillements (1910)
- Un vrai chagrin d'amour c'est conduire avec les essuie-glaces même quand il fait beau.Auteur : Patrick Sébastien - Source : Carnet de notes (2001)
- Je pense qu’il est extrêmement difficile de se défaire d’une telle emprise, dix, vingt ou trente ans plus tard. Toute l’ambiguïté de se sentir complice de cet amour qu’on a forcément ressenti, de cette attirance qu’on a soi-même suscitée, nous lie les mains plus encore que les quelques adeptes qui restent à G. dans le milieu littéraire.Auteur : Vanessa Springora - Source : Le consentement (2020)
- Aussi disait-on de Fontenelle qu'il avait été le patriarche d'une secte dont il n'était pas.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Eloges, Despréaux
- Démission des parents: action consistant à donner beaucoup d'argent de poche et peu de gifles.Auteur : Jean Dutourd - Source : Sans référence
- C'était tous les jours de nouvelles accusations : la première est repoussée, la seconde effleure, la troisième blesse, la quatrième tue.Auteur : Voltaire - Source : Zadig ou la Destinée (1748), XV. Les yeux bleus
- Il y a quantité de choses qui ne sentent rien, mais qui carient les sens, le coeur et l'âme plus sûrement que tous les excréments.Auteur : Philippe Claudel - Source : Le Rapport de Brodeck (2007)
- Un esprit positif, qui lui non plus n'avait pas goûté de la drogue béatifique, propose de la limonade et des acides. Le malade, l'extase dans les yeux, le regarde avec le plus indicible mépris.Auteur : Charles Baudelaire - Source : Les Paradis artificiels (1860)
- Je vous ai parlé très franchement. Que vous me fassiez passer pour un antisémite, pour quelqu'un qui reconnaît pas la Shoah, j'ai entendu cela cent fois et cela m'est totalement égal.Auteur : Raymond Barre - Source : Sans référence
- Donne toi-même, si tu veux avoir.Auteur : Proverbes anglais - Source : Proverbe
- Un changement d'environnement est le miroir aux alouettes traditionnel auquel s'en remettent les amours et les poumons dont le sort est scellé.Auteur : Vladimir Nabokov - Source : Lolita (1955)
- Qui se règle sur l'idée qu'il a du devoir, est un homme libre jusque dans ses erreurs.Auteur : Charles Dollfus - Source : De la Nature humaine (1868)
- Je désire même qu'on s'aperçoive, en me lisant, que certaines choses ne vont nulle part. Il y a des destinées qui finissent on ne sait où, comme les oueds dans le sable. Il y a les êtres, les entreprises, les espérances «dont on n'entend plus parler».Auteur : Louis Farigoule, dit Jules Romains - Source : Les Hommes de bonne volonté (1932-1946), Préface
Les mots proches de « d »
D Da Dactyle Dactyliographie Dactylologie Dada Dadais Dague Daguer Daguet Dahlia Daï-co Daigner Dail Daille Daim Daïmiat Daintiers Daïri ou daïro Dais Dallage Dalle Dalleur Dalmatique Dam Damas Damasquin Damasquiné, ée Damasquiner Dame Dame Dame-jeanne Damer Dameret Damiéniste Damier Damnable Damnablement Damnation Damné, ée Damnement Damner Damoclès Damoiseau Damoiselle Dandin Dandinant, ante Dandiner Dandy DangerLes mots débutant par d Les mots débutant par d
d d d d' d' d'abord d'autres d'autres d'emblée d'emblée D'Huison-Longueville D'Huison-Longueville d'ores et déjà D?uil-sur-le-Mignon da da dab daba dabe Dabo dabs dabuche dabuches dace daces daces dache Dachstein dacique dacron dactyle dactyles dactylo dactylographe dactylographes dactylographie dactylographié dactylographié dactylographiée dactylographiée dactylographiées dactylographiées dactylographier dactylographiés dactyloptères dactylos dactyloscopie dada dadais dadaïsme
Les synonymes de « d»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot d dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « d » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot d dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de D ?
Citations d Citation sur d Poèmes d Proverbes d Rime avec d Définition de d
Définition de d présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot d sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot d notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 1 lettres.
