La définition de F du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
F
Nature : s. f. quand on prono
Prononciation : èf, ou, suivant la manière moderne d'épe
Etymologie : F des Latins ; F, digamma des Grecs.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de f de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec f pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de F ?
La définition de F
La sixième lettre de l'alphabet et la quatrième consonne.
Toutes les définitions de « f »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Sixième lettre de l'alphabet. Elle représente une des consonnes. Elle se prononce Effe. Une F. Un grand F. Une petite f. Quand cette lettre est à la fin d'un mot, elle se prononce toujours. Une soif brûlante. Une soif ardente. Il fut piqué jusqu'au vif de ce refus. Pièce de bœuf saignante. Il est veuf de sa troisième femme. Elle ne se prononce pas dans Clef (qu'on écrit aussi Clé) et dans les mots composés : Bœuf gras, Cerf-volant, Nerf de bœuf, ainsi que dans les pluriels : Les bœufs. Les œufs. F se prononce V en liaison dans Neuf heures et est généralement muet dans Neuf kilomètres, Neuf cents, etc. Le son F est représenté par PH dans la plus grande partie des mots d'origine grecque comme Philosophie, Phosphate, Phénomène, etc.
Littré
-
1La sixième lettre de l'alphabet et la quatrième consonne.
Depuis dix ans dessus l'F [du dictionnaire de l'Académie] on travaille?; Et le destin m'aurait fort obligé, S'il m'avait dit, tu vivras jusqu'au G.
Boisrobert, Épigr. VI, dans RICHELET.Il jurait par f et par b, se dit quand on veut faire entendre qu'il s'agit de jurements très grossiers que la décence ne permet pas de répéter.
Les b, les f voltigeaient sur son bec?; Les jeunes s?urs crurent qu'il parlait grec
, Gresset, Vert-Vert, IV.C'est un grand if (c'est-à-dire un grand j. f.), expression très injurieuse fondée sur ce que la qualification j. f. avant l'invention du j, et en supprimant les points, faisait précisément le mot if.
-
2 Terme de musique. F ou F-ut-fa, indique le ton de fa.
F écrit au-dessus ou au-dessous d'une note signifie forte. FF signifie fortissimo.
- 3F indique une monnaie frappée à Angers.
HISTORIQUE
XIIIe s. F nous rendi joie au monde?; Par quoi nous fuissiemes [serions] tuit monde [purs], Se nostre creance fust ferme, Qui chascun jour devient enferme, Senefiance de l'ABC
, Jubinal, t. II, p. 277.
Encyclopédie, 1re édition
F, s. m. (Gramm.) c'est la sixieme lettre de l'alphabet latin, & de ceux des autres langues qui suivent l'ordre de cet alphabet. Le f est aussi la quatrieme des consonnes qu'on appelle muettes, c'est-à-dire de celles qui ne rendent aucun son par elles-mêmes, qui, pour être entendues, ont besoin de quelques voyelles, ou au moins de l'e muet, & qui ne sont ni liquides comme l'r, ni sifflantes comme s, z. Il y a environ cent ans que la grammaire générale de Port-Royal a proposé aux maîtres qui montrent à lire, de faire prononcer fe plûtôt que effe. Gramm. génér. ch. vj. pag. 23. sec. éd. 1664. Cette pratique, qui est la plus naturelle, comme quelques gens d'esprit l'ont remarqué avant nous, dit P. R. id. ibid. est aujourd'hui la plus suivie. Voyez Consonne.
Ces trois letres F, V, & Ph, sont au fond la même lettre, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées par une situation d'organes qui est à-peu-près la même. En effet ve n'est que le fe prononcé foiblement ; fe est le ve prononcé plus fortement ; & ph, ou plûtôt fh, n'est que le fe, qui étoit prononcé avec aspiration. Quintilien nous apprend que les Grecs ne prononçoient le fe que de cette derniere maniere (inst. orat. cap. jv.) ; & que Cicéron, dans une oraison qu'il fit pour Fundanius, se mocqua d'un témoin grec qui ne pouvoit prononcer qu'avec aspiration la premiere lettre de Fundanius. Cette oraison de Cicéron est perdue. Voici le texte de Quintilien : Græci aspirare solent ?, ut pro Fundanio, Cicero testem, qui primam ejus litteram dicere non posset, irridet. Quand les Latins conservoient le mot grec dans leur langue, ils le prononçoient à la greque, & l'écrivoient alors avec le signe d'aspiration : philosophus, de ?????????, Philippus de ????????, &c. mais quand ils n'aspiroient point le ?, ils écrivoient simplement f : c'est ainsi qu'ils écrivoient fama, quoiqu'il vienne constamment de ???? ; & de même fuga de ????, fur de ???, &c.
Pour nous qui prononçons sans aspiration le ? qui se trouve dans les mots latins ou dans les françois, je ne vois pas pourquoi nous écrivons philosophe, Philippe, &c. Nous avons bien le bon esprit d'écrire feu, quoiqu'il vienne de ??? ; front, de ???????, &c. Voyez Ortographe.
Les Eoliens n'aimoient pas l'esprit rude ou, pour parler à notre maniere, le h aspiré : ainsi ils ne faisoient point usage du ? qui se prononçoit avec aspiration ; & comme dans l'usage de la parole ils faisoient souvent entendre le son du fe sans aspiration, & qu'il n'y avoit point dans l'alphabet grec de caractere pour désigner ce son simple, ils en inventerent un ; ce fut de représenter deux gamma l'un sur l'autre ?, ce qui fait précisément le ? qu'ils appellerent digamma ; & c'est de-là que les Latins ont pris leur grand F. Voyez la Méthode greque de P. R. p. 42. Les Eoliens se servoient sur-tout de ce digamma, pour marquer le fe doux, ou, comme on dit abusivement, l'u consonne ; ils mettoient ce v à la place de l'esprit rude : ainsi l'on trouve ??????, vinum, au lieu de ????? ; ????????, au lieu de ???????, vesperus ; ??????, au lieu de ????? avec l'esprit rude, vestis, &c. & même, selon la méthode de P. R. (ibid.) on trouve serFus pour servus, DaFus pour Davus, &c. Dans la suite, quand on eut donné au digamma le son du fe, ou se servit du ? ou digamma renversé pour marquer le ve.
Martinius, à l'article ?, se plaint de ce que quelques grammairiens ont mis cette lettre au nombre des demi-voyelles ; elle n'a rien de la demi-voyelle, dit-il, à moins que ce ne soit par rapport au nom qu'on lui donne effe : Nihil aliud habet semivocalis nisi nominis prolationem. Pendant que d'un côté les Eoliens changeoient l'esprit rude en f, d'un autre les Espagnols changent le f en hé aspiré ; ils disent harina pour farina, hava pour faba, herver pour fervor, hermoso pour formoso, humo au lieu de fumo, &c.
Le double f, ff, signifie par abbréviation les pandectes, autrement digeste ; c'est le recueil des livres des jurisconsultes romains, qui fut fait par ordre de Justinien empereur de Constantinople : cet empereur appella également ce recueil digeste, mot latin, & pandectes, mot grec, quoique ce livre ne fût écrit qu'en latin. Quand on appelle ce recueil digeste, on le cite en abregé par la premiere lettre de ce mot d. Quand dans les pays latins on voulut se servir de l'autre dénomination, & surtout dans un tems où le grec étoit peu connu, & où les Imprimeurs n'avoient point encore de caracteres grecs, on se servit du double f, ff, c'est le signe dont la partie inférieure approche le plus du ?? grec, premiere lettre de ?????????, c'est-à-dire livres qui contiennent toutes les décisions des jurisconsultes. Telle est la raison de l'usage du double f, ff, employé pour signifier les pandectes ou digeste dont on cite tel ou tel livre.
Le dictionnaire de Trévoux, article F, fait les observations suivantes :
1°. En Musique, F-ut-fa est la troisieme des clés qu'on met sur la tablature.
2°. F, sur les pieces de monnoie, est la marque de la ville d'Angers.
3°. Dans le calendrier ecclésiastique, elle est la sixieme lettre dominicale. (F)
F, (Ecriture.) si l'on considere ce caractere du côté de sa formation, dans notre écriture ; c'est dans l'italienne & la ronde, la huitieme, la premiere, & la seconde partie de l'o ; trois flancs de l'o l'un sur l'autre, & la queue de la premiere partie de l'x. L'f coulée a les mêmes racines, à l'exception de sa partie supérieure qui se forme de la sixieme & de la septieme partie de l'o : on y employe un mouvement mixte des doigts & du poignet, le pouce plié dans ses trois jointures. Voyez les Planches à la table de l'Ecriture, planche des Alphabets.
F-UT-FA, (Musique.) F-ut-fa, ou simplement F ; caractere ou terme de Musique, qui indique la note de la gamme que nous appellons fa. Voy. Gamme.
C'est aussi le nom de la plus basse des trois clés de la Musique. Voyez Clés. (S)
F, (Comm.) les marchands, banquiers, teneurs de livres, se servent de cette lettre pour abréger les renvois qu'ils font aux différentes pages, ou comme ils s'expriment au folio de leurs livres & registres. Ainsi F°. 2. signifie folio 2. ou page seconde. Les florins se marquent aussi par un F de ces deux manieres : FL ou FS. Dict. du Comm. & Chambers. (G)
Trésor de la Langue Française informatisé
F, f, lettre
F, f, lettre
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Sixième lettre de l'alphabet. Elle représente une des consonnes. Elle se prononce Effe. Une F. Un grand F. Une petite f. Quand cette lettre est à la fin d'un mot, elle se prononce toujours. Une soif brûlante. Une soif ardente. Il fut piqué jusqu'au vif de ce refus. Pièce de bœuf saignante. Il est veuf de sa troisième femme. Elle ne se prononce pas dans Clef (qu'on écrit aussi Clé) et dans les mots composés : Bœuf gras, Cerf-volant, Nerf de bœuf, ainsi que dans les pluriels : Les bœufs. Les œufs. F se prononce V en liaison dans Neuf heures et est généralement muet dans Neuf kilomètres, Neuf cents, etc. Le son F est représenté par PH dans la plus grande partie des mots d'origine grecque comme Philosophie, Phosphate, Phénomène, etc.
Littré
-
1La sixième lettre de l'alphabet et la quatrième consonne.
Depuis dix ans dessus l'F [du dictionnaire de l'Académie] on travaille?; Et le destin m'aurait fort obligé, S'il m'avait dit, tu vivras jusqu'au G.
Boisrobert, Épigr. VI, dans RICHELET.Il jurait par f et par b, se dit quand on veut faire entendre qu'il s'agit de jurements très grossiers que la décence ne permet pas de répéter.
Les b, les f voltigeaient sur son bec?; Les jeunes s?urs crurent qu'il parlait grec
, Gresset, Vert-Vert, IV.C'est un grand if (c'est-à-dire un grand j. f.), expression très injurieuse fondée sur ce que la qualification j. f. avant l'invention du j, et en supprimant les points, faisait précisément le mot if.
-
2 Terme de musique. F ou F-ut-fa, indique le ton de fa.
F écrit au-dessus ou au-dessous d'une note signifie forte. FF signifie fortissimo.
- 3F indique une monnaie frappée à Angers.
HISTORIQUE
XIIIe s. F nous rendi joie au monde?; Par quoi nous fuissiemes [serions] tuit monde [purs], Se nostre creance fust ferme, Qui chascun jour devient enferme, Senefiance de l'ABC
, Jubinal, t. II, p. 277.
Encyclopédie, 1re édition
F, s. m. (Gramm.) c'est la sixieme lettre de l'alphabet latin, & de ceux des autres langues qui suivent l'ordre de cet alphabet. Le f est aussi la quatrieme des consonnes qu'on appelle muettes, c'est-à-dire de celles qui ne rendent aucun son par elles-mêmes, qui, pour être entendues, ont besoin de quelques voyelles, ou au moins de l'e muet, & qui ne sont ni liquides comme l'r, ni sifflantes comme s, z. Il y a environ cent ans que la grammaire générale de Port-Royal a proposé aux maîtres qui montrent à lire, de faire prononcer fe plûtôt que effe. Gramm. génér. ch. vj. pag. 23. sec. éd. 1664. Cette pratique, qui est la plus naturelle, comme quelques gens d'esprit l'ont remarqué avant nous, dit P. R. id. ibid. est aujourd'hui la plus suivie. Voyez Consonne.
Ces trois letres F, V, & Ph, sont au fond la même lettre, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées par une situation d'organes qui est à-peu-près la même. En effet ve n'est que le fe prononcé foiblement ; fe est le ve prononcé plus fortement ; & ph, ou plûtôt fh, n'est que le fe, qui étoit prononcé avec aspiration. Quintilien nous apprend que les Grecs ne prononçoient le fe que de cette derniere maniere (inst. orat. cap. jv.) ; & que Cicéron, dans une oraison qu'il fit pour Fundanius, se mocqua d'un témoin grec qui ne pouvoit prononcer qu'avec aspiration la premiere lettre de Fundanius. Cette oraison de Cicéron est perdue. Voici le texte de Quintilien : Græci aspirare solent ?, ut pro Fundanio, Cicero testem, qui primam ejus litteram dicere non posset, irridet. Quand les Latins conservoient le mot grec dans leur langue, ils le prononçoient à la greque, & l'écrivoient alors avec le signe d'aspiration : philosophus, de ?????????, Philippus de ????????, &c. mais quand ils n'aspiroient point le ?, ils écrivoient simplement f : c'est ainsi qu'ils écrivoient fama, quoiqu'il vienne constamment de ???? ; & de même fuga de ????, fur de ???, &c.
Pour nous qui prononçons sans aspiration le ? qui se trouve dans les mots latins ou dans les françois, je ne vois pas pourquoi nous écrivons philosophe, Philippe, &c. Nous avons bien le bon esprit d'écrire feu, quoiqu'il vienne de ??? ; front, de ???????, &c. Voyez Ortographe.
Les Eoliens n'aimoient pas l'esprit rude ou, pour parler à notre maniere, le h aspiré : ainsi ils ne faisoient point usage du ? qui se prononçoit avec aspiration ; & comme dans l'usage de la parole ils faisoient souvent entendre le son du fe sans aspiration, & qu'il n'y avoit point dans l'alphabet grec de caractere pour désigner ce son simple, ils en inventerent un ; ce fut de représenter deux gamma l'un sur l'autre ?, ce qui fait précisément le ? qu'ils appellerent digamma ; & c'est de-là que les Latins ont pris leur grand F. Voyez la Méthode greque de P. R. p. 42. Les Eoliens se servoient sur-tout de ce digamma, pour marquer le fe doux, ou, comme on dit abusivement, l'u consonne ; ils mettoient ce v à la place de l'esprit rude : ainsi l'on trouve ??????, vinum, au lieu de ????? ; ????????, au lieu de ???????, vesperus ; ??????, au lieu de ????? avec l'esprit rude, vestis, &c. & même, selon la méthode de P. R. (ibid.) on trouve serFus pour servus, DaFus pour Davus, &c. Dans la suite, quand on eut donné au digamma le son du fe, ou se servit du ? ou digamma renversé pour marquer le ve.
Martinius, à l'article ?, se plaint de ce que quelques grammairiens ont mis cette lettre au nombre des demi-voyelles ; elle n'a rien de la demi-voyelle, dit-il, à moins que ce ne soit par rapport au nom qu'on lui donne effe : Nihil aliud habet semivocalis nisi nominis prolationem. Pendant que d'un côté les Eoliens changeoient l'esprit rude en f, d'un autre les Espagnols changent le f en hé aspiré ; ils disent harina pour farina, hava pour faba, herver pour fervor, hermoso pour formoso, humo au lieu de fumo, &c.
Le double f, ff, signifie par abbréviation les pandectes, autrement digeste ; c'est le recueil des livres des jurisconsultes romains, qui fut fait par ordre de Justinien empereur de Constantinople : cet empereur appella également ce recueil digeste, mot latin, & pandectes, mot grec, quoique ce livre ne fût écrit qu'en latin. Quand on appelle ce recueil digeste, on le cite en abregé par la premiere lettre de ce mot d. Quand dans les pays latins on voulut se servir de l'autre dénomination, & surtout dans un tems où le grec étoit peu connu, & où les Imprimeurs n'avoient point encore de caracteres grecs, on se servit du double f, ff, c'est le signe dont la partie inférieure approche le plus du ?? grec, premiere lettre de ?????????, c'est-à-dire livres qui contiennent toutes les décisions des jurisconsultes. Telle est la raison de l'usage du double f, ff, employé pour signifier les pandectes ou digeste dont on cite tel ou tel livre.
Le dictionnaire de Trévoux, article F, fait les observations suivantes :
1°. En Musique, F-ut-fa est la troisieme des clés qu'on met sur la tablature.
2°. F, sur les pieces de monnoie, est la marque de la ville d'Angers.
3°. Dans le calendrier ecclésiastique, elle est la sixieme lettre dominicale. (F)
F, (Ecriture.) si l'on considere ce caractere du côté de sa formation, dans notre écriture ; c'est dans l'italienne & la ronde, la huitieme, la premiere, & la seconde partie de l'o ; trois flancs de l'o l'un sur l'autre, & la queue de la premiere partie de l'x. L'f coulée a les mêmes racines, à l'exception de sa partie supérieure qui se forme de la sixieme & de la septieme partie de l'o : on y employe un mouvement mixte des doigts & du poignet, le pouce plié dans ses trois jointures. Voyez les Planches à la table de l'Ecriture, planche des Alphabets.
F-UT-FA, (Musique.) F-ut-fa, ou simplement F ; caractere ou terme de Musique, qui indique la note de la gamme que nous appellons fa. Voy. Gamme.
C'est aussi le nom de la plus basse des trois clés de la Musique. Voyez Clés. (S)
F, (Comm.) les marchands, banquiers, teneurs de livres, se servent de cette lettre pour abréger les renvois qu'ils font aux différentes pages, ou comme ils s'expriment au folio de leurs livres & registres. Ainsi F°. 2. signifie folio 2. ou page seconde. Les florins se marquent aussi par un F de ces deux manieres : FL ou FS. Dict. du Comm. & Chambers. (G)
Étymologie de « f »
F des Latins?; ?, digamma des Grecs.
F au Scrabble
Le mot f vaut 4 points au Scrabble.
Informations sur le mot f - 1 lettres, 0 voyelles, 1 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot f au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
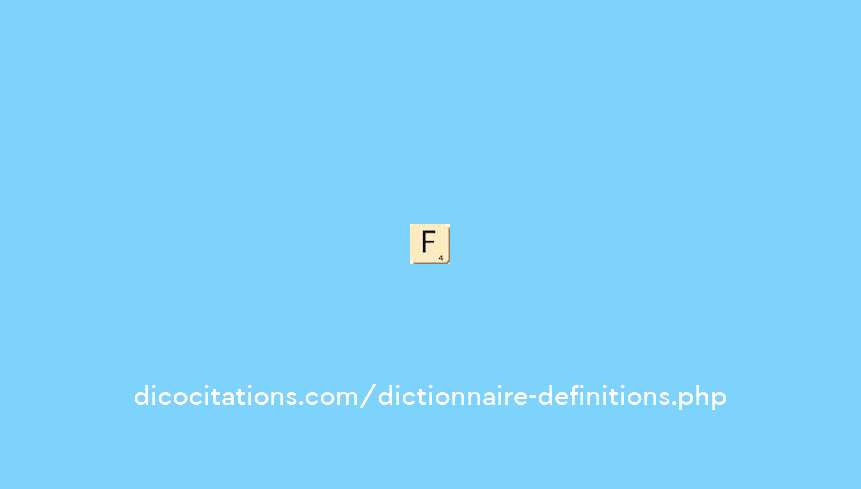
Les mots proches de F
F Fa Fable Fabliau Fablier Fabricateur, trice Fabrication Fabrique Fabriquer Fabuleusement Fabuleux, euse Fabuliste Fabulosité Façade Face Facétie Facétieusement Facétieux, euse Facette Fâché, ée Fâcher Fâcherie Fâcheusement Fâcheux, euse Faciendaire Faciende Facile Facilement Facilitation Facilité Faciliter Façon Faconde Façonné, ée Façonner Façonnier, ière Fac-similer Facteur Factice Facticement Factieusement Factieux, euse Faction Factionnaire Factorat Factorerie ou factorie Factotum Factum Facture Facture f F?il fa Fa Fabas Fabas Fabas fabien fabienne fabiens fabiola fable fables fabliau fabliaux Fabras Fabrègues Fabrezan fabricant fabricante fabricantes fabricants fabrication fabrications fabrice fabriqua fabriquai fabriquaient fabriquais fabriquait fabriquant fabrique fabrique fabriqué fabriquée fabriquées fabriquent fabriquer fabriquera fabriquerai fabriquerais fabriquerait fabriquèrent fabriquerez fabriquerons fabriqueront fabriques fabriques fabriqués fabriquezMots du jour
Gaucherie Crierie Rampant, ante Mouvementer Embarrer Contenter Conjouir (se) Scélan Décrasser Contre-sujet
Les citations avec le mot F
- Il ne faut point se jouer de la haine des petites gens,
De fort grands personnages ont été suffoqués par une mouche.Auteur : Proverbes arabes - Source : Proverbe - Les anciens ont défini l'éloquence le talent de persuader, et ils ont distingué persuader de convaincre, le premier de ces mots ajoutant à l'autre l'idée d'un sentiment actif excité dans l'âme de l'auditeur et joint à la conviction.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Mélanges littéraires
- Ses camarades eussent été fort embarrassés d'asseoir un jugement vrai sur lui.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Les Marana
- Le vent gonfle les outres vides, l'outrecuidance les hommes sans jugement.Auteur : Jean Stobée - Source : Sentences
- J'ignorais ce qu'une femme doit attendre d'un époux, mais le contentement que j'éprouvais à m'endormir auprès de lui, sitôt nos corps délivrés du singulier mystère des gestes de la nuit, me fut une réponse suffisante.Auteur : Gaëlle Josse - Source : Les Heures silencieuses (2011)
- De Chirac on ne se souviendra de rien, sauf de mes réformes.Auteur : François Fillon - Source : Le Monde, 4 juin 2005.
- Un sot est quelqu'un qui a toujours le mot pour faire rire de lui.Auteur : Jules Renard - Source : Journal
- Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices, - Et chercher sur la terre un endroit écarté - Où d'être homme d'honneur on ait la liberté.Auteur : Molière - Source : Le Misanthrope (1666), V, 4, Alceste
- Si tu crois que tu as besoin de faire un voyage, il est temps de préparer tes bagages.Auteur : Daniel Desbiens - Source : Maximes d'Aujourd'hui
- Une fois de plus, il sentit les mots de l'écrivain le prendre et l'emporter vers des territoires où régnaient la nuit et le crime. Une fois de plus, le même sentiment de malaise et de fascination mêlés l'étreignit au fil des pages. Dans la bulle de lumière de la lampe, les mots, les scènes, les personnages sortaient du livre et dansaient une ronde autour de lui. Auteur : Bernard Minier - Source : Soeurs (2018)
- Rien ne semble vrai, qui ne puisse sembler faux.Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais, II, 13
- Les engagés blancs ne s'intéressaient pas à elle, rebutés par l'annonce de son état ; le propriétaire attendait la naissance du nouvel esclave, tout ravi de cette augmentation de capital qui n'avait entraîné aucune dépense ni demandé quelque aménagement que ce fût. Auteur : Edouard Glissant - Source : La Case du Commandeur (1981)
- La tendresse c'est l'amour exempt de toute convoitise, de toute possession. C'est faire le choix de l'autre pour lui donner du bon.Auteur : Jacques Salomé - Source : Apprivoiser la tendresse (2005)
- Elle allait dans un institut de beauté pour se faire désincruster le visage. Qu'est-ce que ça pouvait être cette désincrustation? Peut-être que ça faisait sortir de petits vers de chaque pore.Auteur : Albert Cohen - Source : Belle du Seigneur (1968)
- Ce que je déteste le plus à l'étranger, c'est que les gens parlent pas français. Et selon les pays où l'on va, ils parlent pas le même étranger.Auteur : Coluche - Source : Les Vacances (1980)
- Lorsqu'on n'est pas conduit par l'intérêt ou par l'amour, il est difficile de ne pas l'être par orgueil. Croit-on avoir vaincu l'orgueil, il suit notre humilité en l'encourage à voix basse.Auteur : Gérard Bauër - Source : Carnets inédits
- Nous nous jetâmes dans les bras l'un de l'autre avec une fureur que je n'avais jamais connue, comme si nos corps se heurtaient l'un contre l'autre dans l'intention de se briser. C'était donc ça, le plaisir : se fracasser, se mêler, ne plus savoir ce qui était à lui ou à moi. Auteur : Elena Ferrante - Source : L'Amie prodigieuse, tome 3 : Celle qui fuit et celle qui reste (2017)
- L'ingrate me condamne à mourir dans la flamme
Que l'éclat de ses yeux alluma dans mon âme.Auteur : Pierre Du Ryer - Source : Les Vendanges de Suresnes (1636) - L'homme est un animal crédule, il a besoin de croire et, à défaut de fondements solides à sa croyance, il se contentera de fondements bancals.Auteur : Bertrand Russell - Source : De la fumisterie intellectuelle (2013)
- Mes respects : Formule de politesse qui n'a perduré qu'en perdant son possessif et le pluriel : respect !Auteur : Philippe Bouvard - Source : Bouvard de A à Z (2014)
- Rien n'y manque pour aggraver l'émeute, ni les excitations plus vives pour la provoquer, ni les bandes plus nombreuses pour la faire.Auteur : Hippolyte Taine - Source : Les Origines de la France contemporaine (1876-1893)
- Alors, Nana devint une femme chic, rentière de la bêtise et de l'ordure des mâles, marquise des hauts trottoirs.Auteur : Emile Zola - Source : Nana (1880)
- Les femmes nous qualifient de virils dès que nous possédons ces quatre attributs : un visage intense, un sourire latent, un aplomb naturel, une vitalité posée.Auteur : Vincent Cespedes - Source : L'Homme expliqué aux femmes (2010)
- Rien de triste ou d'attendri n'amollissait ce regard pâle. Dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Madame Bovary (1857), II, 8
- Une certaine confusion règne encore, mais encore un peu de temps et tout s'éclaircira; nous verrons enfin apparaître le miracle d'une société animale, une parfaite et définitive fourmilière.Auteur : Paul Valéry - Source : Variété, I
Les citations du Littré sur F
- Il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fieffé, le plus vilain homme du mondeAuteur : Molière - Source : Scapin, III, 3
- Se li parleres rent foible raison de son ditAuteur : BRUN. LATINI - Source : ib.
- Connaissant l'iniquité du pere, qui laissoit moisir sa fille, de peur de demoisir ses escusAuteur : MARGUER. - Source : Nouv. 44
- Les enfants n'en veulent plus croire leurs grands-pèresAuteur : BOSSUET - Source : Hist. II, 2
- C'était un rassemblement de commérages, une collection d'ennuis tout à la fois divers et monotonesAuteur : Mme DE STAËL - Source : Corinne, XIV, 1
- Vous figurez-vous Ce diable habillé d'écarlate ? Bossu, louche et roux ; Un serpent lui sert de cravate ; Il a le nez crochuAuteur : BÉRANG. - Source : H. rouge.
- La vie monastique, qui fait tant de bien et tant de mal, qui a été une des colonnes de la papauté, et qui a produit celui [Luther] par qui la papauté fut exterminée dans la moitié de l'Europe, mérite une attention particulièreAuteur : Voltaire - Source : Moeurs, 139
- Nous avons dans nos pucerons un genre d'insectes qui, à la propriété de se multiplier sans accouplement, joint encore celle d'être à la fois vivipare et ovipareAuteur : BONNET - Source : Observ. Pucerons.
- Fille que j'ay, puis que vous fustes née, Orphenine de mere defaillant, Dix et sept ans nourrie et gouvernée....Auteur : E. DESCH. - Source : Ball. Comment le père....
- Aussi, à dire le vrai, c'est une extrême méchanceté de se moquer d'un pauvre enfant qui n'a appris le français que pour l'amour de moi, et qui a eu du moins l'esprit de me choisir entre tous ceux qui sont iciAuteur : Vincent Voiture - Source : Lett. 57
- Votre idée d'élever différemment des quadrupèdes de la même portée ou des oiseaux de la même nichée est excellenteAuteur : BONNET - Source : Lett. divers. Oeuv. t. XII, p. 468, dans POUGENS
- Vous rompez à la peine vos personnes, à fin qu'il [le tyran] se puisse mignarder en ses delicesAuteur : LA BOÉTIE - Source : Servit. volont.
- Il était impossible de soutenir que l'auteur ne connaissait point le monde, et que le tableau qu'il en présentait manquait de fidélitéAuteur : GENLIS - Source : Veillées du château t. III, p. 224, dans POUGENS
- .... Qu'elles sont bonnes ou mauvaises, utiles ou dommageables, à suyvre ou fuyrAuteur : CHARRON - Source : Sagesse, I, 19
- Il [un oiseau] est difficile à tirerAuteur : BUFF. - Source : Ois. t. VI, p. 110
- J'ai forcé le débris de leurs armées de s'enfermer dans leurs placesAuteur : VERTOT - Source : Révol. rom. liv. III, p. 251
- Je doute qu'une démonstration mathématique parût une vérité à quelqu'un dont elle combattrait une passion forte ; il y supposerait des paralogismesAuteur : DUCLOS - Source : Consid. moeurs, 14
- Elle vit qu'elle allait unir la maison de France à la royale famille des StuartsAuteur : BOSSUET - Source : Reine d'Anglet.
- Il [Aristote] dit que les lions, les ours, les renards naissent informes, presque inarticulésAuteur : BUFF. - Source : Quadrup. t. III, p. 116
- De toutes les fausses piétés, je prétends qu'il n'en est point de plus indigne que cette piété mercenaire et intéresséeAuteur : BOURDAL. - Source : 5e dim. après la Pentecôte, Dominic. t. II, p. 459
- Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne intéressée, n'est qu'infidèle ; s'il la croit fidèle, elle est perfideAuteur : LA BRUY. - Source : III
- Faulchez le pré en la saison, l'herbe y reviendra plus drueAuteur : François Rabelais - Source : V, 7
- Qui ennuy fait ennuy requiert, Et ferus doit estre qui fiertAuteur : LEROUX DE LINCY - Source : Prov. t. II, p. 390
- Il vint trouver le roi, duquel il fut magnifiquement receuAuteur : D'AUB. - Source : Hist. II, 68
- Que si j'unis à ce motif principal les autres motifs très considérables, mais toutefois subsidiaires et moins principaux, qui ont rapport à nousAuteur : BOSSUET - Source : Avert. sur des écrits.... 9
Les mots débutant par F Les mots débutant par F
Une suggestion ou précision pour la définition de F ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 04h36

- Facilite - Faible - Faiblesse - Faim - Faire - Fait - Famille - Fanatique - Fatalite - Fatigue - Faute - Faveur - Felicitations - Femme - Femme_homme - Ferocite - Fete - Fête des mamans - Fête des papas - Fête des mères - Fête des pères - Fidele - Fidèle - Fidelite - Fidélité - Fierte - Fille - Fils - Finalite - Finance - Flamme - Flatter - Flatterie - Fleur - Foi - Folie - Fonctionnaire - Foot - Football - Force - Fortune - Fou - Foule - Français - Française - France - Franchise - Fraternite - Frustation - Fuir - Futur
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur f
Poèmes f
Proverbes f
La définition du mot F est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot F sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification F présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
