Définition de « ô »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot o de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur ô pour aider à enrichir la compréhension du mot ô et répondre à la question quelle est la définition de o ?
Une définition simple : (lettre|ô|Ô|o a.ks?? si?.k??.fl?ks) ô (m) (inv)
Définitions de « o »
Trésor de la Langue Française informatisé
O, o, lettre
La quinzième lettre de l'alphabet; un spécimen de cette lettre. La gamme implacable a e i o u (Gourmont,Esthét. lang. fr., 1899, p.129).Ils mangent et, après un moment de silence, Z demande à Y ce qu'est devenu un autre de leurs amis: ?Et O? ?Pets! Cure, air: aise... [P, Q, R, S] (P. Couratin, G.Kolebka, Au restaurant, Histoire de parler la bouche pleine ds Okapi, 1erjanv. 1983, no267, p.25):O, o, lettre
La quinzième lettre de l'alphabet; un spécimen de cette lettre. La gamme implacable a e i o u (Gourmont,Esthét. lang. fr., 1899, p.129).Ils mangent et, après un moment de silence, Z demande à Y ce qu'est devenu un autre de leurs amis: ?Et O? ?Pets! Cure, air: aise... [P, Q, R, S] (P. Couratin, G.Kolebka, Au restaurant, Histoire de parler la bouche pleine ds Okapi, 1erjanv. 1983, no267, p.25):Wiktionnaire
Préposition - ancien français
o \Prononciation ?\
- Variante de od (« avec »).
Pronom - ancien français
o \Prononciation ?\
-
Cela.
- in o quid il mi altresi fazet ? (Serments de Strasbourg)
-
« di nos, prophete, chi t'o fedre ? » ? (Passion du Christ de Clermont, édition de G. Paris)
- « dis nous, prophète, qui te fit cela ? »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
La quinzième lettre de l'alphabet. Elle représente une des voyelles. Un grand O. Un petit o. Former un o. O est marqué d'un accent circonflexe dans côte. O est ouvert dans bord. O est fermé dans rose. O se combine avec E dans Œuf. O est nasalisé dans bon. O ne se prononce pas dans faon, paon. Ô, avec l'accent circonflexe, est une interjection qui sert à marquer diverses passions, divers mouvements de l'âme, etc. Ô temps! ô mœurs! Ô douleur! ô regret! Ô le malheureux d'avoir fait une si méchante action! Ô le plaisant homme de prétendre que... Il marque aussi le vocatif, l'apostrophe. Ô mon fils! Ô mon Dieu! Les O de Noël, Neuf antiennes qui commencent chacune par la particule latine O et que l'Église chante successivement dans les neuf jours qui précèdent Noël.
Littré
-
1La quinzième lettre de l'alphabet et la quatrième voyelle. Un grand O. Un petit o.
Il est vrai qu'on a fort longtemps prononcé en France l'o simple comme s'il y eût eu un u, comme chouse pour chose, foussé pour fossé, arrouser pour arroser, et ainsi plusieurs autres?; mais, depuis dix ou douze ans, ceux qui parlent bien disent arroser, fossé, chose
, Vaugelas, Rem. t. II, p. 536, dans POUGENS.Comment voulez-vous qu'une nation puisse subsister avec honneur, quand on imprime je croyois, j'octroyois, et qu'on prononce je croyais, j'octroyais?? comment un étranger pourra-t-il deviner que le premier o se prononce comme un o, et le second comme un a??
Voltaire, Disc. Velches, Suppl.L'o bref, celui qui n'est marqué d'aucun signe et qui se prononce comme dans hotte?; l'ô long, celui qui est marqué d'un accent circonflexe et qui se prononce dans hôte.
-
2Dans les chiffres romains, lettre numérale qui signifiait onze.
Avec un tiret dessus, dans cette ferme, O signifiait onze mille.
- 3Sur les anciennes monnaies de France, O indique celles qui ont été frappées à Riom.
- 4Dans l'ancienne musique, signe qui marquait le temps parfait, c'est-à-dire la mesure en trois temps?; la moitié de ce signe, ou un C indiquait le temps imparfait?; cette dernière indication est seule restée en usage.
- 5Dans le calendrier républicain, O marque le 8e jour de la décade, octidi.
-
6O désignait l'alun dans l'ancienne chimie?; OO désignait l'huile.
O désigne maintenant l'oxygène.
- 7En géographie, astronomie et marine, O signifie ouest?; S. O., sud-ouest?; N. O., nord-ouest.
- 8 Terme de commerce. Abréviation du mot ouvert?: C/O, compte ouvert.
- 9Parmi les anciens, la lettre O était le symbole de l'éternité, à cause qu'elle figure un cercle qui n'a pas de fin.
-
10Se dit d'une ouverture ronde. Ainsi on appelle quelquefois O l'ouverture faite à la nef d'une église pour communiquer avec les combles.
Il se dit plus fréquemment de la rose ou fenêtre circulaire qui se trouve au-dessus du portail des anciennes églises.
- 11L'O du Giotto, se dit d'une figure parfaitement ronde, tracée, dit-on, par le Giotto d'un seul coup de pinceau, pour donner au pape Benoît IX une preuve de son habileté?; c'est le pendant de l'histoire d'Apelle et de Protogène.
HISTORIQUE
XIIIe s. O est roons comme li mons [le monde]?; O est maniere d'arester, D'estanchier et de coi ester, Etde mal faire cesser rueve [demande]?; Lceste lettre bien le prueve, Senefiance de l'A B C
, Jubinal, t. II, p. 282.
Encyclopédie, 1re édition
, S. m. (Gram.) c'est la quinzieme lettre, &
la quatrieme voyelle de l'alphabet françois.
Ce caractere a été long-tems le seul
dont les Grecs fissent usage pour représenter
le même son, & ils l'appelloient du nom même
de ce son. Dans la suite on introduisit un second
caractere ?, afin d'exprimer par l'ancien l'o bref, &
par le nouveau, l'o long : l'ancienne lettre ? ou ?,
fut alors nommée ???????, o parvum ; & la nouvelle,
? ou ?, fut appellée ?????, O magnum.
Notre prononciation distingue également un o long & un o bref ; & nous prononçons diversement un hôte (hospes), & une hotte (sporta dossuaria) ; une côte (costa), & une cotte (habillement de femme) ; il saute (saltat), & une sotte (stulta) ; beauté (pulchritudo), & botté (ocreatus), &c. Cependant nous n'avons pas introduit deux caracteres pour désigner ces deux diverses prononciations du même son. Il nous faudroit doubler toutes nos voyelles, puisqu'elles sont toutes ou longues ou breves : a est long dans cadre, & bref dans ladre ; e est long dans tête, & bref dans il tette ; i est long dans gîte, & bref dans quitte ; u est long dans flûte, & bref dans culbute ; eu est long dans deux, bref dans feu, & plus bref encore dans me, te, de, & dans les syllabes extrèmes de fenêtre ; ou est long dans croûte, & bref dans déroute.
Je crois, comme je l'ai insinué ailleurs (voyez Lettres), que la multiplication des lettres pour désigner les différences prosodiques des sons n'est pas sans quelques inconvéniens. Le principal seroit d'induire à croire que ce n'est pas le même son qui est représenté par les deux lettres, parce qu'il est naturel de conclure que les choses signifiées sont entre elles comme les signes : de-là une plus grande obscurité sur les traces étymologiques des mots ; le primitif & le dérivé pourroient être écrits avec des lettres différentes, parce que le méchanisme des organes exige souvent que l'on change la quantité du radical dans le dérivé.
Ce n'est pas au reste que je ne loue les Grecs d'avoir voulu peindre exactement la prononciation dans leur orthographe : mais je pense que les modifications accessoires des sons doivent plutôt être indiquées par des notes particulieres ; parce que l'ensemble est mieux analysé, & conséquemment plus clair ; & que la même note peut s'adapter à toutes les voyelles, ce qui va à la diminution des caracteres & à la facilité de la lecture.
L'affinité méchanique du son o avec tous les autres, fait qu'il est commuable avec tous, mais plus ou moins, selon le degré d'affinité qui résulte de la disposition organique : ainsi o a plus d'affinité avec eu, u, & ou, qu'avec a, ê, é, i ; parce que les quatre premieres voyelles sont en quelque sorte labiales, puisque le son en est modifié par une disposition particuliere des levres ; au lieu que les quatre autres sont comme linguales, parce qu'elles sont différentiées entre elles par une disposition particuliere de la langue, les levres étant dans le même état pour chacune d'elles : l'abbé de Dangeau, opusc. pag. 62. avoit insinué cette distinction entre les voyelles.
Voici des exemples de permutations entre les voyelles labiales, & la voyelle o.
O changé en eu : de mola vient meule ; de novus, neuf ; de soror, s?ur qui se prononce seur ; de populus, peuple ; de cor, c?ur.
O changé en u : c'est ainsi que l'on a dérivé humanus & humanitas de homo ; cuisse de coxa ; cuir de corium ; cuit de coctus ; que les Latins ont changé en us la plûpart des terminaisons des noms grecs en ?? ; qu'ils ont dit, au rapport de Quintilien & de Priscien, huminem pour hominem, frundes pour frondes, &c.
Au contraire u changé en o : c'est par cette métamorphose que nous avons tombeau de tumulus, combles de culmen, nombre de numerus ; que les Latins ont dit Hecoba pour Hecuba, colpa pour culpa ; que les Italiens disent indifféremment fosse ou fusse, facoltà ou facultà, popolo ou populo.
O changé en ou : ainsi mouvoir vient de movere, moulin de moletrina, pourceau de porcus, glousser de glocio, mourir de mori, &c.
Les permutations de l'o avec les voyelles linguales sont moins fréquentes ; mais elles sont possibles, parce que, comme je l'ai déja remarqué d'après M. le président de Brosses (art. Lettres), il n'y a proprement qu'un son diversement modifié par les diverses longueurs ou les divers diametres du tuyau : & l'on en trouve en effet quelques exemples. O est changé en a dans dame, dérivé de domina : en e dans adversùs, au lieu de quoi les anciens disoient advorsùs, comme on le trouve encore dans Térence ; en i dans imber, dérivé du grec ??????.
Nous représentons souvent le son o par la diphtongue oculaire au, comme dans aune, baudrier, cause, dauphin, fausseté, gaule, haut, jaune, laurier, maur, naufrage, pauvre, rauque, sauteur, taupe, vautour : d'autres fois nous représentons o par eau, comme dans eau, tombeau, cerceau, cadeau, chameau, fourneau, troupeau, fuseau, gâteau, veau. Cette irrégularité orthographique ne nous est pas propre : les Grecs ont dit ???? & ?????, sulcus (sillon) ; ????? & ??????, vulnus, (blessure) : & les Latins écrivoient indifféremment cauda & coda (queue) ; plaustrum & plostrum (char) ; lautum & lotum au supin du verbe lavare (laver).
La lettre o est quelquefois pseudonyme, en ce qu'elle est le signe d'un autre son que de celui pour lequel elle est instituée ; ce qui arrive par-tout où elle est prépositive dans une diphtongue réelle & auriculaire : elle représente alors le son ou ; comme dans bésoard, bois, soin, que l'on prononce en effet bésouard, bouas, souèn.
Elle est quelquefois auxiliaire, comme quand on l'associe avec la voyelle u pour représenter le son ou qui n'a pas de caractere propre en françois ; comme dans bouton, courage, douceur, foudre, goutte, houblon, jour, louange, moutarde, nous, poule, souper, tour, vous. Les Allemands, les Italiens, les Espagnols, & presque toutes les nations, représentent le son ou par la voyelle u, & ne connoissent pas le son u, ou le marquent par quelqu'autre caractere.
O est encore auxiliaire dans la diphtongue apparente oi, quand elle se prononce é ou è ; ce qui est moins raisonnable que dans le cas précédent, puisque ces sons ont d'autres caracteres propres. Or oi vaut ê : 1°. dans quelques adjectifs nationnaux, anglois, françois, bourbonnois, &c : 2°. aux premieres & secondes personnes du singulier, & aux troisiemes du pluriel, du présent antérieur simple de l'indicatif, & du présent du suppositif ; comme je lisois, tu lisois, ils lisoient ; je lirois, tu lirois, ils liroient : 3°. dans monnoie, & dans les dérivés des verbes connoître & paroître où l'oi radical fait la derniere syllabe, ou bien la pénultieme avec un e muet à la derniere ; comme je connois, tu reconnois, il reconnoît ; je comparois, tu disparois, il reparoît ; connoître, méconnoître, que je reconnoisse : comparoître, que je disparoisse, que tu reparoisses, qu'ils apparoissent. Oi vaut è : 1°. dans les troisiemes personnes singulieres du présent antérieur simple de l'indicatif, & du présent du suppositif ; comme il lisoit, il liroit : 2°. dans les dérivés des verbes connoître & paroître où l'oi radical est suivi d'une syllabe qui n'a point d'e muet ; comme connoisseur, reconnoissance, je méconnoitrai ; vous comparoitrez, nous reparoitrions, disparoissant.
La lettre o est quelquefois muette : 1°. dans les trois mots paon, faon, Laon (ville), que l'on prononce pan, fan, Lan ; & dans les dérivés, comme paonneau (petit paon) qui differe ainsi de panneau (terme de Menuiserie), laonnois (qui est de la ville ou du pays de Laon) : 2°. dans les sept mots ?uf, b?uf, m?uf, ch?ur, c?ur, m?urs & s?ur, que l'on prononce euf, beuf, meuf, keur, keur, meurs & seur : 3°. dans les trois mots ?il, ?illet & ?illade, soit que l'on prononce par è comme à la fin de soleil, ou par eu comme à la fin de cercueil. On écrit aujourd'hui économe, économie, écuménique, sans o ; & le nom ?dippe est étranger dans notre langue.
O' apostrophé devant les noms de famille, est en Irlande un signe de grande distinction, & il n'y a en effet que les maisons les plus qualifiées qui le prennent : o'Briem, o'Carrol, o'Cannor, o'Néal.
En termes de Marine, O veut dire ouest ; S. O. sud-ouest ; S. S. O. sud-sud-ouest ; O. S. O. ouest-sud-ouest. Voyez N & Rhumb.
Sur nos monnoies, la lettre o désigne celles qui sont fabriquées à Riom.
Chez les anciens, c'étoit une lettre numérale qui valoit 11 ; & surmontée d'une barre, O valoit 11000, selon la regle ordinaire :
O numerum gestat qui nunc undecimus extat.
(B. E. R. M.)
O, s. m. (Théol.) nom qu'on a donné aux sept ou neuf antiennes qu'on chante dans l'Avent pendant sept ou neuf jours auparavant la fête de Noël, & qui précedent le cantique Magnificat. On les appelle encore ainsi parce que chacune d'elles commence par cette exclamation : comme O rex gentium. O Emmanuel, &c. Voyez Antienne.
O, o, o, (Ecriture.) considéré dans sa forme, c'est une ligne courbe continue, dont tous les points supérieurs & inférieurs sont plus éloignés du centre que ceux des flancs ; elle est presque racine de toutes les mineures ; elle se forme sans interruption du mouvement mixte des doigts & du poignet : dans l'italienne les angles de l'o sont beaucoup plus obtus que ceux de l'o coulé ; ce qui fait que celui-ci est moins ouvert que celui-là. A l'égard de l'o rond, il est ainsi appellé, parce qu'il approche du cercle, que ses points supérieurs & inférieurs sont à un point près aussi proche du centre que ceux des flancs. Voyez le volume des Planches à la table de l'Ecriture des figures radicales mineures.
O, (Comm.) dans les livres des marchands, banquiers, ou négocians, joint à quelques autres lettres, marque différentes abréviations : ainsi C. O. est l'abbréviation de compte ouvert ; O N C. ou O N. signifient onces. Dictionn. de Comm. (G)
O, majuscule (Musique.) qui est proprement un cercle, ou double C, est dans nos musiques anciennes ; la marque de ce qu'ils appelloient tems parfait, c'est-à-dire, de la mesure triple ou à trois, à la différence du tems imparfait ou de la mesure double, qu'ils marquoient par un C simple, ou par un O tronqué à droite ou à gauche C, ou ?
Le tems parfait se marquoit par un O simple, ou
pointé en-dedans, ou barré. ![]() Voyez Tems.
(S)
Voyez Tems.
(S)
Étymologie de « o »
Lat. o?; grec, ? et ?.
- (842) (Les Serments de Strasbourg) Du latin hoc.
ô au Scrabble
Le mot ô vaut 1 points au Scrabble.
Informations sur le mot o - 1 lettres, 1 voyelles, 0 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ô au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
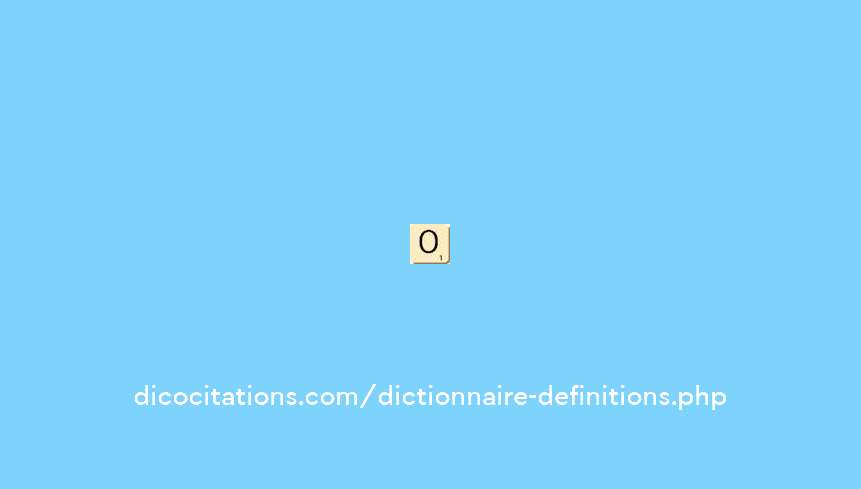
Les rimes de « ô »
On recherche une rime en O .
Les rimes de ô peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en O
Mots du jour
Les citations sur « ô »
- La Négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut, et sursaut de dignité.Auteur : Aimé Césaire - Source : Conférence des peuples noirs de la diaspora, à Miami, 26 février 1987.
- Je photographie mon réveille-matin toutes les heures pour garder un souvenir du temps qui passe.Auteur : Philippe Geluck - Source : Le tour du chat en 365 jours (2006)
- Le cours de toute chose a ses sources lointaines
Ou s'amassent longtemps les passions humaines,
Et, quand le flot grossi doit enfin deborder,
Nul homme, quel qu'il soit, ne saurait le guider.Auteur : François Ponsard - Source : Charlotte Corday (1850), I, 1 - Donne le lait de l'automne à ceux qui te sont chers.Auteur : Proverbes kurdes - Source : Proverbe
- Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage.Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais, I, 31, Des Cannibales
- La neige dehors est très blanche ; et il règne ce silence étouffé de la neige, ce silence qui attend une révélation dont on sait seulement que la venue fait battre le coeur plus allègrement. Auteur : Marcelle Sauvageot - Source : Laissez-moi
- La jalousie part toujours d'une profonde ignorance.Auteur : Olivier de Kersauson - Source : Sans référence
- Toute tête est un entrepôt, où dorment des statues de dieux et de démons de toute taille et de tout âge, dont l'inventaire n'est jamais dressé.Auteur : Michel Butor - Source : Passage de Milan
- Qui s'étonnera des erreurs de l'antiquité, s'il considère qu'encore aujourd'hui, dans le plus philosophe de tous les siècles, bien des gens de beaucoup d'esprit n'oseraient se trouver à une table de treize couverts?Auteur : Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues - Source : Réflexions et Maximes (1746)
- ... soigner c'est aussi dévisager, parler - reconnaître par le regard et la parole la souveraineté intacte de ceux qui ont tout perdu.Auteur : Christian Bobin - Source : La présence pure
- Boudin: Signe de gaieté dans les maisons. Indispensable la nuit de Noël.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- C'est l'abbé qui fait l'église
C'est le roi qui fait la tour
Qui fait l'hiver ? C'est la bise.
Qui fait le nid ? C'est l'amour.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Chansons des rues et des bois (1865) - Les signes ne peuvent pas figurer, dans un rapport d'espion, aussi avantageusement que des paroles.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : Le Rouge et le Noir (1830)
- Un gouvernement qui pactise sans cesse avec l'émeute périt par l'émeute.Auteur : Gustave Le Bon - Source : Aphorismes du temps présent (1913)
- il scruta son visage : elle avait vieilli. Ses yeux disparaissaient, enfoncés dans les rides qui les mangeaient, rivière jamais rassasiée. Le vert si dur, si beau de ce regard avalé par le temps se transformait en gris, un gris de terre, un gris de jument, un gris qui ternissait tout, amplifiait les petites peurs, les angoisses sans importance. Auteur : Cécile Coulon - Source : Une bête au paradis (2019)
- Tout homme qui possède son alphabet est un écrivain qu'il ne faut pas méconnaître.Auteur : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline - Source : Sans référence
- Toutes les religions ont raison au fond et tort dans la forme. Texte: Dieu. Traducteur, trahisseur. Une religion est un traducteur.Auteur : Victor Hugo - Source : Tas de pierres (1901)
- Celui qui sombre dans la drogue ou dans l'alcool paiera un jour ou l'autre l'addictionAuteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Tant que le beau-père de son fils s'était montré rogue et agressif, elle avait trouvé de la force dans la résistance qu'elle opposait à la brutalité du boutiquier.Auteur : Honoré de Balzac - Source : La Cousine Bette (1846)
- Comprendre, analyser, c'est, pour l'artiste, détruire et se détruire.Auteur : Henri-René Lenormand - Source : Confession d'un auteur dramatique (1949), VII. Fantômes et mirages
- Alors je dirais au moment : attarde-toi, si tu es si beau ! La trace de mes jours terrestres ne peut s'engloutir dans l'Oeone. Dans le pressentiment d'une telle félicité sublime, je goûte maintenant l'heure ineffable.Auteur : Johann Wolfgang Goethe - Source : Second Faust (1832), V, La grande cour du palais
- Un sot savant est plus sot qu'un sot ignorant.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Les mots ne peuvent pas toujours faire recommencer l'amour. Ni les mots ni l'a musique hélas. Mais on essaie. Depuis dix mille ans on essaie tous.Auteur : Erik Orsenna - Source : La grammaire est une chanson douce (2001)
- Quand on est jeune on a du temps mais pas d'argent, quand on est vieux c'est le contraire. Et dans tous les cas on dépense n'importe comment.Auteur : Martin Page - Source : L'apiculture selon Samuel Beckett (2013)
- J'avais la sensation que mon acidité gastrique était en train de bouffer mon gilet pare-balles.Auteur : Donald Harstad - Source : Onze jours (2004)
Les mots proches de « o »
O O O Ô Oasis Obédience Obédientiel, elle Obéi, ie Obéir Obéissamment Obéissance Obéissant, ante Obélisque Obéré, ée Obérer Obier Obit Objecter Objecteur Objectif, ive Objection Objectionnable Objectivation Objectivement Objet Objurgation Oblat Oblation Obligation Obligatoire Obligé, ée Obligeamment Obligeance Obligeant, ante, Obliger Oblique Obliquement Obliquité Oblitéré, ée Oblitérer Oblivieux, euse Oblong, ongue Obnoxiation Obole Obombration Obombrer Obreptice Obreption Obscène ObscénitéLes mots débutant par ô Les mots débutant par o
o o ô oaristys oasis ob Obaix obédience obédiences obéi obéie obéîmes obéir obéira obéirai obéiraient obéirais obéirait obéiras obéirent obéirez obéiriez obéirons obéiront obéis obéissaient obéissais obéissait obéissance obéissant obéissant obéissante obéissantes obéissants obéisse obéissent obéisses obéissez obéissiez obéissions obéissons obéit obélisque obélisques Obenheim obérant Oberbronn Oberbruck Oberdorf Oberdorf-Spachbach
Les synonymes de « o»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot ô dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « o » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot ô dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de ô ?
Citations ô Citation sur ô Poèmes ô Proverbes ô Rime avec ô Définition de ô
Définition de ô présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot ô sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot ô notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 1 lettres.
