Définition de « chiner »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot chiner de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur chiner pour aider à enrichir la compréhension du mot Chiner et répondre à la question quelle est la définition de chiner ?
Une définition simple :
Approchant : chinage, chine, chiné, chineur, chinure
Définitions de « chiner »
Trésor de la Langue Française informatisé
CHINER1, verbe trans.
[Le compl. d'obj. désigne une étoffe] Faire alterner des couleurs sur les fils de la chaîne de sorte qu'en les tissant se forme un dessin.CHINER2, verbe.
Wiktionnaire
Verbe 2 - français
chiner \?i.ne\ transitif ou intransitif 1er groupe (voir la conjugaison)
-
(Intransitif, ou parfois transitif) Chercher des occasions (chiffonniers, brocanteurs).
- Quitte parfois le bureau en milieu d'après-midi pour aller s'occuper de sa trentaine de ruches ou chiner des poteries antiques. ? (Site www.lepoint.fr)
- Il aimait chiner dans les brocantes pour retaper sa maison et la décorer dans un style traditionnel et ancien. ? (Jacques Bellanger, Le Puzzle de Dan Alaric, 2010)
- Tout dans la salle, la vaisselle comme l'ameublement, avait été chiné chez des antiquaires et formait un mélange coquet et disparate de meubles copiés du dix-huitième siècle français, de bibelots Art Nouveau, de vaisselle et de porcelaine anglaises. ? (Michel Houellebecq, La carte et le territoire, 2010, J'ai lu, page 64)
- [...] chiner, aller à la recherche des occasions et conclure de bons marchés avec des détenteurs ignorants [...]. ? (Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, 1847, chapitre XXIX, page 115 de l'édition Garnier)
-
Critiquer sur le ton de la plaisanterie ironique.
- Mais, de ce moment, c'est la guerre entre les Plâtriers et les Panoyaux, parce que les ceusses de l'école des Panoyaux ont chiné nos croix qui sont pas si belles qu'à eux? ? (Léon Frapié, La maternelle, Librairie Universelle, 1908)
- ? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. C'est un excellent homme, qui a confiance en moi. Et je ne voudrais pas qu'on le chine : je l'aime beaucoup? Mais, de ma vie passée, je ne lui ai pas tout dit. ? (Paul-Jean Toulet, Mon Amie Nane, 1922)
- « Vous pouvez me chiner, allez ! » ? (Elsa Triolet, Le premier accroc coûte deux cents francs, Les Amants d'Avignon, 1944, page 44)
- Marie-Lou avait été chic aussi, après tout. Elle ne l'avait pas trop chinée. ? (Georges Simenon, Strip-tease, première partie, ch. 5, Presses de la Cité, 1958)
-
(Argot) Faire la cour à une personne dans le but d'obtenir ses faveurs amoureuses.
- Ce mec n'arrête pas de chiner, je crois qu'il est en chien.
Verbe 1 - français
chiner \?i.ne\ transitif 1er groupe (voir la conjugaison)
- Colorier différemment les fils de la chaîne avant de tisser une étoffe, de manière qu'il en résulte un dessin quand le tissage est terminé.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Colorier différemment les fils de la chaîne avant de tisser une étoffe, de manière qu'il en résulte un dessin quand l'étoile est fabriquée. Le participe passé
CHINÉ, ÉE, s'emploie comme adjectif. Étoffe chinée, Qui a plusieurs couleurs.
Littré
- Terme de tisserand. Donner des couleurs différentes aux fils de la chaîne, et les disposer de sorte que la fabrication produise un dessin. Chiner une étoffe.
Encyclopédie, 1re édition
* CHINER, v. act. (Manufact. en soie.) Chiner une étoffe, c'est donner aux fils de la chaîne des couleurs différentes, & disposer ces couleurs sur ces fils de maniere que quand l'étoffe sera travaillée, elles y représentent un dessein donné, avec moins d'exactitude à la vérité que dans les autres étoffes, qui se font soit à la petite tire soit à la grande tire, mais cependant avec assez de perfection pour qu'on l'y distingue très-bien, & que l'étoffe soit assez belle pour être de prix. Voyez Tire (petite & grande).
Le chiner est certainement une des man?uvres les plus délicates qu'on ait imaginées dans les arts ; il n'y avoit guere que le succès qui pût constater la vérité des principes sur lesquels elle est appuyée. Pour sentir la différence des étoffes chinées & des étoffes faites à la tire, il faut savoir que pour les étoffes faites à la tire on commence par tracer un dessein sur un papier divisé horisontalement & verticalement par des lignes ; que les lignes horisontales représentent la largeur de l'étoffe ; que les lignes verticales représentent autant de cordes du métier (Voy. le métier à l'article Velours ciselé) ; que l'assemblage de ces cordes forme le semple, voyez Semple) ; que chaque corde de semple aboutit à une autre coide ; que l'assemblage de ces secondes cordes s'appelle le rame (Voyez Rame) ; que chaque corde de rame correspond a des fils de poil & de chaîne de diverses couleurs (Voyez Poil & Chaîne), ensorte qu'à l'aide d'une corde de semple on fait lever tel fil de poil & de chaîne, en tel endroit & de telle couleur qu'on desire ; que faire une étoffe à la petite ou à la grande tire, c'est tracer, pour ainsi dire, sur le semple le dessein qu'on veut exécuter sur l'étoffe, & projetter ce dessein sur la chaine ; que ce dessein se trace sur le semple, en marquant avec des ficelles & les cordes l'ordre selon lequel les cordes du semple doivent être tirées, ce qui s'appelle lire (Voyez Lire) ; & que la projection se fait & se fixe sur la chaîne, par la commodité qu'on a par les cordes de semple d'en faire lever un fil de telle couleur qu'on veut, & d'arrêter une petite portion de ce fil coloré à l'endroit de l'étoffe par le moyen de la trame.
Cette notion superficielle du travail des étoffes figurées, suffit pour montrer que la préparation du dessein, sa lecture sur le semple, la correspondance des cordes de semple avec celles de rame, & de celles de rame avec les fils de chaîne, & le reste du montage du métier, doivent former une suite d'opérations fort longues, en cas qu'elles soient possibles (& elles le sont), & que chaque métier demande vraissemblablement deux personnes, un ouvrier à la trame & au battant, & une tireuse au semple (& en effet il en faut deux).
Quelqu'un songeant à abréger & le tems & les frais de l'étoffe à fleurs, rencontra le chiner, en raisonnant à-peu-près de la maniere suivante. Il dit : si je prenois une étoffe ou toile toute blanche, & que je la tendisse bien sur les ensuples d'un métier, & qu'avec un pinceau & des couleurs je peignisse une fleur sur cette toile, il est évident 1° que s'il étoit possible de desourdir (pour ainsi parler) cette toile lorsque ma fleur peinte seroit seche, chaque fil de chaîne correspondant à la fleur que j'aurois peinte, emporteroit avec lui un certain nombre de points colorés de ma fleur, distribués sur une certaine portion de sa longueur ; 2° que l'action de desourdir n'etant autre chose que celle de défaire les petites boucles que la chaîne a formées par ses croisemens sur la trame, toute ma fleur se trouveroit éparse & projettée sur une certaine portion de chaine dont la largeur seroit la même, mais dont la longueur seroit beaucoup plus grande que celle de ma fleur, & que cette longueur diminueroit de la quantité requise pour reformer ma fleur & rapprocher les points colorés épars sur les fils de chaine, si je venois à l'ourdir derechef : donc, a continué l'ouvrier que je fais raisonner, si la qualité de ma chaine & de ma trame étant donnée, je connoissois la quantité de l'emboi de ma chaîne sur ma trame (dans le cas où cet emboi seroit fort sensible), pour exécuter des fleurs en étoffe, je n'aurois 1° qu'à peindre une fleur, ou tel autre dessein, sur un papier : 2° qu'à faire une anamorphose de ce dessein, telle que la largeur de l'anamorphose fût la même que celle du dessein, & que sa longueur sur chaque ligne de cette anamorphose fût à celle de mon dessein sur chacune de ses lignes, comme la longueur du fil de chaîne non ourdi est à la longueur du fil de chaîne ourdi : 3° qu'à prendre cette anamorphose pour modele, & qu'à faire teindre les différentes longueurs de chacun des fils de ma chaîne, de chacune des couleurs que j'y verrai dans mon anamorphose (supposé qu'il y eût plusieurs couleurs) ; il est évident que venant à étendre sur les ensuples ma chaîne ainsi préparée par différentes teintures, elle porteroit l'anamorphose d'un dessein que l'exécution de l'étoffe réduiroit à ses justes & véritables proportions. Voilà la théorie très-exacte du chiner des velours, qui n'est en effet que l'anamorphose peinte sur chaîne d'un dessein, que l'emboi de cette chaîne par la trame raccourcit & remet en proportion. Je dis des velours parce que pour les taffetas l'emboi n'est pas assez sensible pour exiger l'anamorphose ; le dessein lui-même dirige, comme on verra dans l'exposition que nous allons faire de la pratique du chiner.
On ne chine ordinairement que les étoffes unies & minces. On a chiné des velours, mais on n'y a pas réussi jusqu'à un certain degré de perfection. Après ce que nous avons dit, on connoît que le coupé du velours n'est pas assez juste pour que la distribution du chinage soit exacte ; on sait à la vérité que chaque partie du poil exige pour le velours chiné six fois plus de longueur qu'il n'en paroîtra dans l'étoffe ; on peut donc établir entre le poil non ourdi & le poil ourdi, tel rapport qu'on jugera convenable ; mais l'inégalité de la trame, celle des fers, les variétés qui s'introduisent nécessairement dans l'extension qu'on donne au poil, enfin la main de l'ouvrier qui frappe plus ou moins dans un tems que dans un autre, toutes ces circonstances ne permettent pas à l'anamorphose du dessein de se réduire à ses justes proportions. Cependant nous expliquerons la maniere dont on s'y prend pour cette étoffe. Les taffetas sont les étoffes qu'on chine ordinairement : on chine rarement les satins.
Pour chiner une étoffe, on fait un dessein sur un papier réglé, comme on le voit fig. 1. Plan. de soieries du chiner ; on le fait tel qu'on veut qu'il paroisse en étoffe ; on met la soie destinée à être chinée en teinture, pour lui donner la couleur dont on veut que soit le fond de l'étoffe : mais ce fond est ordinairement blanc, parce que les autres couleurs de fond ne recevroient qu'avec peine celles qu'on voudroit leur donner ensuite pour la figure.
Lorsque la soie est teinte, on la fait devider & ourdir ; quand elle est levée de dessus l'ourdissoir, on la met sur un tambour semblable à celui dont on se sert pour plier les étoffes. Voyez ce tambour, fig. 1. 1 le tambour. 2 les montans du tambour. 3 bascule pour arrêter le tambour. 4 cordes qui servent au même usage. 5 la chaîne tendue. 6 le rateau. 7 le porte-rateau. 8 l'aspe. 9 le banc de l'aspe. 10 les montans du banc. 11 les piés. 12 les traverses. Les chaînes des taffetas chinés doivent être composées de 50 portées, qui composent quatre mille fils, & passées dans des 250 de peigne, ce qui fait quatre fils par dent.
On tire de dessus le tambour 1, la chaîne qu'on va accrocher à l'axe de l'aspe ou devidoir 8, 8, éloigné du tambour de sept à huit aulnes : cela fait, on divise la chaîne par douze fils, dont chaque division est portée dans une dent du rateau 6, placé près de l'aspe. Il faut que ce rateau soit de la largeur de l'étoffe. Douze fils sont juste la quantité de fils qui doit être contenue dans trois dents du peigne. On enverge toutes les branches de douze fils, & on arrête l'envergure en séparant pareillement celle des fils simples qui a été faite en ourdissant.
Si le dessein est répété quatre fois dans la largeur de l'étoffe, on met quatre parties de la division par douze, dans chaque dent du rateau, ce qui donne quarante-huit fils, qu'on aura soin d'enverger & d'attacher de façon qu'on puisse les séparer quand il en sera besoin. On ajuste ensuite l'aspe 8, 8, de maniere qu'il puisse contenir exactement sur sa circonférence, une fois, deux fois, plus ou moins, le dessein, selon que ce dessein court plus ou moins. On met chaque partie séparée & placée par ordre sur le rateau, à chacune des chevilles attachées à l'arbre de l'aspe ; on charge le tambour à discrétion, on tourne l'aspe ; une personne entendue conduit le rateau, afin de bien dégager les fils ; on enroule toute la piece sur l'aspe : chaque partie de quarante-huit fils faisant un écheveau, une chaîne de quatre mille fils donnera quatre-vingts-trois écheveaux, & seize fils qui serviront de lisiere ; chaque bout de la partie de quarante-huit est attachée au premier bout de l'écheveau, lorsque la piece est devidée sur l'asple.
Quand toute la chaîne est enroulée sur l'aspe, de maniere que sa circonférence divise exactement les écheveaux en un certain nombre de fois juste de la longueur du dessein, on prend des petites bandes de parchemin de trois lignes de largeur ou environ (Voyez ces bandes, fig. 15. & 16.) ; on en couche une sur les trois premieres cordes paralleles à ab du dessein de la fig. 17. & on marque avec une plume & les couleurs contenues sur la longueur de ces trois cordes, & l'espace que chaque couleur occupe sur cette longueur : cela fait, on prend une seconde bande qu'on applique sur les trois cordes suivantes, observant de porter sur cette seconde bande, comme sur la premiere, & les couleurs contenues dans ces trois cordes, & l'espace qu'elles occupent sur elles ; puis on prend une troisieme bande pour les trois cordes suivantes, & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait épuisé la largeur du dessein. On numérote bien toutes les bandes, afin de ne pas les confondre, & de savoir bien précisément quelle partie de la largeur du dessein elles représentent chacune.
On prend ensuite une de ces bandes & on la porte sur l'aspe, & l'on examine si la circonférence de l'aspe contient autant de fois la longueur de la bande, qu'elle est présumée contenir de fois la longueur du dessein, afin de voir si les mesures des bandes & des écheveaux coincident.
Cela fait, on prend la premiere bande numérotée 1 ; on la porte sur la premiere flotte ou le premier écheveau ; elle fait le tour de l'aspe sur l'écheveau ; on l'y attache des deux bouts avec une épingle, un bout d'un côté d'un fil qui traverse l'aspe sur toute sa longueur, & l'autre bout de l'autre côté de ce fil ; ce fil coupant tous les écheveaux perpendiculairement, sert de ligne de direction pour l'application des bandes. On commence par arrêter toutes les bandes sur les écheveaux, le long de ce fil, du côté de la main droite ; après quoi on marque avec un pinceau & de la couleur, sur le premier écheveau, tous les endroits qui doivent en être colorés, & les espaces que chaque couleur doit occuper, précisément comme il est prescrit par la bande numérotée 1. On passe à la bande numérotée 2, qui est attachée au second écheveau, sur lequel on marque pareillement avec un pinceau & des couleurs, les endroits qui doivent être colorés, & les espaces que chaque couleur doit occuper, précisément comme il est prescrit par cette bande 2. On passe à la troisieme bande, & au troisieme écheveau, faisant la même chose jusqu'au quatre-vingt-troisieme écheveau, & à la quatre-vingt-troisieme bande.
Lorsque le dessein est pour ainsi dire tracé sur les écheveaux, on les leve de dessus l'aspe, & on les met ses uns après les autres sur les roulettes du banc à lier, qu'on voit fig. 13. 13 Banc à lier, 14 roulettes sur lesquelles sont posés les écheveaux, quand il s'agit de les attacher. Les porte-roulettes sont mobiles ; c'est la qu'on couvre les parties qui ne doivent pas être teintes. Les écheveaux sont tendus, autant qu'il est possible, sur les bancs à lier. On en met un sur les poulies 14, 14. De ces poulies, celle qui est à gauche s'écarte & se fixe en tel endroit qu'on veut des tringles, le long desquelles elle se meut ; de cette maniere, l'écheveau se trouve aussi distendu qu'il est possible, sans empêcher les poulies ou roulettes de tourner sur elles-mêmes. On commence, en se faisant présenter successivement par le moyen des roulettes, toute la longueur de l'écheveau, par appliquer un papier qui couvre les parties qui ne doivènt point être teintes ; on numérote ce papier d'un o ; on couvre ce papier d'un parchemin ; on attache bien ce parchemin en le liant par les deux bouts. On place ensuite un second écheveau sur le banc à lier ; on en couvre pareillement les parties qui ne doivent pas être teintes, d'un papier d'abord, ensuite d'un parchemin, numérotant le papier comme il le doit être.
Quand tous les écheveaux sont liés, on les fait teindre de la couleur indiquée par le dessein ; & avant qu'ils soient secs, on délie le parchemin, qu'on enleveroit trop difficilement si on le laissoit durcir en séchant ; on les laisse sécher ensuite, après quoi on ôte le papier, excepté celui qui porte le numéro de l'écheveau.
On remet par ordre, & selon leurs numéros, les flottes ou les écheveaux sur l'aspe, comme ils y étoient auparavant ; le bout de chacune se remet aux chevilles, l'autre bout est passé dans un rateau de la largeur de l'étoffe ou du dessein répeté. Quand on a tous les bouts qui ne sont pas aux chevilles, on les attache à une corde qui vient de dessus le tambour ; & après avoir ajusté le dessein distribué sur tous les écheveaux, de maniere qu'aucune partie n'avance ni ne recule plus qu'elle ne doit, on tire deux ou trois aunes de chaque écheveau de dessus l'aspe, & l'on reporte la chaîne sur le tambour, observant de la lier de trois aunes en trois aunes, afin que le dessein ne se dérange pas.
Quand on a tiré toute la chaîne sur le tambour, on change de rateau ; on en prend un plus grand ; on y distribue chaque branche à autant de distance les unes des autres, qu'il y en a entre les chevilles auxquelles elles sont arrêtées. Il faut se ressouvenir que chaque bout d'écheveau est composé de 48 fils, & que ces 48 fils sont divisés en quatre parties de 12 fils, séparées chacune par une envergure, sans compter l'envergure de la chaîne ou de l'ourdissage, qui sépare encore chacun des douze fils. On se sert de l'envergure pour séparer chaque partie de douze fils, qui forment le nombre de quarante-huit. On prend la premiere partie de douze fils, & on y passe une verge ; on prend la seconde partie de douze fils, des trente-six qui restent, & on y passe une seconde verge, & ainsi de la troisieme & de la quatrieme.
Quand on a séparé tous les écheveaux de la même façon, & qu'on a mis chaque partie sur une verge par ordre de numéros, on reporte toute la chaîne de dessus le tambour sur l'aspe, en laissant les verges passées dans les quatre parties de chaque écheveau séparé, ayant soin de conduite les verges qui séparent les fils, & qui sont bien différentes de celles qui tiennent les quatre parties séparées, jusqu'à ce que la chaîne soit toute sur l'aspe, après quoi on la remet toute sur le tambour, rangeant les parties de façon qu'on ne fait de toute la piece ou chaîne qu'une envergure ; on la plie dans cet état sur l'ensuple, & elle est prête à être travaillée.
Voilà la maniere de disposer une chaîne pour un taffetas chiné, à une seule couleur, avec le fond.
S'il s'agissoit d'un velours, on ne chineroit que le poil ; c'est lui qui en exécuteroit tout le dessein : mais comme le poil s'emboit par le travail des fers six fois autant que la chaîne, après qu'on a tracé son dessein, comme on le voit fig. 17. il faut en faire l'anamorphose ou projection, comme on le voit fig. 18. Cette projection a la même largeur que le dessein ; mais sa longueur & celle de toutes ses lignes est six fois plus grande.
C'est sur cette projection qu'on prendra les mesures avec les bandes de parchemin. Si le dessein n'est répeté que deux fois dans la largeur de l'étoffe, on ne prendra que vingt-quatre fils par écheveau ; s'il ne l'est qu'une, on n'en prendra que douze. Il s'agit ici de taffetas ; mais si c'est un velours, on n'en prendra que la moitié, parce que le poil ne contient que la moitié des fils des chuines de taffetas. Enfin on ne doit prendre & séparer des fils pour chaque branche, qu'autant que trois dents du peigne en peuvent contenir.
Quand il y a plusieurs couleurs dans un dessein, on les distingue par des marques différentes ; on les couvre & on les découvre selon la nécessité ; on fait prendre ces couleurs à la chaîne qu'on prépare, les unes après les autres. Le fond en est toûjours couvert : du reste l'ouvrage s'acheve comme nous venons de l'expliquer. Quant à la maniere de travailler le taffetas (voyez l'art. Taffetas), comme la teinture altere toûjours un peu la soie, il est évident que des étoffes chinées, la meilleure ce sera celle qui aura le moins de couleurs différentes ; & que la plus belle, ce sera celle où les couleurs seront les mieux assorties, & où les contours des desseins seront les mieux terminés.
Étymologie de « chiner »
La Chine?: car les Italiens, pour chiner, disent?: far i drappi alla chinese, faire les draps à la chinoise.
- (Verbe 1) (1753) De Chine, pays d'où provient le procédé.
- (Verbe 2) (1847) Probablement une altération d'échiner.
chiner au Scrabble
Le mot chiner vaut 11 points au Scrabble.
Informations sur le mot chiner - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot chiner au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
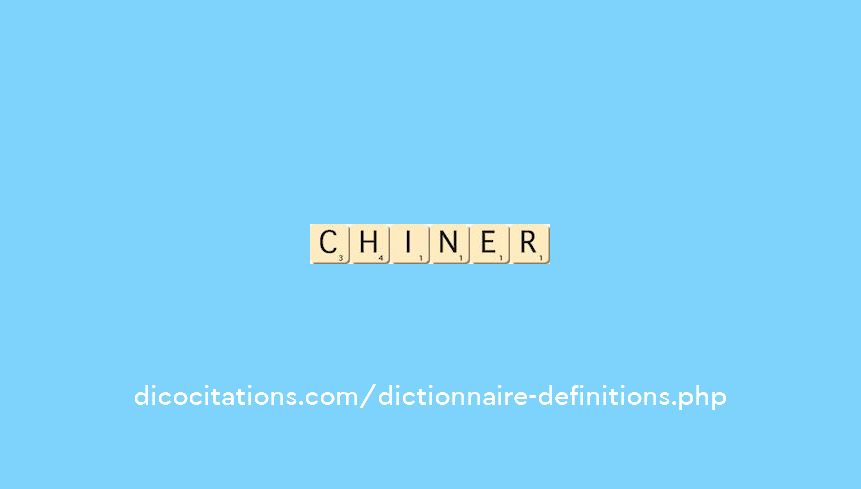
Les rimes de « chiner »
On recherche une rime en NE .
Les rimes de chiner peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ne
Rimes de éliminées Rimes de démenais Rimes de reprenaient Rimes de insoupçonnés Rimes de galopiner Rimes de stationné Rimes de cheminé Rimes de encaserner Rimes de saignée Rimes de albanais Rimes de cuisinées Rimes de nouveau-nés Rimes de ramoner Rimes de praliné Rimes de ahané Rimes de abandonné Rimes de raffiné Rimes de égrenais Rimes de éperonner Rimes de chantonnai Rimes de galonné Rimes de survenais Rimes de entraînée Rimes de bourdonnaient Rimes de rayonnez Rimes de ponctionnait Rimes de cornée Rimes de illuminait Rimes de potinais Rimes de enfariné Rimes de cognais Rimes de pistonnés Rimes de amenez Rimes de exterminés Rimes de baignaient Rimes de ramenées Rimes de profanaient Rimes de ruinées Rimes de ripolinées Rimes de alignait Rimes de couronnées Rimes de capitonner Rimes de indignait Rimes de emprisonnées Rimes de baleinées Rimes de reconditionnée Rimes de boudinée Rimes de chagrinait Rimes de arrière-cabinets Rimes de balluchonnéMots du jour
éliminées démenais reprenaient insoupçonnés galopiner stationné cheminé encaserner saignée albanais cuisinées nouveau-nés ramoner praliné ahané abandonné raffiné égrenais éperonner chantonnai galonné survenais entraînée bourdonnaient rayonnez ponctionnait cornée illuminait potinais enfariné cognais pistonnés amenez exterminés baignaient ramenées profanaient ruinées ripolinées alignait couronnées capitonner indignait emprisonnées baleinées reconditionnée boudinée chagrinait arrière-cabinets balluchonné
Les citations sur « chiner »
- Je n'ai rien à faire avec la machinerie grinçante de l'humanité - j'appartiens à la terre.Auteur : Henry Miller - Source : Tropique du Cancer (1934), XIII
- Dans la machinerie, le chef criait qu'un paquet de mer, passé, au coup d'acculée, par la descente, venait de l'envahir.Auteur : Roger Vercel - Source : Remorques (1935)
- Ce n'est jamais le temps qui manque aux scélérats pour nuire, et machiner de nouveaux attentats.Auteur : Sénèque - Source : Sans référence
- Que sert de s'échiner à perfectionner les accessoires, la mise en scène lorsque c'est la poétique qui pèche ?Auteur : Anne F. Garréta - Source : La Décomposition (1999)
- Au début, je voulais écrire une pièce de théâtre car je voulais parler aux gens clairement, et comme je m’emberlificotais dans la préparation de cette pièce, au bout d’un moment je me suis dit : on arrête les machineries, les expérimentations, les systèmes et les complications stylistiques et on va à l’essentiel c’est-à-dire, juste parler, ce qui est un peu nouveau pour moi. Je voulais montrer à quel point le performatif est effectif chez moi, je suis vraiment devenue celle que je voulais, indépendamment du déterminisme social, des traumas pas toujours évidents à gérer et de ma bipolarité. C’est une conquête de territoire corporel finalement.Auteur : Chloé Delaume - Source : Interview France Culture, émission Par les temps qui courent par Marie Richeux, avril 2019
- Ne vous retrouvez jamais pris dans le système de la justice américaine. Dès que vous êtes pris dans la machinerie, juste la machinerie, vous avez perdu. La seule question qui demeure, c'est combien vous allez perdre.Auteur : Tom Wolfe - Source : Le Bûcher des vanités (1987)
- Voilà la vraye cause qui l'incita à conspirer et machiner la mort de la royne.Auteur : Jacques Amyot - Source : Artaxerxès, 23
Les mots proches de « chiner »
Chiaoux Chic Chicane Chicaner Chicanerie Chicaneur, euse Chiche Chiche Chiche-face Chichement Chicheté Chicorée Chicot Chicoter Chicotin Chien, chienne Chiénaille Chiendent Chienne Chienner Chier Chiffe Chiffle Chiffon Chiffonnage Chiffonné, ée Chiffonner Chiffonnier, ière Chiffrable Chiffrage Chiffre Chiffrer Chignon Chiliogone Chimère Chimérique Chimériquement Chimériser Chimico-légal, ale Chimie ou chymie Chimique Chimiste China-grass Chiné, ée Chineur Chinfreneau Chinois, oise Chinquer Chiourme ChipieLes mots débutant par chi Les mots débutant par ch
chi chia chiadé chiadée chiadées chiader chiaient chiais chiait chiala chialaient chialais chialait chialant chiale chialé chialent chialer chialera chialeraient chialerais chialerait chialeras chialèrent chialeries chiales chialeur chialeur chialeuse chialez chiant chiant chiante chiantes chianti chiants chiard chiards chiasma chiasme chiasse chiasses chiasseux chiatique chiatiques Chiatra Chiatra chibouk chibre chic
Les synonymes de « chiner»
Les synonymes de chiner :- 1. acheter
2. acquérir
3. procurer
4. négocier
5. payer
6. brocanter
7. soudoyer
8. suborner
9. stipendier
10. corrompre
11. brader
12. échanger
13. marchander
14. troquer
15. vendre
16. revendre
17. chercher
18. moquer
synonymes de chiner
Fréquence et usage du mot chiner dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « chiner » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot chiner dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Chiner ?
Citations chiner Citation sur chiner Poèmes chiner Proverbes chiner Rime avec chiner Définition de chiner
Définition de chiner présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot chiner sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot chiner notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
