La définition de Impératif, Ive du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Impératif, ive
Nature : adj.
Prononciation : in-pé-ra-tif, ti-v'
Etymologie : Provenç. imperatiu ; espagn. et ital. imperativo ; du lat. imperativus, de imperare, commander (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de impératif, ive de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec impératif, ive pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Impératif, Ive ?
La définition de Impératif, Ive
Qui a le commandement.
Toutes les définitions de « impératif, ive »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Qui exige ou prétend exiger l'obéissance à un ordre. Il ne se dit que des Paroles et des gestes. Vous prenez un ton bien impératif. Il parle d'un air impératif. On ne l'emploie guère que dans le langage familier. Mandat impératif, Instructions qu'un mandataire reçoit de ses mandants et dont il promet de ne pas s'écarter. La loi en France ne reconnaît pas le mandat impératif. En termes de Jurisprudence, Loi, disposition impérative, Celle qui exprime un ordre absolu. En termes de Grammaire, Mode impératif ou, par ellipse, L'Impératif, Mode qui exprime le commandement, la prière, l'exhortation, la défense, etc.
IMPÉRATIF est également employé comme nom dans l'expression Impératif catégorique. Commandement obligatoire de la loi morale, fait que ses prescriptions sont conçues comme obligatoires sans conditions par la conscience humaine.
Littré
-
1Qui a le commandement.
Précieuse est la variété qui fait des forts et des faibles, qui met le besoin de protection, la nécessité d'obéir, à côté des aptitudes impératives
, Dupont-White, Liberté politique, p. 254. -
2Qui ordonne absolument de faire une chose.
Agénor?: Je prétends d'Euphrosine être le seul captif. - Ésope?: Moi je veux abaisser ce ton impératif
, Boursault, les Fables d'Ésope, IV, 4.Mandat impératif, mandat par lequel des électeurs, en nommant un député, l'astreignent à voter de telle ou telle façon sur telle ou telle question.
Terme de pratique. Disposition impérative, disposition qui ordonne absolument de faire une chose.
- 3 S. m. Terme du système de Kant. Impératif moral ou catégorique, sentiment absolu du devoir.
HISTORIQUE
XVIe s. Son parler estoit plein de tres utile et salutaire instruction, mais c'estoit avec une briefveté imperative, austere et nullement addoulcie
, Amyot, Phocion, 7.
Encyclopédie, 1re édition
IMPÉRATIF, v. adj. (Gram.) on dit le sens impératif, la forme impérative. En Grammaire on emploie ce mot substantivement au masculin, parce qu'on le rapporte à mode ou m?uf, & c'est en effet le nom que l'on donne à ce mode qui ajoute à la signification principale du verbe l'idée accessoire de la volonté de celui qui parle.
Les Latins admettent dans leur impératif deux formes différentes, comme lege & legito ; & la plûpart des Grammairiens ont cru l'une relative au présent, & l'autre au futur. Mais il est certain que ces deux formes différentes expriment la même relation temporelle, puisqu'on les trouve réunies dans les mêmes phrases pour y exprimer le même sens à cet égard, ainsi que l'observe la méthode latine de P. R. Rem. sur les verbes, chap. ij. art. 5.
Aut si es dura, nega ; sin es non dura, venito.
Et potum pastas age, Tityre ; & interagendum,
Occursare capro (cornu ferit ille) caveto. Virg.
Ce n'est donc point de la différence des relations temporelles que vient celle de ces deux formes également impératives ; & il est bien plus vraissemblable qu'elles n'ont d'autre destination que de caractériser en quelque sorte l'espece de volonté de celui qui parle. Je crois, par exemple, que lege exprime une simple exhortation, un conseil, un avertissement, une priere même, ou tout au plus un consentement, une simple permission ; & que legito marque un commandement exprès & absolu, ou du-moins une exhortation si pressante, qu'elle semble exiger l'exécution aussi impérieusement que l'autorité même : dans le premier cas, celui qui parle est ou un subalterne qui prie, ou un égal qui donne son avis ; s'il est supérieur, c'est un supérieur plein de bonté, qui consent à ce que l'on desire, & qui par ménagement, déguise les droits de son autorité sous le ton d'un égal qui conseille ou qui avertit : dans le second cas, celui qui parle est un maître qui veut absolument être obéi, ou un égal qui veut rendre bien sensible le desir qu'il a de l'exécution, en imitant le ton impérieux qui ne souffre point de délai. Ceci n'est qu'une conjecture ; mais le style des lois latines en est le fondement & la preuve ; ad divos adeunto castè (Cic. iij. de leg.) ; & elle trouve un nouveau degré de probabilité dans les passages mêmes que l'on vient de citer.
Aut si es dura, nega ; c'est comme si Properce avoit dit : « si vous avez de la dureté dans le caractere, & si vous consentez vous-même à passer pour telle, il faut bien que je consente à votre refus, nega » : (simple concession). Sin es non dura, venito ; priere urgente qui approche du commandement absolu, & qui en imite le ton impérieux ; c'est comme si l'auteur avoit dit : « mais si vous ne voulez point avouer un caractere si odieux ; si vous prétendez être sans reproche à cet égard, il vous est indispensable de venir, il faut que vous veniez, venito ».
C'est la même chose dans les deux vers de Virgile. Et potum pastas age, Tityre ; ce n'est ici qu'une simple instruction, le ton en est modeste, age. Mais quand il s'intéresse pour Tityre, qu'il craint pour lui quelqu'accident, il éleve le ton, pour donner à son avis plus de poids, & par-là plus d'efficacité ; occursare Capro? caveto : cave seroit foible & moins honnête, parce qu'il marqueroit trop peu d'intérêt ; il faut quelque chose de plus pressant, caveto.
Trompé par les fausses idées qu'on avoit prises des deux formes impératives latines, M. l'abbé Régnier a voulu trouver de même dans l'impératif de notre langue, un présent & un futur : dans son système le présent est lis ou lisez ; le futur, tu liras ou vous lirez (Gramm. franç. in-12. Paris 1706, pag. 340) ; mais il est évident en soi, & avoué par cet auteur même, que tu liras ou vous lirez ne differe en rien de ce qu'il appelle le futur simple de l'indicatif, & que je nomme le présent postérieur (voyez Tems) ; si ce n'est, dit-il, en ce qu'il est employé à un autre usage. C'est donc confondre les modes que de rapporter ces expressions à l'impératif : & il y a d'ailleurs une erreur de fait, à croire que le présent postérieur, ou si l'on veut, le futur de l'indicatif, soit jamais employé dans le sens impératif. S'il se met quelquefois au lieu de l'impératif, c'est que les deux modes sont également directs (voyez Mode), & que la forme indicative exprime en effet la même relation temporelle que la forme impérative. Mais le sens impératif est si peu commun à ces deux formes, que l'on ne substitue celle de l'indicatif à l'autre, que pour faire disparoître le sens accessoire impératif, ou par énergie, ou par euphémisme.
On s'abstient de la forme impérative par énergie, quand l'autorité de celui qui parle est si grande, ou quand la justice ou la nécessité de la chose est si évidente, qu'il suffit de l'indiquer pour en attendre l'exécution : Dominum Deum tuum adorabis, & illi soli servies (Matth. iv. 10.), pour adora ou adorato, servi ou servito.
On s'abstient encore de cette forme par euphémisme, ou afin d'adoucir par un principe de civilité, l'impression de l'autorité réelle, ou afin d'éviter par un principe d'équité, le ton impérieux qui ne peut convenir à un homme qui prie.
Au reste le choix entre ces différentes formes est uniquement une affaire de goût, & il arrive souvent à cet égard la même chose qu'à l'égard de tous les autres synonymes, que l'on choisit plutôt pour la satisfaction de l'oreille que pour celle de l'esprit, ou pour contenter l'esprit par une autre vûe que celle de la précision. Au fond il étoit très-possible, & peut-être auroit-il été plus régulier, quoique moins énergique, de ne pas introduire le mode impératif, & de s'en tenir au tems de l'indicatif que je nomme présent postérieur : vous adorerez le Seigneur votre Dieu, & vous ne servirez que lui. C'est même le seul moyen direct que l'on ait dans plusieurs langues, & spécialement dans la nôtre, d'exprimer le commandement à la troisieme personne : le style des réglemens politiques en est la preuve.
Puisque dans la langue latine & dans la françoise, on remplace souvent la forme reconnue pour impérative par celle qui est purement indicative, il s'ensuit donc que ces deux formes expriment une même relation temporelle, & doivent prendre chacune dans le mode qui leur est propre, la même dénomination de présent postérieur. Cette conséquence se confirme encore par l'usage des autres langues. Non seulement les Grecs emploient souvent comme nous, le présent postérieur de l'indicatif pour celui de l'impératif, ils ont encore de plus que nous la liberté d'user du présent postérieur de l'impératif pour celui de l'indicatif : ????'??? ? ??????, pour ??????? (Eurip.) ; littéralement, scis ergo quid fac, pour facies (vous savez donc ce que vous ferez ?). C'est pour la même raison que la forme impérative est la racine immédiate de la forme indicative correspondante, dans la langue hébraïque ; & que les Grammairiens hébreux regardent l'une & l'autre comme des futurs : par égard pour l'ordre de la génération, ils donnent à l'impératif le nom de premier futur, & à l'autre le nom de second futur. Leur pensée revient à la mienne ; mais nous employons diverses dénominations. Je ne puis regarder comme indifférentes, celles qui sont propres au langage didactique ; & j'adopterois volontiers dans ce sens la maxime de Comenius (Janua ling. tit. 1. period. 4.) : Totius eruditionis posuit fundamentum, qui nomenclaturam rerum artis perdicit. J'ose me flater de donner à l'article Tems une justification plausible du changement que j'introduis dans la nomenclature des tems.
Je me contenterai d'ajouter ici une remarque tirée de l'analogie de la formation des tems : c'est qu'il en est de celui que je nomme présent postérieur de l'impératif, comme de ceux des autres modes qui sont reconnus pour des présens en latin, en allemand, en françois, en italien, en espagnol ; il est dérivé de la même racine immédiate qui est exclusivement propre aux présens, ce qui devient pour ceux qui entendent les droits de l'analogie, une nouvelle raison d'inscrire dans la classe des présens, le tems impératif dont il s'agit.
| Indicatif. | Subjonctif. | Infinitif. | Impératif. | |
| Latin. | laudo. | laudem. | laudare. | lauda ou laudato. |
| Allemand. | ich lobe. | dass ich lobe. | loben. | lobe. |
| François. | je loue. | que je loue. | louer. | loue ou loue. |
| Italien. | lodo. | ch'io lodi. | lodare. | lodà. |
| Espagnol. | alabo. | que alâbe. | alabar. | alaba. |
Si nos Grammairiens avoient donné aux analogies l'attention qu'elles exigent ; outre qu'elles auroient servi à leur faire prendre des idées justes de chacun des tems, elles les auroient encore conduits à reconnoître dans notre impératif un prétérit, dont je ne sache pas qu'aucun grammairien ait fait mention, si ce n'est M. l'abbé de Dangeau, qui l'a montré dans ses tables, mais qui semble l'avoir oublié dans l'explication qu'il en donne ensuite. Opusc. sur la lang. franç. On avoit pourtant l'exemple de la langue greque ; & la facilité que nous avons de la traduire littéralement dans ces circonstances, devoit montrer sensiblement dans nos verbes ce prétérit de l'impératif. Mais Apollone avoit dit (lib. I. cap. 30.) qu'on ne commande pas les choses passées ni les présentes : chacun a répeté cet adage sans l'entendre, parce qu'on n'avoit pas des notions exactes du présent ni du prétérit ; & il semble en conséquence que personne n'ait osé voir ce que l'usage le plus fréquent mettoit tous les jours sous les yeux. ayez lu ce livre quand je reviendrai : il est clair que l'expression ayez lû est impérative ; qu'elle est du tems prétérit, puisqu'elle désigne l'action de lire comme passée à l'égard de mon retour : enfin que c'est un prétérit postérieur, parce que ce passé est relatif à une époque postérieure à l'acte de la parole, je reviendrai.
Ce prétérit de notre impératif a les mêmes propriétés que le présent. Il est pareillement bien remplacé par le prétérit postérieur de l'indicatif ; vous aurez lu ce livre quand je reviendrai : & cette substitution de l'un des tems pour l'autre a les mêmes principes que pour les présens ; c'est énergie ou euphémisme quand on s'attache à la précision ; c'est harmonie quand on fait moins d'attention aux idées accessoires différencielles. Enfin ce prétérit se trouve dans l'analogie de tous les prétérits françois ; il est composé du même auxiliaire, pris dans le même mode.
| Indicatif. | Subjonctif. | Infinitif. | Impératif. | |
| Prés. auxil. | j'ai. | que j'aye. | avoir. | aye. |
| Prét. comp. | j'ai lû. | que j'aye lû. | avoir lû. | aye lû. |
| Prés. auxil. | je suis. | que je sois. | être. | sois. |
| Prét. comp. | je suis sorti. | que je sois sorti. | être sorti. | sois sorti. |
M. l'abbé Girard prétend (vrais princ. Disc. viij. du verbe, pag. 13.) que l'usage n'a point fait dans nos verbes de mode impératif, parce qu'il ne caractérise l'idée accessoire de commandement, à la premiere & seconde personne, que par la suppression des pronoms dont le verbe se fait ordinairement accompagner, & à la troisieme personne par l'addition de la particule que.
J'avoue que nous n'avons pas de troisieme personne impérative, que nous employons pour cela celle du tems correspondant du subjonctif, qu'il lise, qu'il ait lû ; & qu'alors il y a nécessairement une ellipse qui sert à rendre raison du subjonctif, comme s'il y avoit par exemple, je veux qu'il lise, je désire qu'il ait lû. En cela nous imitons les Latins qui font souvent le même usage, non-seulement de la troisieme, mais même de toutes les personnes du subjonctif, dont on ne peut alors rendre raison que par une ellipse semblable.
Mais pour ce qui concerne la seconde personne au singulier, & les deux premieres au pluriel, la suppression même des pronoms, qui sont nécessaires partout ailleurs, me paroît être une forme caractéristique du sens impératif, & suffire pour en constituer un mode particulier ; comme la différence de ces mêmes pronoms suffit pour établir celle des personnes.
D'après toutes ces considérations, il résulte que l'impératif des conjugaisons latines n'a que le présent postérieur ; que ce tems a deux formes différentes, plus ou moins impératives, pour la seconde personne tant au singulier qu'au pluriel, & une seule forme pour la troisieme.
| sing. | 2. lege ou legito. |
| 3. legito. | |
| plur. | 2. legite ou legitote. |
| 3. legunto. |
Ce qui manque à l'impératif, l'usage le supplée par le subjonctif ; & ce que les rudimens vulgaires ajoutent à ceci, comme partie du mode impératif, y est ajouté faussement & mal-à-propos.
La méthode latine de P. R. propose une question, savoir comment il se peut faire qu'il y ait un impératif dans le verbe passif, vû que ce qui nous vient des autres ne semble pas dépendre de nous, pour nous être commandé à nous-mêmes : & on répond que c'est que la disposition & la cause en est souvent en notre pouvoir ; qu'ainsi l'on dira amator ab hero, c'est-à-dire faites si bien que votre maître vous aime. Il me semble que la définition que j'ai donnée de ce mode, donne une réponse plus satisfaisante à cette question. La forme impérative ajoute à la signification principale du verbe, l'idée accessoire de la volonté de celui qui parle ; & de quelque cause que puisse dépendre l'effet qui en est l'objet, il peut le desirer & exprimer ce desir : il n'est pas nécessaire à l'exactitude grammaticale, que les pensées que l'on se propose d'exprimer aient l'exactitude morale ; on en a trop de preuves dans une foule de livres très-bien écrits, & en même tems très-éloignés de cette exactitude morale que des écrivains sages ne perdent jamais de vûe.
Par rapport à la conjugaison françoise, l'impératif admet un présent & un prétérit, tous deux postérieurs ; dans l'un & dans l'autre, il n'y a au singulier que la seconde personne, & au pluriel les deux premieres.
| Présent post. | Prétérit post. | ||
| sing. | 2. lis ou lisez. | sing. | 2. aye ou ayez lû. |
| plur. | 1. lisons. | plur. | 1. ayons lû. |
| 2. lisez. | 2. ayez lû. |
Je m'arrête principalement à la conjugaison des deux langues, qui doivent être le principal objet de nos études ; mais les principes que j'ai posés peuvent servir à rectifier les conjugaisons des autres langues, si les Grammairiens s'en sont écartés.
Je terminerai cet article par deux observations, la premiere, c'est qu'on ne trouve à l'impératif d'aucune langue, de futur proprement dit, qui soit dans l'analogie des futurs des autres modes ; & que les tems qui y sont d'usage, sont véritablement un présent postérieur, ou un prétérit postérieur. Quel est donc le sens de la maxime d'Apollone, qu'on ne commande pas les choses passées ni les présentes ? On ne peut l'entendre que des choses passées ou présentes à l'égard du moment où l'on parle. Mais à l'égard d'une époque postérieure à l'acte de la parole, c'est le contraire ; on ne commande que les choses passées ou présentes, c'est-à-dire que l'on desire qu'elles précedent l'époque, ou qu'elles coexistent avec l'époque, qu'elles soient passées ou présentes lors de l'époque. Ce n'est point ici une these métaphysique que je prétends poser, c'est le simple résultat de la déposition combinée des usages des langues ; mais j'avoue que ce résultat peut donner lieu à des recherches assez subtiles, & à une discussion très-raisonnable.
La seconde observation est de M. le président de Brosses. C'est que, selon la remarque de Léibnitz (Otium Hanoverianum, pag. 427.), la vraie racine des verbes est dans l'impératif, c'est-à-dire au présent postérieur. Ce tems en effet est fort souvent monosyllabe dans la plûpart des langues : & lors même qu'il n'est pas mono-syllabe, il est moins chargé qu'aucun autre, des additions terminatives ou préfixes qu'exigent les différentes idées accessoires, & qui peuvent empêcher qu'on ne discerne la racine premiere du mot. Il y a donc lieu de présumer, qu'en comparant les verbes synonymes de toutes les langues par le présent postérieur de l'impératif, on pourroit souvent remonter jusqu'au principe de leur synonymie, & à la source commune d'où ils descendent, avec les altérations différentes que les divers besoins des langues leur ont fait subir. (B. E. R. M.)
Wiktionnaire
Nom commun - français
impératif \??.pe.?a.tif\ masculin
-
(Conjugaison) (Au singulier) Mode qui exprime le commandement, la prière, l'exhortation, la défense, etc.
- L'espéranto emploie toujours l'impératif-subjonctif si le fait ne relève ni de l'indicatif ni du conditionnel.
-
? Julie, conjuguez-moi le verbe aller, à l'impératif !
? Impératif du verbe aller : Va, vasons, vasez !
Julie s'était déjà assise, débarrassée de « sa récitation ». Elle avait commencé même à ne plus se rappeler ce qu'elle venait de dire.
Il y eut une seconde pendant laquelle toute la première division, pour mieux se pénétrer de l'erreur commise, conjugua mentalement l'impératif du verbe aller. Mais lorsque cette seconde fut écoulée, la première division partit dans un rire entrecoupé d'exclamations, qui déborda les bancs qu'elle occupait et gagna dans le fond de la salle les toutes petites de la dernière division. On eût pu comparer la classe entière à une rivière sur laquelle nageaient les bateaux : Va, vasons, vasez. ? (Charles-Louis Philippe, Dans la petite ville, 1910, réédition Plein Chant, page 137)
-
Impératif catégorique : (Philosophie) Commandement obligatoire de la loi morale, qui fait que ses prescriptions sont conçues comme obligatoires sans conditions par la conscience humaine.
- Il y a une jalousie intellectuelle, faite d'amour-propre et de sens de l'honneur qui agit comme un impératif catégorique kantien. À l'opposé Spinoza définit une jalousie viscérale [?]. ? (Michel Tournier, Journal extime, 2002, Gallimard, collection Folio, page 43)
-
Obligation, devoir.
- Tout le monde n'aime pas les abats, il est donc indispensable de bien connaître les goûts de ses invités avant de les servir. Ne pas se soumettre à cet impératif est une faute grave de goût. ? (Jean-Pierre Coffe, SOS Cuisine, Paris, Éditions Stock, 2006)
Adjectif - français
impératif \??.pe.?a.tif\
- Qui exige ou prétend exiger l'obéissance à un ordre, en parlant des paroles et des gestes.
- Vous prenez un ton bien impératif.
- Il parle d'un air impératif.
- Dans notre société postmoderne, il faut assumer, qu'on le veuille ou non, que l'époque d'un droit impératif et transcendant qui s'impose de haut à la collectivité nous semble à jamais révolue. ? (Jocelyn Giroux et Denis Laliberté, « Entre embâcles et méandres », in Argument, vol. 19, n° 1, automne-hiver 2017, page 59)
-
(Familier) Nécessaire ; impérieux ; urgent.
- Pour un premier boisement derrière prairie par exemple, il est impératif de décompacter l'horizon de surface. ? (Vincent Thècle, Peupliers : comment réussir les nouvelles plantations, dans La France agricole, nº 3361 du 26 novembre 2010)
- Sorbet, gâteau au chocolat, tarte au pommes, crème caramel, mousse au chocolat. Je vous récite la litanie mais il n'y a qu'un dessert qui compte : nos îles flottantes. Il est impératif que vous goûtiez nos îles flottantes. Spécialité absolue. ? (Paul Emond, Les îles flottantes : théâtre, Éditions Lansman, 2005, page 51)
- [?] mais, comme nos estomacs criaient famine à force de gargouillements de plus en plus impératifs, il accepta l'idée d'une halte quand on eut repéré un petit restaurant pourlingue en bord de route. ? (Erin Lange, Ma dernière chance s'appelle Billy D., traduit de l'anglais (États-Unis) par Valérie Dayre, L'École des Loisirs, 2018, chap. 34)
- (Programmation) Qualifie un langage de programmation qui met l'accent sur les modifications des variables provoquées par l'exécution des instructions.
Trésor de la Langue Française informatisé
IMPÉRATIF, -IVE, adj. et subst. masc.
Impératif, Ive au Scrabble
Le mot impératif, ive vaut 21 points au Scrabble.
Informations sur le mot imperatif--ive - 12 lettres, 6 voyelles, 6 consonnes, 9 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot impératif, ive au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
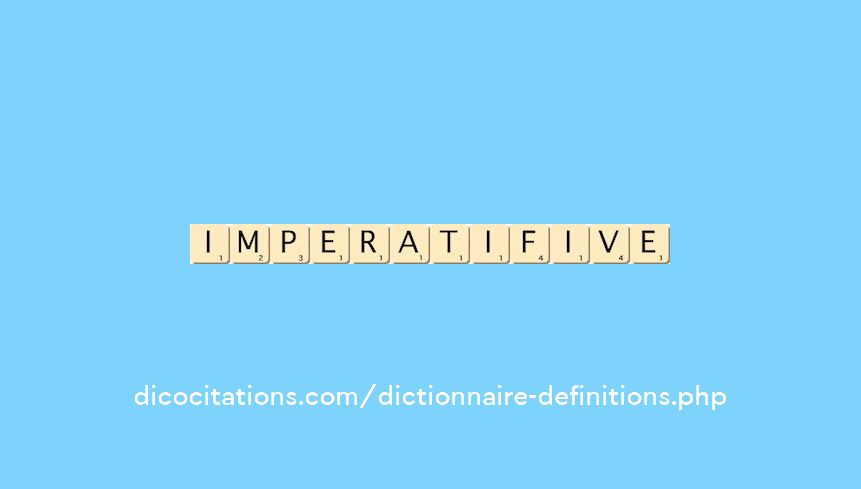
Les mots proches de Impératif, Ive
Impair, aire Impalpable Impaludisme Impanation Impané, ée Impardonnable Impareil, eille Imparfait, aite Imparfait Imparfaitement Imparité Impartable Impartageable Impartialité Impartir Impassable Impasse Impassibilité Impassible Impatiemment Impatience Impatient, ente Impatientant, ante Impatienter Impatriotisme Impatronisation Impatroniser Impayable Impeccabilité Impeccable Impécunieux, euse Impédiments Impénétrable Impénétrablement Impénitence Impénitent, ente Impense Impératif, ive Impératif Impérativement Impératoire Impératoriat Impératrice Imperceptibilité Imperceptible Imperceptiblement Imperdable Imperfectible Imperfection Impérial, ale impact impacts impair impair impaire impaires impairs impairs impala impalas impalpabilité impalpable impalpablement impalpables imparable imparablement imparables impardonnable impardonnablement impardonnables imparfait imparfait imparfaite imparfaitement imparfaites imparfaits imparfaits impartageable imparti imparti impartial impartiale impartialement impartiales impartialité impartiaux impartie impartir impartis impassable impasse impasses impassibilité impassible impassiblement impassibles impatiemment impatience impatiences impatiensMots du jour
-
luttai légitimera éclipsés récapitulons moucher commenceras dépareillaient mordillements fédérés intéressés
Les citations avec le mot Impératif, Ive
Les citations du Littré sur Impératif, Ive
Les mots débutant par Imp Les mots débutant par Im
Une suggestion ou précision pour la définition de Impératif, Ive ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 00h37

- Idee - Idée - Identite - Idiot - Idiotie - Ignorance - Illusion - Image - Imaginaire - Imagination - Imbecile - Imitation - Impatience - Impossible - Impot - Impression - Improvisation - Inattendu - Indelicatesse - Independance - Indifference - Indigestion - Individu - Infini - Ingrat - Ingratitude - Injure - Injustice - Innocence - Inoubliable - Inquietude - Insomnie - Inspiration - Instant - Instinct - Insulte - Intellectuel - Intelligence - Interet - Intérêt - International - Internet - Interprete - Interrogation - Introspection - Intuition - Inutilite - Invitations - Invite - Ironie - Irresolution - Irriter - Islam - Ivresse
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur impératif, ive
Poèmes impératif, ive
Proverbes impératif, ive
La définition du mot Impératif, Ive est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Impératif, Ive sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Impératif, Ive présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
