La définition de Généralité du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Généralité
Nature : s. f.
Prononciation : jé-né-ra-li-té
Etymologie : Provenç. generalitat ; espagn. generalidad ; ital. generalità ; du lat. generalitatem, de generalis, général.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de généralité de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec généralité pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Généralité ?
La définition de Généralité
Terme de logique. Qualité de ce qui est général. Cette proposition dans sa généralité est fausse.
Toutes les définitions de « généralité »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Qualité de ce qui est général. Cette proposition dans sa généralité est fausse. Votre affirmation a trop de généralité. Au pluriel, il se dit des Discours qui n'ont pas un rapport précis au sujet. Il n'est pas entré dans le vif de son sujet : il s'en est tenu à des généralités. S'attarder à des généralités sans intérêt.
GÉNÉRALITÉ s'est dit aussi de l'Étendue de la juridiction d'un bureau de trésoriers de France. Généralité de Paris, de Moulins.
Littré
-
1 Terme de logique. Qualité de ce qui est général. Cette proposition dans sa généralité est fausse.
Au plur. L'ensemble des idées générales d'un sujet quelconque. Généralités scientifiques.
Je ne puis entrer avec elle dans des généralités
, Bossuet, Lett. abb. 160. - 2 Au plur. Paroles, discours sans rapport direct au sujet. Il n'a dit que des généralités. Se perdre en des généralités.
- 3Le plus grand nombre. Telle est l'opinion de la généralité des philosophes.
-
4 Anciennement. Nom d'une certaine division du royaume de France, établie pour faciliter la levée des impôts et de tout ce qui avait rapport aux finances. Chaque généralité était subdivisée en élections, et avait un tribunal dit bureau des finances.
Mazarin imposait des sommes extraordinaires sur les généralités
, Voltaire, Louis XIV, 25. -
5S'est dit pour généralat, qui est seul usité présentement.
Il connaît bien qu'il n'y a point de si mauvaise place auprès du roi, qui ne vaille mieux que la généralité de son armée
, Guez de Balzac, le Prince, ch. 3.La réunion des généraux, sens qui est tombé aussi en désuétude.
Devisant ainsi, nous rencontrâmes toute la généralité qui revenait
, Saint-Simon, II, 128.
HISTORIQUE
XIIIe s. En generauté [en général]
, Du Cange, generalis. Qu'il aint [aime] en generalité, Et laist especialité
, la Rose, 5465.
XIVe s. La quarte [rubrique] est de la generalité de l'anathomie
, H. de Mondeville, f° 1.
XVe s. Et à la verité la generalité du pays ne quiert jamais autre chose
, Commines, III, 11.
XVIe s. Departemens et estats generaulx des sommes de deniers que porte la charge et generalité d'outre-Seine et Yonne par maistre Jehan Groliez, tresorier de France et general des finances en la dicte charge
, Bibl. des chartes, 4e série, t. I, p. 564.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
GÉNÉRALITÉ.On voit dans quelle généralité il faut prendre l'écriture, Bossuet, Avert. 6.
Encyclopédie, 1re édition
GÉNÉRALITÉ, s. f. (Politique.) est une certaine étendue de pays déterminée par la jurisdiction d'un bureau des finances. L'établissement de ces bureaux, & les divisions des provinces en généralités, ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du Roi. C'est aux généraux des finances qu'est due l'origine des généralités.
Sous les deux premieres races, nos rois n'avoient point d'autres recettes que les revenus de leurs propres domaines ; bien avant sous la troisieme, on ne parloit point de généralités, parce qu'il n'existoit point de receveurs généraux. Il n'y avoit alors qu'un seul officier qui avoit l'intendance & l'administration du domaine ; c'étoit le grand trésorier de France.
Ce fut à l'occasion des guerres pour la Religion, que Louis le jeune le premier obtint la vingtieme partie du revenu de ses sujets pour quatre ans. Il commença à lever cette taxe en 1145 pour le voyage de la Terre-Sainte ; Philippe Auguste son fils, se fit donner la dixme des biens meubles des laïcs, & le dixieme du revenu des biens de l'Eglise. En 1188 saint Louis établit une aide dans le royaume, & leva en 1247 le vingtieme du revenu. En 1290 [1] Philippe-le-Bel mit une aide sur les marchandises qu'on vendoit dans le royaume. Philippe-le-Long introduisit le droit de gabelle sur le sel en 1321 ; ces subsides continuerent sous Charles le-Bel, & sous Philippe de Valois.
Jusques-là les impositions furent modiques & passageres ; il n'y avoit pour veiller à cette administration que le grand trésorier : Philippe de Valois en ajoûta un second.
Ce ne fut que sous le roi Jean, que les aides & gabelles prirent une forme, qui encore ne fut rendue stable & fixe que par Charles VII.
Le roi Jean pour prévenir les cris du peuple, donna un édit daté du 28 Décembre 1355, par lequel il établit certains receveurs & neuf personnes, trois de chaque ordre, que les trois états, du consentement du roi, choisissoient & nommoient, pour avoir l'intendance & la direction des deniers de subside.
On nommoit élus & grenetiers, ceux qui devoient veiller sur les aides & gabelles particulieres des provinces ; on appelloit les autres généraux, parce qu'ils avoient l'inspection générale de ces impositions partout le royaume. Voilà l'époque du parfait établissement des généraux des finances : ils furent établis alors tant pour la direction des deniers provenans des aides, que pour rendre la justice en dernier ressort sur le fait des aides [2].
Aux états tenus à Compiegne en 1358 sous le régent Charles, pendant la prison du roi Jean son pere, on élut trois généraux dans chacun des trois ordres. Les états les nommoient, le roi les confirmoit ; c'étoit entre ses mains ou de ses officiers, qu'ils faisoient le serment de remplir leurs fonctions avec honneur & fidélité.
Charles V. parvenu à la couronne, outre les aides, sorte d'imposition sur les marchandises, établit par feux l'impôt qu'on nomma foüage, par lettres du 20 Novembre 1379. Alors il supprima tous les receveurs généraux des aides, & n'en laissa qu'un résident à Paris. Depuis ce fut toûjours le roi qui institua & destitua les généraux à sa volonté.
Ce qu'on appelloit foüage sous Charles V. on le nomma taille sous Charles VI. La commission de lever ces deniers étoit donnée aux favoris du prince ; c'étoient les personnes les plus qualifiées de la cour, les plus distinguées dans l'état ecclésiastique & parmi la noblesse, qui les remplissoient. Charles V. par ordonnance du 17 Avril 1364 rétablit trois généraux des finances, à qui il donna un pouvoir universel pour gouverner les finances du royaume ; il fixa leurs fonctions le 22 Février 1371.
Ce fut vers ce tems que les généraux des finances, pour mieux veiller à la direction des deniers, & pour prendre une connoissance plus exacte du domaine de la couronne, se départirent en Languedoc, en Languedouy, en outre Seine & Yonne, & en Normandie ; ce qui composoit alors tout le royaume. Voilà la premiere notion qu'on puisse donner des généralités, qui étoient au nombre de quatre.
Dans leurs tournées les généraux s'informoient de la conduite des élus, receveurs, & autres officiers soûmis à leur jurisdiction. Ils examinoient s'ils se comportoient avec équité tant envers le roi, que par rapport à ses sujets ; ils avoient le pouvoir d'instituer & de destituer les élus, grenetiers, contrôleurs, receveurs, & sergens des aides.
Des le tems de Charles VI. on commença à mettre quelque distinction entre les généraux des finances, & les généraux de la justice, comme il paroît par l'ordonnance du 9 Février 1387, où le roi nomma quatre généraux, deux pour la finance, & deux pour la justice [3]. Cette distinction de généraux des finances des aides, & généraux de la justice des aides, dura jusques vers la fin du regne de François premier, qui au mois de Juillet 1543, érigea ces offices en cour souveraine, sous le nom de cour des aides. Les officiers furent nommés conseillers généraux sur le fait des aides, nom qu'ils ont conservé jusqu'en 1654.
Le même roi François premier créa 16 recettes générales pour toutes sortes de deniers, soit du domaine, des tailles, aides, gabelles, ou subsides. Ces recettes furent établies dans les villes de Paris, Châlons, Amiens, Roüen, Caën, Bourges, Tours, Poitiers, Issoire, Agen, Toulouse, Montpellier, Lyon, Aix, Grenoble & Dijon. Dans chacune de ces villes, le roi nomma un receveur général ; voilà déjà seize généralités formées.
Henri second créa un trésorier de France & un général des finances dans chaque recette générale établie par son prédécesseur. Il créa une dix-septieme généralité à Nantes ; il réunit dans un même office les charges de trésoriers de France & de généraux des finances, & voulut que ceux qui en seroient revétus fussent appellés dans la suite trésoriers généraux de France, ou trésoriers de France & généraux des finances.
Par édit du mois de Septembre 1558, le même roi créa deux autres recettes générales ; l'une à Limoges, composée d'un démembrement des généralités de Riom & de Poitiers ; l'autre à Orléans, démembrée de la généralité de Bourges. Ces deux généralités furent supprimées bien-tôt après, & ne furent rétablies que sous Charles IX. au mois de Septembre 1573.
Sur les remontrances des états généraux tenus à Orléans, Charles IX. au mois de Février 1566 réduisit les dix-sept anciennes recettes générales au nombre de sept, qui étoient Paris, Rouen, Tours, Nantes, Lyon, Toulose & Bordeaux ; mais la réduction n'eut pas d'effet.
Henri III. établit des bureaux des finances dans chaque généralité, au mois de Juillet 1577. Par lettres-patentes du six Avril 1579, le roi réduisit les dix-neuf généralités (celles de Limoges & d'Orléans étoient rétablies) au nombre de huit ; & le 26 du même mois, il les rétablit. La généralité de Limoges fut encore supprimée au mois de Décembre 1583, & rétablie au mois de Novembre 1586.
Ce fut encore Henri III. qui créa la généralité de Moulins au mois de Septembre 1587. Henri IV. au mois de Novembre 1594 érigea une nouvelle généralité à Soissons ; en 1598 il supprima tous les bureaux des finances, & les rétablit au mois de Novembre 1608.
Au mois de Novembre 1625, Louis XIII. créa des bureaux des finances & des généralités à Angers, à Troyes, à Chartres, à Alençon, & à Agen[4], qu'il supprima au mois de Février 1626. Il en érigea une à Grenoble pour le Dauphiné au mois de Décembre 1627 (la généralité dans cette ville lors de la grande création par Henri second, avoit été supprimée) : le même roi créa un bureau des finances & une recette générale à Montauban, au mois de Février 1635 ; il établit aussi une nouvelle généralité à Alençon au mois de Mai 1636 ; au mois d'Avril 1640, il en avoit institué une à Nîmes, qu'il supprima au mois de Janvier 1641.
Louis XIV. aux mois de Mai & de Septembre 1645, créa des généralités à la Rochelle, à Chartres & à Angers : elles furent supprimées bien-tôt après. Il en établit encore une dans la ville de Beaucaire au mois de Juin 1646, qu'il révoqua tout de suite. Il en érigea une à Metz, au mois de Novembre 1661, une autre à Lille au mois de Septembre 1691. Par même édit du mois d'Avril 1694, le roi rétablit la généralité de la Rochelle, & créa celle de Rennes. Au mois de Février 1696, il établit celle de Besançon, mais les charges des trésoriers furent réunies à la chambre des comptes de Dole. Par édit du mois de Septembre 1700, le roi supprima le bureau des finances qu'il avoit établi à Rennes, & qui depuis avoit été transféré à Vannes. Louis XIV. avoit encore érigé une généralité à Ypres pour la Flandre occidentale au mois de Février 1706.
Louis XV. par un édit du mois d'Avril 1716, registrée en la chambre des comptes de Paris le 6 Mai suivant, créa un bureau des finances & une généralité à Ausch pour la province de Gascogne. Il composa cette généralité d'élections démembrées des généralités de Bordeaux & de Montauban.
Il y a actuellement en France vingt-cinq généralités ; dix-neuf dans les pays d'élection, & six dans les pays d'états : le premieres sont Paris, Châlons, Soissons, Amiens, Bourges, Tours, Orléans, Roüen, Caën, Alençon, Poitiers, Limoges, la Rochelle, Bordeaux, Montauban, Lyon, Riom, Moulins, & Ausch ; les autres sont Bretagne, Bourgogne, Dauphiné, Provence, Montpellier, & Toulouse.
Dans chaque généralité il y a plusieurs élections ; chaque élection est composée de plusieurs paroisses.
Sous Louis XIII. en 1635, on commença à envoyer dans les généralités du royaume des maîtres des requêtes en qualité d'intendans de justice, police, & finances ; on les nomme aussi commissaires départis dans les provinces pour les intérêts du roi & le bien du public dans tous les lieux de leurs départemens.
Il n'y a dans la France considérée comme telle, que vingt-quatre intendans pour vingt-cinq généralités, parce que celles de Montpellier & de Toulouse sont sous le seul intendant de Languedoc. Mais il y en a encore sept departis dans la Flandre, le Haynaut, l'Alsace, le pays Messin, la Lorraine, la Franche-Comté, & le Roussillon. Voyez l'article Intendant.
Il y a aussi dans chaque généralité deux receveurs généraux des finances, qui sont alternativement en exercice ; ils prennent des mains des receveurs des tailles les deniers royaux, pour les porter au trésor royal.
La division du royaume en généralités, comprend tout ce qui est soûmis en Europe à la puissance du roi. Comme cette division a sur-tout rapport aux impositions, de quelque nature qu'elles soient, aucun lieu n'en est excepté ; il en est cependant où le roi ne leve aucune imposition, & dont, par des concessions honorables, les seigneurs joüissent de plusieurs droits de la souveraineté : telle est en Berry la principauté d'Enrichemont, appartenant à une branche de la maison de Bethune ; en Bresse, celle de Dombes ; & telle étoit aussi la principauté de Turenne, avant que le Roi en eût fait l'acquisition. Dans ces principautés, les officiers de justices royales, les intendans ni les bureaux des finances n'ont aucune autorité directe.
Comme les généralités ont été établies, supprimées, réunies, divisées en différens tems sans rapport à aucun projet général ; que le royaume a aussi changé de face en différens tems par les conquêtes de nos rois & les traités avec les princes voisins, & enfin par les différentes natures de droits & d'impôts qui ont été établis en différentes circonstances, & avec des arrondissemens particuliers, suivant la différente nature du pays, & autres impositions plus anciennes auxquelles on les assimiloit pour une plus facile perception ; il n'est pas surprenant que les généralités soient aussi mal arrondies qu'elles le sont : les unes sont trop fortes pour qu'un seul homme puisse porter par-tout une attention égale, & sur-tout depuis que les besoins de l'état ont obligé à augmenter les charges du peuple ; d'autres sont trop petites eu égard aux premieres ; & ces dernieres cependant sont bien suffisantes pour occuper tout entier un homme attentif & laborieux. Dans la même généralité, il se trouve des cantons tout entiers où certaines natures de droits se perçoivent sous l'autorité du commissaire départi d'une autre province : il y a même des paroisses dont une partie est d'une généralité, & l'autre partie d'une autre ; ce qui donne souvent lieu à des abus & des difficultés. Maintenant que le royaume paroît avoir pris toute la consistence dont il est susceptible, il seroit à souhaiter qu'il se fît un nouveau partage des généralités, qui les réduiroit à une presque-égalité, & dans lequel on auroit égard aux bornes que la nature du pays indique, à la nature des impositions, & aux formes d'administration particulieres à chaque province. S'il ne s'agissoit dans ce partage que de dispenser entre un certain nombre d'intendans l'administration de toutes les parties, ce seroit une opération fort aisée ; comme ils n'ont que des commissions, on leur feroit à chacun telle part de cette administration qui conviendroit le mieux au bien des affaires : mais la multitude des charges relatives aux impositions, & dont les finances ont été fixées eu égard aux droits ou à l'étendue de jurisdiction qui leur étoient accordés sur ces impositions mêmes, ou sur un nombre déterminé de paroisses ; telles que les charges de receveurs généraux des finances, receveurs des tailles, trésoriers de France, élus, officiers de greniers à sel, & autres pareils offices : cette multitude de charges, dis-je, donneroit lieu à de grandes difficultés : & c'est sans doute le motif qui empêche le conseil d'y penser.
Voyez, pour l'établissement & succession des généralités, Pasquier, recherches de la France, liv. VII. & VIII. Miraumont, Fournival ; les registres de la chambre des comptes ; les mémoires sur les priviléges & fonctions des trésoriers généraux de France, imprimés à Orléans en 1745 ; l'état de la France, imprimé à Paris en 1749, tome V. à l'article des généralités ; le Dictionnaire encyclopédique, tome IV. au mot Cour des Aides.
Wiktionnaire
Nom commun - français
généralité \?e.ne.?a.li.te\ féminin
-
Qualité de ce qui est général.
- Cette proposition dans sa généralité est fausse.
- Votre affirmation a trop de généralité.
- Grande majorité ; quasi-totalité.
- La généralité des Américains s'imaginaient la guerre d'après les campagnes limitées, avantageuses et pittoresques, qui avaient eu lieu autrefois. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 211 de l'édition de 1921)
-
(Au pluriel) Discours qui n'ont pas un rapport précis au sujet.
- Il n'est pas entré dans le vif de son sujet : il s'en est tenu à des généralités.
- S'attarder à des généralités sans intérêt.
-
(Histoire de France) Étendue de la juridiction d'un bureau de trésoriers de France.
- La généralité de Paris, de Moulins.
Trésor de la Langue Française informatisé
GÉNÉRALITÉ, subst. fém.
Généralité au Scrabble
Le mot généralité vaut 11 points au Scrabble.
Informations sur le mot generalite - 10 lettres, 5 voyelles, 5 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot généralité au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
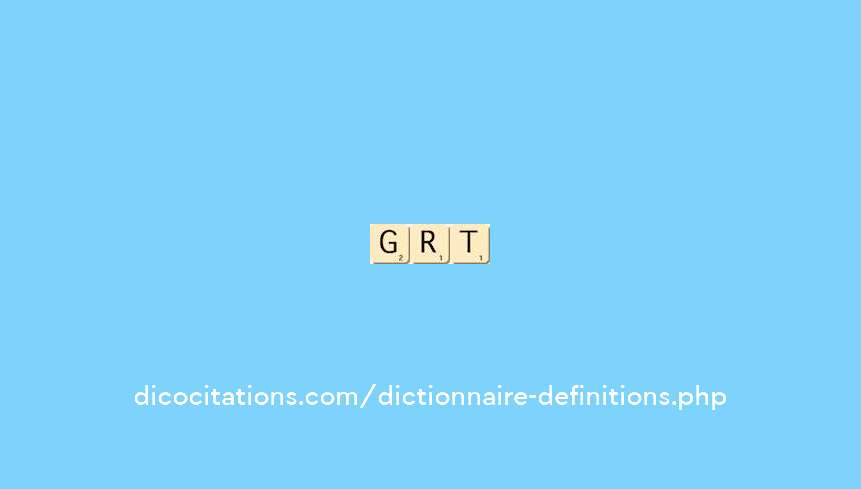
Les mots proches de Généralité
Gênant, ante Génappe Gencive Gendarme Gendarmé, ée Gendarmer (se) Gendarmerie Gendre Gêne Gêné, ée Généagénétique Généalogie Généalogiste Génépi ou génipi Gêner Général, ale Généralat Généralement Généraliser Généralissime Généralité Générateur, trice Génératif, ive Génération Générer Généreusement Généreux, euse Générique Générosité Genèse Genésique Génésiquement Genet Genêt Genétaire Généthliaque Genette Genette, à la Génial, ale Génialement Génialité Génie Genièvre Génisse Genisson Génital, ale Géniteur Génitif Génitoires Géniture gêna Genac gênaient Genainville Genainville gênais gênait gênant gênant gênante gênantes gênants Genappe Genas Genas gênât Génat Genay Genay Genay Gençay gencive gencives gendarme gendarmer gendarmerie gendarmeries gendarmes gendelettres gendre gendres Gendreville Gendrey gêne gène gêne gêné gêné Gené généalogie généalogies généalogique généalogiques généalogiste généalogistes Génébrières Genech gênée gênée gênéesMots du jour
Synodiquement Répresseur Domanier Fainéant, ante Roitelet Zizanie Subreption Strophe Entrepris, ise Interlune ou interlunium
Les citations avec le mot Généralité
- Les concepts de l'histoire sont construits par une série de généralisations successives, et définis par l'énumération d'un certain nombre de traits pertinents, qui relèvent de la généralité empirique, non de la nécessité logique.Auteur : Antoine Prost - Source : Douze leçons sur l'histoire (1996)
- On me dit, aujourd'hui encore, les délinquants sont souvent des Arabes, c'est ainsi, c'est la vie. Sois réaliste. Toi, bien sûr, Najat, c'est pas pareil, c'est différent. Cette dernière phrase est la pire, et elle est la preuve même. Une généralité contredite par une seule personne, une vérité déjugée par celle qui l'écoute, en est blessée, affreusement irritée, et surtout : en est témoin.Auteur : Najat Vallaud-Belkacem - Source : La vie a plus d'imagination que toi (2017)
- L'Etat ne poursuit jamais qu'un but: limiter, enchaîner, assujettir l'individu, le subordonner à une généralité quelconque.Auteur : Max Stirner - Source : L'Unique et sa propriété (1845)
- L'art n'a d'autre objet que d'écarter les symboles pratiquement utiles, les généralités conventionellement et socialement acceptées, enfin tout ce qui nous masque la réalité, pour nous mettre face à face avec la réalité même.Auteur : Henri Bergson - Source : Essai sur la signification du comique (1899), Le Rire
- C’était pour sauver mes parents des généralités, des symboles, des abréviations, pour leur rendre leur particularité et leur caractère distinctif, que je m’étais lancé dans ce voyage étrange et ardu. Tués par les nazis - oui, mais par qui exactement ? Effroyable ironie d’Auschwitz - je m’en suis aperçu en traversant les salles remplies de cheveux humains, de prothèses, de lunettes, de bagages destinés à ne plus aller nulle part -, l’étendue de ce qui est montré est tellement gigantesque que le collectif et l’anonyme, l’envergure du crime, sont constamment et paradoxalement affirmés aux dépens de toute perception de la vie individuelle.Auteur : Daniel Mendelsohn - Source : Les disparus (2007)
- Je ne m'explique que par généralités comme tous les gens seuls.Auteur : Françoise Sagan - Source : Le cheval évanoui
- L'art est de peindre un sujet particulier avec assez de puissance pour que la généralité dont il dépendait s'y comprenne.Auteur : André Gide - Source : Paludes
- Ah! ces généralités sans intérêt mais sublimées par l'expérience personnelle...Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- La puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme législatrice et souveraine.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Du contrat social (1762)
- Les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur ; les généralités sont, au point de vue intellectuel, des maux inévitables.Auteur : Aldous Huxley - Source : Le meilleur des mondes (1932), 1
- Car les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur les généralités sont, au point de vue intellectuel, des maux inévitables.Auteur : Aldous Huxley - Source : Le meilleur des mondes (1932)
- Dans sa généralité le son se définit: le choc que, par l'intermédiaire des oreilles, l'air communique à l'encéphale et au sang et qui se transmet jusqu'à l'âme.Auteur : Platon - Source : Timée, 67b
- Nous avons établi la hiérarchie des sciences d'après le degré de généralité et d'abstraction des phénomènes correspondants.Auteur : Auguste Comte - Source : Cours de philosophie positive (1830-1842)
- Le roman, selon moi, doit être scientifique, c'est-à-dire rester dans les généralités probables.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Correspondance, à Flavie Vasse de Saint-Ouen, 27 décembre 1864
- C'est parce qu'elle peut tout dire que la littérature est un exercice si difficile. C'est parce qu'elle ne peut se contenter de pensées schématiques, de généralités, de clichés, qu'elle est importante et essentielle.Auteur : Leïla Slimani - Source : Le diable est dans les détails
- Parfois c'est dans les généralités qu'il y a le plus de contenu, parce qu'elles ne ligotent pas notre imagination, et lui permettent de vagabonder à sa guise.Auteur : Dezsö Kosztolányi - Source : Anna la douce (1926)
- En considérant des détails de peu d'importance, nous arrivons à négliger les généralités essentielles.Auteur : Edgar Allan Poe - Source : Marginalia (1850)
- Les professeurs récemment nommés débutent par une première leçon de généralités, laquelle se fait d'ordinaire dans un amphithéâtre plus vaste que celui qui sert aux leçons spéciales.Auteur : Ernest Renan - Source : Questions contemporaines (1868)
- En général, ceux qui font des généralités sont des cons.Auteur : Raymond Devos - Source : Les meilleurs sketches de Raymond Devos
- Une maxime est souvent un solipsisme transformé en généralité par un écrivain qui croit en son expérience universelle.Auteur : Charles Dantzig - Source : Dictionnaire égoïste de la littérature française (2005)
- Dis ce qui t'est le plus personnel, dis-le, il n'y a que cela qui importe, n'en rougis pas: les généralités se lisent dans les journaux.Auteur : Elias Canetti - Source : Le coeur secret de l'horloge
- La lecture est la base de l'art d'écrire. Sans doute on peut trouver des exceptions, des exemples de génie, un G. Sand s'improvisant écrivain. Il faut s'en tenir à la généralité.Auteur : Antoine Albalat - Source : L'art d'écrire enseigné en vingt leçons (1900)
Les citations du Littré sur Généralité
- On voit dans quelle généralité il faut prendre l'écritureAuteur : BOSSUET - Source : Avert. 6
- Refutant l'erreur de ceux qui, sous ombre de la generalité des promesses, voudroyent egaler tout le genre humainAuteur : CALV. - Source : Instit. 791
- Et sont tel delit [plaisirs] qui sont divers en generalité si comme est li sensibles et li intelligiblesAuteur : BRUN. LATINI - Source : Trésor, p. 326
- Et à la verité la generalité du pays ne quiert jamais autre choseAuteur : COMM. - Source : III, 11
- Il connaît bien qu'il n'y a point de si mauvaise place auprès du roi, qui ne vaille mieux que la généralité de son arméeAuteur : BALZ. - Source : le Prince, ch. 3
- La généralité comme législatrice ou souveraineAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Contrat social, III, 1
- Il declara au receveur general que toutes les finances de sa generalité et celles de Picardie et Bourgoigne, qui se devoient rapporter par commandement exprès de sa majesté à son tablier....Auteur : CARL. - Source : V, 3
- Mazarin imposait des sommes extraordinaires sur les généralitésAuteur : Voltaire - Source : Louis XIV, 25
- La quarte [rubrique] est de la generalité de l'anathomieAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 1
Les mots débutant par Gen Les mots débutant par Ge
Une suggestion ou précision pour la définition de Généralité ? -
Mise à jour le mercredi 11 février 2026 à 09h08

- Gendarme - Generosite - Genie - Génie - Gentillesse - Gentleman - Geographie - Gloire - Golf - Goût - Gout - Gouvernement - Grâce - Grammaire - Grandeur - Grandir - Gratitude - Gratuit - Gravite - Gregaire - Guerre
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur généralité
Poèmes généralité
Proverbes généralité
La définition du mot Généralité est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Généralité sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Généralité présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
