La définition de Basilique du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Basilique
Nature : adj.
Prononciation : ba-zi-li-k'
Etymologie : Terme grec signifiant royal (voy. ) ; veines ainsi nommées par les anatomistes anciens, qui les regardaient comme jouant un rôle important dans l'économie animale.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de basilique de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec basilique pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Basilique ?
La définition de Basilique
féminin. Terme d'anatomie. La veine basilique, veine qui monte à la partie interne du bras.
Toutes les définitions de « basilique »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. d'Antiquité. Édifice couvert, généralement de forme rectangulaire, divisé en plusieurs nefs par des colonnes et qui était affecté chez les Romains à divers usages publics, justice, commerce, banque ou simple promenade. Il s'est dit plus tard d'un Édifice de ce genre consacré au culte chrétien. À partir de Constantin, beaucoup d'églises chrétiennes furent appelées basiliques. Ce terme désigne aujourd'hui des églises abritant le corps d'un saint ou une relique insigne; ou bien, comme titre purement honorifique, des Sanctuaires que les papes veulent particulièrement honorer. Basilique Sainte-Clotilde. La Basilique de Lourdes.
Littré
- 1 Terme d'antiquité. Édifice public où l'on rendait la justice, et dont les portiques inférieurs étaient occupés par des marchands.
-
2Nom qu'on donne à une église principale.
Hélène avait fait enfermer le sépulcre de Jésus-Christ dans une basilique circulaire de marbre
, Chateaubriand, Mart. II, 151.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. BASILIQUE.Basilique majeure, basilique mineure, titres honorifiques auxquels correspondent certains priviléges canoniques.
Basiliques majeures?; il n'y en a qu'à Rome?: ce sont les cinq principales églises qui correspondent aux cinq grands patriarcats de l'Église catholique?; on les appelle aussi églises patriarcales.
Basiliques mineures, titre accordé, à Rome et hors de Rome, à d'autres églises célèbres par leur antiquité, ou par leurs souvenirs, ou par la dévotion des fidèles?; ainsi la métropole de Paris a été érigée en basilique mineure par l'autorité du Saint-Siège, au commencement de ce siècle.
Encyclopédie, 1re édition
BASILIQUE, s. f. (Hist. anc. & mod.) mot tiré du Grec ????????, roi ; c'est-à-dire, maison royale. C'étoit à Rome un bâtiment public & magnifique, où l'on rendoit la justice à couvert ; ce qui le distinguoit du forum, place publique, où les magistrats tenoient leurs séances en plein air. Il y avoit dans ces basiliques de vastes salles voûtées, & des galeries élevées sur de riches colonnes : des deux côtés étoient des boutiques de marchands, & au milieu une grande place pour la commodité des gens d'affaires. Les tribuns & les centumvirs y rendoient la-justice ; & les jurisconsultes ou légistes gagés par la république, y répondoient aux consultations. C'est ce qu'a voulu dire Cicéron dans une épitre à Atticus, basilicam habeo, non villam, frequentiâ formianorum ; parce qu'on venoit le consulter de toutes parts à sa maison de campagne, comme s'il eût été dans une basilique. Les principales basiliques de Rome étoient Julia, Porcia Sisimini Sempronii, Caii, Lucii, ainsi nommées de leurs fondateurs, & la banque, basilica argentariorum. On en construisit d'autres moindres pour les marchands, & où les écoliers alloient faire leurs déclamations. Le nom de basilique a passé aux édifices dédiés au culte du vrai Dieu, & aux chapelles bâties sur les tombeaux des martyrs : ce nom paroît surtout leur avoir été affecté en Grece. Ainsi l'on nommoit à Constantinople la basilique des saints Apôtres, l'église où les empereurs avoient fait transporter les reliques de quelques Apôtres. Il étoit défendu d'y enterrer les morts, & les empereurs même n'avoient leur sépulture que sous les portiques extérieurs, ou le parvis de la basilique.
Le nom de Basilique signifiant maison royale, il est visible que c'est à cause de la souveraine majesté de Dieu, qui est le roi des rois, que les anciens auteurs ecclésiastiques ont donné ce nom à l'Eglise, c'est-à-dire au lieu où s'assemblent les Fideles pour célébrer l'office divin.
Ce mot est souvent employé dans ce sens par saint Ambroise, S. Augustin, S. Jérôme, Sidoine, Apollinaire, & d'autres écrivains du iv. & du v. siecle.
M. Perrault dit, que les basiliques différoient des temples en ce que les colonnes des temples étoient en-dehors, & celles des basiliques en-dedans. Voyez Temple.
Selon Bellarmin, tom. II. de ses controverses, voici la différence que les Chrétiens mettoient entre les basiliques & les temples. On appelloit basiliques les édifices dédiés au culte de Dieu & en l'honneur des saints, spécialement des martyrs. Le nom de temples étoit propre aux édifices bâtis pour y célébrer les mysteres divins, comme nous l'apprennent S. Basile, S. Grégoire de Nazianze, &c. Quelques anciens, comme Minutius Felix, dans son ouvrage intitulé Octavius, ont soûtenu que le Christianisme n'avoit point de temples, que cela n'étoit propre qu'au Judaïsme & au Paganisme : mais ils parlent des temples destinés à offrir des sacrifices sanglans, & à immoler des animaux. Il est certain que les lieux destinés à conserver & honorer les reliques des martyrs étoient proprement appellés basiliques, & non pas temples. Les Grecs font quelquefois mention des temples des martyrs ; mais ils parlent des lieux qui étoient consacrés à Dieu & dédiés au culte des martyrs. Comme consacrés à Dieu, ils étoient appellés temples ; car c'est à lui seul qu'on peut ériger des autels & offrir des sacrifices : mais comme destinés à la vénération des saints, ils avoient seulement le nom de basiliques. (G)
Basiliques, adj. pris subst. (Jurisprud.) recueil des lois Romaines, traduites en Grec par ordre des empereurs Basile & Léon, & maintenu en vigueur dans l'empire d'Orient jusqu'à sa dissolution. Voyez Droit civil.
Les basiliques comprennent les institutes, le digeste, le code & les novelles, avec quelques édits de Justinien & d'autres empereurs. Le recueil étoit de soixante livres, & s'appelloit par cette raison ????????, soixante. On croit que c'est principalement l'ouvrage de l'empereur Léon le philosophe, & qu'il l'intitula du nom de son pere, Basile le Macédonien, qui l'entreprit le premier. Des soixante livres il n'en reste aujourd'hui que quarante-un. Fabrolus a tiré en quelque façon le supplément des dix-neuf autres du Synopsis basilicon, &c.
Basilique, adj. pris subst. (Hist. anc.) dans l'empire Grec, dénomination qui se donnoit aux mandataires du prince, ou à ceux qui étoient chargés de porter ses ordres & ses commandemens. Voyez Mandement. (G)
Basilique, adj. pris subst. en Anatomie, nom d'une veine qui naît du rameau axillaire, qui court dans toute la longueur du bras. Voyez les Pl. d'Anat. & leur explication dans l'article Anatomie.
La basilique est une des veines que l'on a coûtume d'ouvrir en saignant au bras. Voyez Phlébotomie. (L)
Basilique ou basilica, est, en Astronomie, le nom d'une étoile fixe de la premiere grandeur dans la constellation du Lion : elle s'appelle aussi Regulus & cor Leonis, ou c?ur du Lion. V. Lion. (O)
Wiktionnaire
Nom commun 1 - français
basilique \ba.zi.lik\ féminin
- (Antiquité) Édifice public couvert, généralement de forme rectangulaire, divisé en plusieurs nefs par des colonnades et terminé par une abside, qui était affecté à divers usages : justice, commerce, etc.
-
(Christianisme) Église chrétienne bâtie sur le plan de la basilique romaine, à plusieurs vaisseaux de forme allongée, le vaisseau central étant éclairé de fenêtres percées dans la partie haute de la nef.
- La forme de l'église est celle de la basilique ancienne à croix latine, au transept visible seulement par les voûtes. ? (Gustave Fraipont; Les Vosges, 1923)
-
Lieu de culte de la religion chrétienne, qui a reçu du pape le droit d'être appelée ainsi car il s'y est passé un événement particulier (miracle, lieu de pèlerinage?), ou parce qu'elle abrite le corps d'un saint ou une relique insigne, ou encore à titre purement honorifique.
- La basilique de Lourdes.
Nom commun 2 - français
basilique \ba.zi.lik\ féminin
-
(Anatomie) Veine basilique.
- La basilique est une des quatre veines utilisables pour l'hémodialyse.
Adjectif - français
basilique \ba.zi.lik\ masculin et féminin identiques
-
(Anatomie) Désigne la grosse veine qui se situe sur la face interne de l'avant-bras et qui rejoint la veine brachiale au milieu du bras.
- La veine basilique était utilisée pour les saignées.
Trésor de la Langue Française informatisé
BASILIQUE1, subst. fém.
ARCHITECTUREBASILIQUE2, adj. et subst.
ANAT. Adj. Veine basilique. ,,Une des veines sur lesquelles on pratique la saignée du bras`` (Littré-Robin 1865).Basilique au Scrabble
Le mot basilique vaut 18 points au Scrabble.
Informations sur le mot basilique - 9 lettres, 5 voyelles, 4 consonnes, 8 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot basilique au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
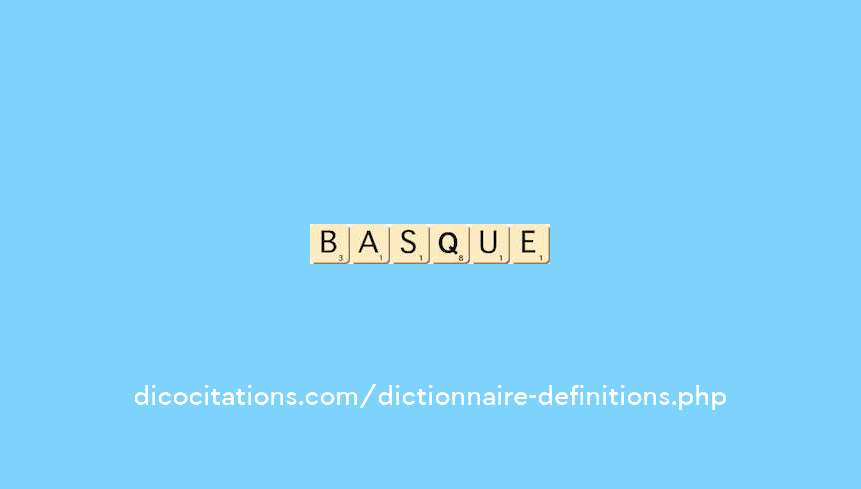
Les mots proches de Basilique
Bas, basse Bas Basaltique Basane Basané, ée Basaner Bascule Basculer Base Basilaire Basilic Basilic Basilicon Basilidien Basilique Basilique Basipète Basque Basquette Basquine Bas-relief Bassa Basse Basse Basse Basse-contre Basse-cour Bassement Bassesse Basset Basse-taille Bassette Bas-siége Bassin Bassine Bassiner Bassinet Bassinoire Bastant, ante Baste Bastide Bastidon Bastille Bastillé, ée Bastion Bastonnade Bastringue Bastringuer bas bas bas bas-bleu bas-bleus bas-côté bas-côtés bas-empire Bas-en-Basset Bas-et-Lezat bas-flanc bas-fond bas-fonds Bas-Lieu Bas-Mauco Bas-Oha bas-relief bas-reliefs Bas-Rhin bas-ventre Bas-Warneton basa basaient basait basal basalte basaltes basaltique basane basané basané basanée basanées basanées basanes basanés basanés basant Bascons Bascous bascula basculai basculaient basculais basculait basculâmes basculant basculant basculante basculantsMots du jour
Onzaine Paréatis Arrêté, ée Abstrait, aite Convoyer Myriade Répréhenseur Fielleux, euse Disjoindre Amèrement
Les citations avec le mot Basilique
- Basilique: Synonyme pompeux d'église. Est toujours imposante.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Le programme de la basilique romane est celui d'une sorte de reliquaire immense, mais ouvert à tous.Auteur : Henri Focillon - Source : L'Art d'Occident (1938)
- J'allai voir la cathédrale, vaisseau gothique à nef élevée. Les bas côtés se partagent en deux voûtes étroites soutenues par un seul rang de piliers, de manière que l'édifice intérieur tient à la fois de la cathédrale et de la basilique.Auteur : François-René de Chateaubriand - Source : Mémoires d'outre-tombe (1848), Partie 3, Livre 36, Chapitre 6
- Le coeur de Simon migre maintenant, il est en fuite sur les orbes, sur les rails, sur les routes, déplacé dans ce caisson dont la paroi plastique, légèrement grumeleuse, brille dans les faisceaux de lumière électrique, convoyé avec une attention inouïe, comme on convoyait autrefois les coeurs des princes, comme on convoyait leurs entrailles et leur squelette, la dépouille divisée pour être répartie, inhumée en basilique, en cathédrale, en abbaye, afin de garantir un droit à son lignage, des prières à son salut, un avenir à sa mémoire –on percevait le bruit des sabots depuis le creux des chemins, sur la terre battue des villages et le pavé des cités, leur frappe lente et souveraine, puis on distinguait les flammes des torches (…) mais l'obscurité ne permettait jamais de voir cet homme, ni le reliquaire posé sur un coussin de taffetas noir, et encore moins le coeur à l'intérieur, le membrum principalissimum, le roi du corps, puisque placé au centre de la poitrine comme le souverain en son royaume, comme le soleil dans le cosmos, ce coeur niché dans une gaze brochée d'or, ce coeur que l'on pleurait.Auteur : Maylis de Kerangal - Source : Réparer les vivants (2013)
Les citations du Littré sur Basilique
- Hélène avait fait enfermer le sépulcre de Jésus-Christ dans une basilique circulaire de marbreAuteur : Chateaubriand - Source : Mart. II, 151
- Salive d'omme jeun [à jeun] naie [tue] le basiliqueAuteur : H. DE MONDEV. - Source : f° 88, verso.
- Le basilique, quant il voit sa figure ou [au] miroir, meurt pour la reverberation du venin que li miroir li rentAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 88, verso
- Soudain tu presses le rameau venant de la cephalique, jusqu'à ce que suffisante evacuation de sang soit faite du foye par la veine basilique ou hepatiqueAuteur : PARÉ - Source : IV, 21
- Le peuple de Saint-Louis regrettera ces basiliques toutes moussuesAuteur : Chateaubriand - Source : Génie, III, I, 8
- Cil qui est regardé du basilique sans atouchement corporel, est tué par l'air que il atraitAuteur : H. DE MONDEVILLE - Source : f° 88, verso.
- Et est appellée [la veine basilique] en la main senestre splenatiqueAuteur : LANFRANC - Source : f° 30
- Le véritable narthex n'était qu'un portique ouvert, au moins sur sa face intérieure, dans les premières basiliques chrétiennesAuteur : VIOLLET-LE-DUC - Source : Dict. de l'architect.
- Vers le coude se monstre apertement la basilique que l'en appelle la epatiqueAuteur : LANFRANC - Source : f° 30
- M. Mowat conclut que le chalcidique était une annexe complémentaire, une partie accessoire de la basilique ou de la curie, c'est-à-dire qu'il n'y avait point de chalcidique sans basilique et sans curieAuteur : Ferdinand-Hippolyte Delaunay - Source : Journ. offic. 11 mars 1873, p. 1690, 2e col.
- La veine qui est faite des deux [céphalique et basilique] est appellée vulgairement mediane, à raison qu'elle est faite de deux rameaux, et située entre iceuxAuteur : PARÉ - Source : IV, 21
- L'autre, aux caveaux des vieilles basiliques, De ses aïeux vient toucher les reliquesAuteur : MILLEV. - Source : Emma et Eginard.
- Il existe à Vienne, sous le vocable de saint Pierre, une église élevée sur la place d'une basilique des premiers sièclesAuteur : LEBLANT - Source : Inscript. chrét. de la Gaule, t. II, p. 113
Les mots débutant par Bas Les mots débutant par Ba
Une suggestion ou précision pour la définition de Basilique ? -
Mise à jour le vendredi 6 février 2026 à 20h40
Dictionnaire des citations en B +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur basilique
Poèmes basilique
Proverbes basilique
La définition du mot Basilique est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Basilique sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Basilique présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
