Définition de « ventousé »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot ventouse de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur ventousé pour aider à enrichir la compréhension du mot Ventousé et répondre à la question quelle est la définition de ventouse ?
Une définition simple : (fr-verbe-flexion |pp=oui)
Définitions de « ventouse »
Trésor de la Langue Française informatisé
VENTOUSE1, subst. fém.
VENTOUSE2, subst. fém.
Wiktionnaire
Nom commun 1 - français
ventouse \v??.tuz\ féminin
- Sorte de petite cloche de verre, qu'on applique sur la peau et dans l'intérieur de laquelle on raréfie l'air au moyen de la chaleur ou par un procédé mécanique, afin de soulever la peau et de produire une révulsion locale.
- Dans les maladies où il faut sur-le-champ une évacuation sanguine avec forte dérivation et prompte révulsion , les ventouses scarifiées souvent l'emportent sur les sangsues : [?]. ? (Louis Vitet, Traité de la sangsue médicale, P.J. Vitet & fils, Paris : chez H. Nicolle, 1809, chap.6, page 333)
- On me posait des ventouses, mon frère tendait la lampe à essence (nous n'avions pas de table où la placer) et ma mère y enflammait les flocons d'ouate. ? (Marcel Arland, Terre natale, 1938, réédition Le Livre de Poche, page 9)
- Moins l'habit et la cornette, c'est une s?ur de la charité qui pose des ventouses, des cataplasmes, applique des sinapismes, masse les rhumatisants, ensevelit les morts. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
- Ventouse sèche, celle qu'on applique sans faire ensuite de scarification.
- Ventouse scarifiée, celle qu'on applique en scarifiant ensuite.
-
(Par analogie) (Zoologie) Organes dont quelques animaux aquatiques sont pourvus, et à l'aide desquels ils s'attachent aux différents corps, ou sucent, en faisant le vide.
- La sangsue a des ventouses.
- Le ténia dit armé a des ventouses.
- il y a cinquante pustules par antenne, et toute la bête en a quatre cents. Ces pustules sont des ventouses. ? (Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866)
-
(Par analogie) Dont la forme évoque une ventouse.
- La femme étalait une hideur provocante. Je la voyais passer un seau à la main, les oreilles décollées, le front fuyant, le nez écrasé, la bouche avancée en ventouse, au sommet du crâne une torsade de cheveux jaunes. ? (Marcel Arland, Terre natale, 1938, réédition Le Livre de Poche, page 209)
- (Par extension) Coupelle élastique et hermétique, que la pression atmosphérique permet de faire adhérer à des surfaces planes et lisses.
- Un outil à main dont le manche tient à son extrémité une membrane en forme de cloche, conçu pour déboucher le drain d'une cuvette, que l'on actionne en tirant sur l'outil dont l'embout recouvre la bouche du drain immergée dans le liquide, pour créer une dépression et ainsi faire reculer l'obstacle de son logement.
- La ventouse permet de déboucher les WC sans utiliser de produit coûteux. ? (« Déboucher ses toilettes avec une ventouse », Futura Sciences.)
Nom commun 2 - français
ventouse \v??.tuz\ féminin
-
Ouverture, pratiquée dans un conduit, dans une fosse, etc., pour donner passage à l'air.
- Il faut mettre des ventouses à cette cheminée pour l'empêcher de fumer.
- La ventouse d'une fosse d'aisances.
Littré
-
1Vaisseau de verre, de cuivre, etc. qu'on applique sur la peau, et dans la capacité duquel on fait le vide, afin de soulever la peau et de produire une irritation locale. Appliquer des ventouses.
Ventouses humides, et, plus ordinairement, ventouses scarifiées, ventouses après lesquelles on pratique la scarification de la peau soulevée?; on réapplique la ventouse pour obtenir plus de sang.
Ventouses sèches, ventouses après lesquelles on ne scarifie pas la peau soulevée.
- 2 Terme d'histoire naturelle. Certains organes dont quelques animaux aquatiques sont pourvus, et au moyen desquels ils font le vide et sucent les corps auxquels ils s'attachent.
-
3Ouverture pratiquée dans un conduit pour donner passage à l'air.
Si la cheminée fumait toujours malgré les précautions indiquées, il faudrait faire une ventouse qui s'ouvrît dans la cheminée
, Genlis, Maison rust. t. I, p. 68, dans POUGENS.Ventouse, ou planche de ventouse, nom de deux planches de plâtre placées l'une devant l'autre sous le manteau d'une cheminée, et entre lesquelles passe l'air.
Se dit aussi de petites ouvertures pratiquées dans l'épaisseur des planchers pour établir un courant d'air sous le manteau d'une cheminée.
Terme de marine. Ouverture pratiquée dans les ponts ou même dans la muraille d'un navire pour renouveler l'air.
Terme de poêlier. Petite grille en fonte donnant passage à l'air froid.
Terme de métallurgie. Ouvertures des canaux d'évaporation dans les fourneaux.
Ouvertures faites aux murs des parcs et clôtures pour faire écouler l'eau (MASSÉ, 1766, Dict. des eaux et for.).
- 4 Terme de jardinage. Branche qu'on laisse sans la tailler aux espaliers trop vigoureux, pour qu'elle consume l'excès de séve.
- 5Ventouse de chapeau, de casquette, petite ouverture pour l'aérer.
HISTORIQUE
XVe s. Ventoise pour aider à relever la marris [matrice] d'icele malade
, Du Cange, ventosa. Des estoupes ardentes dedans venteuses, et les luy passoient en ceste chaleur à l'endroit du cueur [pour lui faire retirer le sang au cueur]
, Commines, V, 5.
XVIe s. Ventouses de cuivre, de corne, de verre, de bois, de terre, d'or et d'argent, les unes sont grandes, autres petites (appelées petits cornets), les autres moyennes
, Paré, XV, 68.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
VENTOUSE. Ajoutez?:On rechausse la dernière rangée de broussailles pour lui permettre de résister au vent? et bien l'appliquer contre le sol, afin de ne donner aucune prise aux ventouses?; car, en une seule nuit, le travail de plusieurs jours peut être perdu [il s'agit de la fixation des dunes], G. Bagneris, Man. de sylvic. p. 293, Nancy, 1873.
Encyclopédie, 1re édition
Ventouse, (Méd. thérap.) cucurbitta, cucurbitula, espece de coupe ou de vase dont on a trouvé anciennement que la figure approche de celle d'une courge, & qu'on emploie en médecine comme un épispastique ou remede vésicatoire des plus efficaces. Voyez Vésicatoire.
Les ventouses peuvent être de plusieurs matieres, comme de plusieurs formes, en ne prenant celles-ci que pour autant de modes de la premiere ; il y en avoit autrefois d'argent, de cuivre, de verre, de corne, &c. Ces derniers s'appelloient cornicula ; mais on n'emploie guere plus aujourd'hui que celles de cuivre, celles d'argent ayant même été rejettées du tems d'Oribase, par le défaut de se trop échauffer, quia vehementer igniuntur, rejicimus (Voyez Oribase, med. collect. lib. VII. chap. xvj.), & les autres n'étant pas propres à résister à la violence du feu ; celles de verre pourroient néanmoins être encore employées dans le cas où il seroit important de fixer la quantité de sang qu'on veut extraire par ce remede. Quant à la forme, il y en a qui sont plus ou moins rondes, plus ou moins larges ou hautes, dont la pointe est plus ou moins aiguë, ou plus ou moins obtuse, &c. Les ventouses des Egyptiens ressemblent presque à de petits cors ou cornets. Voyez la figure & la description dans Prosper Alpin, de med. egypt. lib. II. c. xiij. A l'égard de la maniere d'appliquer les ventouses, voyez Ventouse, (Chirurgie.)
L'effet des ventouses est 1°. en rompant l'équilibre entre les organes, d'occasionner une augmentation de ton ou de vie dans la partie qui y attire les humeurs, & la constitue tumeur : ce qui se rapporte assez aux phénomènes de l'inflammation, 2°. d'attirer méchaniquement au-dehors par une espece de suction les humeurs déja ramassées par le premier effet.
On divise communément les ventouses en seches, inanes & en scarifiées, &c. L'une & l'autre espece ont été employées de tout tems en médecine, & dans presque toutes les maladies. Nous ne saurions mieux constater l'antiquité & l'efficacité de ce remede que par un passage d'Hérodicus qui vivoit avant Hippocrate, & qu'Oribase nous a conservé dans ses collections méd. liv. VII. chap. xvij. Cucurbitula materiam quæ in capite est, evacuare potest, itemque dolorem solvere, inflammationem minuere, inflationes discutere, appetitum revocare, imbecillem exolutumque stomachum roborare, animi defectiones amovere, quæ in profundo sunt ad superficiem traducere, fluxiones siccare, sanguinis eruptiones cohibere, menstruas purgationes provocare, facultates corruptionis effectrices attrahere, rigores sedare, circuitus solvere, à propensione in somnum excitare, somnum conciliare, gravitates levare, atque hæc quidem quæque his similia præstare cucurbitularum usus potest. A ce magnifique éloge des propriétés des ventouses on peut ajouter qu'Hippocrate & les autres anciens en parlent d'après leurs expériences comme les remedes les plus propres à détourner le sang d'une partie sur une autre, & en général à produire des révulsions & évacuations très-utiles. On sait avec quel succès ce pere de la médecine s'en servoit, en les appliquant sur les mamelles, pour arrêter les hémorrhagies de l'uterus. Les méthodiques ont rempli de ces remedes leur regle ciclique ou leur traitement par diatritos ; ils les comptoient parmi leurs principaux métasyncritiques ou recorporatifs ; en conséquence ils en appliquoient dans certaines maladies, comme la phrénesie, non-seulement sur la tête & sur toutes les parties voisines, mais encore sur les fesses, sur le bas-ventre, sur le dos & sur les hypocondres. Aretée est encore un des médecins qui se soit le plus servi de ces remedes, & avec le plus de méthode, sur-tout dans les maladies aiguës. Dans la pleurésie, par exemple, il veut qu'on emploie les ventouses ; mais après le septieme jour & non avant, ce qui est remarquable ; « car, dit-il, les maladies qui exigent l'application des ventouses avant le septieme jour, n'ont pas une marche tranquille ». Non enim placidi morbi sunt quicumque ante septimum cucurbitam requirunt. Les méthodiques ne les appliquoient non plus qu'après le cinq ou le septieme. Notre auteur demande ensuite que la ventouse soit faite d'argille, qu'elle soit légere, & d'une grandeur & forme à pouvoir couvrir tout l'espace qu'occupe la douleur ; il veut qu'on excite beaucoup de flamme dans la ventouse, pour qu'elle soit bien chaude avant l'extinction du feu. Le feu éteint, il faut scarifier & tirer autant de sang que les forces du malade pourront le permettre, on répandra sur les endroits scarifiés du sel avec du nitre, qui à la vérité sont des substances piquantes, mais salutaires. Si le malade est vigoureux & d'un bon tempérament, il convient d'employer le sel, non pas immédiatement sur la plaie, mais de le répandre sur du linge arrosé d'huile qu'on étendra ensuite sur l'endroit scarifié. Le second jour il est à-propos d'appliquer une seconde ventouse au même endroit, celle-ci ayant un avantage réel sur la premiere, en ce qu'elle ne tire pas du corps le sang ou l'aliment, alimentum, mais simplement de la sanie, & que par cette raison elle ménage plus les forces. Voyez morb. acut. lib. I. cap. x. de curat. pleurit.
Quelques autres nations éloignées, outre les peuples orientaux, sont encore en possession des ventouses. Chez les Hottentots, « pour les coliques & les maux d'estomac, leur remede ordinaire est l'application des ventouses. Ils se servent d'une corne de b?uf dont les bords sont unis. Le malade se couche à-terre sur le dos, pour s'abandonner au médecin qui commence par appliquer sa bouche sur le siege du mal, & par sucer la peau ; ensuite il y met la corne, & l'y laisse jusqu'à ce que la partie qu'elle couvre, devienne insensible ; il la retire alors pour faire deux incisions de la longueur d'un pouce ; & la remettant au même lieu, il l'y laisse encore jusqu'à ce qu'elle tombe remplie de sang : ce qui ne manque point d'arriver dans l'espace de deux heures. » Voyez hist. génér. des voyages, tom. XVIII. liv. XIV.
Les ventouses sont encore très-bonnes pour attirer au-dehors le venin des morsures des animaux. Dans la plûpart des maladies soporeuses elles sont recommandées par des auteurs tant anciens que modernes. Rhasès se vante d'avoir guéri le roi Hamet, fils de Hali, qui étoit tombé en apoplexie, en lui faisant appliquer une ventouse au col. Voyez dans Forestus pag. 523. Elles ont quelquefois réussi dans les apoplexies avec paralysie, appliquées à la fesse du côté opposé à la partie affectée. Les ventouses sont encore bonnes entre les deux épaules & au-dessous de l'ombelic dans le cholera morbus ; mais il faut avoir l'attention de les changer de tems-en-tems, crainte qu'elles ne causent de la douleur, & n'excitent des vessies sur la peau, ainsi que l'a noté Aretée, & après lui plusieurs modernes. Voyez de Hêers, obs. med.
Les ventouses ont beaucoup perdu de leur ancienne célébrité ; il est pourtant d'habiles médecins de nos jours qui les emploient avec succès. Cet article est de M. Fouquet, docteur en médecine de la faculté de Montpellier.
Ventouse, s. f. (Hydr.) est un tuyau de plomb élevé & branché à un arbre un pié ou deux plus haut que le niveau du réservoir, afin que la ventouse ne dépense pas tant d'eau, quand les vents en sortant de la conduite la jettent en-haut. De cette maniere il n'y a que les vents qui sortent ; les ventouses sont les seuls moyens de soulager les longues conduites, & d'empêcher les tuyaux de crever.
On soude encore une ventouse sur le tuyau descendant d'un réservoir ; alors les vents y rejettent l'eau par le bout recourbé du tuyau.
Les ventouses renversées ne sont plus d'usage ; ce sont de petites soupapes renversées & soudées sur le bout d'un tuyau, de sorte que les vents les faisoient hausser & baisser, & elles perdoient beaucoup d'eau, on ne les employoit que pour éviter d'élever des tuyaux au niveau du réservoir. (K)
Ventouse, s. f. (Méchan. des cheminées.) c'est le nom qu'on donne à une espece de soupirail pratiqué sous la tablette ou aux deux angles de l'âtre d'une cheminée, pour chasser la fumée. Ce soupirail est un trou fait en trapèse, pratiqué au milieu de l'âtre, qu'on ferme avec une porte de tole, qui s'ouvre en-dehors au moyen de deux especes de gonds dans lesquels elle tourne. L'air de dehors vient de cette trape, comme il entre dans ces cellules, & forme en sortant un soufflet qui donne sur les charbons, & qui les allume quelque peu embrasés qu'ils soient. Ce soupirail doit donc allumer aisément & promptement le feu, & empêcher par-là la fumée. C'est aussi-là tout son usage. Ce soupirail appellé soufflet, parce qu'il en fait l'office, est de l'invention de M. Perrault. (D. J.)
Ventouse d'aisance, (Archit.) bout de tuyau de plomb ou de poterie, qui communique à une chaussée d'aisance, & qui sort au-dessus du comble pour donner de l'air frais & nouveau au cabinet d'aisance, & en diminuer par-là la mauvaise odeur ; c'est une fort bonne invention. (D. J.)
Ventouse, s. f. (Verrerie.) ce mot se dit dans les fours à verre, de chacune des six ouvertures ou ouvreaux où sont placés les pots à fondre ou à cueillir. (D. J.)
Étymologie de « ventouse »
Provenç. espagn. et ital. ventosa?; du latin ventosa, ventouse, de ventosus, venteux.
- (Nom 1) (1240) Du latin ventosa avec ellipse de cucurbita (les premières ventouses médicales sont des courges) : « courge venteuse ».
- (Nom 2) (1676) Variante dialectale de venteuse ? voir ventôse, évent, ventilateur et Ventouse.
ventousé au Scrabble
Le mot ventousé vaut 11 points au Scrabble.
Informations sur le mot ventouse - 8 lettres, 4 voyelles, 4 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot ventousé au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
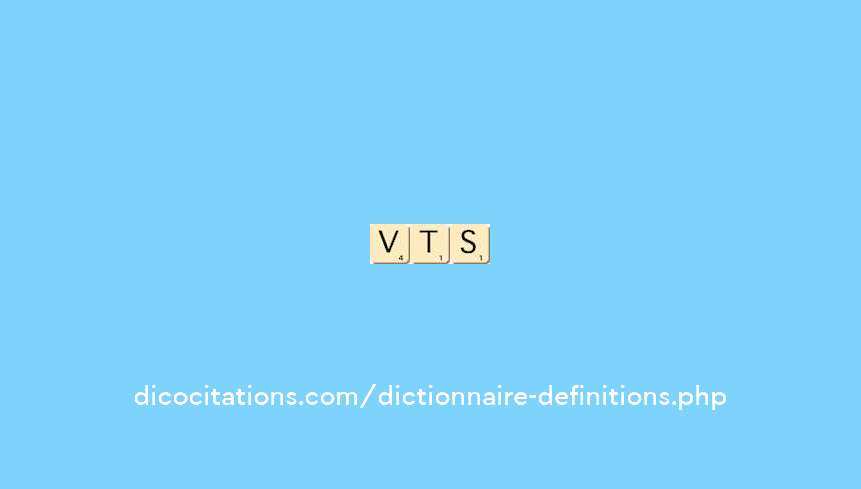
Les rimes de « ventousé »
On recherche une rime en ZE .
Les rimes de ventousé peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en ze
Rimes de arpégé Rimes de rentabilisé Rimes de valorisez Rimes de alléger Rimes de encagée Rimes de porte-objet Rimes de corrigés Rimes de prolongée Rimes de envaser Rimes de ironisé Rimes de anglicisé Rimes de traduisaient Rimes de croisée Rimes de décentralisée Rimes de explosés Rimes de balisée Rimes de galantisait Rimes de échangeaient Rimes de remobilisés Rimes de irisée Rimes de revaloriser Rimes de rechargez Rimes de imposait Rimes de ionisé Rimes de rusés Rimes de hospitalisés Rimes de Rosée Rimes de sodomisé Rimes de généralisé Rimes de interposer Rimes de imposé Rimes de rejets Rimes de ménagées Rimes de submergés Rimes de regorger Rimes de amusés Rimes de ironiser Rimes de grugeaient Rimes de démobilisés Rimes de boisées Rimes de relativisé Rimes de éternisaient Rimes de gagez Rimes de culpabilisais Rimes de manager Rimes de horlogers Rimes de propagée Rimes de diffusé Rimes de étageaient Rimes de atomiséMots du jour
arpégé rentabilisé valorisez alléger encagée porte-objet corrigés prolongée envaser ironisé anglicisé traduisaient croisée décentralisée explosés balisée galantisait échangeaient remobilisés irisée revaloriser rechargez imposait ionisé rusés hospitalisés Rosée sodomisé généralisé interposer imposé rejets ménagées submergés regorger amusés ironiser grugeaient démobilisés boisées relativisé éternisaient gagez culpabilisais manager horlogers propagée diffusé étageaient atomisé
Les citations sur « ventousé »
- Gise lui avait posé ces ventouses; elles commençaient à agir; déjà les bronches se dégagaient, la respiration devenait plus aisée.Auteur : Roger Martin du Gard - Source : Les Thibault
- Il faut descendre encore, enfoncer jusqu'aux chevilles dans la prairie d'où il arrache ses pieds avec un bruit de ventouse.Auteur : François Mauriac - Source : Les Anges noirs (1936)
- Son corps maigre flotte dans la chemise et à travers la batiste apparaît sur sa poitrine et jusqu'à ses flancs la répugnante morsure des ventouses.Auteur : Georges Bernanos - Source : Madame Dargent
- La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux - Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes.Auteur : Arthur Rimbaud - Source : Poésies (1870-1871)
Les mots proches de « ventouse »
Venaison Vénal, ale Vénalement Vénalité Venant, ante Vénation Vendable Vendage Vendange Vendanger Vendangeur, euse Vendeur, eresse Vendication Vendiquer Vendition Vendre Vendredi Vendu, ue Venelle Vénéneux, euse Vénénosité Vener Vénérable Vénérablement Vénérant, ante Vénérateur Vénération Vénérer Venereum Vénerie Vénérien, ienne Venet Veneur Vengé, ée Vengeance Venger Vengeur, geresse Véniel, elle Véniellement Venimé, ée Venimeux, euse Venimosité Venin Venir Vent Vente Ventelle Ventellerie Venter Venteux, euseLes mots débutant par ven Les mots débutant par ve
Venables Venaco Venaco venaient venais venaison venaisons venait vénal vénale vénales vénalité Venansault Venanson venant venant Venarey-les-Laumes Venarsal Venas Venasque vénaux Vence Vencimont vend Vend?uvres vendable vendables vendaient vendais vendait vendange vendange vendangé vendangeait vendanger vendanges vendanges vendangeur vendangeurs vendangeuses vendant Vendargues Vendat Vendays-Montalivet vende Vendée vendéen vendéen vendéenne vendéennes
Les synonymes de « ventouse»
Aucun synonyme.Fréquence et usage du mot ventousé dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « ventouse » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot ventousé dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Ventousé ?
Citations ventousé Citation sur ventousé Poèmes ventousé Proverbes ventousé Rime avec ventousé Définition de ventousé
Définition de ventousé présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot ventousé sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot ventousé notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 8 lettres.
