Définition de « bonnet »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot bonnet de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur bonnet pour aider à enrichir la compréhension du mot Bonnet et répondre à la question quelle est la définition de bonnet ?
Une définition simple : (fr-rég|b?.n?) bonnet (m)
Expression : avoir la tête près du bonnet bonnet blanc, blanc bonnet opiner du bonnet mettre la main au bonnet : Mettre la main au chapeau, ôter son chapeau par respect. mettre son bonnet de travers : (fam) Devenir de mauvaise humeur. avoir le bonnet de travers: être de mauvaise humeur. prendre quelque chose sous son bonnet : (fam) Imaginer quelque chose qui n’a aucun fondement, aucune vraisemblance; Faire quelque chose sous sa propre responsabilité, sans l’avis de personne. parler à son bonnet : (fam) Se parler à soi-même. jeter son bonnet par-dessus les moulins deux têtes dans le même bonnet gros bonnet; personnage important.
Approchant : bonneter, bonnetade, bonnetage, bonneterie, bonnetier, bonnetière
Définitions de « bonnet »
Trésor de la Langue Française informatisé
BONNET, subst. masc.
Wiktionnaire
Nom commun - français
bonnet \b?.n?\ masculin
-
Coiffure faite ordinairement de tissu, de tricot ou de peau et dont la forme varie.
- Elle était si jolie avec son bonnet rond et son ruban rose, son déshabillé de cirsakas et ses petits souliers jonquille, que mon oncle s'arrêta un instant pour la regarder. ? (Pigault-Lebrun, Mon Oncle Thomas, chap. 5, Paris : chez Gustave Barba, 1843)
- Son utilité sociale semble incontestable à voir les bonnets armés de fleurs qu'elle porte, les tours tapés sur ses tempes, et les robes qu'elle choisit. ? (Honoré de Balzac, Modeste Mignon, 1844)
- [?] il ôtait son grand habit noisette, remettait sa perruque dans la boîte et tirait de nouveau son bonnet de soie sur ses oreilles, en disant [?] ? (Erckmann-Chatrian, Histoire d'un conscrit de 1813, J. Hetzel, 1864)
- On l'a obligée aussi à garder son petit bonnet de campagne. Elle en était toute fière à Farreyrolles et savait que les gars disaient qu'elle le portait bien. Mais elle sentait qu'à Saint-Étienne cela faisait rire. On détournait la tête, on la regardait avec curiosité. ? (Jules Vallès, L'Enfant, G. Charpentier, 1889)
- [?] et cependant on rencontre encore des hommes coiffés du bonnet rayé bleu et rouge, vêtu de vadmel avec les bas de laine grise, la culotte courte à trois boutons et les espadrilles en peau de mouton. ? (Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928)
- Son bonnet reste un objet de luxe. C'est à peu près celui de toutes les femmes de ces années-là, de la veuve Capet à Charlotte Corday et aux tricoteuses, mais le sien, énorme et léger, plissé, soufflé, met sur cette citoyenne malgré soi une sorte d'immense auréole de tulle. ? (Marguerite Yourcenar, Archives du Nord, Gallimard, 1977, page 92)
-
(Habillement) Pièce du soutien-gorge qui recouvre le sein.
- Si je pouvais me réincarner, je serai plante, plus précisément coton. Car avec un peu de chance je finirai comme bonnet de sous-tif, le paradis quoi..... ? (Erick Belot, Pensées, Passez....., BoD/Books on Demand France, 2010, page 37)
- Une contradiction permanente, une esthétique inaccessible. Pauvres jeunes filles, qui se rêvent maigres et pulpeuses à la fois. Ironie du sort, le modèle vient de l'Est, à nouveau. Les tops sont russes et faméliques mais portent des bonnets D. ? (Nathalie Loiseau, Choisissez-tout, J-C Lattès, 2014, chapitre 8)
-
(Anatomie) Synonyme de réticulum, le second estomac des ruminants.
- Sur le podium des célébrités du genre, les fameuses tripes à la mode de Caen. Chacun connaît, au moins de nom, cette spécialité normande, mais savez-vous qu'elle est réalisée à partir de bonnet, de caillette et de panse, de pied de b?uf, de cidre et de calvados ? ? (Petit Futé : Produits du terroir 2016/2017)
- (Équitation) Enveloppe à ?illères dont on couvre la tête des chevaux et qui a des étuis pour les oreilles.
- (Cuisine) Partie arrière d'une dinde découpée comprenant le croupion et les deux cuisses.
- (Fumisterie) Chapeau conique en tôle que l'on dispose au dessus d'un conduit de fumée de sorte que la pluie ne puisse pas y pénétrer.
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Coiffure faite ordinairement de tissu, de tricot ou de peau et dont la forme varie. Bonnet de nuit. Bonnet grec. Bonnet phrygien. Bonnet rouge. Bonnet de police. Les grenadiers avaient de grands bonnets à poil. Un bonnet de tulle. Un bonnet de dentelle. Fam., Opiner du bonnet, Ôter son bonnet pour marquer que l'on adhère à l'avis proposé; et, figurément, Se déclarer de l'avis d'un autre, sans y rien ajouter ni en rien retrancher. Fam., Mettre la main au bonnet, ôter son bonnet, Mettre la main au chapeau, ôter son chapeau par respect. Fig. et fam., Avoir la tête près du bonnet, Être prompt, colère; se fâcher aisément pour peu de chose. Fig. et fam., Mettre son bonnet de travers, Entrer en mauvaise humeur. Fig. et fam., Il a pris cela sous son bonnet, C'est une chose qu'il a imaginée et qui n'a aucun fondement, aucune vraisemblance; et encore, Il a fait cela sous sa propre responsabilité, sans l'avis de personne. Fig. et fam., Parler à son bonnet, Se parler à soi-même. Fig. et fam., Jeter son bonnet par-dessus les moulins, Braver les bienséances, l'opinion publique. Fig. et fam., Ce sont deux têtes, ce sont trois têtes dans un bonnet, dans un même bonnet. Ce sont deux ou trois personnes liées d'amitié ou d'intérêt et qui sont toujours de la même opinion, du même sentiment. Fig. et fam., Être triste comme un bonnet de nuit, Être chagrin et mélancolique. Fig. et fam., C'est bonnet blanc et blanc bonnet, Il n'y a presque point de différence entre les deux choses dont il s'agit, l'une équivaut à l'autre. Fig. et fam., Un gros bonnet, Un personnage important. C'est un de nos gros bonnets. Par analogie, il désigne Tout ce qui rappelle la forme d'un bonnet. En termes de Zoologie, il se dit du Second estomac des ruminants et de Diverses variétés de coquillages, telles que Bonnet chinois, Bonnet de Neptune; Bonnet noir se dit d'une Variété de fauvette. En termes de Botanique, il se dit de Champignons, tels que Bonnet d'argent, Bonnet de fou, Bonnet de vache. On appelle aussi Bonnet à prêtre le Fusain à cause de la forme de ses fruits. On appelle aussi BONNET l'Enveloppe à œillères dont on couvre la tête des chevaux et qui a des étuis pour les oreilles.
Littré
-
1Coiffure d'homme sans rebords. Bonnet de laine, de soie?; bonnet de coton.
Tous les valets en bonnet de nuit
, Sévigné, 20.Sitôt qu'il fait un peu de bruit, Je lui mets son bonnet de nuit
, Béranger, Le 3e mari.Bonnet de police, coiffure des militaires quand ils sont en petite tenue.
Bonnet à poil, coiffure très élevée, arrondie, en poil noir, et qui est portée par quelques troupes d'élite d'infanterie et de cavalerie. Les grenadiers à cheval, dans l'ancienne armée impériale, portaient des bonnets à poil.
Fig. et familièrement. Je jetai mon bonnet par-dessus les moulins, phrase par laquelle on terminait les contes que l'on faisait aux enfants, et qui signifie je ne sais comment finir le conte.
Voilà ce que Moreuil m'a dit, espérant que je le vous manderais?; je jette mon bonnet par-dessus les moulins, et je ne sais rien du reste
, Sévigné, 47 (voyez aussi la lettre 379.) Dans un autre sens, aujourd'hui usité, jeter son bonnet par-dessus les moulins, braver l'opinion, les bienséances.Prendre une chose sous son bonnet, imaginer un fait sans fondement.
Ce sont deux têtes dans un bonnet, c'est-à-dire ils sont toujours de la même opinion, du même sentiment.
Voilà trois bonnes têtes dans un bonnet, la vôtre, celle de l'empereur des Romains et celle du roi de Prusse
, Voltaire, Lett. à Cath. 119.Familièrement. Mettre la main au bonnet, saluer. Avoir toujours la main au bonnet, avoir des manières extrêmement civiles et révérencieuses.
C'est un personnage dont il ne faut parler que le bonnet à la main, c'est un homme très respectable.
Coup de bonnet, salutation faite en ôtant son bonnet.
Être triste comme un bonnet de nuit, être chagrin, d'une mélancolie extrême.
C'est bonnet blanc et blanc bonnet, il n'y a point de différence entre ces choses, l'une vaut l'autre.
Parler à son bonnet, se parler à soi-même, parler sans adresser la parole à personne.
Mettre son bonnet de travers, entrer en mauvaise humeur.
Avoir la tête près du bonnet, être vif, emporté, colère.
Où sont donc ces têtes si près du bonnet??
Sévigné, 80.Prendre le bonnet vert, porter le bonnet vert, locution employée autrefois pour signifier faire cession de biens afin d'éviter d'être poursuivi comme banqueroutier?: cela se disait ainsi parce que celui qui faisait cette cession était obligé de porter un bonnet vert.
Les voilà sans crédit, sans argent, sans ressources, Prêts à porter le bonnet vert
, La Fontaine, Fab. XII, 7.Et que d'un bonnet vert le salutaire affront?
, Boileau, Sat. I.Les bonnets ou le parti des bonnets, parti politique en Suède au XVIIIe siècle, opposé au parti des chapeaux.
-
2Coiffure des docteurs, des avocats, des juges, des professeurs.
Un avocat en soutane et le bonnet en tête
, Pascal, Imag. 2.Prendre le bonnet de docteur, ou simplement, le bonnet, se faire recevoir docteur.
Faut-il avoir reçu le bonnet doctoral?
, Boileau, Épît. XI.Quitte là le bonnet, la Sorbonne et les bancs
, Boileau, Sat. VIII.Antigone disputait le bonnet de grand prêtre et même le vain titre de roi des Juifs
, Voltaire, Phil. V, 8.Bonnet carré, coiffure des docteurs en théologie.
Et que les docteurs n'eussent de bonnets carrés?
, Pascal, Imag. 2.Fig. Un gros bonnet, un personnage important dans son corps.
Les supérieurs [des Jésuites] consultèrent les gros bonnets à quatre v?ux, et le résultat fut qu'il fallait céder à l'orage
, Saint-Simon, 45, 20.Il [le cardinal de Bouillon] ne voulut voir que quelques gros bonnets des Jésuites
, Saint-Simon, 297, 21.Le P. de la Chaise et les principaux bonnets ne demandèrent pas mieux que de servir son fils [de Mme de Soubise]
, Saint-Simon, 96, 238.Opiner du bonnet, ne faire qu'ôter son bonnet en signe d'assentiment, accéder, sans aucune modification, à l'avis des autres.
Il opine du bonnet comme un moine en Sorbonne
, Pascal, Prov. 2.M. le marquis sera dispensé de parler, et peut opiner du bonnet
, Courier, II, 312.Cette affaire a passé du bonnet, au bonnet, elle a passé tout d'une voix, sans discussion.
Y jeter son bonnet, ne pouvoir résoudre la difficulté proposée.
L'affaire est consultée, et tous les avocats, Après avoir tourné le cas, Y jettent leur bonnet, se confessant vaincus
, La Fontaine, Fabl. II, 20. - 3Coiffure de gaze, de mousseline, de tulle, de dentelle, etc. à l'usage des femmes. Monter un bonnet. Garniture de bonnet.
-
4Bonnet phrygien, sorte de coiffure que l'antiquité donnait aux Phrygiens. Pâris est représenté avec le bonnet phrygien.
Aujourd'hui, bonnet phrygien, coiffure assez semblable à cette coiffure antique et qu'on donne ordinairement aux images de la Liberté, de la République.
Bonnet rouge, coiffure adoptée par les sans-culottes en 1793, et depuis lors symbole de l'esprit révolutionnaire. C'est un bonnet rouge, c'est un homme qui appartient au parti révolutionnaire.
L'homme rouge venait En sabots, en bonnet
, Béranger, Homme rouge. - 5Bonnet chinois, dit aussi chapeau chinois, instrument de musique militaire garni de sonnettes, qui sert avec la grosse caisse à marquer les temps forts de la mesure.
- 6 Terme d'anatomie. Le bonnet, le second estomac des animaux ruminants.
-
7Bonnet turc, sorte de potiron.
Bonnet-de-prêtre ou d'électeur, bonnet-à-prêtre, nom vulgaire d'une espèce de courge.
Bonnet carré, nom vulgaire du fusain.
- 8 Terme de vénerie. Bonnet carré, la tête du cerf quand il a du refait aussi haut que les oreilles.
- 9 Terme de fortification. Bonnet à prêtre, pièce détachée, dont la tête forme deux angles rentrants et trois angles saillants.
-
10Partie supérieure d'un encensoir.
Sorte d'écrou dont le trou ne perce pas d'outre en outre.
Genouillère des bottes des courriers.
Bonnet carré, espèce de foret à quatre ailes.
PROVERBES
Janvier a trois bonnets, c'est-à-dire, en ce mois il se faut bien couvrir la tête.
Je m'en moque comme un âne d'un coup de bonnet, c'est-à-dire cela m'est bien égal.
HISTORIQUE
XIIe s. Un chapel [il] ot de bonet en sa teste
, Li charois de Nymes, 1047.
XVe s. Quant n'ont assez fait dodo Ces petis enfanchonnès [enfants], Ilz portent soubz leurs bonnès visaiges pleins de bobo
, Orléans, Chanson 5. Afin de pouvoir trouver et recouvrer ses diz chaperon et bonnet
, Bibl. des Chartes, 1re série, t. V, p. 489.
XVIe s. Un Picard a la teste près du bonnet
, Despériers, Contes, IV. La pudicque modestie requise et ordonnée à ceulx de son bonnet [il s'agit d'un cardinal]
, Carloix, VI, 35. Le roy luy dist qu'il avoit merité le pendre, et que jamais plus il ne se trouvast à la cour. Mon valet de chambre s'en alla avec ce bonnet de nuict
, Paré, t. III, p. 699. J'osteray humblement mon bonnet, et tiendray la teste nue devant mon superieur, car ainsi le porte la coustume de mon pays
, Charron, Sagesse, II, 2.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
BONNET. Ajoutez?: - REM. Avoir la tête près du bonnet est une locution fort singulière?; car, toutes les fois qu'on a un bonnet sur la tête, la tête en est près. La première fois qu'on la rencontre est au XVIe siècle?; les Picards sont dits avoir la teste près du bonnet?; et un autre dicton assure qu'ils sont mauvaises têtes. Mais cela ne nous apprend rien sur l'origine de la locution. On ne peut faire que des conjectures. En voici une?: le bonnet dont il s'agit est un bonnet fâcheux, par exemple le bonnet vert des banqueroutiers, ou le bonnet des maris trompés, comme dans ces vers du Candaule de la Fontaine?: La sottise du prince était de tel mérite, Qu'il fut fait in petto confrère de Vulcan?; De là jusqu'au bonnet la distance est petite. En ce sens, avoir la tête près du bonnet, serait être tout près de faire banqueroute, ou d'être trompé par sa femme. Pareille situation met un homme de mauvaise humeur, et on fera bien de ne pas l'agacer. Mais peut-être est-il plus simple d'expliquer cette locution ainsi?: son bonnet est enfoncé, il lui échauffe les oreilles et lui rend la tête chaude?; de là colère et emportement. En concordance avec cette explication est le passage suivant?: XVIe s. Il n'y a ni bonnet quarré, ni bourlet [au parlement, à l'Université] que je ne fasse voler, s'ils m'eschauffent trop les oreilles
, Sat. Mén. p. 100.
HISTORIQUE
Ajoutez?:
XIIIe s. Il vit en cette vision le benoict saint Loys en tel abit come il l'avoit mainte foiz veu, c'est à dire en une chape à manches, un chapel de bonnet sus son chief
, Miracles st. Loys, p. 174.
Encyclopédie, 1re édition
BONNET, s. m. (Hist. mod.) sorte d'habillement de peau ou d'étoffe, qui sert à couvrir la tête.
L'époque de l'usage des bonnets & des chapeaux en France se rapporte à l'an 1449 ; ce fut à l'entrée de Charles VII. à Roüen, qu'on commença à en voir : on s'étoit jusqu'alors servi de chaperons ou de capuchons. M. le Gendre en fait remonter l'origine plus haut ; on commença, dit-il, sous Charles V. à rabattre sur les épaules les angles des chaperons, & à se couvrir la tête de bonnets, qu'on appella mortiers, lorsqu'ils étoient de velours, & simplement bonnets, s'ils étoient faits de laine. Le mortier étoit galonné ; le bonnet au contraire n'avoit pour ornement que deux especes de cornes fort peu élevées, dont l'une servoit à le mettre sur la tête, & l'autre à se découvrir. Il n'y avoit que le roi, les princes, & les chevaliers qui portassent le mortier. Voyez Mortier.
Le bonnet étoit non-seulement l'habillement de tête du peuple, mais encore du clergé & des gradués, au moins fut-il substitué parmi les docteurs-bacheliers, &c. au chaperon qu'on portoit auparavant comme un camail ou capuce, & qu'on laissa depuis flotter sur les épaules. Pasquier dit qu'il faisoit anciennement partie du chaperon que portoient les gens de robe, dont les bords ayant été retranchés, ou comme superflus ou comme embarrassans, il n'en resta plus qu'une espece de calotte propre à couvrir la tête, qu'on accompagna de deux cornes pour l'ôter & la remettre plus commodément, auxquelles on en ajoûta ensuite deux autres ; ce qui forma le bonnet quarré, dont il attribue l'invention à un nommé Patouillet ; ils n'étoient alors surmontés tout au plus que d'un bouton au milieu, les houpes de soie dont on les a couronnés étant une mode beaucoup plus moderne, & qui n'est pas même encore généralement répandue en Italie. Le même auteur ajoûte que la cérémonie de donner le bonnet de maître-ès-arts ou de docteur dans les universités, avoit pour but de montrer que ceux qu'on en décoroit avoient acquis toute liberté, & n'étoient plus soumis à la férule des maîtres ; à l'imitation des Romains qui donnoient un bonnet à leurs esclaves lorsqu'ils les affranchissoient ; d'où est venu le proverbe vocare servum ad pileum, parce que sur les médailles, le bonnet est le symbole de la liberté, dont on y représente le génie, tenant de la main droite un bonnet par la pointe.
Les Chinois ne se servent point comme nous de chapeaux, mais de bonnets d'une forme particuliere, qu'ils n'ôtent jamais en saluant quelqu'un, rien n'étant, selon eux, plus contraire à la politesse que de se découvrir la tête. Ce bonnet est différent selon les diverses saisons de l'année : celui qu'on porte en été a la forme d'un cone renversé ; il est fait d'une espece de natte très-fine & très-estimée dans le pays, & doublé de satin ; on y ajoûte au haut un gros floccon de soie rouge qui tombe tout autour, se répand & flotte de tous côtés, ou une houpe de crin d'un rouge vif & éclatant, qui résiste mieux à la pluie que la soie, & fait le même effet. Le bonnet d'hyver est d'une sorte de peluche, fourré & bordé de zibeline, ou de peau de renard avec les mêmes agrémens que ceux des bonnets d'été ; ces bonnets sont propres, parans, du prix de huit ou dix écus, mais du reste si peu profonds, qu'ils laissent toûjours les oreilles découvertes.
Le bonnet quarré est un ornement, & pour certaines personnes la marque d'une dignité, comme pour les membres des universités, les étudians en philosophie, en droit, en medecine, les docteurs, & en général pour tous les ecclésiastiques séculiers, & pour quelques réguliers. Il y a plusieurs universités où l'on distingue les docteurs par la forme particuliere du bonnet qu'on leur donne en leur conférant le doctorat ; assez communément cette cérémonie s'appelle prendre le bonnet. Il falloit que les bonnets quarrés fussent en usage parmi le clergé d'Angleterre, long-tems avant que celui de France s'en servît ; puisque Wiclef appelle les chanoines bifurcati, à cause de leurs bonnets ; & que Pasquier observe que de son tems, les bonnets que portoient les gens d'église, étoient ronds & de couleur jaune. Cependant ce que nous avons ci-dessus rapporté d'après lui, prouve que ce fut aussi de son tems que leur forme commença à changer en France.
Le bonnet d'une certaine couleur a été & est encore en quelques pays une marque d'infamie. Le bonnet jaune est la marque des Juifs en Italie ; à Luques, ils le portent orangé ; ailleurs on les a obligés de mettre à leurs chapeaux des cordons ou des rubans de cette couleur. En France les banqueroutiers étoient obligés de porter toûjours un bonnet verd. Voyez plus bas Bonnet.
Dans les pays d'inquisition, les accusés condamnés au supplice sont coiffés le jour de l'exécution, d'un bonnet de carton en forme de mitre ou de pain de sucre, chargé de flammes & de figures de diables : on nomme ces bonnets, carochas. Voyez Carocha & Inquisition.
La couronne des barons n'est qu'un bonnet orné de perles sur ses bords ; & celles de quelques princes de l'empire, qu'un bonnet rouge, dont les rebords, ou selon l'ancien terme, les rebras sont d'hermine. Voyez Couronne.
Dans l'université de Paris, la cérémonie de la prise du bonnet, soit de docteur, soit de maître-es-arts, après les examens, theses ou autres exercices préliminaires, se fait ainsi : le chancelier de l'université donne la bénédiction apostolique, & impose son bonnet sur la tête du récipiendaire, qui reçoit l'un & l'autre à genoux. Voyez Docteur, Maistre-ès-Arts. (G)
Bonnet verd, (Jurisprud.) étoit une marque d'infamie à laquelle on assujettissoit ceux qui avoient fait cession en justice, de peur que le bénéfice de cession n'invitât les débiteurs de mauvaise foi à frauder leurs créanciers : on n'en exceptoit pas même ceux qui prouvoient qu'ils avoient été réduits à cette misérable ressource par des pertes réelles & des malheurs imprévûs ; & si le cessionnaire étoit trouvé sans son bonnet verd, il pouvoit être constitué prisonnier : mais à présent on n'oblige plus les cessionnaires à porter le bonnet verd. Il ne nous en reste que l'expression, porter le bonnet-verd, qui signifie qu'un homme a fait banqueroute, & qui a passé en proverbe. (H)
Bonnet à Prêtre, (en terme de Fortification) est une tenaille double construite vis-à-vis un bastion ou une demi-lune, dont le front forme deux tenailles simples, c'est-à-dire un angle saillant & deux angles rentrans. Voyez Tenaille-double & Angle mort. (Q)
Bonnet de prêtre ou Bonnet à prêtre, evonymus, (Jardinage.) espece de citrouille, qui demande la même culture, & que l'on rame comme le fusain, qu'on appelle aussi bonnet de prêtre, parce que son fruit en a la figure. Voyez Fusain. (K)
Evonymus vulgaris granis rubentibus C. B. P. 428. On n'en sauroit faire usage intérieurement sans danger ; son fruit est d'une qualité nuisible. Théophraste assûre qu'elle fait du mal aux bestiaux ; Matthiole & Ruelle confirment ce sentiment, & rapportent que les brebis & les chevres, quelqu'avides qu'elles soient des bourgeons des plantes, ne touchent jamais à celle-là. Trois ou quatre de ses baies purgent par haut & par bas. Les paysans se servent de la poudre du fruit pour tuer les poux, & lavent leurs cheveux avec la decoction de ses graines.
Ce fruit employé extérieurement est émollient & résolutif : il tue les vers, & guérit la teigne & la gratelle. Dale. (N)
Bonnet, s. m. dans les Arts, on donne en général ce nom à tout ce qui est destiné à couvrir la partie supérieure & sphérique d'une machine, d'un instrument, &c.
Cette métaphore est prise de la partie de notre habillement appellée bonnet.
Bonnet, en terme d'Orfevre en grosserie, se dit de la partie supérieure d'un encensoir, commençant au bouton, & finissant aux consoles où passent les chaînes : il forme un dome un peu écrasé.
Bonnet de turquie, c'est, parmi les Patissiers, un ouvrage en forme de bonnet ou turban à la Turque, fait d'une pâte à biscuit, ou autre.
Bonnets, en termes de Bottier, sont les genouillieres échancrées des bottes de Courier, ainsi nommées de leur forme qui approche beaucoup de celle d'un bonnet.
Étymologie de « bonnet »
- (Date à préciser) Du moyen français bonet.
Berry, bounet, bonnette, coiffure de femme?; bourguig. bonô?; provenç. boneta?; anc. catal. bonet?; espagn. et portug. bonete?; bas-lat. boneta, bonetus, bonetum, sorte d'étoffe, comme on le voit par ce passage de Guillaume de Nangis, en la vie de saint Louis?: « Ab illo tempore numquam indutus est squarleta vel panno viridi seu bonneta. » De bon, à cause de quelque qualité?? chapel de bonet, puis bonet, comme chapeau de castor, puis castor.
ÉTYMOLOGIE
Ajoutez?: Dans le haut-normand, c'est le diminutif de bon?: ce cidre est bonnet.
bonnet au Scrabble
Le mot bonnet vaut 8 points au Scrabble.
Informations sur le mot bonnet - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot bonnet au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
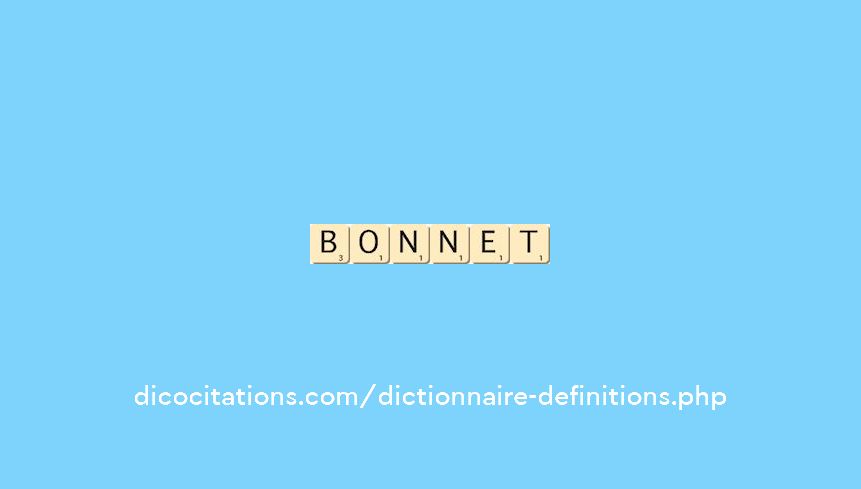
Les rimes de « bonnet »
On recherche une rime en NE .
Les rimes de bonnet peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en nE
Rimes de emmener Rimes de regagnais Rimes de planait Rimes de dernière-née Rimes de zoné Rimes de encapuchonnés Rimes de encalminé Rimes de affinait Rimes de imprégné Rimes de tannés Rimes de imaginais Rimes de bougonner Rimes de bidonnaient Rimes de Gimnée Rimes de chutney Rimes de refréner Rimes de rayonné Rimes de marmonnés Rimes de interné Rimes de freiner Rimes de signer Rimes de illuminer Rimes de disciplinais Rimes de crayonnées Rimes de détoner Rimes de ahanaient Rimes de empoisonnait Rimes de juponnés Rimes de épinaie Rimes de terminai Rimes de bâillonnés Rimes de plafonnées Rimes de sonnais Rimes de rançonner Rimes de jardinet Rimes de égrenaient Rimes de contrevenaient Rimes de cabinets Rimes de questionner Rimes de haquenée Rimes de burinés Rimes de soupçonnais Rimes de contre-miné Rimes de milanais Rimes de lyonnais Rimes de enrubannés Rimes de dégoulinez Rimes de additionnées Rimes de contrevenait Rimes de dionéeMots du jour
emmener regagnais planait dernière-née zoné encapuchonnés encalminé affinait imprégné tannés imaginais bougonner bidonnaient Gimnée chutney refréner rayonné marmonnés interné freiner signer illuminer disciplinais crayonnées détoner ahanaient empoisonnait juponnés épinaie terminai bâillonnés plafonnées sonnais rançonner jardinet égrenaient contrevenaient cabinets questionner haquenée burinés soupçonnais contre-miné milanais lyonnais enrubannés dégoulinez additionnées contrevenait dionée
Les citations sur « bonnet »
- Je suis allé à la piscine pour me nettoyer le yeux avec le chlore comme chaque fois que je ne vois plus rien. J'ai enfilé mon maillot noir, le bonnet argenté qui me donne un air de spermatozoïde de l'espace et j'ai plongé pour chercher de l'air au fond du grand bassin. Auteur : Nicolas Delesalle - Source : Un parfum d'herbe coupée (2013)
- Vous êtes des paysans, des violents, des sauvages, des Bonnets Rouges.Auteur : Pierre Jakez Hélias - Source : Le Cheval d'orgueil (1976)
- Si tous les fous portaient le bonnet blanc, nous ressemblerions à un troupeau d'oies.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Les visages bruns, cuits par le soleil, les visages émaciés par la fatigue ruisselaient de sueur sous le bonnet à passepoils rouges.Auteur : Pierre Dumarchey, dit Pierre Mac Orlan - Source : La Bandera (1931)
- Normands: Croire qu'ils prononcent des hâvresâcs, et les blaguer sur le bonnet de coton.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Un chapeau vaut mieux que cent bonnets.Auteur : Proverbes italiens - Source : Proverbe
- Il ne faut jamais se réjouir de sa journée avant d'avoir mis son bonnet de nuit.Auteur : August Strindberg - Source : La saga des Folkungar
- Qui n'a pas de tête, n'a que faire de bonnet.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Quel sera le sort de ce radieux Homo mixtus ? Je le vois d'ici : une petite voiture, une petite femme (ou homme) végane dans son lit (en compagnie d'un petit chien), deux rejetons, les oreilles bouchées par les écouteurs, des vacances sur une plage infestée d'algues vertes, journal télévisé — élections bonnet blanc blanc bonnet, exposition d'art contemporain, dose quotidienne d'antiracisme, championnat de foot, petite scène de ménage, divorce, déprimes, velléités intellectuelles, c'est-à-dire romans et films sur cette vie, un peu enjolivée… l'Homo mixtus vaincra, mais sur une planète moribonde. Le bon vieux Levi-Strauss l'a compris : « Je suis né dans un monde d'un milliard et demi d'habitants. Et je le quitte à l'heure où il en compte six. » Auteur : Andreï Makine - Source : Au-delà des frontières (2019)
- Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Contemplations (1856)
- Courtois de bouche, main au bonnet, - Peu coûte, et bon est.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- L'homme à la tête légère, perd son bonnet dans la foule.Auteur : Proverbes turcs - Source : Proverbe
- Sous tel bonnet,
Il y a plus qu'il ne paraît.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - Que vous portiez chapeau, bonnet,
Mine de cocu vous gardez.Auteur : Proverbes bretons - Source : Proverbe - La politique et la religion sont comme deux têtes sous un même bonnet.Auteur : Moses Isegawa - Source : Chroniques abyssiniennes
- Un homme chauve est fier de son bonnet, un fou de sa force.Auteur : Proverbes serbo-croates - Source : Proverbes
- Allons, Babet, un peu de complaisance,
Un lait de poule et mon bonnet de nuit.Auteur : Pierre Jean de Béranger - Source : Chansons, Le vieux célibataire - Les sapins en bonnets pointus
De longues robes revêtus
Comme des astrologues
Saluent leurs frères abattus
Les bateaux qui sur le Rhin voguent.Auteur : Guillaume Apollinaire - Source : Alcools (1913), Rhénanes, Les sapins - Je reçus pour cette soirée une invitation qui me venait d'un ancien camarade, devenu gros bonnet dans le commerce des visons. Je me décidai à en profiter.Auteur : Pierre Drieu la Rochelle - Source : La Comédie de Charleroi (1934)
- Il opine du bonnet comme un moine en Sorbonne.Auteur : Blaise Pascal - Source : Les provinciales (1656), II
- Mais y a pas un soldat qui a pas dans son coeur meurtri un petit bout de tendresse pour son ennemi, c'est comme ça. Peut-être parce qu'on est au même endroit au même moment, et finalement tous victimes du même joueur de bonneteau. Auteur : Sebastian Barry - Source : Des jours sans fin (2016)
- Quoi? Quand je dis: «Nicole, apportez-moi mes pantoufles, et me donnez mon bonnet de nuit» c'est de la prose?Auteur : Molière - Source : Le Bourgeois gentilhomme (1670), II, 4, Monsieur jourdain
- Mademoiselle Rouault s'occupa de son trousseau. Une partie en fut commandée à Rouen, et elle se confectionna des chemises et des bonnets de nuit, d'après des dessins de modes qu'elle emprunta.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Madame Bovary (1857), I, 3
- Nous traversions une vraie foule de navires qui venaient à nous toutes voiles dehors, et de loin ressemblaient, avec leurs bonnettes basses, à des silhouettes de femmes portant un seau de chaque main et se dandinant dans leur marche.Auteur : Théophile Gautier - Source : Constantinople
- Il était venu aussi des vieux derviches, avec leurs bonnets de mages, qui psalmodiaient en route, à voix haute et lugubre, comme ces cris de loups, les soirs d'hiver dans les bois.Auteur : Louis Marie Julien Viaud, dit Pierre Loti - Source : Les Désenchantées (1906)
Les mots proches de « bonnet »
Bon, bonne Bon Bon Bon Bonace Bonasse Bonbon Bond Bonde Bondel Bondir Bondissant, ante Bondissement Bondon Bonheur Bonhomie Bonhomme Bonhommeau Bonifier Bonjour Bonne Bonneau Bonnement Bonnet Bonnetade Bonneteau Bonneter Bonneterie Bonneteur Bonnetier, ière Bonne-voglie Bonnier Bonsoir Bonté Bonze BonzesseLes mots débutant par bon Les mots débutant par bo
bon bon bon bon Bon-Encontre bon-papa Bon-Secours Bona Bonac-Irazein bonace bonaces bonapartiste bonapartistes bonard bonardes Bonas bonasse bonassement bonasserie bonasses Bonboillon bonbon bonbonne bonbonnes bonbonnière bonbonnières bonbons Boncé Boncelles Bonchamp-lès-Laval Boncourt Boncourt Boncourt Boncourt Boncourt-le-Bois Boncourt-sur-Meuse bond bondage bondages bondait Bondaroy bonde bondé bondé bondée bondée bondées bondées bonder bondes
Les synonymes de « bonnet»
Les synonymes de bonnet :- 1. béguin
2. amoureux
3. coiffure
4. chapeau
5. couvre
synonymes de bonnet
Fréquence et usage du mot bonnet dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « bonnet » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot bonnet dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Bonnet ?
Citations bonnet Citation sur bonnet Poèmes bonnet Proverbes bonnet Rime avec bonnet Définition de bonnet
Définition de bonnet présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot bonnet sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot bonnet notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
