La définition de Craindre du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Craindre
Nature :
Prononciation : krin-dr'
Etymologie : Saintong. crainre ; provenç. cremer ; du latin tremere, trembler et aussi craindre. L'articulation tr s'est changée facilement en cr ; ce qu'il faut admettre, bien qu'on n'en ait pas d'exemples, l'étymologie étant d'ailleurs appuyée par le sens et par la forme eindre qui répond à emere, comme dans empreindre d'imprimere. Craindre répond à trémere avec l'accent sur tré, comme geindre à gémere ; cremir répond à une conjugaison changée, tremire, comme gémir à gemire ; non pas tremiscere ou gemiscere qui auraient donné cremoistre, gemoistre ou gemaistre, comme dans les formations de ce genre.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de craindre de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec craindre pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Craindre ?
La définition de Craindre
Éprouver le sentiment qui fait reculer, hésiter devant quelque chose qui menace.
Toutes les définitions de « craindre »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Envisager par la pensée quelqu'un ou quelque chose comme devant être nuisible, dangereux. Craindre le péril, la mort, la douleur, les maladies, la pauvreté, etc. Craindre le tonnerre. C'est un homme qui ne craint rien. Je crains qu'il ne vienne. Je crains qu'il ne vienne pas. Il est à craindre que cette entreprise n'échoue. Il craint d'être découvert. Il craint d'être importun. Je ne vous crains pas. Je ne crains pas ses menaces. C'est un homme craint de tous. Absolument, Je crains pour vous. Fam., Ne craindre ni Dieu ni diable, se dit d'un Homme qu'aucune crainte n'arrête. Je ne crains pas de le dire, de l'assurer, etc., Je n'hésite pas à le dire, à l'assurer, etc., parce que j'en ai la certitude. Il se prend aussi pour Respecter, révérer. Craindre Dieu. C'est un homme craignant Dieu. Craindre son père, sa mère. Il se dit également de Certaines choses par rapport a celles qui leur sont contraires, qui peuvent les endommager, les détruire. Ces arbres ne craignent pas le froid. Cette couleur craint le soleil. Ce vase de terre ne craint pas le feu.
Littré
-
1Éprouver le sentiment qui fait reculer, hésiter devant quelque chose qui menace.
Qui ne craint pas la mort ne craint pas les menaces
, Corneille, Cid, II, 1.Qui peut tout doit tout craindre
, Corneille, Cinna, IV, 3.Il ne faut craindre rien quand on a tout à craindre
, Corneille, Héracl. I, 5.Les rois craignent surtout le reproche et la plainte
, Racine, Esth. III, 1.Je le craindrais bientôt s'il ne me craignait plus
, Racine, Brit. I, 1.Comme il les craint sans cesse, ils le craignent toujours
, Racine, Baj. I, 1.Nous [Phéniciens] avions tout à craindre de sa sagesse [de Sésostris]
, Fénelon, Tél. III.C'était une de ses maximes, qu'il fallait craindre les ennemis de loin pour ne les plus craindre de près et se réjouir à leur approche
, Bossuet, Louis de Bourbon.Mentor, qui craignait les maux avant qu'ils arrivassent, ne savait plus ce que c'était que de les craindre dès qu'ils étaient arrivés
, Fénelon, Tél. II.Et dans l'état où j'entre, à te parler sans feinte, Elle a lieu de me craindre, et je crains cette crainte
, Corneille, Rod. I, 5.Prince, je crains le crime et non point le trépas
, Lamotte, Inès de Castro, III, 6.Absolument.
Espérer, c'est se flatter de la jouissance d'un bien?; craindre, c'est se voir menacé d'un mal
, Condillac, Traité sens. part. I, ch. 3, § 8.Craindre pour quelqu'un, pour quelque chose, craindre qu'il ne lui arrive quelque mal, quelque dommage.
Il [Thalès] avait coutume de dire que la preuve d'un bon gouvernement était d'engager les sujets non à craindre le prince, mais à craindre pour lui
, Rollin, Hist. anc. ?uvres, t. II, p. 616, dans POUGENS.Se faire craindre, inspirer la crainte. Ils se sont fait longtemps craindre.
Quand on cherche si fort les moyens de se faire craindre, on trouve toujours auparavant ceux de se faire haïr
, Montesquieu, Lett. pers. 141. -
2Révérer, respecter. Craindre son père.
Je crains Dieu, cher Abner
, Racine, Athal. I, 1.La gloire des méchants en un moment s'éteint?; L'affreux tombeau pour jamais les dévore?; Il n'en est pas ainsi de celui qui te craint?: Il renaîtra, mon Dieu, plus brillant que l'aurore
, Racine, Esth. II, 9.Crains Dieu, et garde ses commandements, car c'est là tout l'homme
, Bossuet, Duch. d'Orl.Souvenez-vous que ceux qui craignent les dieux n'ont rien à craindre des hommes
, Fénelon, Tél. XI.Il faut que les sujets espèrent en Dieu et que les souverains le craignent
, D'Alembert, Éloges, Bossuet.Familièrement. Ne craindre ni Dieu ni diable, se dit d'un homme méchant et capable de tout.
Par extension. Ce cheval craint l'éperon, il obéit à l'éperon.
- 3En parlant des choses inanimées, éprouver du dommage ne pas résister. Ces plantes craignent la gelée Arbres qui ne craignent pas l'hiver.
-
4 V. n. Craindre avec de et l'infinitif, hésiter, ne pas oser. Ne craignons pas de parler en cette circonstance.
On ne voit dans ses jugements [du juge qui veut s'agrandir] qu'une justice imparfaite, semblable, je ne craindrai pas de le dire, à la justice de Pilate?
, Bossuet, le Tellier.Sans cesse on prend le masque, et quittant la nature, On craint de se montrer sous sa propre figure
, Boileau, Épît. X.Sur les pas d'un banni craignez-vous de marcher??
Racine, Phèd. V, 1.Des soupirs qui craignaient de se voir repoussés
, Racine, Androm. III, 6.Le cardinal de Richelieu était mort peu regretté de son maître, qui craignit de lui devoir trop
, Bossuet, le Tellier.Viens régner avec nous si tu crains de servir
, Voltaire, Fanat. I, 4.Avec le subjonctif accompagné de la particule ne.
Craignez-vous qu'il ne vienne?? Je crains qu'en l'apprenant son c?ur ne s'effarouche
, Corneille, Nicom. I, 5.Je n'ai jamais importuné Votre Majesté pour lui demander du bien?; je crains que je ne l'importune en lui disant qu'elle m'en a fait
, Fléchier, dans GIRAULT-DUVIVIER.Je crains presque, je crains qu'un songe ne m'abuse
, Racine, Phèd. II, 2.Quoi?! Craignez-vous déjà qu'ils ne soient écoutés??
Racine, ib. IV, 4.Tout m'est suspect?: je crains que tout ne soit séduit?; Je crains Néron, je crains le malheur qui me suit
, Racine, Brit. V, 1.Tant qu'il vivra, craignez que je ne lui pardonne
, Racine, Andr. IV, 3.Ah?! courez et craignez que je ne vous rappelle
, Racine, ib. IV, 3.On craint qu'il n'essuyât les larmes de sa mère
, Racine, Andr. I, 4.Sans la particule ne.
Il nous fallait, pour vous, craindre votre clémence, Et que le sentiment d'un c?ur trop généreux, Usant mal de vos droits, vous rendît malheureux
, Corneille, Pomp. III, 2.Il craint qu'un indiscret la vienne révéler
, Corneille, Théod. V, 1.Mais je crains qu'elle [la patience] échappe et que, s'il continue, Je ne m'obstine plus à tant de retenue
, Corneille, Nicom. I, 2.Avec juste raison je crains qu'entre nous deux L'égalité rompue en rompe les doux n?uds, Et que ce jour fatal à l'heur de notre vie Jette sur l'un de nous trop de honte ou d'envie
, Corneille, Rod. I, 5.Et le plus grand des maux toutefois que je crains, C'est que mon triste sort me livre entre ses mains
, Corneille, ib. I, 7.Vous craignez que ma foi vous l'ose reprocher
, Corneille, ib. I, 5.Vous l'accusiez pourtant, quand votre âme alarmée Craignait qu'en expirant ce fils vous eût nommée
, Corneille, ib. V, 4.Seigneur, je crains pour vous qu'un Romain vous écoute
, Corneille, Nicom. I, 2.Je craindrais que peut-être à quelques yeux suspects tu me fisses connaître
, Molière, Fâcheux, III, 1.Mais hélas?! je crains bien que j'y perde mes soins
, Molière, D. Garcie, II, 6.?Oui, mais qui rit d'autrui Doit craindre qu'à son tour on rie aussi de lui
, Molière, Éc. des femmes, I, 1.Les soins d'un amour extrême Devroient moins vous alarmer?; Vous craignez trop qu'on vous aime?; Ne craignez-vous point d'aimer??
Quinault, Proserpine, I, 3.Et craignant qu'on me fasse un crime de mes pleurs
, Campistron, Andronic, V, 10.Craignant surtout qu'à rougir on l'expose
, Voltaire, Zaïre, IV, 2.Bien que la particule ne soit réellement explétive, cependant l'usage en a consacré l'emploi?; et la supprimer est une licence qui n'est permise qu'à la poésie?; elle l'est aussi quand la construction est interrogative ou implique un sens négatif?:
Peut-on craindre que des choses si généralement détestées fassent quelque impression dans les esprits??
Molière, Préf. du Tart.On peut prendre du profit, sans craindre qu'il soit usuraire
, Pascal, Prov. 8.Je crains peu qu'un grand roi puisse en être jaloux
, Créb. Électre, II, 4.Ne pas craindre, suivi de que, veut le subjonctif, mais sans la particule ne. Je ne crains pas qu'il fasse cette faute.
Ne craignez pas que, prêt à vous désobéir, Il apprenne avec moi, seigneur, à vous trahir
, Créb. Xerx. III, 5.Je ne crains pas qu'on soupçonne de partialité sur cet article un homme que l'on n'a pas accusé jusqu'ici d'être fort doucereux
, ID. Préf. d'Idom.Si ne pas craindre est dit interrogativement, le que suivant est suivi de ne?: ne craignez-vous pas qu'il ne vienne?? Cependant on peut dire aussi sans ne?: ne craignez-vous pas qu'il vienne??
Craindre, suivi d'un verbe qu'accompagne la négation, exprime la crainte que la chose ne se fasse pas, et par conséquent le désir qu'elle se fasse. Je crains de ne pas le voir. Je craignais qu'il ne vînt pas.
-
5Se craindre, avoir crainte de soi-même, v. réfl. Il se craint soi-même.
Il se craignait trop peu, ce qui est le caractère de ceux qui n'ont pas le soin de leur réputation
, Retz, Mém. liv. II, p. 133, dans POUGENS.
PROVERBE
Un bon vaisseau ne craint que la terre et le feu, c'est-à-dire les seuls dangers qu'il court sont la côte où il peut échouer et le feu qui le peut embraser.
REMARQUE
1. Craindre, suivi d'un verbe à l'infinitif, exige la préposition de?: je ne crains pas de me tromper, si je parle ainsi?; et non?: je ne crains pas me tromper.
2. La construction de craindre, suivi de que et d'un verbe, est le subjonctif?; il faut donc se garder d'imiter ces phrases de Fénelon?: Je crains bien que tous ces petits sophistes grecs achèveront de corrompre les m?urs romaines
, Fénelon, Dial. des morts, n° 37. Je craignais que les Grecs nous communiqueraient bien plus leurs arts que leur sagesse
, Fénelon, ib. Ne craignais-tu pas que Pythias ne reviendrait point et que tu payerais pour lui??
Fénelon, ib. n° 21. C'est un archaïsme.
SYNONYME
CRAINDRE, APPRÉHENDER, AVOIR PEUR, REDOUTER. Redouter se distingue des trois autres en ce qu'il exprime la crainte de quelque chose de supérieur, de terrible, à quoi on ne peut résister Appréhender se distingue de craindre et avoir peur, en ce que, conformément à son étymologie, il indique une vue de l'esprit, une attention portée sur l'avenir, sur la possibilité?; ce qu'on appréhende apparaît moins comme probable que comme possible. Au contraire, ce qu'on craint apparaît non-seulement comme possible, mais aussi comme probable. Enfin, avoir peur désigne un état de l'âme où devant le péril le courage fait défaut?; on peut craindre le danger et pourtant y faire tête?; mais si on a peur du danger, il est le plus fort et nous emporte. Je redoute l'orage veut dire que je le regarde comme formidable?; j'appréhende l'orage, qu'il me paraît possible?; je crains l'orage, que les effets m'en semblent dangereux pour moi?; j'ai peur de l'orage, qu'il m'ôte tout courage.
HISTORIQUE
XIe s. Je me crendreie que vous vous meslissiez [faire mêlée, combattre]
, Ch. de Rol. XVIII. Seürs est Charles, que nul homme [il] ne crent
, ib. X.
XIIe s. Franc, dit Rollant, bone gent honorée, Sur toutes autres cremue et redoutée
, Ronc. p. 48. [Je] creim que occis soit ainz que soions là
, ib. p. 95. Las?! je cren mout qu'il n'i ait encombrer
, ib. p. 165. Mais cil qui faillir crient Est si destrois, quant secours ne lui vient
, Couci, XX. Que povre sont li autre chevalier, Si crement la demorance [de rester à la croisade]
, Quesnes, Romancero, p. 101. Car mult cremi de sei, quant le respuns oï?; Mult nota les paroles que li quens respundi
, Th. le mart. 52. Car plus criement assez le terrien seignur Que il ne funt Jesu le puissant createur
, ib. 28. Li sire est la meie salut?; cui crenderai je??
Liber psalm. p. 31. E crendrunt les genz le tuen num
, ib. p. 146. Uns hom astoit en la terre Us, ki out num Job, simples et droituriers, cremmanz Deu e repairans ensus del mal
, Job, 442.
XIIIe s. Et li autre remestrent [restèrent] moult à malaise dedens Constantinople, come cil qui cremoient à perdre toute la terre
, Villehardouin, CL. Li diex d'amors onc ne cremut, Ne por fortune ne se mut
, la Rose, 6913. Forment se fist la serve et douter et cremir
, Berte, LXIII. Si te criement li paien tuit, à pou que chascuns ne s'en fuit
, Ren. 11269.
XVe s. Un moult haut prince cremu et renommé
, Froissart, II, II, 53. Ja pour mesdit, barat ne jenglerie, Ne cesserai de vous craindre et amer De plus en plus, chiere dame sans per
, Deschamps, Poésies mss. f° 141, dans LACURNE. Le peuple doit chascun jour labourer Pour les estas des nobles soutenir, Et si les doit honourer et cremir
, Deschamps, Gouvern. des rois. Moins se soucyer et moins se travailler et entreprendre moins de choses, plus craindre à offenser Dieu
, Commines, VI, 13.
XVIe s. Reprenez donc vos forces et couraiges, et ne craignez des François les oultraiges
, Marot, J. V, 16. Je ne crains à vous donner de la peine
, Marguerite de Navarre, Lett. 119. Je ne crains vous recommander ung si homme de bien
, Marguerite de Navarre, ib. 120. Ma povre s?ur faict un si très grant duel, que je crains bien sa santé
, Marguerite de Navarre, ib. 133. Je n'entends point parler de la dicte commission, qui me faict craindre qu'il y ait quelque empeschement
, Marguerite de Navarre, ib. 151. Le gentilhomme craignant sa vie s'il offensoit son maistre, et la damoiselle, son honneur
, Marguerite de Navarre, Nouv. XL. Le pape, se craignant qu'on luy teinst propos qui?
, Montaigne, I, 41. Ses adversaires craignoient de le piquer
, Montaigne, I, 41. Ne craindre point à mourir
, Montaigne, I, 69. Si est-il à craindre que la honte les desespere
, Montaigne, I, 56. Ils craignoient à m'accoster
, Montaigne, I, 194. Craignants qu'ils ne vinssent à?
, Montaigne, I, 233. Les medecins ne craignent de s'en servir à toute sorte d'usage
, Montaigne, I, 240. Chascun craint à estre espié et contreroollé
, Montaigne, I, 332. Je ne veulx ny me craindre, ny me sauver à demy
, Montaigne, III, 9. Je crains que c'est un traistre
, Montaigne, III, 310. Bien crains je que nous lui aurons très fort hasté sa ruine par notre contagion, et que nous lui aurons bien cher vendu nos opinions et nos arts
, Montaigne, IV, 17. Les tyrans qui sont contrains, faisans mal à tous, se craindre de tous
, La Boétie, 49. Quand la maison voisine ard, on doit bien craindre la sienne
, Yver, p. 526. Et craignoient les mariniers que leur vaisscau ne peust pas resister à la violence des vagues.I ls craignoient de rencontrer des hommes, et si avoient peur de n'en rencontrer point pour la grande faulte et necessité qu'ilz avoient de vivres
, Amyot, Marius, 65. Le commun populaire craint ordinairement ceulx qui le mesprisent, et avance ceulx qui le craignent
, Amyot, Nicias, 3. Il y en a qui disent que tous les princes le haïssent, et mesmes qu'il a à se craindre du ciel
, D'Aubigné, Faen. III, 20. Le duc d'Albe se craignant de la Bourgongne, quoi que les Suisses fussent obligez à la garantir, despescha quelques troupes legeres
, D'Aubigné, Hist. I, 339. Estrange est son plumage, et je crains à loger, Pour n'estre point deceu, un si jeune estranger
, Ronsard, 814. Il ne craint ni les rez ni les tondus [il ne craint personne]
, Cotgrave ?
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
CRAINDRE. Ajoutez?:La voie que vous avez prise et que vous craignez n'être pas la meilleure, ne le sera pas toujours sans doute, Rousseau, Lett. à l'abbé M. 9 février 1770.
Qu'il [Charles - Quint] était instruit de tout ce qui se disait et se craignait, et qu'il ne négligerait rien pour avoir partout des gens qui lui donnassent avis de tout, Hist. du concile de Trente, trad. de le Courayer, t. I, p. 670.
REMARQUE
1. Ajoutez?: Cependant Corneille a dit craindre à?: Si du sang d'une fille il craint à se rougir, Théod. Mais Corneille a corrigé plus tard craindre à en?: craindre de.
Wiktionnaire
Verbe - français
craindre \k???d?\ transitif ou intransitif 3e groupe (voir la conjugaison)
-
Envisager par la pensée quelqu'un ou quelque chose comme devant être nuisible, dangereux.
- Ces personnes ont craint, en pénétrant trop avant dans le système de l'homme, de voir disparaître ses plus brillantes attributions. ? (Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc, V. 35, 1816, page 376)
- Une accusation de complot contre la vie de Napoléon III fut abandonnée par prudence ; l'idée était dans l'air, on craignait d'évoquer l'événement. ? (Louise Michel, La Commune, Paris : P.-V. Stock, 1898, page 22)
- Nous ne prenions jamais une auto dans que je dise au chauffeur : « Pas trop vite hein, vieux, madame a peur. » Mais il savait bien que c'était moi qui « craignais », comme on dit en Avignon, et il riait de bon c?ur. ? (Léon Daudet, Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux/Vingt-neuf mois d'exil, Grasset, réédition Le Livre de Poche, page 462)
- Stendhal dit quelque part que le soldat ne craint pas la mort, parce qu'il espère bien l'éviter par son industrie ; cela s'appliquait tout à fait à ce genre de guerre que nous faisions. ? (Alain, Souvenirs de guerre, Hartmann, 1937, page 102)
- Jim et Jimmy, qui devaient débuter le surlendemain à Genève, avaient craint qu'on ne les empêchât de partir. ? (Francis Carco, L'Homme de minuit, Éditions Albin Michel, Paris, 1938)
- Ahmed Abdou s'effrayait aussitôt, et craignait que la graine dure et traîtresse, cachée sous les fibres, ne blessât la fillette. ? (Out-el-Kouloub, « Zariffa », dans Trois Contes de l'Amour et de la Mort, 1940)
- Ne craindre ni Dieu ni diable, se dit d'un homme qu'aucune crainte n'arrête.
- Je ne crains pas de le dire, de l'assurer, etc., Je n'hésite pas à le dire, à l'assurer, etc., parce que j'en ai la certitude.
-
Respecter, révérer.
- Craindre Dieu.
- Craindre son père, sa mère.
- Être susceptible de subir certaines choses qui peuvent atteindre, endommager ou détruire.
- Ces arbres ne craignent pas le froid.
- Cette couleur craint le soleil.
- Ce vase de terre ne craint pas le feu.
-
(Intransitif) (Populaire) Présenter un risque, être dangereux, en parlant d'une personne ou d'une situation.
-
Des grosses bêtes
Des choses pas sympa
Des gros trucs cracras qui craignent grouillent et qu'ont les crocs
? (Stupeflip, Les Monstres sur l'album Stupeflip, 2003) - Il craint.
- Ça craint.
-
Des grosses bêtes
Trésor de la Langue Française informatisé
CRAINDRE, verbe trans.
Craindre au Scrabble
Le mot craindre vaut 11 points au Scrabble.
Informations sur le mot craindre - 8 lettres, 3 voyelles, 5 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot craindre au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
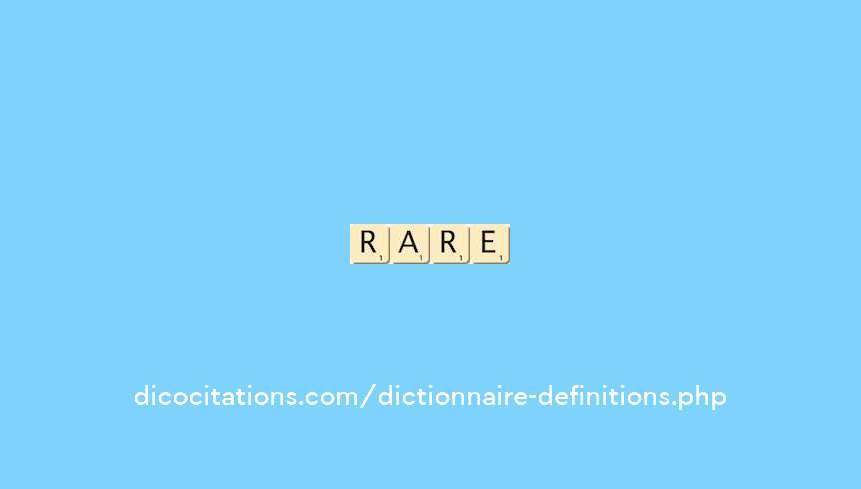
Les mots proches de Craindre
Crabe Crachat Crachement Cracher Craie Craillement Crailler Craindre Craint, crainte Crainte Craintif, ive Craintivement Cramail Cramoisi, ie Crampe Crampon Cramponner Cran Cran Crancelin ou cancerlin ou mieu Crâne Cranequin Cranequinier Craner Crânerie Cranie Crapaud Crapaudaille Crapaudière Crapaudine Crapule Crapuler Crapuleux, euse Craquelé Craquelin Craquelotière Craquement Craquer Craquerolle Craqueter Crase Crassat Crasse Crasse Crasseux, euse Crassitude Cratère Cravache Cravan Cravate crabe crabes crabillon crabillons crabs crac Crach cracha crachai crachaient crachais crachait crachant crachat crachats crache craché craché crachée crachée crachées crachement crachements crachent cracher crachera cracherai cracherais cracherait crachèrent cracheriez cracheront craches crachés crachés Craches cracheur cracheurs cracheuse cracheuses crachez Crachier crachin crachine crachiner crachins crachoir crachoirs crachons crachotaMots du jour
-
kérosène potier effrayante panel déroulera blessants dépressurisation stérilisée rencarde accueilleraient
Les citations avec le mot Craindre
- S'habituer à suivre sa voie sans prêter trop attention à ce qui se déroule autour de soi. Ne pas craindre d'être nombriliste. Peut-être est-ce de cette façon qu'on peut le moins heurter les autres.Auteur : Gilles Archambault - Source : Les plaisirs de la mélancolie
- Pour se protéger d'une liberté que l'on finit par craindre ou trouver abusive, certaines consacrent leurs efforts à trouver le grand amour, convoitant l'éternelle performance du mariage réussi et de la fidélité. Auteur : Inès Bayard - Source : Le malheur du bas
- Dans l'espace immatériel de l'analyse logique abstraite, on peut prouver avec la même rigueur aussi bien l'impossibilité absolue, la défaite certaine de la grève de masse, que sa possibilité absolue et sa victoire assurée. Aussi la valeur de la démonstration est-elle dans les deux cas la même, je veux dire nulle. C'est pourquoi craindre la propagande pour la grève de masse, prétendre excommunier formellement les coupables de ce crime, c'est être victime d'un malentendu absurde. Il est tout aussi impossible de "propager" la grève de masse comme moyen abstrait de lutte qu'il est impossible de "propager" la révolution. La "révolution" et la "grève de masse" sont des concepts qui ne sont eux-mêmes que la forme extérieure de la lutte des classes et ils n'ont de sens et de contenu que par rapport à des situations politiques bien déterminées.Auteur : Rosa Luxemburg - Source : Œuvres I (1906), Rosa Luxemburg (trad. Irène Petit), éd. Maspero, coll. « petite collection Maspero », 1969 (ISBN 2-7071-0264-4), partie Grève de masse, parti et syndicats, chap. 2., p. 100
- L'intellectuel dont la richesse est toute intérieure n'a rien à craindre du percepteur qui voudrait le taxer sur ses signes extérieurs de richesse.Auteur : Raymond Devos - Source : Les meilleurs sketches de Raymond Devos
- Je ne tiens pas assez à la vie pour craindre la mort.Auteur : Alexandre Dumas - Source : Les Trois Mousquetaires (1844)
- Pour atteindre le Zénith de sa Vie, il ne faut pas craindre de faire fi de tous les avis.Auteur : Daniel Desbiens - Source : Maximes d'Aujourd'hui
- Et à la vérité ce que nous disons craindre principalement en la mort, c'est la douleur, son avant-coureuse coutumière.Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais, I, 14
- Ce fut d'abord une joie furtive, insaisissable, comme venue du dehors, rapide, assidue, presque importune. Que craindre ou qu'espérer d'une pensée non formulée, instable, du désir léger comme une étincelle ?Auteur : Georges Bernanos - Source : Sous le soleil de Satan (1926)
- Je n'ai peur de rien. Si vous craignez Dieu vous ne craindrez plus rien.Auteur : Muammar al- Kadhafi - Source : Discours en 1972.
- Ce que mon père ne comprenait pas, c'était qu'il avait beau haïr ou craindre le futur, celui-ci arrivait, et que le seul moyen de s'en accomoder était de monter à bord.Auteur : Jeannette Walls - Source : Des chevaux sauvages, ou presque (2011)
- C'est cette force qui maintient en tout temps l'opinion juste et légitime sur ce qu'il faut craindre et ne pas craindre que j'appelle et définis courage.Auteur : Platon - Source : La République, 430b
- Regretter sans cesse le passé, suivre les succès des autres, craindre la mort... non, je n'en peux plus! je n'en ai pas la force! Et voilà qu'on ne veut même pas me pardonner ma vieillesse!Auteur : Anton Tchekhov - Source : L'Oncle Vania
- Il ne faut craindre que les seules choses qui ont pouvoir de nuire à autrui, les autres non, car elles ne sont pas redoutables.Auteur : Dante - Source : La Divine Comédie, L'Enfer (1314), II
- Les excellentes leçons que Votre Majesté veut bien me donner sur l'hypocondrie plus élégamment appelée vapeurs, me font craindre pour l'honneur de ma raison, que Votre Majesté ne me croie attaqué de cette maladie.Auteur : Jean le Rond d'Alembert - Source : Lettre au roi de Prusse, 29 juin 1781
- Je n'ai de mon amour aucun fruit espéré : Si je n'espère rien, rien ne me fera craindre.Auteur : Philippe Desportes - Source : Les Amours d'Hippolyte (1573)
- Les soldats devraient craindre leur général encore plus que leur ennemi.Auteur : Michel de Montaigne - Source : Sans référence
- Il faut tout attendre et tout craindre du temps et des hommes.Auteur : Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues - Source : Réflexions et Maximes (1746)
- Bacchus, le vrai, le seul, c'est Bacchus conservant les mêmes grâces qui touchèrent Ariane. Aussi tendre et brillant c'est un dieu à suivre et non à craindre; toujours agréable à Vénus, il ne connut d'ivresse que l'ivresse de l'amour.Auteur : Charles de Secondat, baron de Montesquieu - Source : Sans référence
- Jamais vingt volumes in-folio ne feront de révolution; ce sont les petits livres portatifs à trente sous qui sont à craindre. Si l'Evangile avait coûté douze cents sesterces, jamais la religion chrétienne ne se serait établie.Auteur : Voltaire - Source : Lettre, à Jean le Rond d'Alembert, 5 avril 1765
- Quand l'Amour dans nos coeurs vient allumer ses feux,
Rien ne doit les éteindre.
Les maux qu'on en peut craindre
Sont doux à souffrir :
Loin de nous en plaindre,
Craignons d'en guérir.Auteur : Antoine Houdar de La Motte - Source : Amadis de Grèce (1699) - Avec les légendes, tout est à craindre, à commencer par la foi. Avec les traditions, rien à redouter. C'est du solide, du tout fait, de la haute confection. Noël, chez nous, c'est le manteau d'astrakan des vieilles dames. Un placement.Auteur : Germaine Battendier, dite Germaine Beaumont - Source : Si je devais... (2005)
- Un gredin qui tourne la loi est moins à craindre en son action qu'un homme de bien qui la discute.Auteur : Georges Courteline - Source : Sans référence
- La liberté n'est pas à craindre tant qu'elle n'a pas à craindre pour elle-même.Auteur : Emile de Girardin - Source : Pensées et maximes extraites des oeuvres de M. Émile de Girardin (1867)
- Scarlett, gardez toujours quelque chose à craindre, exactement comme vous gardez quelque chose à aimer...Auteur : Margaret Munnerlyn Mitchell - Source : Autant en emporte le vent (1936)
- S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre; s'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge; mais il y en a trente, et elles vivent en paix et heureuses.Auteur : Voltaire - Source : Lettres philosophiques (1734)
Les citations du Littré sur Craindre
- La construction de craindre, suivi de que et d'un verbe, est le subjonctif ; il faut donc se garder d'imiter ces phrases de Fénelon : Je crains bien que tous ces petits sophistes grecs achèveront de corrompre les moeurs romainesAuteur : FÉN. - Source : Dial. des morts, n° 37
- Cet homme si fidèle aux particuliers, si redoutable à l'État, d'un caractère si haut qu'on ne pouvait ni l'estimer, ni le craindre, ni l'aimer, ni le haïr à demi....Auteur : BOSSUET - Source : le Tellier.
- Les menteurs, en inventant tout, semblent avoir d'autant moins à craindre de se mecompterAuteur : MONT. - Source : I, 9
- Et fut en deux batailles et en plusieurs rencontres et sieges, accompaignant son pere ; et desja se monstra fier et courageux et principalement à tenir ordre, où il se delectoit aigrement, monstrant qu'il estoit prince et seigneur apparent, et se faisoit craindreAuteur : O. DE LA MARCHE - Source : Mém. p. 70, dans LACURNE
- Et, pour ne craindre rien de leur noire furie, Je veux de toutes parts fermer la bergerie ; Faire avec soin griller mon château tout autourAuteur : REGNARD - Source : Folies amour. I, 3
- Que sais-je si la disposition même de votre tempérament ne vous laisse rien à craindre là-dessus ; si vous ne portez pas déjà la mort dans le sein ?Auteur : MASS. - Source : Carême, Impén.
- Quel est cet aveuglement dans une âme chrétienne, et qui le pourrait comprendre, d'être incapable de manquer aux hommes et de ne craindre pas de manquer à Dieu ; comme si le culte de Dieu ne tenait aucun rang parmi les devoirsAuteur : BOSSUET - Source : Anne de Gonz.
- Il m'a surtout laissé ferme en ce point D'estimer beaucoup Rome, et ne la craindre pointAuteur : Corneille - Source : Nicom. II, 3
- Las de se faire aimer, il veut se faire craindreAuteur : Jean Racine - Source : Brit. I, 1
- Tant qu'il n'était point nécessaire de parler, la sage princesse gardait le silence ; la vanité et les médisances qui soutiennent tout le commerce du monde lui faisaient craindre tous les entretiensAuteur : BOSSUET - Source : Anne de Gonz.
- Craindre en tout heurt est indice de groz et lasche cueurAuteur : François Rabelais - Source : Pant. IV, 22
- Dernière raison pourquoi la méprise dans le choix d'un état est si fort à craindreAuteur : MASS. - Source : Carême, Vocat.
- Il n'y a rien à craindre en les excommuniant comme les sauterelles et comme ceux qui nouent l'aiguilletteAuteur : Voltaire - Source : Dial. 21
- Il ne faut craindre rien quand on a tout à craindreAuteur : Corneille - Source : Héracl. I, 5
- Elle est si jeune et si peu formée qu'à moins de certains ménagements on pourrait craindre encore pour elle quelques rechutesAuteur : GENLIS - Source : Veill. du chât. t. I, p. 73, dans POUGENS
- Mort soudaine seule à craindre, et c'est pourquoi les confesseurs demeurent chez les grandsAuteur : Blaise Pascal - Source : ib. XXV, 59
- Le plus grand des maux est les guerres civiles ; elles sont sûres, si on veut récompenser les mérites ; car tous diront qu'ils méritent ; le mal à craindre d'un sot qui succède par droit de naissance, n'est ni si grand, ni si sûrAuteur : Blaise Pascal - Source : ib. V, 3, éd. HAVET.
- Dans l'attestation donnée pour la sortie [d'un aliéné guéri], j'avais ajouté une restriction et fait craindre une nouvelle rechute, à moins de grands ménagements pour l'éviterAuteur : PINEL - Source : Inst. Mém. scienc. 1807, 1er sem. p. 197
- ....[L'esprit humain] un furet qui est à craindre...Auteur : CHARRON - Source : Sagesse, I, 15
- Sans craindre ni ses envieux ni les défiances d'un ministre [Mazarin] également soupçonneux et ennuyé de son état, M. le Tellier allait d'un pas intrépide où la raison d'État le déterminaitAuteur : BOSSUET - Source : le Tellier.
- Je pense que je vis d'un air dans le monde à ne pas craindre d'être cherchée dans les peintures qu'on fait là des femmes qui se gouvernent malAuteur : Molière - Source : Critique, 7
- Et.... ne doit-on pas craindre de voir un jour un simple abbé en velours gris et à ramages comme une éminence ?Auteur : LA BRUY. - Source : XIV
- Qui peut tout doit tout craindreAuteur : Corneille - Source : Cinna, IV, 3
- Le physicien peut peser l'air dans son tube sans craindre d'offenser JunonAuteur : CHATEAUBR. - Source : Génie, III, II, 1
- Il n'y a à craindre aucun affaissement ou tassement verticalAuteur : GIRARD - Source : Instit. Mém scienc. t. x, p. 408
Les mots débutant par Cra Les mots débutant par Cr
Une suggestion ou précision pour la définition de Craindre ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 00h04
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur craindre
Poèmes craindre
Proverbes craindre
La définition du mot Craindre est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Craindre sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Craindre présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
