La définition de Revers du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Revers
Nature : s. m.
Prononciation : re-vêr
Etymologie : Provenç. revers, inverse, rebours, envers ; espagn. reverso ; ital. riverso ; du lat. reversus, retourné, de re, et versus, tourné (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de revers de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec revers pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Revers ?
La définition de Revers
La partie, le côté opposé à ce qu'on est convenu de considérer comme le côté principal, le mieux fait, le plus naturel ou celui que l'on regarde le plus habituellement. Le revers d'une tapisserie. Le revers d'un coteau.
Toutes les définitions de « revers »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Côté d'une chose opposé au côté principal, à celui que l'on regarde ou qui se présente d'abord. Le revers ou verso d'un feuillet. Le revers d'une tapisserie, d'une étoffe. Le revers de la main, Le dos de la main, le côté opposé à la paume. Un coup de revers ou simplement Un revers, Un coup d'arrière-main, un coup donné de gauche à droite avec la main droite ou avec une arme, avec un instrument quelconque tenu par la main droite. Je lui donnai un revers de ma main. Il le blessa d'un revers. Donner un revers. Ce joueur de paume, ce joueur de tennis excelle dans les coups de revers, il fait très bien les revers. Frapper de revers, Frapper de gauche à droite avec une arme, un bâton, une raquette, etc., que l'on tient de la main droite. Fig., Un revers de fortune ou simplement Un revers, Une disgrâce, un accident qui change une bonne situation en une mauvaise. Il vient d'avoir un fâcheux revers de fortune. Il a éprouvé, essuyé de cruels revers. Être ferme dans les revers. Il s'est laissé abattre par le premier revers. Il a eu tour à tour des succès et des revers. Les revers d'un vêtement se dit des Parties d'un vêtement qui sont ou qui semblent repliées en dessus de manière à montrer une partie de l'envers ou de la doublure du vêtement. Un uniforme à revers bleus. Les revers de soie d'un habit. Revers de botte, Le haut de la tige d'une botte, lorsqu'il paraît se rabattre et montrer le côté du cuir qui n'est pas noirci. Bottes à revers. En termes de Fortification, Le revers de la tranchée, Le côté de la tranchée qui est tourné vers la campagne et qui est opposé à celui qui regarde la place. On dit de même : Le revers du fossé, Le bord extérieur, opposé à celui de l'enceinte. En termes de Guerre, Prendre, battre à revers une troupe, un ouvrage de fortification, Prendre, battre cette troupe ou cet ouvrage, soit de flanc, soit par-derrière. En termes de Marine, Manœuvres de revers, Les écoutes, boulines et amures de dessous le vent des basses voiles, c'est-à-dire qui ne se trouvent pas du côté du vent.
REVERS désigne spécialement, en parlant de Monnaies ou de médailles, le Côté opposé à la face ou avers, et portant une inscription, un sujet, etc. Cette médaille a sur l'avers la tête d'Auguste, et sur le revers une Victoire. Le revers de la médaille. Fig. et fam., Le revers de la médaille, Le mauvais côté d'une chose. Vous nous avez montré les avantages de cette affaire; mais voici le revers de la médaille. Prov. et fig., Toute médaille a son revers, Chaque chose a deux faces, un bon côté et un mauvais.
Littré
-
1La partie, le côté opposé à ce qu'on est convenu de considérer comme le côté principal, le mieux fait, le plus naturel ou celui que l'on regarde le plus habituellement. Le revers d'une tapisserie. Le revers d'un coteau.
Voyons qui de nous deux, plus aisé dans ses vers, Aura plus tôt rempli la page et le revers
, Boileau, : Épît. II.Nous avons, au huit de mai, plus de cent pieds de neige au revers du mont Jura
, Voltaire, Lett. d'Argental, 8 mai 1773.Les revers de l'Arabie heureuse sont, comme partout ailleurs, plus escarpés vers la mer d'Afrique, c'est-à-dire vers l'occident, que vers la mer Rouge, qui est à l'orient
, Buffon, Add. théor. terr. ?uv. t. XII, p. 404.Fig.
?ôtez d'entre les hommes La simple foi, le meilleur est ôté?; Nous nous jetons, pauvres gens que nous sommes, Dans les procès en prenant le revers
, La Fontaine, Belph.Il est juste maintenant de considérer le revers des choses, et de montrer que l'histoire moderne pourrait encore devenir intéressante, si elle était traitée par une main habile
, Chateaubriand, Génie, II, III, 5. -
2Le revers de la main, le côté opposé à la paume.
Puis me donnant deux petits coups du revers de main sur la joue, il me dit d'être sage
, Rousseau, Confess. II.Marthe?! dis-je, est-il vrai?? - Se levant à ma voix, Et s'essuyant les yeux du revers de ses doigts?: Trop vrai?!
Lamartine, Joc. prol.Un coup de revers, ou, simplement, un revers, coup porté avec le revers de la main.
Ha?! que ne puis-je d'un revers Accompagner ces petits vers?!
Scarron, Mazarinades, t. I, p. 296, dans POUGENS.Fort bien, pour châtier son insolence extrême, Il faut que je lui donne un revers de ma main
, Molière, Tart. II, 2.Fig.
Juges aveugles et précipités, que n'attendez-vous la fin du combat avant d'adjuger la victoire?? viendra le revers de la main de Dieu, qui brisera comme un verre, qui fera évanouir en fumée toute ces grandeurs que vous admirez
, Bossuet, Sermons, Visitat. 3.Un coup de revers, un revers, signifie aussi coup donné de gauche à droite avec un instrument, avec une arme quelconque tenue de la main droite.
Le héros d'un revers coupe en deux l'animal
, La Fontaine, Fianc.Frapper de revers, frapper de gauche à droite avec une arme, un bâton, etc. que l'on tient de la main droite.
Fig. Donner des coups de revers, donner des revers, faire manquer quelque chose, châtier quelqu'un.
N'allez pas? Donner de vos revers au projet que je tente
, Molière, l'Ét. II, 1.Quand on veut forcer la nature et Dieu même pour lui dire en face qu'on [les mystiques] ne se soucie pas du bonheur qu'on trouve en lui, il donne des coups de revers terribles à ceux qui osent lui dire que c'est là l'aimer
, Bossuet, Lett. quiét. 270.Ce n'est pas qu'à mon tour je n'aie un nombre infini de désagréments, et que tous les jours ces femmes ne cherchent à renchérir sur ceux que je leur donne?; elles ont des revers terribles
, Montesquieu, Lett. pers. 9.Un revers de satire, satire qui retombe sur celui qui l'a faite.
Car enfin il faut craindre un revers de satire
, Molière, Éc. des f. I, 1. -
3Revers de fortune, ou, simplement, revers, événement malheureux qui change une bonne situation en une mauvaise.
Ce c?ur si généreux rend si peu de combat, Et du premier revers la fortune l'abat?!
Corneille, Cinna, IV, 6.Mais moi? Qui, d'emplois en emplois, vieilli sous trois sultans, Ai vu de mes pareils les revers éclatants
, Racine, Bajaz. IV, 7.Les revers de la fortune épargnent souvent, lorsqu'on les craint le plus?; et souvent ils accablent, lorsqu'on les mérite et qu'on les prévoit le moins
, Hamilton, Gramm. 8.Ce fut là le dernier de trente ans de revers
, Voltaire, Zaïre, II, 1.Souvent la vie passagère de l'homme s'use dans les revers
, Staël, Corinne, II, 3.Les revers ont soufflé sur la fleur de son âge
, Masson, Helvét. VI.Demi-revers, revers, insuccès qui n'est pas complet.
Si elle [une pièce] avait eu un plein succès, j'aurais déclaré qu'elle était de vous?; si elle avait eu un demi-revers, je l'aurais prise sur mon compte
, Marmontel, Cont. mor. Connaiss. -
4Les revers d'un habit, les deux parties d'un habit qui se croisent sur la poitrine, et dont le haut est renversé.
À ton revers j'admire une reprise, C'est encore un doux souvenir
, Béranger, Mon habit.Se disait de la partie des manches qu'on retrousse, et qui s'appelle aujourd'hui parement.
- 5Revers de botte, le haut de la tige d'une botte, lorsqu'il paraît se rabattre et montrer le côté du cuir qui n'est pas noirci. Bottes à revers.
-
6Dans les monnaies et les médailles, le côté opposé à celui où est la tête.
Le czar s'empressant de la ramasser [une médaille frappée devant lui à la Monnaie de Paris], il se vit gravé sur cette médaille, avec une Renommée sur le revers, posant un pied sur le globe, et ces mots de Virgile si convenables à Pierre le Grand?: vires acquirit eundo
, Voltaire, Russie, II, 8.Fig.
Le loup paraît être modelé sur la même forme que le chien?; cependant il n'offre tout au plus que le revers de l'empreinte
, Buffon, Morc. choisis, p. 233.Fig. et familièrement. Le revers de la médaille, le mauvais côté d'une chose, d'une personne.
Le revers de la médaille, renversement où ce qui était en devant est mis en arrière.
Nostradamus? a prédit dans ses vers, Qu'en l'an deux mil, date qu'on peut débattre, De la médaille on verrait le revers
, Béranger, Nostrad.Toute médaille a son revers, toute chose a un mauvais côté.
-
7Revers de pavé, partie inclinée du pavé, depuis les maisons jusqu'au ruisseau.
Double revers, se dit d'une route ou d'une rue pavée qui a son ruisseau dans le milieu.
-
8 Terme de fortification. Revers de la tranchée, côté opposé à celui qui regarde la place.
Revers du fossé, bord extérieur opposé à celui de l'enceinte.
Les Russes se firent tuer pendant une demi-heure sans quitter le revers des fossés
, Voltaire, Charles XII, 2.On appelle quelquefois, mais improprement et par abus, revers de la tranchée, le côté extérieur du parapet.
Revers de l'orillon, partie de l'orillon vers la courtine.
-
9 Terme de guerre. On voit, on prend, on bat à revers ou de revers une troupe, un ouvrage de fortification, quand on est passé en arrière du prolongement du front ou de la face de cette troupe, de cet ouvrage.
Ayant observé des endroits d'où l'on voit à revers une bonne partie de leurs dehors
, Pellisson, Lett. hist. t. I, p. 301.Le prince de Conti prit à revers le retranchement du front
, Saint-Simon, 12, 139.Il [le duc d'Orléans] acheva de découvrir sur les lieux à revers tout ce qu'il avait déjà aperçu en éloignement
, Saint-Simon, 162, 132.Prendre de revers, occuper une position d'où l'on dirige obliquement son feu contre le dos de l'ennemi.
-
10 Terme de marine. Man?uvres de revers, celles qui sont placées sous le vent.
Partie de la muraille d'un bâtiment qui est en surplomb.
Palan de revers, celui qui fait effort sur le garant d'un autre palan.
Revers d'arcasse, portion de voûte de bois faite à la poupe d'un vaisseau, soit pour un simple ornement, ou pour gagner de l'espace.
Revers de l'éperon, la partie de l'éperon comprise depuis le dos du cabestan jusqu'au dos de la cagouille.
HISTORIQUE
XVe s. Il demanda aux aultres deux s'ils vouloient jouster? telle fut leur adventure que Lyonnel les abatit à revers enmy la prée
, Perceforest, t. II, f° 35. Le suppliant respondi à icellui Mace, qu'il faisoit que revers paillart, de ce qu'il l'appelloit revers gars
, Du Cange, reversatus. Il montoit au revers d'une grande eschelle dressée contre un mur tout au plus hault, sans toucher des pieds, mais seulement sautant des deux mains ensemble d'eschelon en eschelon, armé d'une cotte d'acier
, Boucic. I, 6. Mais je luy tranchy une jambe D'ung revers jusques à la hanche
, Villon, Arch. de Bagn.
XVIe s. Ils se couvrent les testes aulcunes foys de bonnetz à quatre gouttieres ou braguettes?; aultres, de bonnetz à revers?; aultres, de mortiers
, Rabelais, Pant. V, 11. Luy qui estoit advisé, tascha de s'asseurer par le revers de ce qui l'avoit cuidé ruiner
, Amyot, Eum. 3. Je n'estime pas que? mais au revers je pense que?
, Amyot, Com. refrén. la col. 26. Trois mil et plus les champs furent couvers Des corps meurdris de tailles et revers
, Marot, J. V, 135. Le revers [l'opposé] de la verité a cent mille figures
, Montaigne, I, 37. Ce nom lui sembla trop revers [dur, difficile à prononcer]
, Montaigne, I, 344. Tout ce qui vient au revers du cours de nature
, Montaigne, IV, 287. Elle [Claude de France] donna un terrible revers à l'esperance du poure comte de Sault, et la renversa du tout
, Carloix, VI, 37. Il jouoit très bien à la paulme?; aussi disoit on les revers de M. de Nemours
, Brantôme, Cap. franç. t. III, p. 2, dans LACURNE.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
REVERS. Ajoutez?:Le général Lebrun?: Cette clause était certainement attentatoire à l'honneur des officiers français, et elle a eu des conséquences déplorables pour les malheureux qui ont signé le revers? cette clause relative aux armes conservées ne concernait que les officiers qui consentaient à signer le revers, Gaz. des Trib. 14 fév. 1875, p. 150, 2e col.
Encyclopédie, 1re édition
REVERS, s. m. (Gram.) c'est le côté qu'on ne voit qu'en retournant la chose ; on dit revers d'un feuillet ; le revers d'une image ; le revers de la main ; frapper de revers, c'est frapper de gauche à droite avec un bâton, un sabre qu'on tient de la droite.
Revers se prend aussi pour vicissitude fâcheuse ; la fortune d'un commerçant est sujette à d'étranges revers ; la vie est pleine de revers. La vertu la plus essentielle a un être condamné à vivre, est donc la fermeté qui nous apprend à les soutenir. Le revers d'une manche en est le dessous. Voyez les articles suivans.
Revers, (Art numismatiq.) c'est la face de la médaille qui est opposée à la tête ; mais comme c'est le côté de la médaille qu'il importe le plus de considérer, je me propose de le faire avec quelque étendue d'après les instructions du P. Jobert, embellies des notes de M. le baron de la Bastie.
Il est bon avant toutes choses de se rappeller que les médailles, ou plutôt les monnoies romaines, ont été assez long-tems non-seulement sans revers, mais encore sans aucune espece de marque. Le roi Servius Tullius fut le premier qui frappa de la monnoie de bronze, sur laquelle il fit graver la figure d'un b?uf, d'un bélier ou d'un porc ; & pour-lors on nomma cette monnoie pecunia, à pecude. Quand les Romains furent devenus maîtres de l'Italie, ils battirent de la monnoie d'argent sous le consulat de C. Fabius Pictor & de Q. Ogulnius Gallus, cinq ans devant la premiere punique ; la monnoie d'or ne se battit que 62 ans après.
La république étant florissante dans ces heureux tems, on se mit à décorer les médailles & à les perfectionner.
La tête de Rome & des divinités succéda à celle de Janus, & les premiers revers furent tantôt Castor & Pollux à cheval, tantôt une Victoire poussant un char à deux ou à quatre chevaux, ce qui fit appeller les deniers romains, victoriati, bigati, quadrigati, selon leurs différens revers.
Bientôt après les maîtres de la monnoie commencerent à la marquer de leurs noms, à y mettre leurs qualités, & à y faire graver les monumens de leurs familles ; de sorte qu'on vit les médailles porter les marques des magistratures, des sacerdoces, des triomphes des grands, & même de quelques-unes de leurs actions les plus glorieuses. Telle est dans la famille Æmilia, M. Lepidus Pont. Max. Tutor Regis. Lépidus en habit de consul met la couronne sur la tête au jeune Ptolomée, que le roi son pere avoit laissé sous la tutelle du peuple romain ; & de l'autre côté, on voir la tête couronnée de tours de la ville d'Alexandrie, capitale du royaume, où se fit la cerémonie, Alexandrea. Telle, dans la même famille, est la médaille où le jeune Lépidus est représenté à cheval, portant un trophée avec cette in cription : M. Lepidus annorum XV. prætextatus, hostem occidit, civem servavit. Telle dans la famille Julia, celle de Jules-César, qui n'étant encore que particulier & n'osant faire graver la tête, se contenta de mettre d'un côté un éléphant avec le mot Cæsar : mot équivoque, qui marquoit également & le nom de cet animal en langue punique, & le surnom que Jules portoit sur le revers ; en qualité d'augure & de pontife, il fit graver les symboles de ces dignités ; savoir le sympule, le goupillon, la hache des victimes & le bonnet pontifical : ainsi sur celle où l'on voit la tête de Cérès, il y a le bâton augural & le vase. Telle enfin dans la famille Aquilia, la médaille, où par les soins d'un III. Vir monnétaire de ses descendans, M. Aquilius qui défit en Sicile les esclaves révoltés, est représenté revêtu de ses armes, le bouclier au bras, foulant aux piés un esclave, avec ce mot Sicilia.
Voilà comme les médailles devinrent non-seulement considérables pour leur valeur en qualité de monnoies, mais curieuses pour les monumens dont elles étoient les dépositaires, jusqu'à ce que Jules César s'étant rendu maître absolu de la république sous le nom de dictateur perpétuel, on lui donna toutes les marques de grandeur & de pouvoir, & entre autres le privilege de marquer la monnoie de sa tête & de son nom, & de tel revers que bon lui sembleroit. Ainsi les médailles furent dans la suite chargées de tout ce que l'ambition d'une part & la flatterie de l'autre furent capables d'inventer, pour immortaliser les princes bons & méchans. C'est ce qui les rend aujourd'hui précieuses, parce que l'on y trouve mille évenemens dont l'histoire souvent n'a point conservé la mémoire, & qu'elle est obligée d'emprunter de ces témoins, auxquels elle rend témoignage à son tour sur les faits que l'on ne peut démêler que par les lumieres qu'elle fournit. Ainsi nous n'aurions jamais su que le fils qu'Antonin avoit eu de Faustine eût été nommé Marcus Annius Galerius Antoninus, si nous n'avions une médaille greque de cette princesse ??? ?????????, & au revers la tête d'un enfant de dix à douze ans. ?. ?????? ???????? ????????? ???????????? ????????? ????. Qui sauroit qu'il y a eu un tyran nommé Pacatianus, sans la belle médaille d'argent du cabinet du P. Chamillard, qui est peut-être le seul Pacatianus ? Qui sauroit que Barbia a été femme d'Alexandre Sévere, & Etruscille femme de Décius, & non pas de Volusien, & cent autres choses semblables, dont on est redevable à la curiosité des antiquaires ?
Pour faire connoître aux curieux qui commencent à goûter les médailles, la beauté & le prix de ces revers, il faut savoir qu'il y en a de plusieurs sortes. Les uns sont chargés de figures ou de personnages ; les autres de monumens publics ou de simples inscriptions ; je parle du champ de la médaille, pour ne pas confondre ces inscriptions avec celles qui sont autour, que nous distinguerons par le nom de légende. Voyez Légende & Inscription.
Les noms des monnétaires, dont nous avons un fort grand nombre, se trouvent sur plusieurs médailles ; on peut y joindre tous les duumvirs des colonies. Les autres magistratures se rencontrent plus souvent dans les consulaires que dans les impériales.
Quelquefois il n'y a que le nom des villes ou des peuples, Segobriga, Cæsar-Augusta, Obuleo, ?????? ???????, &c.
Quelquefois le seul nom de l'empereur, comme Constantinus Aug. Constantinus Cæsar, Constantinus Nob. Cæsar, &c. ou même le seul mot Augustus.
Quant aux revers chargés de figures ou de personnages, le nombre, l'action, le sujet les rendent plus ou moins précieux ; car pour les médailles dont le revers ne porte qu'une seule figure qui représente ou quelque vertu, par laquelle la personne s'est rendue recommandable, ou quelque déité qu'elle a plus particulierement honorée : si d'ailleurs la tête n'est pas rare, elles doivent être mises au nombre des médailles communes, parce qu'elles n'ont rien d'historique qui mérite d'être recherché.
Il faut bien distinguer ici la simple figure dont nous parlons, d'avec les têtes ou des enfans, ou des femmes, ou des collegues de l'empire, ou des rois alliés : c'est une regle générale chez tous les connoisseurs que les médailles à deux têtes sont presque toujours rares, comme Auguste au revers de Jules, Vespasien au revers de Tite, Antonin au revers de Faustine, M. Aurele au revers de Verus, &c. d'où il est aisé d'inférer que quand il y a plus de deux têtes, la médaille en est encore plus rare. Tel est Sévere au revers de ces deux fils Jéta & Caracalla, Philippe au revers de son fils & de sa femme, Adrien au revers de Trajan, de Plautine. Le P. Jobert ajoute la médaille de Néron au revers d'Octavie ; mais cette médaille ne doit pas être mise au nombre des plus rares ; c'est uniquement la tête de cette princesse qui rend la médaille curieuse.
Les médailles qui ont la même tête & la même légende des deux côtés, ne sont pas aussi de la premiere rareté. M. Vaillant en rapporte une d'argent d'Otacille. Elles sont plus communes en moyen-bronze, sur-tout dans Trajan & dans Adrien.
Il est donc vrai généralement que plus les revers ont des figures, & plus ils sont à estimer, particulierement quand ils marquent quelque action mémorable. Par exemple, la médaille de Trajan, Regna Adsignata, où il paroît trois rois au pié d'un théatre, sur lequel on voit l'empereur qui leur donne le diadème. Le congiaire de Nerva à cinq figures, Congiar. P. R. S. C. une allocution de Trajan, où il y a sept figures ; une d'Adrien au peuple, où il y en a huit sans légende ; une autre aux soldats, où il y en a dix ; un médaille de Faustine, Puellæ Faustinianæ, qui se trouve en or & en argent, mais qui est également rare en ces deux métaux. Dans la médaille d'argent, il y a seulement six figures ; & dans celle d'or, il y en a douze ou treize.
Les monumens publics donnent assurément au revers des médailles une beauté particuliere, sur-tout quand ils marquent quelques événemens historiques. Telle est la médaille de Néron, qui présente le temple de Janus fermé, & pour légende, Pace P. R. Terrâ Marique Partâ, Janum clusit. Telle est encore une médaille très-rare, citée par M. Vaillant, dans laquelle, avec la légende Pace P. R. &c. on trouve au lieu du temple de Janus Rome assise sur un tas de dépouilles des ennemis, tenant une couronne de la main droite, & le parazonium de la gauche. Mettons au nombre de ces beaux monumens l'amphithéatre de Tite, la colonne navale, le temple qui fut bâti, Romæ & Augusto, les trophées de M. Aurele & de Commode, qui sont les premiers connus par les curieux.
Les animaux différens qui se rencontrent sur les revers en augmentent aussi le mérite, sur-tout quand ce sont des animaux extraordinaires. Tels sont ceux que l'on faisoit venir à Rome des pays étrangers pour le divertissement du peuple dans les jeux publics, & particulierement aux jeux séculaires, ou ceux qui représentent les enseignes des légions qu'on distinguoit par des animaux différens. Ainsi voyons-nous les légions de Gallien, les unes avec un porc-épic, les autres avec un ibis, avec le pégase, &c. & dans les médailles de Philippe, d'Otacille, de leur fils, Sæculares Augg. les revers portent la figure des animaux qu'ils firent paroître aux jeux séculaires, dont la célébration tomba sous le regne de Philippe, & dans lesquels ce prince voulut étaler toute sa magnificence, afin de regagner l'esprit du peuple que la mort de Gordien avoit extrèmement aigri. Jamais l'on n'en vit de tant de sortes : un rhinocéros, trente-deux éléphans, dix tigres, dix élans, soixante lions apprivoisés, trente léopards, vingt hyenes, un hippopotame, quarante chevaux sauvages, vingt archoléons, & dix camélopardales. On voit la figure de quelques-uns sur les médailles du pere, de la mere & du fils, & entr autres de l'hippopotame & du strepsikéros envoyé d'Afrique.
Il est bon de savoir que quand les spectacles devoient durer plusieurs jours, on n'exposoit chaque jour aux yeux du public, qu'un certain nombre de ces animaux, pour rendre toujours la fête nouvelle ; & qu'on avoit soin de marquer sur les médailles la date du jour où ces animaux paroissoient. Cela sert à expliquer les chiffres I. II. III. IV. V. VI. qui se trouvent sur les médailles de Philippe, de sa femme & de son fils. Ils nous apprennent que tels animaux parurent le premier, le second, le troisieme ou le quatrieme jour.
On voit des éléphans bardés dans Tite, dans Antonin Pie, dans Sévere, & dans quelques autres empereurs, qui en avoient fait venir pour embellir les spectacles qu'ils donnoient au peuple. Au reste tout ce qu'on peut dire sur les éléphans représentés au revers des médailles, se trouve réuni dans l'ouvrage posthume du célebre M. Cuper, intitulé Gisberti Cuperi? de elephantis in nummis obviis exercitationes duæ, & publié dans le troisieme volume des antiquités romaines de Sallengre. Hag. Com. 1719.
On rencontre aussi quelques autres animaux plus rares, témoin le phénix dans les médailles de Constantin & de ses enfans, à l'exemple des princes & des princesses du haut empire, pour marquer par cet oiseau immortel, ou l'éternité de l'empire, ou l'éternité du bonheur des princes mis au nombre des dieux immortels. Mademoiselle Patin a donné sur ce sujet une belle dissertation latine, qui fait honneur au pere & à la fille. Il y a dans le cabinet du roi de France une médaille greque apportée d'Egypte, où l'on voit d'un côté la tête d'Antonin Pie, & au revers un phénix avec la légende ????, Æternitas, pour apprendre que la mémoire d'un si bon prince ne mourroit jamais.
Mais parmi les médailles qui ont des oiseaux à leurs revers, il n'y en a guere de plus curieuses que celles en petit bronze du même Antonin & d'Adrien. La médaille d'Adrien représente un aigle, un paon, & un hibou sur la même ligne, avec la simple légende Cos. III. pour Adrien, & Cos. IV. pour Antonin Pie. Ces médailles s'expliquent aisément par le moyen d'un médaillon assez commun d'Antonin Pie, dont le revers représente Jupiter, Junon & Minerve. C'est à ces trois divinités que se rapporte le type des trois oiseaux, dont l'aigle étoit consacré à Jupiter, le paon à Junon, & le hibou à Minerve.
On trouve encore sur les médailles d'autres oiseaux & d'autres animaux, soit poissons, soit monstres fabuleux, & même certaines plantes extraordinaires, qui ne se rencontrent que dans des pays particuliers, comme on peut l'apprendre en détail de l'illustre Spanheim, dans sa troisieme dissertation de præstantiâ & usu numismatum.
Nous devons observer aussi que souvent l'empereur ou l'impératrice, dont la médaille porte la tête en grand volume, se voit encore placé sur le revers, ou debout ou assis, sous la figure d'une déité ou d'un génie, & sa figure est quelquefois gravée avec tant d'art & de délicatesse, que quoique le volume en soit très-petit & très-fin, on y reconnoît néanmoins parfaitement le même visage, qui est en relief de l'autre côté. Ainsi paroît Néron dans sa médaille Decursia. Ainsi l'on voit Adrien, M. Aurele, Sévere, Dece, &c. avec les attributs de certaines déités, sous la forme desquelles on aimoit à les représenter pour honorer leurs vertus civiles ou militaires.
Considérons à présent la maniere dont on peut ranger les différens revers des médailles, pour rendre les cabinets plus utiles ; cet arrangement se peut faire de deux façons ; l'une sans donner au revers d'autre liaison que d'appartenir à un même empereur ; l'autre en les liant par une suite historique, selon l'ordre des tems & des années, que nous marquent les consulats & les différentes puissances de tribun. Rien ne seroit plus instructif que cette liaison, cet ordre chronologique par les consulats & par les années différentes des puissances tribuniciennes ; rien de plus naturel & de plus commode en même tems, que de ranger les médailles suivant ce plan. C'est-là sans doute ce qui a déterminé Occo & Mezzabarba à le suivre. Mais malheureusement le plus grand nombre des médailles n'a aucune de ces marques chronologiques ; & il y en a assez peu dont les rapports a des événemens connus, puissent nous servir à fixer l'époque de l'année où elles ont été frappées. Aussi l'arrangement que les deux antiquaires dont je viens de parler ont donné aux médailles impériales, est-il souvent purement arbitraire. Outre cela, comme dans le bas empire on trouve très-rarement les consulats & les puissances tribunitiennes des empereurs, marqués sur leurs médailles ; qu'on n'y lit même jamais ces sortes d'époques après Constantin le jeune, il est absolument impraticable d'arranger chronologiquement une suite impériale complette.
Il y a un autre ordre plus savant qu'a suivi Oiselius : sans s'arrêter à ranger à part ce qui regarde chaque empereur, il n'a songé qu'à réunir chaque revers à certaines especes de curiosité, & par ce moyen on apprend avec méthode, tout ce qui se peut tirer de la science des médailles. Voici la maniere dont il a exécuté son plan, qu'il a peut-être emprunté de Golztius, & qui paroît venir originairement des dialogues du savant archevêque de Tarragone, Antonio Augustino.
D'abord il s'est contenté de placer une suite de têtes impériales, la plus complette qu'il a pû ; ensuite il a rassemblé tous les revers qui portoient quelque chose de géographique, c'est-à-dire qui marquoient ou des peuples, ou des provinces, ou des villes, ou des fleuves, ou des montagnes. De ces revers il en a fait huit planches ; soit qu'il ait voulu simplement fournir un modele aux curieux, soit qu'en effet il ne connût que les médailles dont il nous donne la description, & sur lesquelles il dit tout ce qu'il sait.
Il a mis ensuite ce qui regarde les déités des deux sexes, y joignant les vertus, qui sont comme des divinités du second ordre. Telles sont la Constance, la Clémence, la Modération ; ce qui compose une suite assez nombreuse.
On trouve après cela en quatre planches tous les monumens de la paix, les jeux, les théatres, les cirques, les libéralités, les congiaires, les magistrats, les adoptions, les mariages, les arrivées dans les provinces ou dans les villes, &c.
Dans les planches suivantes on voit tout ce qui concerne la guerre, les légions, les armées. les victoires, les trophées, les allocutions, les camps, les armes, enseignes, &c.
Dans une seule planche est réuni tout ce qui appartient à la religion ; les temples, les autels, les sacerdoces, les sacrifices, les instrumens, les ornemens des augures & des pontifes. Il auroit pû fort bien y rapporter les apothéoses ou les consécrations qu'il a mises à part, & qui sont marquées par des aigles, par des paons, par des autels, par des temples, par des buchers, par des chars tirés à deux ou à quatre éléphans, ou à deux mules ou à quatre chevaux.
Enfin il rassemble tous les monumens publics & les édifices qui servent à immortaliser la mémoire des princes ; comme les arcs-de-triomphe, les colonnes, les statues équestres, les ports, les grands chemins, les ponts, les palais.
Mais le R. P. dom Anselme Banduri s'est déterminé à ne donner aux médailles de son grand recueil d'autre arrangement que l'ordre alphabétique des légendes des revers. Cependant-comme dans le haut empire, les consulats, les puissances tribunitiennes, & le renouvellement du titre d'imperator se rencontrent plus fréquemment ; les personnes qui ont des cabinets nombreux pourroient d'abord commencer par ranger suivant l'ordre des années, les médailles de chaque empereur, qui portent ces caracteres chronologiques, & y joindre même les autres médailles dont on peut déterminer la date par celle des événemens auxquels elles font allusion ; & quant aux médailles qui n'ont aucune marque par où l'on puisse surement juger du tems où elles ont été frappées, on les mettroit à la suite des autres, en suivant comme a fait le P. Banduri, l'ordre alphabétique des revers.
Les curieux peut opter entre la méthode d'Oisélius & celle du P. Banduri ; elles n'ont l'une & l'autre qu'un seul desagrément, c'est qu'il faut méler ensemble les têtes, les métaux & les grandeurs ; mais on ne peut pas réunir tous les avantages.
Les revers se trouvent donc souvent chargés des époques des tems ; ils le sont aussi des marques de l'autorité du sénat, du peuple & du prince, du nom des villes où les monnoies ont été frappées, des marques différentes des monétaires ; enfin de celles de la valeur de la monnoie.
Comme les époques marquées sur les médailles servent beaucoup à éclaircir l'histoire par la chronologie, nous en avons fait un article à part. Voyez Médailles, (époques marquées sur les).
Les marques de l'autorité publique sur les revers des médailles quand elles ne sont point en légende ou en inscription, sont ordinairement ou S. C. ou ?. E. par abreviation ; d'autres fois on iit tout au long Populi jussu : Permissu D. Augusti : Indulgentiâ Augusti ; ou semblables mots.
Quant au nom des villes où les médailles ont été frappées, rien n'est plus ordinaire que de le trouver dans le haut & dans le bas empire, avec cette différence que dans le haut empire, il est souvent en légende ou en inscription ; & dans le bas empire, principalement depuis Constantin, il se trouve toujours dans l'exergue. Ainsi le P. T. Percussa Treveris ; S. M. A. Signata Moneta Antiochiæ. Con. Constantinopoli, &c. au lieu que dans le haut empire, les noms s'y trouvent tout au long ; Lugduni dans celle de M. Antoine, ????????? dans les greques & dans toutes les colonies.
Les revers sont chargés des marques différentes & particulieres des monétaires, qu'ils mettoient de leur chef pour distinguer leur fabrique, & le lieu même où ils travailloient. C'est par-là qu'on explique une infinité de caracteres, ou de petites figures qui se rencontrent, non-seulement dans le bas empire, depuis Gallus & Volusien, mais aussi dans les consulaires.
Il nous reste à dire un mot de certaines marques, qui évidemment n'ont rapport qu'à la valeur des monnoies, & qu'on ne trouve que dans les consulaires, encore ne les y voit-on pas toujours. Ces marques sont X. V. Q. S. L. L. S. l'X signifie Denarius, qui valoit Denos Aeris, dix as de cuivre ; l'V marquoit le Quinaire, cinq as ; le L. L. S. un sesterce, ou deux as & demi ; le Q est encore la marque du Quinaire.
Aucune de ces marques ne se trouve sur le bronze, si ce n'est l'S qui se trouve dans quelques consulaires. Il est plus ordinaire d'y voir un certain nombre de points, qui se mettoit des deux côtés. Voyez Points, (Art numismatique).
Finissons par observer qu'on a certaines médailles dont il est évident que le revers ne convient point à la tête. La plûpart de ces sortes de médailles ont été frappées vers le tems de Gallus & de Volusien, & sur-tout pendant le regne de Gallien, lorsque l'empire étoit partagé entre une infinité de tyrans. Quel que soit ce défaut, on ne doit pas rebuter ces sortes de médailles ; car tout alors étoit dans une si grande confusion, que sans se donner la peine de fabriquer de nouveaux coins, aussi-tôt qu'on apprenoit qu'on avoit changé de maître, on battoit une nouvelle tête sur d'anciens revers : c'est sans doute par cette raison que l'on trouve au revers d'un Æmilien, Concordia Augg. revers qui avoit servi à Hostilien, à Gallus, ou à Volusien : si cependant ce n'est point un des Philippes transformés en Emilien.
Mais d'un autre côté nous ne devons faire aucun cas des médailles dont les revers ont été contrefaits, insérés ou appliqués. C'est une fourberie moderne imaginée pour tromper les curieux. Nous en avons parlé au mot Médaille, & nous avons indiqué en même tems les moyens de découvrir cette friponnerie.
Pour ce qui regarde les divers symboles qu'on voit sur les revers des médailles antiques, on en trouvera l'énumération & l'explication au mot Symbole, Art numismatique. (Le Chevalier de Jaucourt.)
Revers, voir un ouvrage de revers ; c'est dans la Fortification, découvrir le dos de ceux qui le défendent, & qui font face au parapet. Voyez Commandement.
Revers de l'orillon, c'est la partie de l'orillon vers la courtine, qui lui est à-peu-près parallele. Voyez Orillon. (Q)
Revers de la tranchée, c'est dans l'attaque des places, le côté opposé à son parapet. Voyez Tranchée. (Q)
Revers, (Marine.) on caractérise par ce terme, tous les membres qui se jettent en-dehors du vaisseau, comme certaines alonges & certains genoux. Voyez Alonges de revers & Genoux de revers.
On appelle aussi man?uvres de revers les écoutes, les boulines & les bras qui sont sous le vent, qu'on a larguées, & qui ne sont plus d'usage jusqu'à ce que le vaisseau revire de bord. On s'en sert alors à la place des autres, qui en cessant d'être du côté du vent, deviennent man?uvres de revers.
Revers d'arcasse est une portion de voûte de bois faite à la poupe d'un vaisseau, soit pour soutenir un balcon, soit pour un simple ornement, ou pour gagner de l'espace. Voyez Pl. I. fig. 1. le revers d'arcasse ou voûte marquée D.
Revers de l'éperon ; c'est la partie de l'éperon comprise depuis le dos du cabestan, jusqu'au bout de la cagonille.
Revers de pavé, (Pavement.) c'est l'un des côtés en pente du pavé d'une rue, depuis le ruisseau jusqu'au pié du mur.
Wiktionnaire
Nom commun - français
revers \??.v??\ masculin, singulier et pluriel identiques
-
Côté d'une chose opposé au côté principal, à celui que l'on regarde ou qui se présente d'abord.
- Sur une glace, ils tracent des traits au diamant, collodionnent la face ainsi gravée et, après sensibilisation, exposent à la lumière par le revers de la plaque. ? (Bulletin de la Société française de photographie, Paris, 1872, vol.18-21, page 17)
- Cette ville, située à une altitude de mille toises sur le revers oriental des Rocheuses, au bord d'un torrent tributaire du Missouri, forme un vaste entrepôt pour les produits miniers de la région, et compte de quatorze à quinze mille habitants. ? (Jules Verne, Le Testament d'un excentrique, 1899, livre 2, chapitre 12)
- Tout ce qui est sur le revers de la colline est de peu d'attrait dans un récit. ? (René Boylesve, La leçon d'amour dans un parc, Calmann-Lévy, 1920, réédition Le Livre de Poche, page 125)
- Le revers de la main : Le dos de la main, le côté opposé à la paume.
- Un coup de revers ou simplement coup d'arrière-main,
-
Coup donné avec le dos de la main, ou avec une arme ou un instrument quelconque, de la gauche vers la droite dans le cas d'un droitier, de droite à gauche dans celui d'un gaucher.
- Et sans autre préambule, avant qu'elle s'y attendît, il la gifla si largement qu'il l'envoya culbuter contre le lit d'un seul revers de main. ? (Louis Pergaud, Joséphine est enceinte, dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921)
- (Tennis) Revers à deux mains.
- Ce joueur de paume, ce joueur de tennis excelle dans les coups de revers, il fait très bien les revers.
- Frapper de revers, frapper de gauche à droite avec une arme, un bâton, une raquette, etc., que l'on tient de la main droite.
-
(Figuré) Disgrâce ; échec ; accident qui change une bonne situation en une mauvaise.
- L'UE a toutefois fait savoir qu'elle instaurerait automatiquement des droits de douane sur les produits de la pêche si Londres fermait l'accès à ses eaux ? ce qui est un revers de taille pour les pêcheurs d'outre-Manche. ? (Mathilde Damgé, Maxime Vaudano et Jérémie Baruch, Brexit : ce que voulaient les partisans du « Leave », ce qu'ils obtiennent, Le Monde. Mis en ligne le 16 novembre 2018)
- Il s'est laissé abattre par le premier revers.
- Il a eu tour à tour des succès et des revers.
- Partie d'un vêtement qui est ou semble repliée en dessus, de manière à montrer une partie de l'envers ou de la doublure du vêtement.
- Il se leva tout à fait, passa la main entre l'échancrure de son gilet et le plastron de sa chemise qui godait, tira les revers de son habit, et s'assura que le n?ud de sa cravate n'avait pas été dérangé. ? (Octave Mirbeau, Le colporteur,)
- Une véritable épidémie de petits drapeaux et d'insignes pour boutonnières s'abattit sur les torrents de jeunesse laborieuse et pressée [?]. Il était dangereux de ne pas avoir d'insignes patriotiques au revers de l'habit. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 213 de l'édition de 1921)
- Il secoua la tête, jeta un soupir puis essuya son front avec le revers de sa manche de chemise : [?]. ? (Franz-Olivier Giesbert, L'immortel : 22 balles pour un seul homme, Éditions Flammarion, 2011, chapitre 44)
-
(Spécialement) Haut de la tige d'une botte, lorsqu'il paraît se rabattre et montrer le côté du cuir qui n'est pas noirci.
- Bottes à revers.
- Romero seul avait gardé son teint de revers de botte, et ses jambes de bronze, quoique nues, n'avaient pas éprouvé la plus petite altération. ? (Théophile Gautier, Voyage en Espagne, Charpentier, 1859)
-
(Numismatique) Côté opposé à la face ou avers, portant une inscription, un sujet, etc., en parlant de monnaies ou de médailles
- Cette médaille a sur l'avers la tête d'Auguste, et sur le revers une victoire.
- Le monnayage attribué aux Aulerques Diablintes appartient stylistiquement à un ensemble armoricain, notamment par la présence au revers d'un cheval androcéphale. ? (Jacques Naveau, Recherches sur Jublains et sur la cité des Diablintes, Documents archéologiques de l'Ouest, Conseil général de la Mayenne, 1997, page 31)
-
(Vexillologie) Nom donné au côté d'un drapeau opposé à l'avers quand celui-ci est différent.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
Trésor de la Langue Française informatisé
REVERS, subst. masc.
Revers au Scrabble
Le mot revers vaut 9 points au Scrabble.
Informations sur le mot revers - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot revers au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
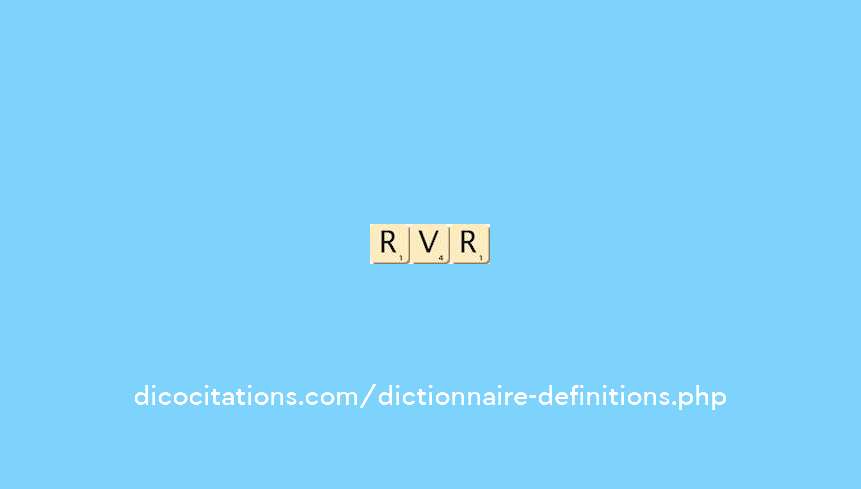
Les mots proches de Revers
Revalidation Revalider Revaloir Revanche Revancher Revancheur Rêvasser Rêvasserie Rêvasseur Rêve Rêve Rêvé, ée Revêche Rêve-creux Réveil Réveillable Réveille-matin Réveillement Réveiller Réveilleur Réveillon Révélateur, trice Révélation Révélé, ée Revenant, ante Revenant Revenant-bon Revendage Revendanger Revendeur, euse Revendication Revendiquer Revendre Revenir Revenir Revente Revenu, ue Revenu Revenue Rêver Réverbérant, ante Réverbération Réverbère Réverbérer Reverdi, ie Reverdie Reverdir Reverdissement Révéré, ée Révéremment rêva rêvai rêvaient rêvais rêvait revalidation revalider revaloir revalorisait revalorisation revalorisé revalorisent revaloriser revancha revanchaient revanchard revanchard revancharde revancharde revanchardes revanchards revanche revanchent revancher revanches rêvant rêvassa rêvassai rêvassaient rêvassais rêvassait rêvassant rêvassant rêvasse rêvassé rêvassent rêvasser rêvasserie rêvasseries rêvât revaudra revaudrai revaudraient revaudrais revaudrait revaudras rêve rêve rêvé rêvéMots du jour
-
sweater supprima mielleuse administraient plaquera épouvantait ischémie grelots détaché bourgeoisisme
Les citations avec le mot Revers
- Il faisait très orphelin dans son complet de flanelle dont le revers était barré d'un crêpe noir.Auteur : Simone de Beauvoir - Source : Les Mandarins (1954)
- L'on ne ressent jamais plus douloureusement l'irréversibilité du temps que dans le remords. L'irréparable n'est que l'interprétation morale de cette irréversibilité.Auteur : Emil Cioran - Source : Le crépuscule des pensées (1940)
- L'homme qui reste calme dans les revers, prouve qu'il sait combien les maux possibles dans la vie sont immenses et multiples, et qu'il ne considère le malheur qui survient en ce moment que comme une petite partie de ce qui pourrait arriver.Auteur : Arthur Schopenhauer - Source : Aphorismes sur la sagesse dans la vie (1851)
- Comment peut-on se donner la mort pour une promotion ajournée ? Comment peut-on se croire indigne de survivre à l'échec lorsque l'échec n'est qu'un incident de parcours censé nous aguerrir ? Comment peut-on oser se situer en deçà de ses ambitions et penser, une seule seconde, qu'il existe un objectif plus fort que l'amour, plus important que sa propre vie ? Que de questions biaisées qui s'évertuent à nous dévier de la seule réponse qui nous importe : nous-mêmes. Depuis les temps reculés, l'Homme court après son ombre et cherche ailleurs ce qui est à portée de sa main, persuadé qu'aucune rédemption n'est possible sans martyre, que le revers est un déni de soi, alors que sa vocation première réside dans sa faculté de rebondir... Ah ! l'Homme, ce prodige réfractaire à ses chances et fasciné par l'échafaud de ses vanités, sans cesse écartelé entre ce qu'il croit être et ce qu'il voudrait être, oubliant que la plus saine façon d'exister est de demeurer soi-même, tout simplement.Auteur : Mohammed Moulessehoul, dit Yasmina Khadra - Source : L'Equation africaine (2011)
- Le passé était irréversible.A ucun pardon ne pourrait défaire ce qui avait été. Auteur : Lola Lafon - Source : Chavirer (2020)
- Ne nous étonnons pas des félicités du méchant et des revers du juste: la vie est un livre, les errata sont après la fin.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- Notre durée est irréversible. Nous ne saurions en revivre une parcelle, car il faudrait commencer par effacer le souvenir de tout ce qui a suivi.Auteur : Henri Bergson - Source : L'Evolution créatrice (1907)
- La propriété foncière et immobilière: à l'abri de tout sauf des glissements de terrain, des catastrophes naturelles, des erreurs de cadastre, des revers de fortune et des révolutions. C'est-à-dire terriblement aléatoire.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Il faut croire que c'est humain, de vouloir être inscrit au Livre des Records, ou de se faire épingler une médaille au revers, et même si c'est marqué dessus Roi des Glands.Auteur : Marie-Sabine Roger - Source : Vivement l'avenir (2010)
- Derrière la vitre brisée de l'adolescence, il y a les murs, les gardes et l'irréversible solitude de la haine.Auteur : Alice Parizeau - Source : L'envers de l'enfance (1976)
- Peu satisfait du train que prennent tes affaires,
Considère l'état où sont celles d'autrui;
S'il a des revers moins contraires,
Si tu dois l'estimer plus malheureux que lui.Auteur : Denys Caton - Source : Distiques de Caton, Livre quatrième, XXXII - Si comme la verité, le mensonge n'avoit qu'un visage, nous serions en meilleurs termes. Car nous prendrions pour certain l'opposé de ce que diroit le menteur. Mais le revers de la verité a cent mille figures et un champ indefiny.Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais, I, 9
- Les faits historiques se succèdent, qui non seulement se contredisent, mais s'annulent. Rien n'est « irréversible » (comme on dit maintenant), au contraire, tout se renverse, et nous avons des milliers de preuves : un excès de science conduit à l'ignorance crasse, et c'est la curiosité de l'ignorance qui récrée la science ; des sociétés marxistes ont existé dix mille ans avant Marx, pour se transformer en régimes aristocratiques, suivant un processus révolutionnaire inverse à celui qui a l'air de vouloir occuper aujourd'hui notre besoin de mouvement ; des empires sont devenus des républiques, et vice versa ; des royaumes se sont anarchiquement balkanisés, pendant que des nomades se coagulaient en empire, pour devenir ensuite socialistes, après être passés par tous les stades et avant de repasser par tous les stades. Rien ne dure. l'histoire n'est que le catalogue des inconstances de fortune. Rien ne durera de ce que nous fabriquons aujourd'hui. L'extrême pointe de l'avenir nous pique les fesses et nous croyons que c'est le passé. Auteur : Jean Giono - Source : Les Trois Arbres de Palzem, 1984
- La médaille avait son revers : rien n'était jamais totalement gratuit. Autrement dit, il n'est rien de plus cher que la gratuité. Auteur : Emmanuelle Richard - Source : Désintégration (2019)
- Tant que sa faveur vous seconde, - Vous êtes les maîtres du monde. - Votre gloire nous éblouit; - Mais, au moindre revers funeste, - Le masque tombe, l'homme reste, - Et le héros s'évanouit.Auteur : Jean-Baptiste Rousseau - Source : Odes
- Mon père détestait les signes de faiblesse, à commencer par la maladie, pour laquelle il affichait une sorte de mépris, comme si le fait d’être souffrant était une défaillance éthique plutôt que physique. Quand il nous arrivait de devoir rester à la maison parce que nous étions malades, il passait la tête par la porte de notre chambre avant de partir travailler et soupirait d’un air las et excédé, comme si cette grippe ou cette varicelle signifiait le début de quelque irréversible décadence morale. Auteur : Daniel Mendelsohn - Source : Une Odyssée : Un père, un fils, une épopée (2019)
- Qui a frôlé l'irréversible, découvre dans le futile merveilles.Auteur : Paul Carvel - Source : Jets d'encre, 34
- Cette femme était vêtue de linon rose à revers jonquille, avec bas de soie champagne brut, ombrelle bleue et blanche.Auteur : Jean Giraudoux - Source : Aventures de Jérôme Bardini (1930)
- Souvent les revers ôtent le courage, plus souvent la prudence s'éclipse dans les succès.Auteur : Stanislas Leszczynski - Source : Pensées diverses in Oeuvres choisies de Stanislas I, Roi de Pologne
- Quelque innocents que nous soyons de nos maux ou de nos revers, ils ont toujours une face où l'égoïsme s'accroche comme à une raison de ne pas s'y intéresser.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- L'ennui habituel est le plus grand des maux ; on peut, avec du courage, se mettre au-dessus des plus grands revers; mais on ne se met point au-dessus de l'ennui.Auteur : Marie-Geneviève-Charlotte Darlus, Thiroux d' Arconville - Source : Pensées et réflexions morales sur divers sujets (1760)
- La ruine est une chose. Le vide infect installé désormais au revers de ces murs une autre chose.Auteur : Antoine Choplin - Source : La Nuit tombée (2012)
- Nérine: - Votre pays vous hait, votre époux est sans foi: - Dans un si grand revers que vous reste-t-il? - - Médée: - Moi, - Moi, dis-je, et c'est assez.Auteur : Pierre Corneille - Source : Médée (1635), I, 5
- Il existe peu de sentiments plus douloureux que de voir ses parents vieillir. Constater que cette force, jadis incarnée par ces figures que l’on pensait immortelles, vient d’être remplacée par une fragilité irréversible. Auteur : Victoria Mas - Source : Le bal des folles (2019)
- Le temps historique est une succession irréversible d'événements imprévisibles et presque toujours catastrophiques dont le plus ordinaire est la guerre, mal absolu.Auteur : Michel Tournier - Source : Le miroir des idées
Les citations du Littré sur Revers
- Créons des charges, des offices, Billets d'État, écus factices, Empruntons à tout l'univers, Replâtrant par des injustices Nos sottises et nos reversAuteur : Voltaire - Source : Lett. en vers et en prose, 123
- Luy qui estoit advisé, tascha de s'asseurer par le revers de ce qui l'avoit cuidé ruinerAuteur : AMYOT - Source : Eum. 3
- Ayant observé des endroits d'où l'on voit à revers une bonne partie de leurs dehorsAuteur : PELLISSON - Source : Lett. hist. t. I, p. 301
- Cette incitation est si mal concluante, que je la treuve plus forte au reversAuteur : MONT. - Source : III, 133
- Pourquoi sortirait-il d'une situation brillante, quoique non assurée, pour se jeter dans une situation si critique où le moindre échec pouvait tout perdre, où tout revers serait décisif ?Auteur : SÉGUR - Source : Hist. de Napol. II, 4
- Je vous crois fort au-dessus des revers que vous avez essuyés ; toutes les âmes nobles sont fermesAuteur : Voltaire - Source : Lett. de la Borde, 16 avr. 1770
- Elle [Claude de France] donna un terrible revers à l'esperance du poure comte de Sault, et la renversa du toutAuteur : CARL. - Source : VI, 37
- On sait que le caractère essentiel de tout organe de transformation de chaleur en mouvement est d'être réversibleAuteur : W. DE FONVIELLE - Source : Acad. des sc. Comptes rend. t. LXXXII, p. 1251
- La ville était prise.... ce petit chevalier [de Longueville] monte sur le revers de la tranchée.... un soldat veut tirer une bécassine, et tire ce petit garçon ; il en est mort le lendemainAuteur : Madame de Sévigné - Source : 8 nov. 1688
- Par le traité d'Utrecht, le roi était également garant et du repos de l'Italie et de la réversion de la Sicile à la couronne d'EspagneAuteur : SAINT-SIMON - Source : 502, 87
- En ce disant, il donna trois coups d'un traict : il s'advance pour donner une taillade, soudain tire une estocade, puis un reversAuteur : MERLIN COCAÏE - Source : t. II, p. 232, dans LACURNE
- Un moment donne au sort des visages divers, Et dans ce grand bonheur je crains un grand reversAuteur : Corneille - Source : Cid, I, 1
- De tes grandeurs tu sus te faire absoudre, France, et ton nom triomphe des reversAuteur : BÉRANGER - Source : Enf. de la France.
- Le roi [Charles XII], qui n'avait point encore éprouvé de revers, ni même de retardement dans ses succès, croyait qu'une année lui suffirait pour détrôner le czarAuteur : Voltaire - Source : Charles XII, 3
- Le revers [l'opposé] de la verité a cent mille figuresAuteur : MONT. - Source : I, 37
- On a justement comparé le commun des traductions à un revers de tapisserie, qui tout au plus retient les linéaments grossiers des figures finies que le beau côté représenteAuteur : ROLLIN - Source : Traité des Ét. I, 1
- À ton revers j'admire une reprise, C'est encore un doux souvenirAuteur : BÉRANG. - Source : Mon habit.
- Du côté de la fortune, le revers que vous éprouvez est accablantAuteur : MARMONT. - Source : Contes mor. École des Pères.
- Plus lui fist de derision Sa femme crueuse et perverse, Et plus son couraige reverse, Que chose qu'il eust à souffrirAuteur : E. DESCH. - Source : Poésies mss. f° 532
- Il [le duc d'Orléans] acheva de découvrir sur les lieux à revers tout ce qu'il avait déjà aperçu en éloignementAuteur : SAINT-SIMON - Source : 162, 132
- Tout ce qui vient au revers du cours de natureAuteur : MONT. - Source : IV, 287
- Il enregistre à son retour Nuit par nuit, jour par jour, semaine par semaine, Les revers de l'hymen, les exploits de l'amourAuteur : DELILLE - Source : Convers. VI
- Au sortir du berceau, j'ai connu les reversAuteur : Voltaire - Source : Tancr. I, 4
- Il [Dieu] étale à son tour des revers équitables, Par qui les grands sont confondusAuteur : IT. - Source : ib.
- Mon fils me mande qu'il s'en va jouer au reversi avec son jeune maître [M. le Dauphin] ; deux, trois, quatre cents pistoles s'y perdent fort aisémentAuteur : Madame de Sévigné - Source : 437
Les mots débutant par Rev Les mots débutant par Re
Une suggestion ou précision pour la définition de Revers ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 01h12

- Racine - Racisme - Raillerie - Raison - Raisonnement - Rancune - Realisme - Realite - Rebelle - Reception - Recevoir - Recherche - Recolter - Recompense - Reconnaissance - Reconnaître - Record - Reddition - Reflechir - Regard - Regime - Regle - Regret - Reincarnation - Reine - Religion - Remède - Remords - Rencontre - Rengaine - Renoncement - Repartie - Repas - Repentir - Repos - Reproduction - Reputation - Resilience - Respect - Respecter - Responsabilite - Restaurant - Retraite - Retrospective - Réussite - Reussite - Reve - Rêve - Reveil - Revolte - Revolution - Riche - Richesse - Ridicule - Rire - Roman - Romantique - Rumination - Rupture - Rythme
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur revers
Poèmes revers
Proverbes revers
La définition du mot Revers est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Revers sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Revers présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
