La définition de Soupe du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Soupe
Nature : s. f.
Prononciation : sou-p'
Etymologie : Bourguig. sôpe ; wallon, sop ; provenç. espagn. et ital. sopa ; du germanique : allem. Suppe ; isl. sup ; suéd. soppa ; holl. sop, mots qui signifient bouillon, potage, ragoût. L'étymologie montre que le sens primitif de soupe est potage ; mais l'antonomase qui a donné à ce mot le sens de tranche de pain est très ancienne.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de soupe de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec soupe pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Soupe ?
La définition de Soupe
Sorte d'aliment fait de potage et de tranches de pain, ou même de pâtes, de riz, etc. et qui se sert avant tout autre mets. Une soupe au vermicelle. Une soupe à la semoule. Soupe grasse. Soupe maigre. Soupe aux herbes. Soupe à la purée. Soupe au lait.
Toutes les définitions de « soupe »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Potage, aliment liquide dans lequel trempe ordinairement du pain et qu'on sert au commencement du repas. Soupe grasse. Soupe maigre. Soupe à la tortue. Soupe aux herbes. Soupe à l'oignon. Soupe aux choux. Soupe au lait. Une bonne soupe. Faire mitonner la soupe. Servir la soupe. Une assiette de soupe. Tailler la soupe, Couper du pain par tranches pour les mettre dans le potage. Tremper la soupe, Verser le bouillon sur les tranches de pain, un moment avant de servir le potage. Fig. et fam., Trempé comme une soupe, Très mouillé. Fig. et fam., S'emporter comme une soupe au lait, Se mettre facilement, promptement en colère. Au moindre mot, il s'emporte comme une soupe au lait. C'est une soupe au lait. Un cheval soupe de lait, un pigeon soupe de lait ou de plumage soupe de lait, Un cheval qui est d'un blanc tirant sur l'isabelle, un pigeon de la même couleur. Fig. et fam., Cela vient comme des cheveux sur la soupe. Voyez CHEVEU. Prov., La soupe fait le soldat, On ne peut rien tirer d'un soldat qui est mal nourri.
Littré
-
1Sorte d'aliment fait de potage et de tranches de pain, ou même de pâtes, de riz, etc. et qui se sert avant tout autre mets. Une soupe au vermicelle. Une soupe à la semoule. Soupe grasse. Soupe maigre. Soupe aux herbes. Soupe à la purée. Soupe au lait.
Et lui qui pour la soupe avait l'esprit subtil
, Régnier, Sat. VIII.Ils s'ennuyaient particulièrement de ne point manger la soupe
, Pellisson, Lett. hist. t. III, p. 202.Quoi?! je mettrais, dit-il, un tel chanteur [un cygne] en soupe?!
La Fontaine, Fabl. III, 12.Une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon, cantonnée de pigeonneaux, et couronnée d'oignons blancs mariés avec la chicorée
, Molière, Bourg. gent. IV, 1.Je vis de bonne soupe et non de beau langage?; Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage
, Molière, Femmes sav. II, 7.L'Allemagne s'est illustrée par sa soupe à la bière, qui, soit dit entre nous, ne vaut pas le diable
, Scribe Et Mazères, Vatel, sc. 4.Dès qu'on a mangé la soupe, dès le matin, à cause de l'habitude, très répandue, de manger le matin de la soupe.
Pour les avertir que demain Leurs envoyés soient en chemin, Dès qu'ils auront mangé la soupe,
Courrier burlesque, p. 22.Dès la soupe, dès le commencement du repas.
Par dénigrement, marchand de soupe, maître de pension.
Soupe économique, sorte de soupe faite non avec de la viande, mais avec des os.
Il a poussé si loin l'ardeur philanthropique, Qu'il nourrit tous ses gens de soupe économique
, Étienne, les Deux gendres, I, 1.Soupe jacobine, voy. JACOBIN.
Fig. S'emporter comme une soupe au lait [le lait chauffé se gonfle et déborde], s'irriter facilement et promptement.
Ce mot-là fit élever le mari comme une soupe au lait
, Comte de Caylus, Hist. de M. Guill. ?uvr. t. x, p. 30, dans POUGENS.Fig. La soupe à l'oignon, se dit, dans l'argot des artistes, de tous ceux qui ont passé par l'École des beaux-arts et qui sont arrivés, de façon ou d'autre, par la filière administrative.
Soupe au lait, soupe de lait, se dit adjectivement des chevaux qui sont d'un blanc tirant sur l'isabelle, et des pigeons de la même couleur. Chevaux soupe de lait. Jument soupe au lait. Pigeons soupe de lait.
-
2 Par extension, dîner en général.
Allons, venez manger ma soupe, vous me donnerez à souper ce soir
, Marivaux, Pays. parv. 3e part.Bonjour, ma nièce?; venez-vous manger la soupe avec nous??
Genlis, Théât. d'éduc. la Lingère, I, 6.Venez manger ma soupe, locution blâmée par Mme de Genlis, Mém. t. v, p. 92, dans POUGENS, mais sans fondement.
Soupe des rentiers, s'est dit jadis pour un ordinaire peu succulent.
Mais surtout évitons la soupe des rentiers, Et tendons nos filets chez de gros financiers
, Colnet, l'Art de dîner en ville, I. -
3 Par antonomase, tranche de pain coupée mince, qu'on met dans la soupe. Mettez deux ou trois soupes dans ce bouillon. Une soupe de pain.
Tailler la soupe, couper du pain par tranches pour le mettre dans le potage.
Tremper la soupe, mettre les tranches de pain dans le potage quelque temps avant de le servir, afin qu'elles s'humectent.
Les bedeaux, distributeurs discrets de ces fragments consacrés [pain bénit offert par un riche personnage], auront de quoi tremper leurs soupes pendant huit jours, et pourront manger leurs potages au pain bénit
, Mercier, Tabl. de Par. ch. 133.Populairement et fig. Tremper une soupe, rosser. Je vais te tremper une soupe.
Trempé, mouillé comme une soupe, très mouillé.
-
4Soupe au vin, soupe au perroquet, soupe à perroquet, tranches de pain dans du vin.
Ivre comme une soupe, se dit d'un homme qui a beaucoup bu et s'est enivré.
Tantale est ivre comme une soupe
, Boileau, Héros de rom.Soupe en vin, sorte de couleur rouge.
Les draps et autres étoffes qu'ils teindront et feront teindre en grandes et hautes couleurs, comme écarlate, cramoisi, soupe en vin, et autres couleurs parfaites,
Règl. des manuf. 22 oct. 1697.On y compte quatre variétés, qui sont les gris de fer, les chamois, les soupes en vin et les gris doux
, Buffon, Ois. t. IV, p. 338. - 5Préparation alimentaire consistant en fourrages verts ou secs que l'on a fait infuser dans l'eau chaude (thé de foin), ou que l'on fait cuire. Les soupes se donnent à tous les animaux, mais principalement au bétail à l'engrais, aux élèves et aux femelles laitières?; on y fait entrer du foin, du regain, des racines et tubercules, des feuilles, des débris de jardin.
- 6Soupe crottée, ancien potage ou ragoût.
- 7Tabac frisé roulé dans une demi-feuille de choix.
PROVERBES
La soupe fait le soldat, une nourriture simple rend propre aux fatigues de la guerre. Elle me ferait de mauvaise soupe, et, comme dit l'autre, c'est la soupe qui nourrit le soldat
, Carmontelle, Proverbes, le Grand chemin, sc. 8.
Quelqu'un lui a mangé le dessus de sa soupe, se dit d'une personne qui est de mauvaise humeur.
Sa soupe est maigre, se dit d'un homme qui fait mauvaise chère.
REMARQUE
1. On dit soupe aux choux, soupe aux herbes, soupe au lait, etc. et non soupe de choux, d'herbes, de lait, etc.
2. De Caillières, en 1600, observe que soupe pour potage est un mot bourgeois.
HISTORIQUE
XIIIe s. Brouet de gelines et soupes en vin bien trempé
, Alebrand, f° 19. Et quant la messe fu faite, si fist li rois aporter pain et vin, et fist tailler des soupes et en manga une
, Chron. de Rains, 147. C'est une taverne planiere Dont Fortune la taverniere Trait aluine et piment en coupes Por faire à tout le monde soupes
, la Rose, 6848. Puisque vous m'avés faite coupe [faute], Je vous ferai d'autel pain soupe
, ib. 14420.
XIVe s. Souvent il mengeoit des naviaux? D'un harenc, d'une soupe à l'oile, Par deffaut de bonne viande
, Machaut, p. 104. Là ont nos bons François prins les meilleurs hostelz?; Prindrent la soupe en vin nos signeurs naturelz
, Guesclin. 20774. Il dit à Thomas qu'il n'estoit mie en sa puissance ne d'un tel fagoteur mengeur de soupes?
, Du Cange, sopa.
XVe s. Quand le jour fut tout venu? et que les chrestiens eurent bu un coup et mangé une soupe en vin grec, malvoisie ou grenache
, Froissart, III, IV, 15. Et il lui dist que son pere et ses freres vouloient lui donner ses soupes dorées, comme il est accoustumé faire ou païs en tel temps [carêmeprenant]
, Du Cange, sopa. On luy [à Jeanne d'Arc] avoit faict appareiller à souper bien et honorablement?; mais elle fist seulement mettre du vin dans une tasse d'argent, où elle mist la moitié d'eau et cinq ou six soupes dedans, qu'elle mangea, et ne print autre chose
, Viriville, Chron. de la Pucelle, ch. 44. Plusieurs qui ne se sont pas feins d'y faire leurs souppes [d'y faire des profits, leurs orges]
, Monstrelet, t. I, ch. 99, p. 161, dans LACURNE. Tu es plus yvre que une soupe
, Mir. de Ste Geneviève. Item aux freres mendiants, Aux devotes et aux béguines? De grasses soupes jacobines
, Villon, Testam.
XVIe s. L'evesque [de Genève] Jehan Louis, lequel, jà soit qu'il fust de la maison de Savoye, si ne vouloit il toutesfois que le duc ny ses aultres freres missent le museau dedans sa soupe
, Bonivard, Chron. de Genève, III, 1. Perrin se y opposoit [à ce que les étrangers fussent reçus bourgeois de Genève]? disant que les François chasseroient encore les anciens de la ville dehors, et, comme dist le commun proverbe, que la derniere soupe [tranche de pain] gecteroit la premiere hors de l'escuelle
, Bonivard, Anc. et nouv. polit. de Genève, p. 129. Beaulx jambons, et force souppes de prime [tranches de pain et de fromage trempées dans du bouillon, qu'on mangeait le matin dans les monastères]
, Rabelais, Garg. I, 21. Le plus entendu de touts [les Romains, festoyés par les empereurs] n'eust pas quité son escuelle de soupe, pour recouvrer la liberté de la republique de Platon
, La Boétie, Servit. volont. De la main à la bouche se perd souvent la soupe
, Leroux de Lincy, Prov. t. II, p. 217. Cervelles chaudes les unes avec les autres ne font jamais bonne soupe
, ib. Soupe dorée [pain dans des ?ufs battus et frits]
, Oudin, Dict.
Encyclopédie, 1re édition
SOUPE, s. f. (Cuisine.) est une espece de potage composé de pain & de bouillon, ou jus de viande, & autres matieres, que l'on sert ordinairement au commencement d'un repas.
Ce mot est françois, & formé de l'italien zuppa ou suppa, qui vient du latin sapa, qui signifie du vin réduit au tiers : d'autres le dérivent du mot celtique sauben, qui a la même signification.
En France, la soupe est regardée comme une partie essentielle d'un dîner. On en rehausse quelquefois le goût avec des oignons ou des choux, des navets, des porreaux, des coulis, &c.
Soupe de lait, (Manege.) ce terme de manege & de commerce de chevaux, se dit du poil qui tire sur le blanc. Trévoux. (D. J.)
Wiktionnaire
Nom commun - français
soupe \sup\ féminin
- (Désuet) Pain que l'on trempe dans le potage.
-
(Cuisine) Potage dans lequel on trempe du pain et qu'on sert au commencement du repas.
- Il trempait son pain dans sa soupe et il en mordait d'énormes bouchées, [?]. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 246 de l'édition de 1921)
-
On peut dire que ce fut le lendemain matin seulement, lorsque, au réveil, il se trouva seul chez lui, que le père Turpin s'aperçut que sa femme était morte.
Ce ne fut pas, comme on pourrait le croire, parce qu'il dut préparer sa soupe lui-même. Non. Il la mit au feu, elle bouillit, il la trempa : cela ne faisait pas un gros travail. ? (Charles-Louis Philippe, Dans la petite ville, 1910, réédition Plein Chant, page 80) - Le dîner se composait d'une soupe copieuse, d'un bon bouilli et d'une entrée suffisante pour huit personnes. ? (Gustave Fraipont, Les Vosges, 1923)
-
Le repas de midi se prenait dans une ancienne grange dont la fraîcheur paraissait délicieuse. On nous apporta de la soupe, et je tâchai de cacher ma surprise, mais Lucie, ma voisine, dut la deviner et me lança :
? C'est la coutume ici, même en plein été. Tu verras, ça aide à mieux supporter la chaleur. ? (Philippe Delerm, Quiproquo, nouvelle, supplément au magazine « Elle », 1999, page 28.)
-
(Par extension) Tout type de potage.
- [?] et les libations en l'honneur du brave Coignet furent multipliées pendant toute l'après-midi. Le soir, on mangea la soupe à la jacobine; puis on vagua toute la nuit dans les promenades d'Auxerre. ? (Anonyme, Notice, sur Les Cahiers de Capitaine Coignet, dans Les Veillées populaires, n° 2, le 23 novembre 1899, p. 2, Paris : Librairie Hachette)
- Rappelons seulement que la harira, soupe marocaine très spécifique est, quand elle est réussie, un chef-d'?uvre de l'ingéniosité des femmes de cette contrée. ? (???ishah Bil?arab?, Corps au féminin, Éditions le Fennec, 1991, page 7)
- Je vis de bonne soupe et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage [?] ? (Molière, Les Femmes savantes (1672) ? lire en ligne)
-
(Familier) (Par extension) Repas.
- À la soupe !
-
(Sports d'hiver) (Figuré) Neige gorgée d'eau.
- En bas des pistes, c'était plutôt de la soupe, mais on avait beau temps.
-
(Péjoratif) Ensemble de mots dits ou écrits de façon incompréhensible.
- [L'étude] peut certes être interprétée de façon intéressée, permettant à d'aucuns conseils, en permanence connectés à Wall Street, de servir une soupe technophile et délicieusement dérégulée à leurs multinationales clientes.? (Ariel, Kyrou, Le numérique creuse-t-il vraiment la tombe de l'emploi ?, Uzbek & Rica le 31 mars 2017)
- (Péjoratif) (Musique) Morceau de musique trop commercial et simpliste.
- (Par extension) (Péjoratif) (Télévision) Programmation télévisuelle (feuilleton, téléfilm, journal, jeux, etc.) bas de gamme à visée commerciale explicite qui tente de s'aligner sur le plus large public possible.
-
(Péjoratif) Production intellectuelle, considérée comme une marchandise.
-
Il écrivait aussi, et répétait désormais à qui voulait l'entendre qu'un livre vendu à plus de trois mille exemplaires était une infamie.
Tout cela oui, mais autre chose. Le principe même de la promotion. Comme une salissure. Aller vendre sa soupe. Finalement, ce n'était pas autre chose. Ne plus écrire, mais devenir une espèce de commis voyageur de son écriture. ? (Philippe Delerm, La bulle de Tiepolo, Gallimard, 2005, collection Folio, pages 66-67.)
-
Il écrivait aussi, et répétait désormais à qui voulait l'entendre qu'un livre vendu à plus de trois mille exemplaires était une infamie.
Trésor de la Langue Française informatisé
SOUPE, subst. fém.
Soupe au Scrabble
Le mot soupe vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot soupe - 5 lettres, 3 voyelles, 2 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot soupe au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
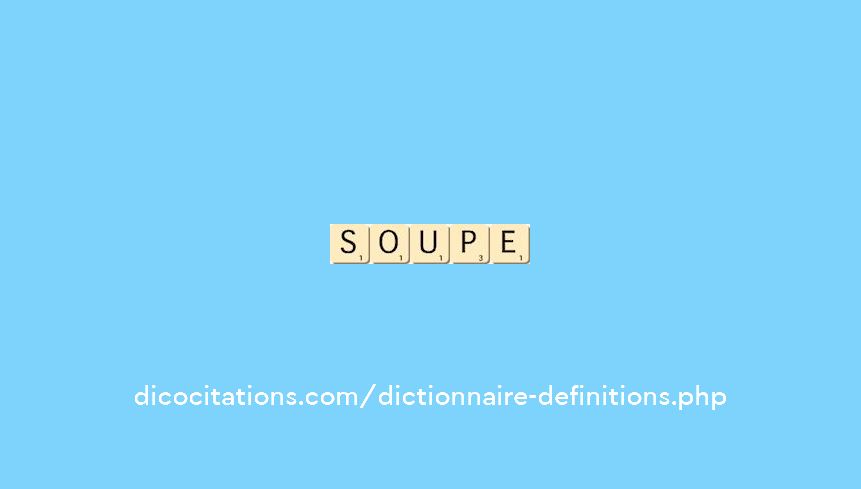
Les mots proches de Soupe
Sou Souage Soubassement Soubergue Soubredent Soubresaut Soubrette Soubreveste Souche Souchet Souci Souci Soucier Soucieusement Soucieux, euse Soucoupe Soudage Soudain, aine Soudainement Soudaineté Soudan Soudard ou soudart Soude Soudé, ée Souder Soudoyer Soudre Soudrille Soudure Souffert, erte Soufflant, ante Soufflard Souffle Soufflé, ée Soufflement Souffler Soufflerie Soufflet Souffletade Souffleté, ée Souffleter Souffleur, euse Soufflure Souffrable Souffrance Souffrant, ante Souffre-bonheur Souffre-douleur Souffreteux, euse Souffrir sou souabe souabes souabes Souain-Perthes-lès-Hurlus Soual Souancé-au-Perche Souanyas Souastre soubassement soubassements Soubès soubise Soubise Soublecause Soubran Soubrebost soubresaut soubresautaient soubresautait soubresauts soubrette soubrettes Soucé Soucelles souche Souche Souché souches souchet souchette Souchez Soucht souci soucia Soucia souciai souciaient souciais souciait souciant souciât soucie soucié souciée souciées soucient soucier souciera soucieraiMots du jour
Préséance Griffer Entre-plaider (s') Chaput Aviation Harceler Crépu, ue Virilité Dessalé, ée Embordurer
Les citations avec le mot Soupe
- Toujours la même malchance... tu peux parier... le jour ou il pleuvra de la soupe... c'est une fourchette que j'aurai en main.Auteur : Hugo Pratt - Source : Corto Maltese, 12. La Lagune des mystères (2002)
- La mère posa la soupe fumante sur la table, et comme à ce moment je parlais, d'un geste discret elle arrêta ma phrase, et le vieux dit le bénédicité.Auteur : André Gide - Source : Si le grain ne meurt (1926)
- Grottes à stalactites: Il y a eu dedans une fête célèbre, bal ou souper, donné par un grand personnage. On y voit «comme des tuyaux d'orgue». On y a dit la messe pendant la Révolution.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Les femmes laides sont très utiles. Si vous voulez passer pour respectable, il suffit de les inviter à souper.Auteur : Oscar Wilde - Source : Sans référence
- Qui se lève tard trouve la soupe froide.Auteur : Proverbes auvergnats - Source : Proverbe
- Les animateurs du petit écran semblent de plus en plus ignorer qu'il existe un devoir de courtoisie envers les personnes conviées. On peut ne pas servir la soupe sans pour autant renverser la soupière sur la tête de l'invité.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Les grands hommes qui écrivent leurs mémoires ne parlent pas assez de l'influence d'un bon souper sur la situation de leur esprit.Auteur : Eugène Delacroix - Source : Journal, 8 août 1850
- Dans les fermes, on en prenait soin, des chiens, même s'il s'agissait des seuls animaux pas véritablement productifs, fidèles commis pourtant, à qui l'on confiait bien souvent les tourments et les secrets de l'âme, qui semblaient avoir été conçus pour cela également, et peut-être surtout, en échange d'un peu de soupe et parfois de caresses.Auteur : Franck Bouysse - Source : Glaise (2018)
- Pour un catholique, je vous trouve profanant, dit-elle lentement, mais un peu crispée, et je vous prie de m'épargner le détail des soupers de vos coquines.Auteur : Jules Amédée Barbey d'Aurevilly - Source : Les Diaboliques (1874), Le plus bel amour de Don Juan, I
- Le bachelier eut dans cette soupente ces doutes, ces tentations, ces triomphes et ces défaites, ces pleurs de rage et ces joies de la jeunesse que l'âge mur ignore ou dédaigne, et dont lui-même ne garda par la suite qu'un souvenir entaché d'oubli.Auteur : Marguerite Yourcenar - Source : L'Oeuvre au noir (1968)
- Aimer de bonne heure et se marier tard, c'est entendre chanter le matin une alouette en l'air et en manger le soir une rôtie à son souper.Auteur : Johann Paul Friedrich Richter, dit Jean-Paul - Source : Pensées extraites de tous les ouvrages de Johann Paul Friedrich Richter dit Jean-Paul
- Le soir, pendant le souper, son père déclara que l'on devait à son âge apprendre la vénerie; et il alla chercher un vieux cahier d'écriture contenant, par demandes et réponses, tout le déduit des chasses.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Trois contes (1877), La légende de Saint Julien l'Hospitalier
- Lever à six, dîner à dix;
Souper à six, coucher à dix;
Font vivre l'homme dix fois dix.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - Maintenant je suis grand et j'ai acquis de l'expérience
Moi aussi j'ai mes dictons bourrés de vérité
C'est dans les vieux pots que la soupe est la plus dégueulasse
Et c'est en forgeant qu'on devient vachement fatigué
C'est parfois les petits lits qui font les grandes maîtresses
Et les p'tits oiseaux qui entretiennent les saletés
Frappe toujours un homme à terre avant qu'il se redresse
Il te remerciera, pour vivre heureux vivons couchés.Auteur : Pierre Perret - Source : Les proverbes (1970) - Hier au soir, Madame n'a pas soupé: elle n'a pris que du thé. Elle a sonné de bonne heure ce matin; elle a demandé ses chevaux tout de suite, et elle a été, avant neuf heures, aux Feuillans, où elle a entendu la Messe.Auteur : Pierre Choderlos de Laclos - Source : Les Liaisons dangereuses (1782)
- Enfin le souper vint, bon ou mauvais; la Rappinière but tant qu'il s'enivra et la Rancune s'en donna aussi jusques aux gardes.Auteur : Paul Scarron - Source : Le Roman comique (1651-1657)
- Je fais mon beurre en crachant dans la soupe.Auteur : Jean Gouyé, dit Jean Yanne - Source : J'me marre (2003)
- Vous soupez peut-être à l'heure qu'il est chez l'Intendant. Vous n'y faites pas, à mon avis, débauche de sincérité.Auteur : Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné - Source : Lettres (1646-1696), 5 janvier 1674
- Il y a une chose dont je suis certain c'est qu'il y a autant de misogynes femmes qu'hommes. Les femmes qui servent debout la soupe aux mecs assis ça existe encore et c'est souvent la volonté des femmes... Ce n'est pas un truc de mec la misogynie.Auteur : Pierre Desproges - Source : Le Petit Reporter (1981)
- Un reste de soupe qui aigrit dans une écuelle.Auteur : Roger Martin du Gard - Source : Vieille France (1933)
- L'infortune, dit le proverbe écossais, est saine à déjeuner, indifférente à dîner, et mortelle à souper.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : Proverbes
- Il faisait, en avalant sa soupe, un gloussement à chaque gorgée, et, comme il commençait d'engraisser, ses yeux, déjà petits, semblaient remontés vers les tempes par la bouffissure de ses pommettes.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Madame Bovary (1857), I, 9
- Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut, - Bon souper, bon gîte et le reste?Auteur : Jean de La Fontaine - Source : Fables (1668 à 1694)
- Lever à cinq, diner à neuf
Souper à cinq, coucher à neuf
Font vivre d'ans nonante et neuf.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - Les huit filles qui se trouvaient pour lors au souper, étaient si distantes par l'âge qu'il me serait impossible de vous les esquisser en masse.Auteur : Donatien Alphonse François, marquis de Sade - Source : Justine ou les Malheurs de la vertu (1791)
Les citations du Littré sur Soupe
- Jamais Lise à souper ne prie Un pédant à citationsAuteur : Voltaire - Source : Lett. en vers et en prose, 81
- Il fut reçu courtoisement par les gens [de] Collatin ; si avint que après le souper....Auteur : BERCHEURE - Source : f° 26, verso.
- Depuis qu'il avait la goutte, il [Leibnitz] ne dînait que d'un peu de lait ; mais il faisait un grand souper, sur lequel il se couchait à une ou deux heures après minuitAuteur : FONTEN. - Source : Leibnitz.
- Ce pacquet lui ayant esté rendu pendant son souper....Auteur : MONT. - Source : II, 43
- Les beautés vagabondes, qui vont de spectacles en spectacles, chercher des aventures, c'est-à-dire des soupersAuteur : MERC. - Source : Tabl. de Paris, 542
- Il est vrai que M. de Florian, qui a une charmante petite maison dans Ferney, donna il y a quelque temps un grand souper à Mme de Suchet, où elle joua une ou deux scènes de proverbesAuteur : Voltaire - Source : Lett. d'Argental, 3 avr. 1775
- Le souper hors du choeur chasse les chapelains, Et de chantres buvants les cabarets sont pleinsAuteur : BOILEAU - Source : Lutrin, II
- Qui garde son disner, il a mieux à souperAuteur : COTGRAVE - Source :
- S'informe-t-on à souper si Clodion le chevelu a passé le Rhin ?Auteur : Voltaire - Source : Jeannot et Colin.
- J'ai soupé hier avec trois des plus jolies femmes de Paris ; nous avons bu jusqu'au jour....Auteur : LESAGE - Source : Turc. III, 5
- Il [La Reynière, célèbre gourmand du siècle dernier] trouva son fils à table : Comment donc ! c'est vous qui faites embrocher sept dindons pour votre souper ! - Monsieur, je vous avais ouï dire assez souvent qu'il n'y a presque rien de bon dans une grosse dinde, et je n'en voulais manger que les sot-l'y-laisseAuteur : DECOURCHAMPS - Source : Souvenirs de la marquise de Créquy, t. IV, ch. 6
- Lequel fut, seulement par soupecon et comme presumptivement consentant de l'homicide fait par ses gens, emprisonné le vendredy et le dimanche jugé et executéAuteur : M. DU BELLAY - Source : 204
- Il fit apporter du meilleur vin de leans, et alla querir de belles cerises toutes fraisches, et vint banqueter avec elle en attendant le souperAuteur : LOUIS XI - Source : Nouv. LXV
- Elle me ferait de mauvaise soupe, et, comme dit l'autre, c'est la soupe qui nourrit le soldatAuteur : CARMONTELLE - Source : Proverbes, le Grand chemin, sc. 8
- Notre hôte cependant, s'adressant à la troupe : Que vous semble, a-t-il dit, du goût de cette soupe ?Auteur : BOILEAU - Source : Sat. III
- Il [un homme de qualité arrivant en équipage] ne perd rien auprès d'elle [une bourgeoise], on lui tient lieu [lisez compte] des doubles soupentes et des ressorts qui le font rouler plus mollement : elle l'en estime davantageAuteur : LA BRUY. - Source : VII
- Le roi dit à son souper : Orange est pris ; Grignan avait sept cents gentilshommes avec lui : on a tiraillé du dedans ; et enfin on s'est rendu le troisième jour : je suis fort content de GrignanAuteur : Madame de Sévigné - Source : 173
- Elle s'entretint depuis la dînée jusqu'à la soupéeAuteur : MARG. - Source : Nouv. XV
- Je vais contremander le souper et déprier nos gensAuteur : BOISSY - Source : Français à Londres, sc. 6
- Je mis Vambroc dans une soupente où il eût fallu être chat ou diable pour le trouverAuteur : RETZ - Source : I, 14
- Notre souper d'hier au soir, ma fille, il me semble qu'il était fort beau, fort bien servi ; je m'y trouvai avec la fleur de mes amisAuteur : Madame de Sévigné - Source : 29 janv. 1685
- Soupeçonneux comme singes de cour parmi des pagesAuteur : BRANT. - Source : Charles-Quint.
- Parce que noz veismes qu'il estoit tués d'un seul coup de mail ou de machue, noz preismes un boucier, li quix avoit soupé la nuit devant aveques liAuteur : BEAUMANOIR - Source : XL, 20
- Il y avait à votre souper deux ragoûts manquésAuteur : Voltaire - Source : Facéties, Sur l'encycl.
- L'après-soupée se passa en jeu, en conversationAuteur : Madame de Sévigné - Source : 447
Les mots débutant par Sou Les mots débutant par So
Une suggestion ou précision pour la définition de Soupe ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 02h32

- Sacrifice - Sacrilege - Sage - Sagesse - Sagesse_populaire - Saint_Valentin - Salete - Sante - Santé - Sante - Satisfaction - Satyre - Savant - Savoir - Savoir_vivre - Scandale - Scepticisme - Science - Scrupule - Sculpture - Secret - Secte - Seigneur - Sein - Semblable - Sens - Sensibilite - Sentiment - Separation - Séparation - Serenite - Sérénité - Sérieux - Service - Servitude - Seul - Seule - Sexe - Sexologie - Sexualite - Silence - Simplicite - Sincère - Sincerite - Sincérité - Singe - Snob - Sobre - Sociabilite - Societe - Sociologie - Sodomie - Soi_même - Soleil - Solitude - Solution - Sommeil - Sondage - Songe - Sot - Sottise - Soucis - Souffrance - Souffrir - Soulage - Soupçon - Sourire - Souvenir - Specialiste - Spectacle - Sport - Stabilite - Star - Statistiques - Stimulation - Stress - Style - Subjonctif - Succes - Suggestion - Suicide - Superflu - Superiorite - Supermarche - Superstition - Supplice - Survie - Suspicion - Systeme
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur soupe
Poèmes soupe
Proverbes soupe
La définition du mot Soupe est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Soupe sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Soupe présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
