La définition de Force du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Force
Nature : s. f.
Prononciation : for-s'
Etymologie : Provenç. forsa, forza ; espagn. fuerza ; portug. força ; ital. forza ; du bas-latin forcia, fortia, dérivé du latin fortis, fort. Ce qui empêche d'y voir le pluriel neutre fortia, c'est que les noms ainsi dérivés de pluriels neutres ont un sens collectif qui manque ici : biblia, bible, mirabilia, merveille, etc.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de force de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec force pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Force ?
La définition de Force
La propriété qui fait que le corps d'un homme ou d'un animal a une grande puissance d'action. Être doué d'une grande force de corps. Avoir de la force. Une force d'Hercule. Un cheval d'une grande force. Je n'ai pas la force de travailler.
Toutes les définitions de « force »
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
force \Prononciation ?\ féminin
-
Ciseau.
-
Qui un rous peliçon portoit,
Bien fet sanz cisel et sanz force. ? (Roman de Renart, XIIIe siècle)
-
Qui un rous peliçon portoit,
Adjectif indéfini - français
force \f??s\ masculin et féminin identiques, invariable
-
(Archaïsme) ou (Littéraire) Beaucoup de.
-
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,
J'ai dévoré force moutons ;
Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense. ? (Jean de La Fontaine, Les Animaux malades de la peste) - Au musée, il y a quelques tableaux passables, mais rien de supérieur ; en revanche, force sculptures sur bois et force christs d'ivoire, plutôt remarquables par la grandeur de leurs proportions et leur antiquité, que par la beauté réelle du travail. ? (Théophile Gautier, Voyage en Espagne, Charpentier, 1859)
- Force allusions au passé, force demandes pour l'avenir furent adroitement glissées au roi au milieu de ces harangues ; [?]. ? (Alexandre Dumas, La Reine Margot, 1845, volume I, chapitre I)
- De joyeuse humeur, le mari cause avec force gestes, prend parfois les mains de sa femme, la taille aussi ; [?]. ? (Jules Verne, Claudius Bombarnac, chapitre VI, J. Hetzel et Cie, Paris, 1892)
- Et ce qui était plus intéressant encore, la Vierge avait, dans ce lieu, accompli force miracles. ? (Joris-Karl Huysmans, La Cathédrale, Plon-Nourrit, 1915)
- Deux ivrognes mâles d'une quarantaine d'années, vêtus comme des chiffonniers ou des vagabonds et échangeant des horions dont la violence était exprimée par force étoiles de diverses grosseurs. ? (Michel Leiris, L'âge d'homme, 1939, collection Folio, page 31)
- Le temps où les Soviétiques soutenaient puissamment les ennemis arabes d'Israël, avec force armes, barrages ou centrales électriques est révolu. ? (Fabrice Nodé-Langlois, Le Kremlin tente un retour sur la scène du Proche-Orient, dans Le Figaro, 15 octobre 2007)
-
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,
Nom commun 2 - français
force \f??s\ féminin
- (Héraldique) S'emploie toujours au pluriel car comme les ciseaux, il s'agit d'une paire de lames ? voir forces.
Nom commun 1 - français
force \f??s\ féminin
-
Faculté naturelle d'agir vigoureusement, en particulier en parlant de l'être humain et des animaux.
- Force physique. ? Force musculaire. ? Une force d'Hercule.
- Frapper de toute sa force. ? Lancer une chose avec force.
- Crier de toute la force de ses poumons.
- Perdre de sa force. ? Reprendre quelque force.
-
(Figuré) Aptitude à réfléchir, à concevoir, à produire, en parlant de l'esprit, de l'imagination, du génie, etc.
- La force, les forces de l'intelligence. ? Par la force de son génie.
- L'esprit humain n'a pas assez de force pour pénétrer tous les secrets de la nature.
-
Habileté, talent, expérience qu'on a dans un art, dans un exercice, etc.; et, en général, ensemble des ressources dont on peut disposer, des facultés, du bien, du crédit, du pouvoir, etc., dont on jouit.
- Ces deux joueurs, ces deux écoliers, sont d'égale force. ? Ses adversaires ne sont pas de sa force.
- Cet écrivain n'est pas de force à traiter un pareil sujet. ? Il est de première force aux échecs.
- Le partenaire du maréchal est un petit capitaine d'état-major, sanglé, frisé, ganté de clair, qui est de première force au billard et capable de rouler tous les maréchaux de la terre. ? (Alphonse Daudet, La partie de billard, dans Contes du lundi, 1873, Fasquelle, collection Le Livre de Poche, 1974, page 17.)
- S'opposer de toutes ses forces à l'adoption d'une mesure dangereuse.
-
Énergie vitale ; vigueur.
- Lorsque l'on ne peut faire autrement que d'affronter le mauvais temps, les forces humaines se décuplent et l'esprit devient plus clairvoyant. ? (Dieudonné Costes & Maurice Bellonte, Paris-New-York, 1930)
- Et tout le village bientôt, à des degrés variant selon la constitution et la force de résistance de chacun, fut en proie à des malaises étranges, symptômes inexplicables d'empoisonnement. ? (Louis Pergaud, Un petit logement, dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921)
- Il s'acharnera au travail, il ne ménagera ni son temps, ni ses forces, à une époque où le radium et la radiothérapie profonde était encore inconnue. ? (Bulletin de la Société d'obstétrique et de gynécologie de Paris, 1924, vol.3, page 403)
-
Énergie, activité, intensité d'action.
- La lutte des intérêts matériels et des principes moraux, de l'utilité et du devoir, du matérialisme et du spiritualisme, se représente ici avec une nouvelle force, et sous un point de vue encore plus important. ? (Pellegrino Rossi, Traité de droit pénal, 1829, page 180)
- [?] ; et le gros des troupes était une horde de barbares dans toute la force du terme. C'était de ces figures étranges qui avaient parcouru la Gaule au temps d'Attila et de Chlodowig, [?]. ? (Augustin Thierry, Récits des temps mérovingiens, 2e récit : Suites du meurtre de Galeswinthe ? Guerre civile ? Mort de Sighebert (568-575), 1833 - éd. Union Générale d'Édition, 1965)
- L'alcool donne au vin sa force et sa propriété enivrante ; il dérive du sucre, et n'existe jamais tout formé dans le raisin. ? (Edmond Nivoit, Notions élémentaires sur l'industrie dans le département des Ardennes, E. Jolly, Charleville, 1869, page 135)
- La force de la chaleur. ? La force d'un coup.
- S'élever avec force contre les abus.
- Cet homme semblait entraîné à sa perte par une force irrésistible.
- La force d'un argument, d'une preuve, d'une objection.
- Des vers pleins de force et d'éclat.
- Sentez-vous toute la force de ce mot, de cette expression ?
-
Abondance et vigueur.
- La force de la sève. ? La force d'une passion, d'un sentiment.
- Son amour sembla renaître avec plus de force.
-
Volonté, caractère, sensibilité, fermeté d'âme, courage qui fait braver les obstacles ou supporter le malheur, les maux, les tourments.
- La force morale triomphe de la force physique, et c'est vainement que les Peel et les Wellgton de la société voudraient s'opposer à ses progrès vers la prospérité et la liberté ; [?]. ? (Anonyme, Réélection d'O'Connell en Irlande, Revue des Deux Mondes, 1829, tome 1)
- Il lui a fallu beaucoup de force pour dompter cette émotion.
- Quelle force morale il faut pour accepter une telle existence, pour accomplir une telle mission!
- Elle a une force de caractère, une force d'âme digne d'admiration.
- N'avoir pas la force de faire une chose, ne pouvoir pas se déterminer à la faire.
- Je n'eus pas, je ne me sentis pas la force de lui en dire davantage.
- Il n'eut pas la force de refuser.
-
Puissance d'un peuple, d'un état, de tout ce qui contribue à le rendre ou à le maintenir puissant.
- Le pays réparait lentement ses forces. ? La force militaire d'un empire.
- Les forces comparées de la France et de l'Angleterre.
-
(En particulier) (Militaire) Ce qui la rend une armée redoutable.
- La discipline est ce qui fait la principale force des armées.
-
(Militaire) (Nom collectif) L'ensemble des moyens de défense d'une place forte, ses fortifications, sa garnison, etc.
- [?], car il était aisé à la garnison de garder les bords de l'Aude, au moyen de la grande barbacane (?) qui permettait de faire des sorties avec des forces imposantes et de culbuter les assiégeants dans le fleuve. ? (Eugène Viollet-le-Duc, La Cité de Carcassonne, 1888)
-
Personne ou institution qui possède ou exerce un pouvoir, une influence, une contrainte ou une autorité.
- La ploutocratie chilienne s'était appuyée sur deux forces : les milieux réactionnaires de la Marine et les intérêts impérialistes britanniques. ? (Armando Uribe, Le livre noir de l'intervention américaine au Chili, traduction de Karine Berriot & Françoise Campo, Seuil, 1974)
- Opposer la force à la force.
- Avoir la force en main.
- La force publique.
- Les agents de la force publique.
- Force majeure.
- Force est demeurée à la loi, les magistrats chargés de l'exécution de la loi l'ont emporté sur toutes les résistances.
-
Autorité ou influence d'une chose.
- Les lois étaient sans force.
- Cette coutume avait force de loi.
- Décision passée en force de chose jugée.
- La force des événements.
- La force de l'évidence.
- La force de l'exemple, de l'habitude, du préjugé.
- La force des choses, La nécessité qui résulte logiquement d'une situation.
- On ne peut lutter contre la force des choses.
- Cela se fera par la force des choses.
- La force de la vérité, Le pouvoir que la vérité a sur l'esprit des hommes.
- La force du sang se dit des mouvements secrets de la nature entre les personnes les plus proches.
-
(En particulier) Impétuosité.
- Mermoz allait dans son bureau contempler la carte. Il faisait et refaisait les calculs. Oui, selon la direction et la force des vents, il mettrait de vingt à vingt-quatre heures pour aller de Dakar à Natal en avion. ? (Joseph Kessel, Mermoz, illustré par Roger Parry, Gallimard, 1939, page 129)
- La force de l'eau, du courant. Le sang, l'eau jaillissait avec force.
- La force du pouls, Le plus ou le moins de vitesse et d'élévation du pouls.
- Le c?ur bat avec force, les pulsations en sont rapides et violentes.
-
Unité militaire ; corps de troupes requis pour faire exécuter la loi ou les mesures des agents de l'autorité, lorsqu'il y a résistance de la part des citoyens.
- Si les Spinaliens soutinrent vaillamment un siège contre Charles le Téméraire, il n'en fut pas de même, deux siècles plus tard, quand Louis XIV déploya contre eux ses forces et fit raser [?] l'enceinte fortifiée et le château de la ville. ? (Gustave Fraipont; Les Vosges, 1895)
- Le gros des forces aériennes indo-britanniques périt dans la Birmanie sur un bûcher d'antagonistes embrasés. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 413 de l'édition de 1921)
- Étant donné la nature ambivalente du Corps des carabiniers du Chili (force de police et force constituant virtuellement une quatrième Arme), c'est par un double canal que se sont développées ses relations avec les États-Unis. ? (Armando Uribe, Le livre noir de l'intervention américaine au Chili, traduction de Karine Berriot & Françoise Campo, Seuil, 1974, page 25)
-
Solidité, pouvoir de résister.
- J'allai dans la sellerie où je choisis des courroies solides dont j'éprouvai la force de résistance... [?]. ? (Octave Mirbeau, Le colporteur,)
- La température à laquelle le kérosène brûle est suffisante pour faire perdre à l'acier environ 75 % de sa force. ? (Louis Dubé, L'argument déterminant et les théories du complot, dans Le Québec sceptique, n° 67, p.5, automne 2008)
-
(Mécanique, Physique) Effet physique qui produit un changement physique comme une pression, un mouvement. Action mécanique de type glisseur. Vecteur qui la représente.
- Il est très important de placer les écouteurs correctement. Les recommandations faites par les organismes de standardisation disent qu'il faut appliquer une force par l'emploi d'un serre-tête ou de tout autre moyen équivalent. Une force au moins égale à 4 newton est indispensable, [?]. ? (Acta oto-rhino-laryngologica belgica, 1963, vol. 17-18, page 67)
-
(Par extension) (Familier) Puissance mécanique.
- Le curage des vases de la Darse au moyen d'un dragueur à la vapeur de la force de 14 chevaux, a été complet en 1837. ? (Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille, page 370, 1838)
- Les locomobiles de la force de 4 à 5 chevaux ont un poids qui atteint déjà 2000 kilogrammes. ? (Ch. Drion & E. Fernet, Traité de Physique élémentaire, Masson, 1885, note bas de page 325)
- La force nécessaire pour la manutention est de 50 HP environ ; le personnel est de 100 ouvriers. ? (Vals-Saint-Jean - la station de Vals-les-Bains et environs, éditée spécialement pour la Société Vals-Saint-Jean par G.-L. Arlaud, éditeur, Lyon (sans date ; vers 1931), page 32)
-
(En particulier) Valeur d'un raisonnement, d'une preuve, d'une raison, etc.
- L'accusation tirait de ce fait une nouvelle force.
- Il fallut céder à la force de ces raisons.
-
(Didactique) Toute cause ou puissance à laquelle on attribue la propriété de produire ou de déterminer certains effets, certains phénomènes.
- Il serait impossible de comprendre les succès des démagogues, depuis les temps d'Athènes jusqu'à la New York contemporaine, si on ne tenait compte de la force extraordinaire que possède l'idée de vengeance pour oblitérer tout raisonnement. ? (Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Chapitre V, La grève générale politique, 1908, page 230.)
- Les diverses forces répandues dans la nature.
- (Cartes à jouer) Onzième arcane du tarot de Marseille.
Littré
Résumé
- 1° Propriété qui fait que le corps d'un homme ou d'un animal a une grande puissance d'action.
- 2° La force de l'âge.
- 3° Puissance, supériorité.
- 4° Se dit des États, que l'on compare à un corps vivant.
- 5° Ce qui rend une armée considérable, redoutable.
- 6° Supériorité physique de force, pouvoir de contraindre.
- 7° Violence.
- 8° Maison de force.
- 9° Il est bien force.
- 10° Aptitude à concevoir, à combiner, à réfléchir, à imaginer.
- 11° Habileté, talent, expérience.
- 12° Énergie morale.
- 13° Puissance d'action et d'impulsion des agents physiques.
- 14° Impétuosité.
- 15° Puissance de résistance.
- 16° Toute cause de mouvement.
- 17° Forces au sens métaphysique.
- 18° Forces de la nature.
- 19° Intensité, énergie, efficacité des choses.
- 20° Il se dit des choses intellectuelles et morales.
- 21° Action exercée sur l'esprit par le discours, le style, les expressions.
- 22° Il se dit du raisonnement et des preuves.
- 23° La force d'un sujet, qualités solides qu'il renferme.
- 24° Caractère et vigueur, en parlant de peinture et de sculpture.
- 25° Ce qu'il y a de fort, de contraignant dans les choses.
- 26° Grande quantité.
- 27° Mofette.
- 28° À force.
- 29° À force de.
- 30° À toute force.
- 31° De force.
- 32° Par force, à force ouverte, de vive force.
-
1La propriété qui fait que le corps d'un homme ou d'un animal a une grande puissance d'action. Être doué d'une grande force de corps. Avoir de la force. Une force d'Hercule. Un cheval d'une grande force. Je n'ai pas la force de travailler.
Les deux extrémités [du muscle] ont plus de force, parce que l'une soutient le muscle, et que par l'autre, c'est-à-dire par le tendon, qui est aussi le plus fort, s'exerce immédiatement le mouvement
, Bossuet, Connaiss. II, 2.Je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne
, Racine, Phèdre, I, 3.Réparez promptement votre force abattue
, Racine, ib.Il donnera la force à vos bras languissants
, Voltaire, Zaïre, IV, 1.La force des hommes n'est estimée que vingt-cinq livres et celle des chevaux de cent soixante et quinze
, Voltaire, Dict. phil. Force physique.La force de tout animal a reçu son plus haut degré quand l'animal a pris toute sa croissance?; elle décroît quand les muscles ne reçoivent plus une nourriture égale
, Voltaire, ib. Force.Des hommes qui avaient employé toute la force de leur corps, qui en avaient même abusé, s'il est possible d'en abuser autrement que par l'oisiveté et la débauche
, Buffon, Hist. nat. hom. t. IV, p. 357, dans POUGENS.Hercule eut en partage la force à qui rien ne résiste?; Hélène, la beauté qui triomphe de la force même
, Courier, Éloge d'Hélène.De toute sa force, autant que l'on peut, aussi bien que l'on peut.
Criant de toute sa force
, Bossuet, Hist. II, 8.La Senantes était à sa toilette, qui se coiffait de toute sa force en faveur de Matta
, Hamilton, Gram. 4.À forces égales, à force égale, à égalité de force ou de forces, en supposant que des deux côtés les forces sont égales.
Être de force à, être assez fort pour. Il est de force à lutter contre trois hommes.
Par extension. Être assez habile pour, ou, ironiquement, assez niais pour, et, généralement, être capable de. Il est de force à vous convaincre. Il est bien de force à faire cette bévue.
Tour de force, action qui demande beaucoup de force ou d'adresse?; et fig. solution heureuse d'une grande difficulté.
Tour de force, dans les beaux-arts, se dit, en mauvaise part, des effets plus difficiles qu'agréables.
N'avoir ni force ni vertu, être d'une complexion délicate?; et fig. n'être bon à rien, capable de rien. C'est le soleil de janvier, il n'a ni force ni vertu.
Dans les métiers, man?uvres ou opérations de force, celles qui exigent des efforts considérables et des appareils puissants.
Travaux de force, travaux qui exigent l'emploi des forces musculaires.
Au plur. Les forces du corps. Ce malade sent ses forces augmenter. Il fait plus que ses forces ne permettent.
C'était [se retirer] la résolution qu'il avait prise dans sa dernière maladie?; et, plutôt que de voir languir les affaires avec lui, si ses forces ne lui revenaient, il se condamnait, en rendant les sceaux, à rentrer dans la vie privée
, Bossuet, Letellier.Peu à peu ils [Mentor et Télémaque] reprirent leurs forces
, Fénelon, Tél. VIII.Céson tomba aussitôt sur lui, et, se prévalant de ses forces, lui donna tant de coups de poings et de pieds?
, Vertot, Révol. rom. IV, p. 309. -
2La force de l'âge, l'époque de la vie où l'on a le plus de force.
Racine, dans la force de son âge, né avec un c?ur tendre, un esprit flexible, une oreille harmonieuse, donnait à la langue française un charme qu'elle n'avait point eu jusqu'alors
, Voltaire, Comm. Corn. Attila, préface.La force du tempérament, ce qui, dans le tempérament, rend l'individu capable de résister à de grandes fatigues, d'exécuter de grands travaux.
Être dans toute sa force, avoir la plénitude de sa vigueur.
Être dans toute sa force, se dit des affaires politiques, judiciaires ou autres qui sont au plus haut point du débat, et qui préoccupent l'attention publique.
L'affaire contre M. de la Chalotais, aussi odieuse et aussi absurde que celle d'Urbain Grandier, était dans toute sa force
, Duclos, Voy. Ital. ?uv. t. VII, p. 5, dans POUGENS. -
3Puissance, supériorité.
Pour te récompenser, ma force est trop petite
, Corneille, Cid, IV, 3.Il leur a paru [aux libertins] que c'était une contrainte importune de reconnaître qu'il y eût au ciel une force supérieure qui gouvernât tous nos mouvements et châtiât nos actions déréglées avec une autorité souveraine
, Bossuet, Sermons, 3e dim. après Pâq. préambule.Quelle force vous peut arracher des mains toutes-puissantes de Dieu, que vous irritez par vos crimes, et dont vous attirez sur vous les vengeances??
Bossuet, IV, Vêture, 1.Souvenez-vous comment Moïse, ce serviteur de Dieu, brisa autrefois la force d'Amalec
, Massillon, Car. Motifs de conv.Le grand vizir crut que son expédition était assez heureuse? s'il ne mettait pas des avantages certains au risque d'une nouvelle bataille, qu'après tout le désespoir pouvait gagner contre la force
, Voltaire, Russie, II, 1.Cette soumission [du roi de Prusse] n'a point encore rassuré Napoléon?; à sa force, il ajoute la feinte, les forteresses que, par pudeur, il laisse à Frédéric, sa défiance en convoite encore l'occupation
, Ségur, Hist. de Nap. I, 2.La force la plus forte C'est un c?ur innocent
, Hugo, F. d'aut. 37.Avoir force, avoir une influence active.
Son exemple aurait force, et ferait qu'à l'envi Tous voudraient imiter le chef qu'ils ont suivi
, Corneille, Toison d'or, I, 2.Ressources que procurent le bien, le crédit, le pouvoir, le talent, la position, etc. Ce personnage prend tous les jours une nouvelle force. Les forces d'un parti.
Je suis toujours étonné que vous ne sentiez pas votre force et que vous ne traitiez pas tous les polissons qui vous attaquent comme vous avez fait Aliboron
, D'Alembert, Lett. à Voltaire, 4 août 1767.Les forces humaines, ce que l'homme en général est en état de faire ou de supporter. Les forces humaines ne vont pas jusque-là. Cela est au-dessus des forces humaines.
Il [Davoust] s'écriait que des hommes de fer pouvaient seuls supporter de pareilles épreuves?; qu'il y avait impossibilité matérielle d'y résister?; que les forces humaines avaient des bornes, qu'elles étaient toutes dépassées
, Ségur, Hist. de Napol. X, 6. -
4Force se dit des États que l'on compare à un corps vivant.
Le royaume d'Israël reprenait ses forces
, Bossuet, Hist. I, 6.L'empire reprend quelque force sous Justinien
, Bossuet, ib. III, 7.Les grands hommes font la force d'un empire
, Bossuet, III, 6.Dans sa force première Athènes se relève?; Ses braves sont armés de leurs longs javelots
, Millevoye, Élég. II.Il se dit aussi de la puissance d'un peuple, d'un État, de ses ressources, de ce qui le rend florissant. Les forces comparées de la France et de l'Angleterre. La force militaire d'un empire.
-
5La force d'une armée, ce qui la rend considérable, redoutable.
Vitellius avance avec sa force unie
, Corneille, Othon, I, 3.La force d'un régiment, d'un bataillon, le nombre effectif d'hommes qui s'y trouvent.
La force d'une place de guerre, ses moyens de défense, ses fortifications, sa garnison.
Être en force, être en état de se défendre ou d'attaquer. L'ennemi se montre en force sur notre flanc gauche.
Au plur. Les forces, les troupes d'un État, d'un souverain.
Je me vis en déroute avec toutes mes forces
, Corneille, Attila, I, 1.J'ai des forces assez pour tenir la campagne
, Racine, Théb. I, 3.Ses v?ux tardifs n'étant pas exaucés, il envisage l'énormité de ses forces, il revient sur les souvenirs de Tilsitt et d'Erfurt, il accueille des renseignements inexacts sur le caractère de son rival
, Ségur, Hist. de Nap. I, 5.Alexandre et, sous lui, Barclay de Tolly, son ministre de la guerre, dirigeaient toutes ces forces?; elles étaient partagées en trois armées
, Ségur, ib. IV, 1.Terme de marine. Force ou forces navales, réunion indéterminée de bâtiments de guerre.
La flotte d'un pays.
Ligne de force, la ligne dans laquelle les plus forts vaisseaux sont placés en tête de la ligne, en tactique navale. La ligne de contre-force se forme, au contraire, en plaçant les plus forts vaisseaux à la queue de la ligne.
-
6Supériorité physique de force?; pouvoir de contraindre. Repousser la force par la force. L'empire de la force. On a nommé la guerre le jeu de la force et du hasard.
Parlez, la force en main et hors de leur atteinte
, Corneille, Nicom. I, 1.Patience et longueur de temps Font plus que force ni que rage
, La Fontaine, Fabl. II, 11.Je sais? Que jamais par la force on n'entra dans un c?ur
, Molière, Mis. IV, 3.À quoi la force doit-elle servir qu'à défendre la raison??
Bossuet, Reine d'Angl.La force tenait lieu de droit et d'équité
, Boileau, Art p. IV.La force fonde, étend et maintient un empire
, Saurin, Spart. III, 4.Enfin, sans toutes ces causes de haine, la position de la Prusse entre la France et la Russie obligeait Napoléon à y être le maître, il ne pouvait y régner que par la force?; il ne pouvait y être fort qu'en l'affaiblissant
, Ségur, Hist. de Nap. I, 2. Force majeure, force à laquelle on ne peut résister. Cas, événement de force majeure. Céder à la force majeure. Il y eut force majeure.Il est juste que l'homme ressente qu'il y a une force majeure à laquelle il faut céder
, Bossuet, 2e serm. Purification, 2.Force publique, réunion des forces individuelles organisées par la constitution pour maintenir les droits de tous et assurer l'exécution de la volonté générale.
Force armée, corps de troupe requis pour faire exécuter la loi, ou les mesures des agents de l'autorité, lorsqu'il y a résistance. La force armée dissipa les attroupements.
Force est demeurée à la loi, les magistrats chargés de l'exécution de la loi ont triomphé de ceux qui voulaient l'enfreindre.
Agir de force, agir par la force.
Voyez s'il faut agir de force ou d'industrie
, Corneille, Sophon. II, 2.Il faut agir de force avec de tels esprits
, Corneille, Héracl. I, 1.Force ouverte, l'emploi patent de la force.
Oui, si sa cruauté s'obstine à votre perte, J'irai, pour l'empêcher, jusqu'à la force ouverte
, Corneille, Héracl. I, 4.Faire force à, contraindre, contenir.
Et parce que la force qu'elle se faisait en cela était très grande et qu'elle ne pouvait la supporter plus longtemps?
, D'Urfé, Astrée, I, 1.Faites un peu de force à votre impatience
, Corneille, Pomp. v, 4.Venez, madame? montrer? La force qu'on vous fait pour me donner la main
, Corneille, Sert. III, 3.Je veux bien néanmoins, pour te plaire une fois, Faire force à l'amour qui m'impose ses lois
, Molière, l'Ét. IV, 5. -
7Violence. Employer la force. Céder à la force.
? Force n'a point de loi?; S'accommoder à tout est chose nécessaire
, La Fontaine, Fianç.J'essaierai tour à tour la force et la douceur
, Racine, Brit. III, 5.C'est lui, seigneur, c'est lui dont la coupable audace Veut la force à la main m'attacher à son sort
, Racine, Mithr. I, 2.À la force?! signifie à la violence?!
On enlève madame?; ami, secourez-nous?; à la force?! aux brigands?! au meurtre?! accourez tous
, Corneille, la Veuve, III, 10.Je sais qu'un vieux respect que la pudeur embrasse Veut qu'au seul nom d'amour nous fassions la grimace, Et que, lorsqu'un amant prétend nous en conter, Nous criions à la force avant que d'écouter
, Th. Corneille, le Berger extravag. IV, 3. -
8Maison de force, maison où l'on enferme les gens de mauvaises m?urs qu'on veut corriger.
La Force, une des prisons de Paris où l'on enfermait les prévenus?; elle est démolie.
-
9Il est bien force, force m'est, force lui est de, il est nécessaire, indispensable.
?Sans pouvoir attendre le reste de son armée, ce lui fut force de hasarder la bataille
, Malherbe, le XXXIIIe liv. de T. Live, ch. 8.Pour ingrat que soit un homme, c'est force que l'objet excite sa mémoire, et qu'en dépit de lui, quand il voit le présent, il se ressouvienne de l'auteur
, Malherbe, Traité des bienf. de Sénèque, I, 12.Mais il me fut bien force? Que ma discrétion expiât mon péché
, Régnier, Sat. VIII.Il m'a été force de manquer aux principales obligations de la vie civile
, Guez de Balzac, liv. VII, lett. 31.Force lui fut de quitter la maison
, La Fontaine, Mazet.Il est donc force, en toute façon, que le peuple croisse?; ainsi fait-il, ayant repos, biens et chevances
, Courier, Lett. VI. -
10Aptitude à concevoir, à combiner, à réfléchir, à imaginer. Avoir une grande force de tête, de conception.
Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces, Et consultez longtemps votre esprit et vos forces
, Boileau, Art p. I.Ô si l'esprit divin, esprit de force et de vérité, avait enrichi mon discours de ces images vives et naturelles qui représentent la vertu et qui la persuadent tout ensemble
, Fléchier, Tur.Absolument. Ce penseur a de la force.
La force de la mémoire, la ténacité de la mémoire. Il a une grande force de mémoire.
-
11Habileté, talent, expérience qu'on a dans un art, dans un exercice, dans une science. Il est de première force sur le violon, au pistolet, aux échecs. Ces deux écoliers sont de la même force.
J'aurai la joie de pouvoir parler de vous avec l'honneur qui est dû à un homme de votre force
, Bossuet, Projet de réunion des prot. Lettre IX.Ironiquement. De même force, se dit de gens ou de choses qui ne valent pas mieux les unes que les autres.
Venez, Pradon et Bonnecorse, Grands écrivains de même force, De vos vers recevoir le prix
, Boileau, Épigr. XVII.Tout ce que dit Diodore de Sicile, sept siècles après Hérodote, est de la même force dans tout ce qui regarde les antiquités et la physique
, Voltaire, Dict. phil. Diodore et Hérodote.Ironiquement. Un fou de sa force, un homme aussi fou que lui.
Dorante, sais-tu bien qu'il n'y a point de fol aux Petites-maisons de ta force??
Marivaux, Fausses confid. II, 3. -
12Il se dit de l'énergie morale. Il lui manque la force d'âme.
L'entretien? où, m'ayant ouvert votre c?ur, j'y vis tant de résolution, de force et de générosité que vous achevâtes de gagner le mien
, Voiture, Lett. 34.Il [Pierre le Grand] a eu cette force dans l'âme, qui met un homme au-dessus des préjugés de tout ce qui l'environne et de tout ce qui l'a précédé
, Voltaire, Russie, Anecdotes.Mais, me direz-vous, la force peut-elle se donner?? oui, sans doute, et plus facilement que toute autre vertu?; car elle ne tient qu'à l'habitude
, Genlis, Ad. et Théod. t. I, lett. 16, p. 117, dans POUGENS.La véritable force, qui vient de la grandeur d'âme, est de savoir vaincre ses passions, et non de s'y livrer
, Genlis, Théât. d'éduc. Ennemi génér. I, 5.Dans ce désastre désormais irrémédiable, où il fallait à chacun toute sa force
, Ségur, Hist. de Nap. IX, 12.Avoir la force de, être assez ferme pour?; n'avoir pas la force de, n'être pas assez ferme pour.
Le roi n'a pas la force de lui rien refuser
, Maintenon, Lett. à Mme de St-Géran, 16 déc. 1697.Je n'avais pas la force de reprendre l'autorité
, Fénelon, Tél. XII.Je n'ai pu de ma main te conduire au supplice, Je n'en eus pas la force
, Voltaire, Orphel. II, 1. -
13Il se dit de la puissance d'action et d'impulsion des agents physiques. La force de la poudre à canon. La force d'une machine à vapeur. La force d'un ressort. La force d'une chute d'eau.
Impulsion qu'a reçue le corps lancé, poussé. La force d'un boulet de canon.
On dit de même?: la force d'un coup.
De la force du coup pourtant il s'abattit
, La Fontaine, Fabl. VIII, 27.Terme de marine. Faire force de rames, ramer à toutes forces.
Faire force de voiles, augmenter la surface de la voilure déjà déployée pour donner plus de prise au vent, et, par là, plus de vitesse au navire.
Ruyter, se voyant en liberté d'agir parce que M. du Quesne ne l'occupait point, voulut décider de cette journée par la défaite de notre avant-garde?; il fit pour cela force de voiles pour nous envelopper, et courut jusques par mon travers,
Mém. de Villette, p. 23, dans JAL.Fig. Faire force de voiles, faire tous ses efforts pour réussir en quelque affaire.
Faire force de vent, forcer de voiles.
Comme la barque longue faisait force de vent sur nous, et que même elle nous le gagnait, nous crûmes que nous ne ferions que mieux de nous jeter à terre dans l'île de Rais
, Retz, Mém. p. 312, éd. d'Amsterd. 1717, dans JAL. -
14Impétuosité. La force de l'eau, du courant.
[Par l'obéissance] vous trouverez de la consistance au milieu de l'inconstance des choses humaines?; les flots n'auront point de force pour vous abattre, ni les abîmes pour vous engloutir
, Bossuet, Panég. St Benoît, 2.La force du pouls, le plus ou moins de force avec laquelle l'artère soulève le doigt qui la presse.
Le c?ur bat avec force, les pulsations en sont fortes et rapides.
-
15Force se dit aussi de la puissance de résistance. La force d'une poutre, d'un drap, d'une toile.
Terme d'architecture. Forces ou jambes de forces, pièces de bois qu'on met sur les tirants pour porter l'entrait et lui servir de jambes.
Il se dit aussi des arcs-boutants et contre-forts en maçonnerie.
-
16 Terme de mécanique. Toute cause de mouvement. Force centripète. Force centrifuge. Deux forces appliquées en un même point. La résultante des forces.
Force mouvante ou motrice, celle qui produit un mouvement.
S'il est bien prouvé que ce qu'on appelle force motrice est le produit de la simple vitesse par la masse, sera-t-il moins aisé de parvenir à connaître ce que c'est que cette force??
Voltaire, Physique, Mesure des forces, II, 1.Force morte, celle qui est actuellement neutralisée.
Autrefois force vive, action de forces combinées avec leur vitesse comme dans le choc.
Quoiqu'il parût s'être renfermé dans l'astronomie, il se mêla de la célèbre question des forces vives?; il fut le premier de l'académie qui osât se déclarer contre M. Leibnitz
, Fontenelle, Louville.Si la force n'est autre chose que le produit d'une masse par la vitesse, ce n'est donc précisément que le corps lui-même agissant ou prêt à agir avec vitesse
, Voltaire, Physique, Mesure des forces, II, 2.Cette querelle était une suite de celle qui divisa si longtemps les mathématiciens sur les forces vives et sur les forces mortes
, Voltaire, Comment. hist. sur les ?uvres de l'auteur de la Henriade.Aujourd'hui force vive d'un corps, le produit de sa masse par le carré de sa vitesse.
Fig. Les forces vives de la nation, la partie la plus vigoureuse et la plus saine de la nation.
Force d'inertie, celle en vertu de laquelle un mobile tend à conserver l'impulsion reçue, et aussi la résistance qu'il oppose à ce qui doit le mettre en mouvement quand il est en repos.
Il faut considérer tout corps se mouvant dans une courbe comme mû par deux puissances, dont l'une est celle qui lui ferait parcourir des tangentes et qu'on nomme la force centrifuge ou plutôt la force d'inertie, d'inactivité, par laquelle un corps suit toujours une droite, s'il n'en est empêché?; et l'autre force qui retire les corps vers le centre, laquelle on nomme la force centripète, et qui est la véritable force
, Voltaire, Newton, III, 4.Fig. Force d'inertie, résistance passive qui consiste surtout à ne pas obéir. Ils opposèrent la force d'inertie aux mesures de l'autorité.
- 17Au sens métaphysique, les forces, les substances qui sont causes?; ce qui est à la fois substance et cause des phénomènes. L'esprit est une force. L'âme, la monade sont des forces.
-
18Forces de la nature, nom que l'on donne aux diverses propriétés de la matière telles que la gravitation, la chaleur, l'électricité, le magnétisme, l'affinité chimique, la vie.
L'on ne connaît les forces qui animent l'univers, que par le mouvement et par ses effets?; ce mot même de forces ne signifie rien de matériel, et n'indique rien de ce qui peut affecter nos organes, qui cependant sont nos seuls moyens de communication avec la nature
, Buffon, Min. t. IX, p. 5, dans POUGENS.La force n'est autre chose que le principe des changements
, Bonnet, ?uv. mél. t. XVIII, p. 86, note 5, dans POUGENS.Leibnitz définit la force, le principe qui a en soi la raison suffisante de l'actualité de l'action
, Bonnet, ib. p. 77.Équivalence des forces, voy. ÉQUIVALENCE.
-
19 Par extension, en parlant des choses, intensité, énergie, efficacité. La force de la chaleur. La force d'un acide, d'un poison. Ce vin a beaucoup de force, c'est-à-dire il est très tonique. Cette eau-de-vie a beaucoup de force, c'est-à-dire elle est très spiritueuse.
Si ce charme a force contre nous
, Régnier, Élég. IV.Cela est si vrai, qu'ayant fait cet hiver un effort pour en échapper avant ce terme, la force du charme me ramena de quarante lieues loin
, Voiture, Lett. 34.Que de ses mots savants les forces inconnues Transportent les rochers, font descendre les nues
, Corneille, l'Illus. comique, I, 1.Le printemps par malheur était lors en sa force
, La Fontaine, Fiancée.La force de la séve, l'abondance et la vigueur de la séve.
Fig. et familièrement. C'est la force du bois, se dit quand quelque chose se fait par la seule impétuosité de la nature.
Qualité du son appelée aussi intensité.
-
20En parlant des choses intellectuelles et morales.
Mais, au lieu de goûter ces grossières amorces, Sa vertu combattue a redoublé ses forces
, Corneille, Cinna, V, 3.Je sais quelle est ta flamme et quelles sont ses forces
, Corneille, Pomp. V, 4.L'esprit le mieux fondé n'a jamais trop de forces
, Corneille, Sert. II, 2.Je tâche avec respect à vous faire connaître Les forces d'un amour que vous avez fait naître
, Corneille, Rod. IV, 3.Il me faut essayer la force de mes pleurs
, Corneille, Poly. III, 2.Les lois de l'Église perdent leur force
, Pascal, Prov. 6.Saint Ascole, qui en était évêque [de Thessalonique], la défendit par la seule force de ses prières
, Fléchier, Hist. de Théod. I, 78.Seconde mes soupirs, donne force à mes pleurs
, Racine, Théb. I, 6.J'ai vu vos sentiments, j'en ai connu la force
, Voltaire, Tancr. I, 6.La force du sang, mouvements secrets de la nature entre personnes unies par les liens du sang.
-
21Il se dit du discours, du style, des expressions, pour signifier l'action puissante exercée sur l'esprit. La force du style.
La force de l'éloquence n'est pas seulement une suite de raisonnements justes et vigoureux, qui subsisteraient avec la sécheresse?; cette force demande de l'embonpoint, des images frappantes, des termes énergiques
, Voltaire, Dict. phil. Force.On a dit que les sermons de Bourdaloue avaient plus de force, ceux de Massillon plus de grâce
, Voltaire, ib.Dans la force, dans toute la force du mot, complétement, sans réserve.
Êtes-vous voyageur dans la force du mot??
Collin D'Harleville, Chât. en Esp. II, 4. -
22Il se dit du raisonnement, des preuves pour exprimer l'action par laquelle ils s'imposent à l'esprit.
J'en ai [de vos raisons] senti la force et connu l'équité
, Racine, Andr. II, 4.La force du raisonnement consiste dans une exposition claire des preuves exposées dans leur jour, et une conclusion juste
, Voltaire, Dict. phil. Force. -
23La force d'un sujet, les qualités solides que renferme le sujet sur lequel on travaille.
Corneille, qui ne produisait ses beautés que quand il était animé par la force de son sujet
, Voltaire, Comm. Corn. Rem. Hor.En un sens analogue, la force de la situation, en parlant d'une situation dramatique.
La force de la situation a fait apparemment passer tous ces défauts, qui aujourd'hui seraient relevés sévèrement dans une pièce nouvelle
, Voltaire, Comm. Corn. Rem. Rodogune. - 24Force se dit, en peinture et en sculpture, du caractère et de la vigueur manifestés dans les formes?; en parlant du coloris, de l'emploi intelligent de couleurs vigoureuses?; en parlant d'un tableau entier, de l'effet vigoureux que produit l'opposition habile des ombres et des lumières.
-
25Ce qu'il y a de fort, de contraignant dans les choses, et quelquefois de nécessaire ou d'inévitable. La force des choses. La force de l'habitude. La force de l'évidence.
La force de la vérité, le pouvoir que la vérité a sur l'esprit des hommes.
Terme de législation. Force de chose jugée, autorité d'une décision administrative ou judiciaire rendue en dernier ressort, et contre laquelle il ne reste aucun moyen ordinaire de se pourvoir.
Combien de fois s'est-on plaint que les affaires n'avaient ni de règle ni de fin?; que la force des choses jugées n'était presque plus connue?
, Bossuet, Letellier.Force de loi, autorité équivalente à celle d'une loi.
Il s'introduisit une coutume ayant force de loi en France, en Allemagne, en Angleterre, de faire grâce de la corde à tout criminel condamné qui savait lire?; tant un homme de cette érudition était nécessaire à l'État
, Voltaire, Dict. phil. Clerc.Un long usage donne force de loi
, Diderot, Opin. des anc. phil. Hobbisme. -
26Il s'emploie pour exprimer une forte quantité.
Il faut mêler pour un guerrier à peu de myrte et peu de roses Force palme et force laurier
, Malherbe, IV, 5.Force gens croient être plaisants qui ne sont que ridicules
, Guez de Balzac, liv. VI, lett. 4.Peu de jasmin d'Espagne et force serpolet
, La Fontaine, Fabl. IV, 4.Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, J'ai dévoré force moutons
, La Fontaine, Fabl. VII, 1.Je mets aussi sur la scène Des trompeurs, des scélérats, Des tyrans et des ingrats, Mainte imprudente pécore, Force sots, force flatteurs
, La Fontaine, ib. IX, 1.Ainsi que force monde accourus d'aventure
, Molière, l'Ét. V, 14.Voir cajoler sa femme et n'en témoigner rien Se pratique aujourd'hui par force gens de bien
, Molière, Sgan. 17.La renommée n'en dit pas force bien
, Molière, D. Juan, III, 5.Voilà monsieur le marquis qui en dit force mal [de l'École des femmes]
, Molière, Critique, 6. - 27Nom que les mineurs de la Loire donnent à la mofette.
- 28À force, loc. adv. Beaucoup, extrêmement. Travailler à force. Étudier à force.
-
29À force de, loc. prép. Par beaucoup de.
Auguste chaque jour, à force de bienfaits, Semble assez réparer les maux qu'il vous a faits
, Corneille, Cinna, I, 2.À force de se faire admirer, on deviendrait insupportable
, Méré, dans BOUHOURS Nouv. rem.À force de façons il assomme le monde
, Molière, Mis. II, 5.À force de sagesse on peut être blâmable
, Molière, ib. I, 1.Il ne se conserve qu'à force de verser le sang
, Fénelon, Tél. III.À force de médecins et de saignées la maladie de Candide devint sérieuse
, Voltaire, Candide, 22.Il semble qu'à force de livres on est devenu ignorant
, Voltaire, Lett. Mme du Deffant, 8 août 1770.Il obligea à force de mérite le roi, qui ne l'aimait pas, à l'employer
, Voltaire, Louis XIV, 9.À force de bras, sans autre aide que les bras. Ils montèrent le canon à force de bras.
À force de rames, en forçant de rames.
À force de reins, par la force des reins.
Neptune frappait la terre et on en voyait sortir un cheval fougueux?; il ne marchait point, il sautait à force de reins
, Fénelon, Tél. XVII.On dit de même?: à la force du poignet.
-
30À toute force, loc. adv. Par toute sorte de moyens.
Un pâtre, à ses brebis trouvant quelque mécompte, Voulut à toute force attraper le larron
, La Fontaine, Fabl. VI, 1.Il veut à toute force être au nombre des sots [maris trompés]
, La Fontaine, Coupe.Il veut rentrer à toute force dans la conversation
, Sévigné, 511.Ils voulaient m'emmener à toute force
, Sévigné, 577.À toute extrémité.
À toute force enfin elle se résolut
, La Fontaine, Fabl. IV, 22.À tout prendre, absolument parlant. On pourrait à toute force lui accorder ce qu'il demande.
Il se pourrait à toute force que Pépin eût donné aux papes l'exarchat de Ravenne
, Voltaire, M?urs, 12.N'est-ce pas que les Anglais ont besoin de la mer, dont les Français peuvent à toute force se passer??
Voltaire, Louis XV, 35. -
31De force, loc. adv. Avec effort. Faire entrer de force une chose dans une autre.
On attache les membres du martyr à deux arbres rapprochés de force
, Chateaubriand, Mart. XVIII.Par la contrainte. Il lui fit signer de force cet acte.
Il ne faut rien de force et cependant il ne faut rien de lenteur
, Pascal, dans COUSIN.Et tâchons d'ébranler, de force ou d'industrie, Ce malheureux dessein qui nous a tous troublés
, Molière, Tart. IV, 2.Prendre une ville de force, s'en emparer par une attaque.
Prendre une femme de force, la violer.
De gré ou de force, soit qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Il faudra bien de gré ou de force qu'il paye le dommage.
-
32Par force, à force ouverte, de vive force, loc. adv. En employant la force, la violence, par une violence manifeste.
Il [l'amour] entre avec douceur, mais il règne par force
, Corneille, Hor. III, 4.Contre un si grand rival j'agis à force ouverte
, Corneille, Nicom. III, 8.Trop heureux si bientôt la faveur d'un divorce Me soulageait d'un joug qu'on m'imposa par force
, Racine, Brit. II, 2.Malgré qu'on en ait.
Les Maures ont appris par force à vous connaître
, Corneille, Cid, II, 7.Et, vertueux par force, espèrent par envie ôter aux jeunes gens les plaisirs de la vie
, Molière, l'Ét. I, 2.Emporter une place de vive force, l'emporter par une attaque brusque.
Fig. Attaquer de vive force les préjugés.
HISTORIQUE
XIe s. Ki abat femme à terre pur faire lui force
, Lois de Guill. 19. Il va ferir Gerin par sa grant force
, Ch. de Rol. CXXI. Par vive force les en chasserent Franc
, ib. CXXIII. Com decherat ma force et ma baudur [hardiesse]?!
ib. CCIV.
XIIe s. Mais estez vous à force et à vigor
, Ronc. p. 25. [Ils] Sont en Espagne, par force l'ont saisie
, ib. p. 116. Ains [j'] ai mis en lui [elle] servir Cuer et cors, force et pooir
, Couci, X. Li cuens de Blois devroit bien mercier Force d'amors qui lui dona amie
, ib. XX. Nos forces, nos aïes [aides] lui metons en defois [refus]
, Sax. XVIII. Mais tenons nos honors à force et à vertu
, ib. XXVIII. Des mains la [la croix] li voleit par vive force oster
, Th. le mart. 38. ? Quant il murdrist la gent, E emble altrui aveir, e à force le prent
, ib. 31.
XIIIe s. Ensi nagierent à force de rames toute la vesprée
, Villehardouin, CLXX. Si cuidierent que jamais li Frnc n'eussent force
, Villehardouin, CLIV. À force [ils] lui ouvrirent la bouche outre son gré
, Berte, X. Li Barrois le saisit par le col et feri le cheval des esporons et le traïst par force de bras des archons [arçons]
, Chr. de Rains, p. 40. D'autre part covient il à fine force que li orbis [la terre ronde] soit touz pleins dedenz soi, si que l'une chose sostiegne l'autre
, Latini, Trésor, p. 111. Il dist k'à parfurnir n'apent, K'est à force fait, serement [qu'on n'est point obligé de tenir un serment fait par force]
, Édouard le conf. v. 4319. Si cum el le [Sanson] tenoit forment Soef en son giron dormant, Copa les cheveux o ses forces [ciseaux], Dont il perdit toutes ses forces
, la Rose, 16885. Et François sont laiens remès à sauveté, Por çou [ce] dist-on sovent?: la force paist le pré
, Ch. d'Ant. III, 366. Godefrois de Bouillon a la crois atacie [attachée]?; Or se croisent à force, Diex lor soit en aïe?!
ib. I, 920. Ne me semble il pas que l'on puisse saveir toz les plais ne totes les forces et les soutillances qui sont en plait
, Ass. de Jér. I, 51. Et se il en est ataint ou prové, il sera encheu en la main dou seignor, come ataint de force [violence]
, ib. 104. Sire, vés là Jehan qui à tort et sans reson, il ou ses commans, vint en tel liu et m'a fet tele forche [force, violence]
, Beaumanoir, VI, 9. Et pour ce ne font force [résistence] li assacis [assassins], se l'en les occist, quant il font le commandement du vieil de la montaigne
, Joinville, 230. Et me dit que c'estoit force [lui faire violence], et m'otroia ma requeste
, Joinville, 267. En ceste presente charte metons nostres saelz en la force et el tesmoignage de verité
, Duchesne, Généal. de Coligny, p. 58, dans LACURNE.
XVe s. Tant fut cil assaut continué et pourmené, que les Anglois entrerent de force et de fait dedans le chastel
, Froissart, II, II, 15. Là furent [les chevaliers gardiens d'Ypre] assaillis roidement et reculés contreval la rue, car la force n'estoit pas la leur [ils n'étaient pas en force]
, Froissart, II, II, 57. Le comte de Flandre manda ouvriers à force
, Froissart, II, II, 63. En toute Gascogne on ne trouveroit pas son pareil de force de membres
, Froissart, II, III, 10. Se vostre bonté n'y pourvoye, Force sera que par eux voye Finer ma vie maleurée
, Orléans, Fredet au duc d'Orl. Il y prenoit grant peine [à la chasse] pourtant qu'il couroit les cerfs à force
, Commines, VI, 13. Tous deux [Alphonse de Naples et son fils] ont pris à force plusieurs femmes
, Commines, VII, 11. Grant force d'archiers, gens de sa maison pensionnaires et autres gens de bien?
, Commines, I, 8. Ledit seigneur d'Aubigny estoit en force de cent cinquante, ou de deux cens hommes d'armes françois
, Commines, VII, 6. Veci telle femme, qui de vous se complaint très fort de force?: est-il ainsi?? l'avez-vous efforcée??
Louis XI, Nouv. XX. Ne dormoit ne nuit ne jour, de force de penser à sa dame
, Louis XI, ib. XLVIII. Un peu de belle force vaut moult
, Leroux de Lincy, Prov. t. II, p. 432. Item il convenroit passer par la force [lieux fortifiés] de plusieurs seigneurs, qui ne sont pas si entiers ne si loiaus aus chrestiens comme il deussent
, Du Cange, força.
XVIe s. Il mourut de force de rire
, Rabelais, Garg. I, 20. Il s'escria on meurtre et à la force, tant qu'il peut
, Rabelais, ib. I, 25. Mais, puysque? force me est te rappeller on subside de?
, Rabelais, ib. I, 29. Ils molestent tout leur voisinage à force de trinqueballer leurs cloches
, Rabelais, ib. I, 40. Le jugement de Pantagruel feut incontinent sceu et entendu de tout le monde, et imprimé à force [en quantité]
, Rabelais, Pant. II, 14. Force attractive
, Montaigne, I, 102. La force de l'imagination
, Montaigne, ib. I, 93. Pour gaigner cet advantage d'avoir faict force à [vaincre] leur constance
, Montaigne, I, 242. À toute force [de toutes ses forces]
, Montaigne, I, 367. Un enfant, arrivé à la force de se nourrir
, Montaigne, II, 163. La dame print patience moitié par force et moitié par ciseaux [jeu de mots sur force et forces]
, Despériers, Contes, XXXIV. Ses mariniers firent telle diligence de lever l'ancre, et faire, comme dit est, force et volte, que?
, Carloix, I, 37. ? Non force [qu'importe], dist M. de Vieilleville, nous avons du temps assez
, Carloix, V, 5. Le dit seigneur de Brissac, voyant la force n'estre sienne, delibera sa retraitte
, Du Bellay, M. 582. Ayans vescu longuement, il est force qu'ils ayent beaucoup veu
, Amyot, Préf. VII, 32. Juba veult à toute force que ce mot Ancylia ait esté tiré de la langue grecque
, Amyot, Numa, 23. Où force est, raison n'a lieu
, Leroux de Lincy, Prov. t. II, p. 365. Meurtres, larcins, force de femme ou autres cas enormes
, Coust. génér. t. II, p. 863. Tellement que, par force forcée, il faut que ce traité soit publié
, Mém. de Bellièvre et de Sillery, p. 340, dans LACURNE. Estant mon intention qu'il ne soit faict aucune force ny violence aux consciences de mes subjets
, Henri IV, Lettres missives, t. IV, p. 824.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
FORCE.En force, se dit d'une figure où la vigueur se manifeste. Il [l'Amour, de Bouchardon] allonge sa main gauche, autant qu'il est possible à une figure debout, en force, et qui n'est, par conséquent, que médiocrement inclinée
, J. Dumesnil, Hist. des amat. français, I, 283.
On lit dans le Messager de Cronstadt? Cette machine, qui est de 1400 forces nominales, est le moteur le plus puissant?, Journ. offic. 10 oct. 1874, p. 6938, 2e col.
On lit dans l'Invalide russe?:?Par le peu de puissance de la machine du Pérovsky (40 forces seulement), qui rend ce vapeur peu propre à remonter un fleuve aussi rapide que l'Amou-Daria, Journ. offic. 11 oct. 1874, p. 6956, 1re col.
Encyclopédie, 1re édition
FORCE, s. f. (Gramm. & Littér.) ce mot a été transporté du simple au figuré.
Force se dit de toutes les parties du corps qui sont en mouvement, en action ; la force du c?ur, que quelques-uns ont fait de quatre cents livres, & d'autres de trois onces ; la force des visceres, des poumons, de la voix ; à force de bras.
On dit par analogie, faire force de voiles, de rames ; rassembler ses forces ; connoître, mesurer ses forces ; aller, entreprendre au-delà de ses forces ; le travail de l'Encyclopédie est au-dessus des forces de ceux qui se sont déchaînés contre ce livre. On a long-tems appellé forces de grands ciseaux (Voyez Forces, Arts méch.) ; & c'est pourquoi dans les états de la ligue on fit une estampe de l'ambassadeur d'Espagne, cherchant avec ses lunettes ses ciseaux qui étoient à terre, avec ce jeu de mots pour inscription, j'ai perdu mes forces.
Le style très-familier admet encore, force gens, forces gibier, force fripons, force mauvais critiques. On dit, à force de travailler il s'est épuisé ; le fer s'affoiblit à force de le polir.
La métaphore qui a transporté ce mot dans la Morale, en a fait une vertu cardinale. La force en ce sens est le courage de soûtenir l'adversité, & d'entreprendre des choses vertueuses & difficiles, animi fortitudo.
La force de l'esprit est la pénétration, & la profondeur, ingenii vis. La nature la donne comme celle du corps ; le travail modéré les augmente, & le travail outré les diminue.
La force d'un raisonnement consiste dans une exposition claire, des preuves exposées dans leur jour, & une conclusion juste ; elle n'a point lieu dans les théorèmes mathématiques, parce qu'une démonstration ne peut recevoir plus ou moins d'évidence, plus ou moins de force ; elle peut seulement procéder par un chemin plus long ou plus court, plus simple ou plus compliqué. La force du raisonnement a sur-tout lieu dans les questions problématiques. La force de l'éloquence n'est pas seulement une suite de raisonnemens justes & vigoureux, qui subsisteroient avec la sécheresse ; cette force demande de l'embonpoint, des images frappantes, des termes énergiques. Ainsi on a dit que les sermons de Bourdaloue avoient plus de force, ceux de Massillon plus de graces. Des vers peuvent avoir de la force, & manquer de toutes les autres beautés. La force d'un vers dans notre langue vient principalement de l'art de dire quelque chose dans chaque hémystiche :
Et monté sur le faîte, il aspire à descendre.
L'éternel est son nom, le monde est son ouvrage.
Ces deux vers pleins de force & d'élégance, sont le
meilleur modele de la Poésie.
La force dans la Peinture est l'expression des muscles, que des touches ressenties font paroître en action sous la chair qui les couvre. Il y a trop de force quand ces muscles sont trop prononcés. Les attitudes des combattans ont beaucoup de force dans les batailles de Constantin, dessinées par Raphael & par Jules romain, & dans celles d'Alexandre peintes par le Brun. La force outrée est dure dans la Peinture, empoulée dans la Poésie.
Des philosophes ont prétendu que la force est une qualité inhérente à la matiere ; que chaque particule invisible, ou plûtôt monade, est doüée d'une force active : mais il est aussi difficile de démontrer cette assertion, qu'il le seroit de prouver que la blancheur est une qualité inhérente à la matiere, comme le dit le dictionnaire de Trévoux à l'article Inhérent.
La force de tout animal a reçu son plus haut degré, quand l'animal a pris toute sa croissance ; elle décroît, quand les muscles ne reçoivent plus une nourriture égale, & cette nourriture cesse d'être égale quand les esprits animaux n'impriment plus à ces muscles le mouvement accoûtumé. Il est si probable que ces esprits animaux sont du feu, que les vieillards manquent de mouvement, de force, à mesure qu'ils manquent de chaleur. Voyez les articles suivans. Article de M. de Voltaire.
Force, (Iconolog.) On représente la force sous la figure d'une femme vêtue d'une peau de lion, appuyée d'une main sur un bout de colonne, & tenant de l'autre main un rameau de chêne. Elle est quelquefois accompagnée d'un lion.
Force, terme fort usité en Méchanique, & auquel les Méchaniciens attachent différens sens, dont nous allons detailler les principaux.
Force d'inertie, est la propriété qui est commune à tous les corps de rester dans leur état, soit de repos ou de mouvement, à moins que quelque cause étrangere ne les en fasse changer.
Les corps ne manifestent cette force, que lorsqu'on veut changer leur état ; & on lui donne alors le nom de résistance ou d'action, suivant l'aspect sous lequel on la considere. On l'appelle résistance, lorsqu'on veut parler de l'effort qu'un corps fait contre ce qui tend à changer son état ; & on la nomme action, lorsqu'on veut exprimer l'effort que le même corps fait pour changer l'état de l'obstacle qui lui résiste. Voyez Action, Cosmologie, & la suite de cet article.
Dans la définition de la force d'inertie, je me suis servi du mot de propriété, plûtôt que de celui de puissance ; parce que le second de ces mots semble désigner un être métaphysique & vague, qui réside dans le corps, & dont on n'a point d'idée nette ; au lieu que le premier ne désigne qu'un effet constamment observé dans les corps.
Preuves de la force d'inertie. On voit d'abord fort clairement qu'un corps ne peut se donner le mouvement à lui-même : il ne peut donc être tiré du repos que par l'action de quelque cause étrangere. De-là il s'ensuit que si un corps reçoit du mouvement par quelque cause que ce puisse être, il ne pourra de lui-même accélérer ni retarder ce mouvement. On appelle en général puissance ou cause motrice, tout ce qui oblige un corps à se mouvoir. Voyez Puissance, &c.
Un corps mis une fois en mouvement par une cause quelconque, doit y persister toûjours uniformément & en ligne droite, tant qu'une nouvelle cause différente de celle qui l'a mis en mouvement, n'agira pas sur lui, c'est-à-dire qu'à moins qu'une cause étrangere & différente de la cause motrice n'agisse sur ce corps, il se mouvra perpétuellement en ligne droite, & parcourra en tems égaux des espaces égaux.
Car, ou l'action indivisible & instantanée de la cause motrice au commencement du mouvement, suffit pour faire parcourir au corps un certain espace, ou le corps a besoin pour se mouvoir de l'action continuée de la cause motrice.
Dans le premier cas, il est visible que l'espace parcouru ne peut être qu'une ligne droite décrite uniformément par le corps mû : car (hyp.) passé le premier instant, l'action de la cause motrice n'existe plus, & le mouvement néanmoins subsiste encore : il sera donc nécessairement uniforme, puisqu'un corps ne peut accélérer ni retarder son mouvement de lui-même. De plus, il n'y a pas de raison pour que le corps s'écarte à droite plûtôt qu'à gauche ; donc dans ce premier cas, où l'on suppose qu'il soit capable de se mouvoir de lui-même pendant un certain tems, indépendamment de la cause motrice, il se mouvra de lui même pendant ce tems uniformément & en ligne droite.
Or un corps qui peut se mouvoir de lui-même uniformément & en ligne droite pendant un certain tems, doit continuer perpétuellement à se mouvoir de la même maniere, si rien ne l'en empêche : car supposons le corps partant de A, (fig. 32. Méchan.) & capable de parcourir de lui-même uniformément la ligne AB ; soient pris sur la ligne AB deux points quelconques C, D, entre A & B ; le corps étant en D est précisément dans le même état que lorsqu'il est en C, si ce n'est qu'il se trouve dans un autre lieu. Donc il doit arriver à ce corps la même chose que quand il est en C. Or étant en C, il peut (hyp.) se mouvoir de lui-même uniformément jusqu'en B. Donc étant en D, il pourra se mouvoir de lui-même uniformément jusqu'au point G, tel que DG = CB, & ainsi de suite.
Donc si l'action premiere & instantanée de la cause motrice est capable de mouvoir le corps, il sera mû uniformément & en ligne droite, tant qu'une nouvelle cause ne l'en empêchera pas.
Dans le second cas, puisqu'on suppose qu'aucune cause étrangere & différente de la cause motrice n'agit sur le corps, rien ne détermine donc la cause motrice à augmenter ni à diminuer ; d'où il s'ensuit que son action continuée sera uniforme & constante, & qu'ainsi pendant le tems qu'elle agira, le corps se mouvra en ligne droite & uniformément. Or la même raison qui a fait agir la cause motrice constamment & uniformément pendant un certain tems, subsistant toûjours tant que rien ne s'oppose à son action, il est clair que cette action doit demeurer continuellement la même, & produire constamment le même effet. Donc, &c.
Donc en général un corps mis en mouvement par quelque cause que ce soit, y persistera toûjours uniformément & en ligne droite, tant qu'aucune cause nouvelle n'agira pas sur lui.
La ligne droite qu'un corps décrit ou tend à décrire, est nommée sa direction. Voyez Direction.
Nous nous sommes un peu étendus sur la preuve de cette seconde loi, parce qu'il y a eu & qu'il y a peut-être encore quelques philosophes qui prétendent que le mouvement d'un corps doit de lui-même se ralentir peu-à-peu, comme il semble que l'expérience le prouve. Il faut convenir au reste, que les preuves qu'on donne ordinairement de la force d'inertie, en tant qu'elle est le principe de la conservation du mouvement, n'ont point le degré d'évidence nécessaire pour convaincre l'esprit ; elles sont presque toutes fondées, ou sur une force qu'on imagine dans la matiere, par laquelle elle résiste à tout changement d'état, ou sur l'indifférence de la matiere au mouvement comme au repos. Le premier de ces deux principes, outre qu'il suppose dans la matiere un être dont on n'a point d'idée nette, ne peut suffire pour prouver la loi dont il est question : car lorsqu'un corps se meut, même uniformément, le mouvement qu'il a dans un instant quelconque, est distingué & comme isolé du mouvement qu'il a eu ou qu'il aura dans les instans précédens ou suivans. Le corps est donc en quelque maniere à chaque instant dans un nouvel état ; il ne fait, pour ainsi dire, continuellement que commencer à se mouvoir, & on pourroit croire qu'il tendroit sans cesse à retomber dans le repos, si la même cause qui l'en a tiré d'abord, ne continuoit en quelque sorte à l'en tirer toûjours.
A l'égard de l'indifférence de la matiere au mouvement ou au repos, tout ce que ce principe présente, ce me semble, de bien distinct à l'esprit, c'est qu'il n'est pas essentiel à la matiere de se mouvoir toûjours, ni d'être toûjours en repos ; mais il ne s'ensuit pas de cette loi, qu'un corps en mouvement ne puisse tendre continuellement au repos, non que le repos lui soit plus essentiel que le mouvement, mais parce qu'il pourroit sembler qu'il ne faudroit autre chose à un corps pour être en repos, que d'être un corps, & que pour le mouvement il auroit besoin de quelque chose de plus, & qui devroit être pour ainsi dire continuellement reproduit en lui.
La démonstration que j'ai donnée de la conservation du mouvement, a cela de particulier, qu'elle a lieu également, soit que la cause motrice doive toûjours être appliquée au corps, ou non. Ce n'est pas que je croye l'action continuée de cette cause, nécessaire pour mouvoir le corps ; car si l'action instantanée ne suffisoit pas, quel seroit alors l'effet de cette action ? & si l'action instantanée n'avoit point d'effet, comment l'action continuée en auroit-elle ? Mais comme on doit employer à la solution d'une question le moins de principes qu'il est possible, j'ai cru devoir me borner à démontrer que la continuation du mouvement a lieu également dans les deux hypothèses : il est vrai que notre démonstration suppose l'existence du mouvement, & à plus forte raison sa possibilité ; mais nier que le mouvement existe, c'est se refuser à un fait que personne ne révoque en doute. Voyez Mouvement.
Voilà, si je ne me trompe, comment on peut prouver la loi de la continuation du mouvement, d'une maniere qui soit à l'abri de toute chicane. Dans le mouvement il semble, comme nous l'avons déja observé, qu'il y ait en quelque sorte un changement d'état continuel ; & cela est vrai dans ce seul sens, que le mouvement du corps, dans un instant quelconque, n'a rien de commun avec son mouvement dans l'instant précédent ou suivant. Mais on auroit tort d'entendre par changement d'état, le changement de place ou de lieu que le mouvement produit : car quand on examine ce prétendu changement d'état avec des yeux philosophiques, on n'y voit autre chose qu'un changement de relation, c'est-à-dire un changement de distance du corps mû aux corps environnans.
Nous sommes fort enclins à croire qu'il y a dans un corps en mouvement un effort ou énergie, qui n'est point dans un corps en repos. La raison pour laquelle nous avons tant de peine à nous détacher de cette idée, c'est que nous sommes toûjours portés à transférer aux corps inanimés les choses que nous observons dans notre propre corps. Ainsi nous voyons que quand notre corps se meut, ou frappe quelque obstacle, le choc ou le mouvement est accompagné en nous d'une sensation qui nous donne l'idée d'une force plus ou moins grande ; or en transportant aux autres corps ce même mot force, nous appercevrons avec une legere attention, que nous ne pouvons y attacher que trois différens sens : 1°. celui de la sensation que nous éprouvons, & que nous ne pouvons pas supposer dans une matiere inanimée : 2°. celui d'un être métaphysique, différent de la sensation, mais qu'il nous est impossible de concevoir, & par conséquent de définir : 3°. enfin (& c'est le seul sens raisonnable) celui de l'effet même, ou de la propriété qui se manifeste par cet effet, sans examiner ni rechercher la cause. Or en attachant au mot force ce dernier sens, nous ne voyons rien de plus dans le mouvement, que dans le repos, & nous pouvons regarder la continuation du mouvement, comme une loi aussi essentielle que celle de la continuation du repos. Mais, dira-t-on, un corps en repos ne mettra jamais un corps en mouvement ; au lieu qu'un corps en mouvement meut un corps en repos. Je réponds que si un corps en mouvement meut un corps en repos, c'est en perdant lui-même une partie de son mouvement ; & cette perte vient de la résistance que fait le corps en repos au changement d'état. Un corps en repos n'a donc pas moins une force réelle pour conserver son état, qu'un corps en mouvement, quelque idée qu'on attache au mot force. Voyez Communication de mouvement, &c.
Le principe de la force d'inertie peut se prouver aussi par l'expérience. Nous voyons 1°. que les corps en repos y demeurent tant que rien ne les en tire ; & si quelquefois il arrive qu'un corps soit mû sans que nous connoissions la cause qui le meut, nous sommes en droit de juger, & par l'analogie, & par l'uniformité des lois de la nature, & par l'incapacité de la matiere à se mouvoir d'elle-même, que cette cause, quoique non apparente, n'en est pas moins réelle. 2°. Quoiqu'il n'y ait point de corps qui conserve éternellement son mouvement, parce qu'il y a toûjours des causes qui le rallentissent peu-à-peu, comme le frotement & la résistance de l'air ; cependant nous voyons qu'un corps en mouvement y persiste d'autant plus long-tems, que les causes qui retardent ce mouvement sont moindres : d'où nous pouvons conclure que le mouvement ne finiroit point, si les forces retardatrices étoient nulles.
L'expérience journaliere de la pesanteur semble démentir le premier de ces deux principes. La multitude a peine à s'imaginer qu'il soit nécessaire qu'un corps soit poussé vers la terre pour s'en approcher ; accoûtumée à voir tomber un corps dès qu'il n'est pas soûtenu, elle croit que cette seule raison suffit pour obliger le corps à se mouvoir. Mais une réflexion bien simple peut desabuser de cette opinion. Qu'on place un corps sur une table horisontale ; pourquoi ce corps ne se meut-il pas horisontalement le long de la table, puisque rien ne l'en empêche ? pourquoi ce corps ne se meut-il pas de bas en-haut, puisque rien n'arrête son mouvement en ce sens ? Donc, puisque le corps se meut de haut en-bas, & que par lui-même il est évidemment indifférent à se mouvoir dans un sens plûtôt que dans un autre, il y a quelque cause qui le détermine à se mouvoir en ce sens. Ce n'est donc pas sans raison que les Philosophes s'étonnent de voir tomber une pierre ; & le peuple qui rit de leur étonnement, le partage bien-tôt lui-même pour peu qu'il refléchisse.
Il y a plus : la plûpart des corps que nous voyons se mouvoir, ne sont tirés du repos que par l'impulsion visible de quelque autre corps. Nous devons donc être naturellement portés à juger que le mouvement est toûjours l'effet de l'impulsion : ainsi la premiere idée d'un philosophe qui voit tomber un corps, doit être que ce corps est poussé par quelque fluide invisible. S'il arrive cependant qu'après avoir approfondi davantage cette matiere, on trouve que la pesanteur ne puisse s'expliquer par l'impulsion d'un fluide, & que les phénomenes se refusent à cette hypothèse ; alors le philosophe doit suspendre son jugement, & peut-être même doit-il commencer à croire qu'il peut y avoir quelque autre cause du mouvement des corps que l'impulsion ; ou du moins (ce qui est aussi contraire aux principes communément reçûs) que l'impulsion des corps, & sur-tout de certains fluides inconnus, peut avoir des lois toutes différentes de celles que l'expérience nous a fait découvrir jusqu'ici. Voyez Attraction.
Un savant géometre de nos jours (Voyez Euleri opuscula, Berlin, 1746.) prétend que l'attraction, quand on la regarde comme un principe différent de l'impulsion, est contraire au principe de la force d'inertie, & par conséquent ne peut appartenir aux corps ; car, dit ce géometre, un corps ne peut se donner le mouvement à lui-même, & par conséquent ne peut tendre de lui-même vers un autre corps, sans y être déterminé par quelque cause. Il suffit de répondre à ce raisonnement, 1°. que la tendance des corps les uns vers les autres, quelle qu'en soit la cause, est une loi de la nature constatée par les phénomenes. Voyez Gravitation. 2°. Que si cette tendance n'est point produite par l'impulsion, ce que nous ne décidons pas, en ce cas la présence d'un autre corps suffit pour altérer le mouvement de celui qui se meut ; & que comme l'action de l'ame sur le corps n'empêche pas le principe de la force d'inertie d'être vrai, de même l'action d'un corps sur un autre, exercée à distance, ne nuit point à la vérité de ce principe, parce que dans l'énoncé de ce principe, on fait abstraction de toutes les causes (quelles qu'elles puissent être) qui peuvent altérer le mouvement du corps, soit que nous puissions comprendre ou non la maniere d'agir de ces forces.
Le même géometre va plus loin ; il entreprend de prouver que la force d'inertie est incompatible avec la faculté de penser, parce que cette derniere faculté entraîne la propriété de changer de soi-même son état : d'où il conclut que la force d'inertie étant une propriété reconnue de la matiere, la faculté de penser n'en sauroit être une. Nous applaudissons au zele de cet auteur pour chercher une nouvelle preuve d'une vérité que nous ne prétendons pas combattre : cependant à considérer la chose uniquement en philosophes, nous ne voyons pas que pas cette nouvelle preuve il ait fait un grand pas en Métaphysique. La force d'inertie n'a lieu, comme l'expérience le prouve, que dans la matiere brute, c'est-à-dire dans la matiere qui n'est point unie à un principe intelligent dont la volonté la meut : ainsi soit que la matiere reçoive par elle-même la faculté de penser (ce que nous sommes bien éloignés de croire), soit qu'un principe intelligent & d'une nature différente lui soit uni, dès-lors elle perdra la force d'inertie, ou, pour parler plus exactement, elle ne paroîtra plus obéir à cette force. Sans doute il n'est pas plus aisé de concevoir comment ce principe intelligent, uni à la matiere & différent d'elle, peut agir sur elle pour la mouvoir, que de comprendre comment la force d'inertie peut se concilier avec la faculté de penser, que les Matérialistes attribuent faussement aux corps : mais nous sommes certains par la religion, que la matiere ne peut penser ; & nous sommes certains par l'expérience, que l'ame agit sur le corps. Tenons-nous-en donc à ces deux vérités incontestables, sans entreprendre de les concilier.
Force vive, ou Force des Corps en mouvement ; c'est un terme qui a été imaginé par M. Leibnitz, pour distinguer la force d'un corps actuellement en mouvement, d'avec la force d'un corps qui n'a que la tendance au mouvement, sans se mouvoir en effet : ce qui a besoin d'être expliqué plus au long.
Supposons, dit M. Leibnitz, un corps pesant appuyé sur un plan horisontal. Ce corps fait un effort pour descendre ; & cet effort est continuellement arrêté par la résistance du plan ; de sorte qu'il se réduit à une simple tendance au mouvement. M. Leibnitz appelle cette force & les autres de la même nature, force mortes.
Imaginons au contraire, ajoûte le même philosophe, un corps pesant qui est jetté de bas en haut, & qui en montant ralentit toûjours son mouvement à cause de l'action de la pesanteur, jusqu'à ce qu'enfin sa force soit totalement perdue, ce qui arrive lorsqu'il est parvenu à la plus grande hauteur à laquelle il peut monter ; il est visible que la force de ce corps se détruit par degrés & se consume en s'exerçant. M. Leibnitz appelle force vive cette derniere force, pour la distinguer de la premiere, qui naît & meurt au même instant ; & en général, il appelle force vive la force d'un corps qui se meut d'un mouvement continuellement retardé & rallenti par des obstacles, jusqu'à ce qu'enfin ce mouvement soit anéanti, après avoir été successivement diminué par des degrés insensibles. M. Leibnitz convient que la force morte est comme le produit de la masse par la vîtesse virtuelle, c'est-à-dire avec laquelle le corps tend à se mouvoir, suivant l'opinion commune. Ainsi pour que deux corps qui se choquent ou qui se tirent directement, se fassent équilibre, il faut que le produit de la masse par la vîtesse virtuelle soit le même de part & d'autre. Or en ce cas, la force de chacun de ces deux corps est une force morte, puisqu'elle est arrêtée tout-à-la-fois & comme en son entier par une force contraire. Donc dans ce cas, le produit de la masse par la vîtesse doit représenter la force. Mais M. Leibnitz soûtient que la force vive doit se mesurer autrement, & qu'elle est comme le produit de la masse par le quarré de la vîtesse ; c'est-à-dire qu'un corps qui a une certaine force lorsqu'il se meut avec une vîtesse donnée, aura une force quadruple, s'il se meut avec une vîtesse double ; une force neuf fois aussi grande, s'il se meut avec une vîtesse triple, &c. & qu'en général, si la vitesse est successivement 1, 2, 3, 4, &c. la force sera comme 1, 4, 9, 16, &c. c'est-à-dire comme les quarrés des nombre 1, 2, 3, 4 : au lieu que si ce corps n'étoit pas réellement en mouvement, mais tendoit à se mouvoir avec les vitesses 1, 2, 3, 4, &c. sa force n'étant alors qu'une force morte, seroit comme 1, 2, 3, 4, &c.
Dans le système des adversaires des force vives, la force des corps en mouvement est toûjours proportionnelle à ce qu'on appelle autrement quantité de mouvement, c'est-à-dire au produit de la masse des corps par la vitesse ; au lieu que dans le système opposé, elle est le produit de la quantité de mouvement par la vîtesse.
Pour réduire cette question à son énoncé le plus simple, il s'agit de savoir si la force d'un corps qui a une certaine vitesse, devient double ou quadruple quand sa vîtesse devient double. Tous les Méchaniciens avoient crû jusqu'à M. Leibnitz qu'elle étoit simplement double : ce grand philosophe soûtint le premier qu'elle étoit quadruple ; & il le prouvoit par le raisonnement suivant. La force d'un corps ne se peut mesurer que par ses effets & par les obstacles qu'elle lui fait vaincre. Or si un corps pesant étant jetté de bas en haut avec une certaine vîtesse monte à la hauteur de quinze piés, il doit, de l'aveu de tout le monde, monter à la hauteur de 60 piés, étant jetté de bas en haut avec une vîtesse double, voyez Accélération. Il fait donc dans ce dernier cas quatre fois plus d'effet, & surmonte quatre fois plus d'obstacles : sa force est donc quadruple de la premiere. M. Jean Bernoulli, dans son discours sur les lois de la communication du mouvement, imprimé en 1726, & joint au recueil général de ses ?uvres, a ajoûté à cette preuve de M. Leibnitz une grande quantité d'autres preuves. Il a démontré qu'un corps qui ferme ou bande un ressort avec une certaine vîtesse, peut avec une vîtesse double, fermer quatre ressorts semblables au premier ; neuf avec une vîtesse triple, &c. M. Bernoulli fortifie ce nouvel argument en faveur des forces vives, par d'autres observations très curieuses & très-importantes, dont nous aurons lieu de parler plus bas, à l'article Conservation des Forces vives . Cet ouvrage a été l'époque d'une espece de schisme entre les savans sur la mesure des forces.
La principale réponse qu'on a faite aux objections des partisans des forces vives, voyez les mém. de l'académie de 1728, consiste à réduire le mouvement retardé en uniforme, & à soûtenir qu'en ce cas la force n'est que comme la vitesse : on avoue qu'un corps qui parcourt quinze piés de bas en haut, parcourra soixante piés avec une vîtesse double : mais on dit qu'il parcourra ces soixante piés dans un tems double du premier. Si son mouvement étoit uniforme, il parcourroit dans ce même tems double cent vingt piés, voyez Accélération. Or dans le cas où il parcourroit quinze piés d'un mouvement retardé, il parcourroit trente piés dans le même tems, & soixante piés dans un tems double avec un mouvement uniforme : les effets sont donc ici comme 120 & 60, c'est-à-dire comme 2 & 1 ; & par conséquent la force dans le premier cas n'est que double de l'autre, & non pas quadruple. Ainsi, conclut-on, un corps pesant parcourt quatre fois autant d'espace avec une vîtesse double, mais il le parcourt en un tems double ; & cela équivaut à un effet double & non pas quadruple. Il faut donc, dit-on, diviser l'espace par le tems pour avoir l'effet auquel la force est proportionnelle, & non pas faire la force proportionnelle à l'espace. Les défenseurs des forces vives répondent à cela, que la nature d'une force plus grande est de durer plus longtems ; & qu'ainsi il n'est pas surprenant qu'un corps pesant qui parcourt quatre fois autant d'espace, le parcoure en un tems double : que l'effet réel de la force est de faire parcourir quatre fois autant d'espace : que le plus ou moins de tems n'y fait rien ; parce que ce plus ou moins de tems vient du plus ou moins de grandeur de la force ; & qu'il n'est point vrai de dire, comme il paroît résulter de la réponse de leurs adversaires, que la force soit d'autant plus petite, toutes choses d'ailleurs égales, que le tems est plus grand ; puisqu'au contraire il est infiniment plus naturel de croire qu'elle doit être d'autant plus grande qu'elle est plus long-tems à se consumer.
Au reste, il est bon de remarquer que pour supposer la force proportionnelle au quarré de la vîtesse, il n'est pas nécessaire, selon les partisans des forces vives, que cette force se consume réellement & actuellement en s'exerçant ; il suffit d'imaginer qu'elle puisse être consumée & anéantie peu-à-peu par degrés infiniment petits. Dans un corps mû uniformément, la force n'en est pas moins proportionnelle au quarré de la vîtesse, selon ces Philosophes, quoique cette force demeure toûjours la même ; parce que si cette force s'exerçoit contre des obstacles qui la consumassent par degrés, son effet seroit alors comme le quarré de la vîtesse.
Nous renvoyons nos lecteurs à ce qu'on a écrit pour & contre les forces vives dans les mémoires de l'acad. 1728, dans ceux de Petersbourg, tome I. & dans d'autres ouvrages. Mais au lieu de rappeller ici tout ce qui a été dit sur cette question, il ne sera peut-être pas inutile d'exposer succinctement les principes qui peuvent servir à la résoudre.
Quand on parle de la force des corps en mouvement, ou l'on n'attache point d'idée nette au mot que l'on prononce, ou l'on ne peut entendre par-là en général que la propriété qu'ont les corps qui se meuvent, de vaincre les obstacles qu'ils rencontrent, ou de leur résister. Ce n'est donc ni par l'espace qu'un corps parcourt uniformément, ni par le tems qu'il employe à le parcourir, ni enfin par la considération simple, unique, & abstraite de sa masse & de sa vîtesse, qu'on doit estimer immédiatement la force ; c'est uniquement par les obstacles qu'un corps rencontre, & par la résistance que lui font ces obstacles. Plus l'obstacle qu'un corps peut vaincre, ou auquel il peut résister, est considérable, plus on peut dire que sa force est grande ; pourvû que sans vouloir représenter par ce mot un prétendu être qui réside dans le corps, on ne s'en serve que comme d'une maniere abrégée d'exprimer un fait ; à-peu-près comme on dit, qu'un corps a deux fois autant de vîtesse qu'un autre, au lieu de dire qu'il parcourt on tems égal deux fois autant d'espace, sans prétendre pour cela que ce mot de vîtesse représente un être inhérent au corps.
Ceci bien entendu, il est clair qu'on peut opposer au mouvement d'un corps trois sortes d'obstacles ; ou des obstacles invincibles qui anéantissent tout-à-fait son mouvement, quel qu'il puisse être ; ou des obstacles qui n'ayent précisément que la résistance nécessaire pour anéantir le mouvement du corps, & qui l'anéantissent dans un instant, c'est le cas de l'équilibre ; ou enfin des obstacles qui anéantissent le mouvement peu-à-peu ; c'est le cas du mouvement retardé. Comme les obstacles insurmontables anéantissent également toutes sortes de mouvemens, ils ne peuvent servir à faire connoître la force : ce n'est donc que dans l'équilibre, ou dans le mouvement retardé, qu'on doit en chercher la mesure. Or tout le monde convient qu'il y a équilibre entre deux corps quand les produits de leurs masses par leurs vîtesses virtuelles, c'est-à-dire par les vîtesses avec lesquelles ils tendent à se mouvoir, sont égaux de part & d'autre. Donc dans l'équilibre, le produit de la masse par la vîtesse, ou, ce qui est la même chose, la quantité de mouvement peut représenter la force. Tout le monde convient aussi que dans le mouvement retardé, le nombre des obstacles vaincus est comme le quarré de la vîtesse : en sorte qu'un corps qui a fermé un ressort, par exemple, avec une certaine vîtesse, pourra avec une vîtesse double fermer, ou tout-à-la-fois ou successivement, non pas deux, mais quatre ressorts semblables au premier, neuf avec une vîtesse triple, & ainsi du reste. D'où les partisans des forces vives concluent que la force des corps qui se meuvent actuellement, est en général comme le produit de la masse par le quarré de la vîtesse. Au fond, quel inconvénient pourroit-il y avoir à ce que la mesure des forces fût différente dans l'équilibre & dans le mouvement retardé, puisque si on veut ne raisonner que d'après des idées claires, on doit n'entendre par le mot de force, que l'effet produit en surmontant l'obstacle, ou en lui résistant ? Il faut avoüer cependant, que l'opinion de ceux qui regardent la force comme le produit de la masse par la vîtesse, peut avoir lieu non seulement dans le cas de l'équilibre, mais aussi dans celui du mouvement retardé, si dans ce dernier cas on mesure la force, non par la quantité absolue des obstacles, mais par la somme des résistances de ces mêmes obstacles. Car cette somme de résistances est proportionnelle à la quantité de mouvement, puisque, de l'aveu général, la quantité de mouvement que le corps perd à chaque instant, est proportionnelle au produit de la résistance par la durée infiniment petite de l'instant ; & que la somme de ces produits est évidemment la résistance totale. Toute la difficulté se réduit donc à savoir si on doit mesurer la force par la quantité absolue des obstacles, ou par la somme de leurs résistances. Il me paroîtroit plus naturel de mesurer la force de cette derniere maniere : car un obstacle n'est tel qu'en tant qu'il résiste ; & c'est, à proprement parler, la somme des résistances qui est l'obstacle vaincu. D'ailleurs en estimant ainsi la force, on a l'avantage d'avoir pour l'équilibre & pour le mouvement retardé une mesure commune : néanmoins, comme nous n'avons d'idée précise & distincte du mot de force, qu'en restraignant ce terme à exprimer un effet, je crois qu'on doit laisser chacun le maître de se décider comme il voudra là-dessus ; & toute la question ne peut plus consister que dans une discussion métaphysique très-futile, ou dans une dispute de mots plus indigne encore d'occuper des Philosophes.
Ce que nous venons de dire sur la fameuse question des forces vives, est tiré de la préface de notre traité de Dynamique, imprimé en 1743, dans le tems que cette question étoit encore fort agitée parmi les Savans. Il semble que les Géometres conviennent aujourd'hui assez unanimement de ce que nous soûtenions alors, que c'est une dispute de mots : & comment n'en seroit-ce pas une, puisque les deux partis sont d'ailleurs entierement d'accord sur les principes fondamentaux de l'équilibre & du mouvement ? En effet, qu'on propose un problème de Dynamique à résoudre à deux géometres habiles, dont l'un soit adversaire & l'autre partisan des forces vives, leurs solutions, si elles sont bonnes, s'accorderont parfaitement entre elles : la mesure des forces est donc une question aussi inutile à la Méchanique, que les questions sur la nature de l'étendue & du mouvement : sur quoi on peut voir ce que nous avons dit au mot Elémens des Sciences, tome V. pag. 493. col. 1. & 2. Dans le mouvement d'un corps nous ne voyons clairement que deux choses ; l'espace parcouru, & le tems qu'il employe à le parcourir. C'est de cette seule idée qu'il faut déduire tous les principes de la Méchanique, & qu'on peut en effet les déduire. Voyez Dynamique.
Une considération qu'il ne faut pas négliger, & qui prouve bien qu'il ne s'agit ici que d'une question de nom toute pure ; c'est que soit qu'un corps ait une simple tendance au mouvement arrêtée par quelque obstacle, soit qu'il se meuve d'un mouvement uniforme avec la vîtesse que cette tendance suppose, soit enfin que commençant à se mouvoir avec cette vîtesse, son mouvement soit anéanti peu-à-peu par quelque obstacle ; dans tous ces cas, l'effet produit par le corps est différent : mais le corps en lui même ne reçoit rien de nouveau ; seulement son action est différemment appliquée. Ainsi quand on dit que la force d'un corps est dans certains cas comme la vîtesse, dans d'autres comme le quarré de la vîtesse ; on veut dire seulement que l'effet dans certains cas est comme la vîtesse, dans d'autres comme le quarré de cette vîtesse : encore doit on remarquer que le mot effet est ici lui-même un terme assez vague, & qui a besoin d'être défini avec d'autant plus d'exactitude, qu'il a des sens différens dans chacun des trois cas dont nous venons de parler. Dans le premier, il signifie l'effort que le corps fait contre l'obstacle ; dans le second, l'espace parcouru dans un tems donné & constant ; dans le troisieme, l'espace parcouru jusqu'à l'extinction totale du mouvement, sans avoir d'ailleurs aucun égard au tems que la force a mis à se consumer.
On peut remarquer par tout ce que nous venons de dire, qu'un même corps, selon que sa tendance au mouvement est différemment appliquée, produit différens effets ; les uns proportionnels à sa vîtesse, les autres au quarré de sa vîtesse. Ainsi ce prétendu axiome, que les effets sont proportionnels à leurs causes, est au moins très-mal énoncé, puisque voilà une même cause qui produit différens effets. Il faudroit mettre cette restriction à la proposition dont il s'agit, que les effets sont proportionnels à leurs causes, agissantes de la même maniere. Mais nous avons déjà fait voir aux mots Accélératrice & Cause, que ce prétendu axiome est un principe très-vague, très-mal exprimé, absolument inutile à la Méchanique, & capable de conduire à bien des paralogismes, quand on n'en fait pas usage avec précaution.
Conservation des forces vives. C'est un principe de Méchanique que M. Huyghens semble avoir apperçû le premier, & dont M. Bernoulli, & plusieurs autres géometres après lui, ont fait voir depuis l'étendue & l'usage dans la solution des problèmes de Dynamique. Voici quel est ce principe ; il consiste dans les deux lois suivantes.
1°. Si des corps agissent les uns sur les autres, soit en se tirant par des fils ou des verges inflexibles, soit en se poussant, soit en se choquant, pourvû que dans ce dernier cas, ils soient à ressort parfait, la somme des produits des masses par les quarrés des vîtesses fait toûjours une quantité constante. 2°. Si les corps sont animés par des puissances quelconques, la somme des produits des masses par les quarrés des vîtesses à chaque instant, est égale à la somme des produits des masses par les quarrés des vîtesses initiales, plus les quarrés des vîtesses que les corps auroient acquises, si étant animés par les mêmes puissances, ils s'étoient mûs librement chacun sur la ligne qu'il a décrite.
Nous avons dit soit en se poussant, soit en se choquant, & nous distinguons la pulsion d'avec le choc, parce que la conservation des forces vives a lieu dans les mouvemens des corps qui se poussent, pourvû que ces mouvemens ne changent que par degrés insensibles, ou plûtôt infiniment petits ; au lieu qu'elle a lieu dans les corps élastiques qui se choquent, dans le cas même où le ressort agiroit en un instant indivisible, & les feroit passer sans gradation d'un mouvement à un autre.
M. Huyghens paroît être le premier qui ait apperçu cette loi de la conservation des forces vives dans le choc des corps élastiques. Il paroît aussi avoir connu la loi de la conservation des forces vives dans le mouvement des corps qui sont animés par des puissances. Car le principe dont il se sert pour résoudre le problème des centres d'oscillation, n'est autre chose que la seconde loi exprimée autrement. M. Jean Bernoulli dans son discours sur les lois de la communication du mouvement dont nous avons parlé, a développé & étendu cette découverte de M. Huyghens, & il n'a pas oublié de s'en servir pour prouver son opinion sur la mesure des forces, à laquelle il croit ce principe très-favorable, puisque dans l'action mutuelle de deux corps, ce n'est presque jamais la somme des produits des masses par les vîtesses qui fait une somme constante, mais la somme des produits des masses par les quarrés des vîtesses. Descartes croyoit que la même quantité de force devoit toûjours subsister dans l'univers, & en conséquence il prétendoit faussement que le mouvement ne pouvoit pas se perdre, parce qu'il supposoit la force proportionnelle à la quantité de mouvement. Ce philosophe n'auroit peut-être pas été éloigné d'admettre la mesure des forces vives par les quarrés des vîtesses, si cette idée lui fût venue dans l'esprit. Cependant si on fait attention à ce que nous avons dit ci-dessus sur la notion qu'on doit attacher au mot de force, il semble que cette nouvelle preuve en faveur des forces vives, ou ne présente rien de net à l'esprit, ou ne lui présente qu'un fait & une vérité avoués de tout le monde.
Dans mon traité de Dynamique imprimé en 1743, j'ai démontré le principe de la conservation des forces vives dans tous les cas possibles ; & j'ai fait voir qu'il dépend de cet autre principe, que quand des puissances se font équilibre, les vîtesses virtuelles des points où elles sont appliquées, estimées suivant la direction de ces puissances, sont en raison inverse de ces mêmes puissances. Ce dernier principe est reconnu depuis long-tems par les Géometres pour le principe fondamental de l'équilibre, ou du moins pour une conséquence nécessaire de l'équilibre.
M. Daniel Bernoulli dans son excellent ouvrage intitulé Hydrodynamica, a appliqué le premier au mouvement des fluides le principe de la conservation des forces vives, mais sans le démontrer. J'ai publié à Paris en 1744, un traité de l'équilibre & du mouvement des fluides, où je crois avoir démontré le premier la conservation des forces vives dans le mouvement des fluides. C'est aux savans à juger si j'y ai réussi. Je crois aussi avoir prouvé que M. Daniel Bernoulli s'est servi quelquefois du principe de la conservation des forces vives dans certains cas où il n'auroit pas dû en faire usage. Ce sont ceux où la vîtesse du fluide ou d'une partie du fluide change brusquement & sans gradation, c'est-à-dire sans diminuer par des degrés insensibles. Car le principe de la conservation des forces vives n'a jamais lieu lorsque les corps qui agissent les uns sur les autres passent subitement d'un mouvement à un mouvement différent, sans passer par les degrés de mouvement intermédiaires, à-moins que les corps ne soient supposés à ressort parfait. Encore dans ce cas le changement ne s'opere-t-il que par des degrés infiniment petits ; ce qui le fait rentrer dans la regle générale. Voyez Hydrodynamique & Fluide.
Dans les mém. de l'académie des Sciences de 1742, M. Clairaut a démontré aussi d'une maniere particuliere le principe de la conservation des forces vives ; & je dois remarquer à ce sujet, que quoique le mémoire de M. Clairaut soit imprimé dans le vol. de 1742, & que mon traité de Dynamique n'ait paru qu'en 1743, cependant ce mémoire & ce traité ont été présentés tous deux le même jour à l'académie.
On peut voir par différens mémoires répandus dans les volumes des académies des Sciences de Paris, de Berlin, de Petersbourg, combien le principe de la conservation des forces vives facilite la solution d'un grand nombre de problemes de Dynamique ; nous croyons même qu'il a été un tems où on auroit été fort embarrassé de résoudre plusieurs de ces problemes sans employer ce principe ; & il me semble, si une prévention trop favorable pour mon propre travail ne m'en impose point, que j'ai donné le premier dans mon traité de Dynamique une méthode générale & directe pour résoudre toutes les questions imaginables de ce genre, sans y employer le principe de la conservation des forces vives, ni aucun autre principe indirect & secondaire. Cela n'empêche pas que je ne convienne de l'utilité de ces derniers principes pour faciliter, ou plûtôt pour abréger en certains cas les solutions, sur-tout lorsqu'on aura eu soin de démontrer auparavant ces mêmes principes.
Du rapport de la force vive avec l'action. Nous avons vû au mot Cosmologie, que les partisans modernes des forces vives avoient imaginé l'action comme le produit de la masse par l'espace & par la vîtesse, ou ce qui revient au même, comme le produit de la masse par le quarré de la vîtesse & par le tems, car dans le mouvement uniforme tel qu'on le suppose ici, l'espace est le produit de la vîtesse par le tems. Voyez Vîtesse.
Nous avons dit aussi aux mots Action & Cosmologie, que cette définition de l'action prise en elle-même, est absolument arbitraire ; cependant nous craignons que les partisans modernes des forces vives n'ayent prétendu attacher par cette définition quelque réalité à ce qu'ils appellent action. Car selon eux la force instantanée d'un corps en mouvement, est le produit de la masse par le quarré de la vîtesse ; & ils paroissent avoir regardé l'action comme la somme des forces instantanées, puisqu'ils font l'action égale au produit de la force vive par le tems. On peut voir sur cela un mémoire, d'ailleurs assez médiocre, du feu professeur Wolf, inséré dans le I. volume de Petersbourg ; & l'on se convaincra que ce professeur croyoit en effet avoir fixé dans ce mémoire la véritable notion de l'action ; mais il est aisé de voir que cette notion, quand on voudra la regarder autrement que comme une définition de nom, est tout-à-fait chimérique & en elle-même & dans les principes des partisans des forces vives ; 1°. en elle-même, parce que dans le mouvement uniforme d'un corps, il n'y a point de résistance à vaincre, ni par conséquent d'action à proprement parler ; 2°. dans les principes des partisans des forces vives, parce que selon eux, la force vive est celle qui se consume, ou qu'on suppose pourvoir se consumer en s'exerçant. Il n'y a donc proprement d'action que lorsque cette force se consume réellement en agissant contre des obstacles. Or dans ce cas, selon les défenseurs même des forces vives, le tems doit être compté pour rien, parce qu'il est de la nature d'une force plus grande d'être plus long-tems à s'anéantir. Pourquoi donc veulent-ils faire entrer le tems dans la considération de l'action ? L'action ne devroit être dans leurs principes que la force vive même en tant qu'elle agit contre des obstacles ; & cette maniere de la considérer ne doit rien changer à sa mesure, puisque selon eux cette force n'est regardée comme proportionnelle au quarré de la vîtesse, qu'autant qu'on suppose cette force anéantie insensiblement par des obstacles contre lesquels elle agit.
Reconnoissons donc que cette définition de l'action donnée par les partisans des forces vives est purement arbitraire, & même peu conforme à leurs principes. A l'égard de ceux qui comme M. de Maupertuis, n'ont point pris de parti dans la dispute des forces vives, on ne peut leur contester la définition de l'action, sur-tout lorsqu'ils paroissent la donner comme une définition de nom ; M. de Maupertuis dit lui-même à la page 26 du premier volume de ses nouvelles ?uvres imprimés à Lyon ; Ce que j'ai appellé action, il auroit peut-être mieux valu l'appeller force ; mais ayant trouvé ce mot tout établi par Leibnitz & par Wolf, pour exprimer la même idée, & trouvant qu'il y répond bien, je n'ai pas voulu changer les termes. Ces paroles semblent faire connoître que M. de Maupertuis, quoiqu'il croye que l'action peut-être représentée par le produit du quarré de la vîtesse & du tems, croit en même tems qu'on pourroit attacher à ce mot une autre notion ; à quoi nous ajoûterons relativement aux articles Action & Cosmologie, que quand il regarde l'action envisagée sous ce point de vûe, comme la dépense de la nature, ce mot de dépense ne doit point sans doute être pris dans un sens métaphysique & rigoureux, mais dans un sens purement mathématique, c'est-à-dire pour une quantité mathématique, qui dans plusieurs cas est égale à un minimum.
Par les mêmes raisons, je crois qu'on peut adopter également toute autre définition de l'action, par exemple celle que M. d'Arcy en a donnée dans les Mém. de l'acad. des Sciences de 1747 & 1752, pourvû (ce qui ne contredit en rien les principes de M. d'Arcy) qu'on regarde aussi cette définition comme une simple définition de nom. On peut dire dans un sens avec M. d'Arcy, que l'action d'un système de deux corps égaux qui se meuvent en sens contraire avec des vîtesses égales, est nulle, parce que l'action qui feroit équilibre à la somme de ces actions seroit nulle ; mais on peut aussi dans un autre sens regarder l'action de ce système comme la somme des actions séparées, & par conséquent comme réelle. Ainsi on peut regarder comme très-réelle l'action de deux boulets de canon qui vont en sens contraires. Au reste M. d'Arcy remarque avec raison que la conservation de l'action, prise dans le sens qu'il lui donne, a lieu en général dans le mouvement des corps qui agissent les uns sur les autres, & il s'est servi avantageusement de ce principe pour faciliter la solution de plusieurs problemes de Dynamique[1].
Comme l'idée qu'on attache ordinairement au mot action suppose de la résistance à vaincre, & que nous ne pouvons avoir d'idée de l'action que par son effet, j'ai cru pouvoir définir l'action dans l'Encyclopédie, en disant qu'elle est le mouvement qu'un corps produit, ou qu'il tend à produire dans un autre corps. Un auteur qui m'est inconnu prétend dans les mém. de l'acad. de Berlin de 1753, que cette définition est vague. Je ne sai s'il a prétendu m'en faire un reproche ; en tout cas, je l'invite à nous donner une définition mathématique de l'action qui représente d'une maniere plus exacte & plus précise, non la notion métaphysique du mot action, qui est une chimere, mais l'idée qu'on attache vulgairement à ce mot.
Tout ce que nous venons de dire sur l'action avoit un rapport nécessaire au mot force, & peut être regardé comme un supplément aux mots Action & Cosmologie, auxquels nous renvoyons.
Réflexions sur la nature des forces mortes, & sur leurs différentes especes. En adoptant comme une simple définition de nom l'idée que les défenseurs des forces vives nous donnent de la forces morte, on peut distinguer deux sortes de forces mortes ; les unes cessent d'exister dès que leur effet est arrêté, comme il arrive dans le cas de deux corps durs égaux qui se choquent directement en sens contraires avec des vîtesses égales. La seconde espece de forces mortes renferme celles qui périssent & renaissent à chaque instant, ensorte que si on supprimoit l'obstacle, elles auroient leur plein & entier effet ; telle est celle de deux ressorts bandés, tandis qu'ils agissent l'un contre l'autre ; telle est encore celle de la pesanteur. Voyez la fin de l'article Equilibre, (Méchan.) où nous avons remarqué que le mot équilibre ne convient proprement qu'à l'action mutuelle de cette derniere sorte de forces mortes.
Cette distinction entre les forces mortes nous donnera lieu d'en faire encore une autre : ou la force morte est telle qu'elle produiroit une vîtesse finie, s'il n'y avoit point d'obstacle ; ou elle est telle que l'obstacle ôté, il n'en résulteroit d'abord qu'une vîtesse infiniment petite, ou pour parler plus exactement, que le corps commenceroit son mouvement par zéro de vîtesse, & augmenteroit ensuite cette vîtesse par degrés. Le premier cas est celui de deux corps égaux qui se choquent, ou qui se poussent, ou qui se tirent en sens contraire avec des vîtesses égales & finies ; le second est celui d'un corps pesant qui est appuyé sur un plan horisontal. Ce plan ôté, le corps descendra ; mais il commencera à descendre avec une vîtesse nulle, & l'action de la pesanteur fera croître ensuite à chaque instant cette vîtesse ; c'est du moins ainsi qu'on le suppose. Voyez Accélération & Descente. De-là les Méchaniciens ont conclu que la force de la percussion étoit infiniment plus grande que celle de la pesanteur, puisque la premiere est à la seconde comme une vîtesse finie est à une vîtesse infiniment petite, ou plûtôt à zéro ; & par-là ils ont expliqué pourquoi un poids énorme qui charge un clou à moitié enfoncé dans une table ne fait pas avancer ce clou, tandis que souvent une percussion assez legere produit cet effet. Sur quoi voyez l'article Percussion.
Forces accélératrices. Les forces mortes prises dans le dernier sens, deviennent des forces accélératrices ou retardatrices, lorsqu'elles sont en pleine liberté de s'exercer ; car alors leur action continuée, ou accélere le mouvement, ou le retarde, si elle agit en sens contraire. V. Accélératrice. Mais cette maniere de considérer les forces accélératrices paroît sujette à de grandes difficultés. En effet, pourra-t-on dire, si le mouvement produit par une forces accélératrice quelconque, comme la pesanteur, commence par zéro de vîtesse, pourquoi un corps pesant soûtenu par un fil fait-il éprouver quelque résistance à celui qui le soûtient ? Il devroit être absolument dans le même cas qu'un corps placé sur un plan horisontal, & attaché à un fil aussi horisontal à l'extrémité duquel on placeroit une puissance. Cette puissance n'auroit aucun effort à faire pour retenir le corps, parce que ce corps est en repos, ou ce qui revient au même, parce que la vîtesse avec laquelle il tend à se mouvoir est zéro. Or si la premiere vîtesse avec laquelle un corps pesant tend à se mouvoir est aussi égale à zéro comme on le suppose, pourquoi l'effort qu'il faut faire pour le retenir n'est-il pas absolument nul ? Ce corps en descendant prendra sans doute une vîtesse finie au bout d'un tems quelconque, mais l'effort qu'on fait pour le soûtenir n'agit pas contre la vîtesse qu'il prendra, il agit contre celle avec laquelle il tend actuellement à se mouvoir, c'est-à-dire contre une vîtesse nulle. En un mot, un corps pesant soûtenu par un fil tend à se mouvoir horisontalement & verticalement avec zéro de vîtesse ; d'où vient donc faut-il un effort pour l'empêcher de se mouvoir verticalement, & n'en faut-il point pour l'empêcher de se mouvoir horisontalement ? On ne peut répondre à cette objection que de deux manieres, dont ni l'une ni l'autre n'est capable de satisfaire pleinement.
On peut dire en premier lieu que l'on a tort de supposer que la vîtesse initiale d'un corps qui descend soit zéro absolu ; que cette vîtesse est finie quoique très-petite, & aussi petite qu'on voudra le supposer ; qu'il paroît difficile de concevoir comment une vîtesse qui a commencé par zéro absolu deviendroit ensuite réelle ; comment une puissance dont le premier effet est zéro de mouvement, pourroit produire un mouvement réel par la succession du tems ; que la pesanteur est une force du même genre que la force centrifuge, ainsi qu'on le verra dans la suite de cet article ; & que cette derniere force telle qu'elle a lieu dans la nature, n'est point une force infiniment petite, mais une force finie très-petite, les corps qui se meuvent suivant une courbe, ne décrivant point réellement des courbes rigoureuses, mais des courbes polygones, composées d'une quantité finie, mais très grande, de petites lignes droites contigues entr'elles à angles très-obtus. Voilà la premiere réponse.
Sur quoi je remarque, 1°. que s'il est difficile & peut-être impossible de comprendre comment une force qui a commencé par produire dans un corps zéro de vîtesse, peut par des corps successifs & réitérés à l'infini, produire dans ce corps une vîtesse finie, on ne comprend pas mieux comment un solide est formé par le mouvement d'une surface sans profondeur, comment une suite de points indivisibles peut former l'étendue, comment une succession d'instans indivisibles forme le tems, comment même des points & des instans indivisibles se succedent, comment un atome en repos dans un point quelconque de l'espace peut être transporté dans un point différent ; comment enfin l'ordonnée d'une courbe qui est zéro au sommet, devient réelle par le seul transport de cette ordonnée le long de l'abscisse : toutes ces difficultés & d'autres semblables, tiennent à l'essence toûjours inconnue & toûjours incompréhensible du mouvement, de l'étendue & du tems. Ainsi, comme elles ne nous empêchent point de reconnoître la réalité de l'étendue, du tems & du mouvement, la difficulté proposée contre le passage de la vîtesse nulle à la vîtesse finie, ne doit pas non plus être regardée comme décisive. 2°. Sans doute la force centrifuge, soit dans les courbes rigoureuses, soit dans les courbes considérées comme des polygones infinis, est comparable, quant à ses effets, à la pesanteur : mais pourquoi veut-on qu'aucune portion de courbe décrite par un corps dans la nature, ne soit rigoureuse, & que toutes soient des polygones d'un nombre de côtés fini, mais très grand ? Ces côtés en nombre fini, & très-petits, seroient des lignes droites parfaites. Or pourquoi trouve-t-on moins de difficulté à supposer dans la nature des lignes droites parfaites très-petites, que des lignes courbes parfaites aussi très-petites ? Je ne vois point la raison de cette préférence, la rectitude absolue étant aussi difficile à concevoir dans une portion d'étendue si petite qu'on voudra, que la courbure absolue. 3°. Et c'est ici la difficulté principale à la 1re réponse, si la nature de la force accélératrice est de produire au 1er instant une vîtesse très-petite, cette force agissant à chaque instant pendant un tems fini, produiroit donc au bout de ce tems une vîtesse infinie ; ce qui est contre l'expérience. On dira peut-être que la nature de la pesanteur n'est point d'agir à chaque instant, mais de donner de petits coups finis qui se succedent comme par secousses dans des intervalles de tems finis, quoique très-petits : mais on sent bien que cette supposition est purement arbitraire ; & pourquoi la pesanteur agiroit-elle ainsi par secousses & non pas par un effort continu & non-interrompu ? On ne pourroit tout-au-plus admettre cette hypothèse que dans le cas où l'on regarderoit la pesanteur comme l'effet de l'impulsion d'un fluide ; & l'on sait combien il est douteux que la pesanteur vienne d'une pareille impulsion, puisque jusqu'ici les phénomenes de la pesanteur n'ont pû s'en déduire, ou même y paroissent contraires. Voyez Pesanteur, Gravité & Gravitation. On voit par toutes ces réflexions, que la premiere réponse à la difficulté que nous avons proposée sur la nature des forces accélératrices, est elle-même sujette à des difficultés considérables.
On pourroit dire en second lieu pour répondre à cette difficulté, qu'à la vérité un corps pesant, ou tout autre corps mû par une force accélératrice quelconque, doit commencer son mouvement par zéro de vîtesse : mais que ce corps n'en est pas moins en disposition de se mouvoir verticalement si rien ne l'en empêche ; au lieu qu'il n'a aucune disposition à se mouvoir horisontalement ; qu'il y a par conséquent dans ce corps un nisus, une tendance au mouvement vertical, qu'il n'a point pour le mouvement horisontal ; que c'est ce nisus, cette tendance qu'on a à soûtenir dans le premier cas, & qu'on n'a point à soûtenir dans le second ; qu'elle ne peut être contre-balancée que par un nisus, une tendance pareille ; que l'effort que l'on fait pour soûtenir un poids, est de même nature que la pesanteur ; que cet effort produiroit, à la vérité, au premier instant une vîtesse infiniment petite, mais qu'il est très différent d'un effort nul, parce qu'un effort nul ne produiroit aucun mouvement, & que l'effort dont il s'agit en produiroit un fini, au bout d'un tems fini. Cette seconde réponse n'est guere plus satisfaisante que l'autre ; car qu'est-ce qu'un nisus au mouvement, qui ne produit pas une vîtesse finie dans le premier instant ? Quelle idée se former d'un pareil effort ? D'ailleurs pourquoi l'effort qu'il faut faire pour soûtenir un grand poids, est-il beaucoup plus considérable que celui qu'il faut faire pour arrêter une boule de billard qui se meut avec une vîtesse finie ? Il semble au contraire que ce dernier devroit être beaucoup plus grand, si en effet la force de la pesanteur étoit nulle par rapport à celle de la percussion.
Il résulte de tout ce que nous venons de dire, que la difficulté proposée mérite l'attention des Physiciens & des Géometres. Nous les invitons à chercher des moyens de la résoudre plus heureusement que nous ne venons de faire, supposé qu'il soit possible d'en trouver.
Lois des forces accélératrices, & maniere de les comparer. Quoi qu'il en soit de ces réflexions sur la nature des forces accélératrices, il est au-moins certain dans le sens qu'on l'a expliqué au mot Accélératrice, que si on appelle ? la force accélératrice d'un corps, dt l'élément du tems, du celui de la vîtesse, on aura ?dt = du ; si la force est retardatrice, au lieu d'être accélératrice, on aura ?dt = ?du, parce qu'alors t croissant, u diminue ; sur quoi voyez mon traité de Dynamique, articles 19 & 20. Or nommant e l'espace parcouru, on a (voyez Vitesse) ; donc l'équation , donne aussi celle-ci ; c'est-à-dire que les petits espaces que fait parcourir à chaque instant une force accélératrice ou retardatrice, sont entr'eux comme les quarrés des tems.
Cette équation , ou, ce qui revient au même, l'équation n'est point un principe de méchanique, comme bien des auteurs le croyent, mais une simple définition ; la force accélératrice ne se fait connoître à nous que par son effet : cet effet n'est autre chose que la vitesse qu'elle produit dans un certain tems ; & quand on dit, par exemple, que la force accélératrice d'un corps est réciproquement proportionnelle au quarré de la distance, on veut dire seulement que est réciproquement proportionnel à ce quarré ; ainsi ? n'est que l'expression abregée de , & le second membre de l'équation qui exprime la valeur de . Voyez l'article Accélératrice & mon traité de Dynamique déjà cités.
L'équation fait voir que pendant un instant l'effet de toute force accéleratrice quelconque est comme le quarre du tems ; car la quantité variable ? pouvant être censée constante pendant un instant, est donc constant pendant cet instant, & par conséquent dde est comme dt2. Ainsi pendant un instant quelconque les petits espaces qu'une force accélératrice quelconque fait parcourir, sont entr'eux comme les quarrés des tems ou plûtôt des instans correspondans ; toute cause accélératrice agit donc dans un instant de la même maniere & suivant les mêmes lois que la pesanteur agit dans un tems fini ; car les espaces que la pesanteur fait parcourir sont comme les quarrés des tems. Voyez Accélération & Descente. Donc si on nomme a l'espace que la pesanteur p feroit parcourir pendant un tems quelconque ?, on aura , & par conséquent ; formule générale pour comparer avec la pesanteur p une force accélératrice quelconque ?.
Mais il y a sur cette formule une remarque importante à faire ; elle ne doit avoir lieu que quand on regarde comme courbe rigoureuse la courbe qui auroit les tems t pour abscisses & les espaces e pour ordonnées ; ou, ce qui revient au même, qui représenteroit par l'équation entre ses coordonnées l'equation entre e & t. Voyez Equation. Car si on regarde cette courbe comme polygone, alors dde prise à la maniere ordinaire du calcul différentiel aura une valeur double de celle qu'elle a dans la courbe rigoureuse, & par conséquent il faudra supposer , afin de conserver à ? la même valeur. Voyez sur cela les mots Courbe polygone & Différentiel, page 988. col. 1. C'étoit faute d'avoir fait cette attention, que le célebre M. Newton s'étoit trompé sur la mesure des forces centrales dans la premiere édition de ses Principes ; M. Bernoulli l'a prouvé dans les mémoires de l'académie des Sciences de 1711 ; on faisoit alors en Angleterre une nouvelle édition des principes de M. Newton ; & ce grand homme se corrigea sans répondre. Pour mieux faire sentir par un exemple simple combien cette distinction entre les deux équations est nécessaire, je suppose ? constante & égale à p ; on aura donc par la premiere équation ; & en intégrant . Donc si , on auroit ; ce qui est contre l'hypothèse, puisqu'on a supposé que a est l'espace décrit dans le tems ?, & que par conséquent si t = ?, on aura e = a ; au contraire en faisant , on trouvera, comme on le doit, e = a. Cette remarque est très-essentielle pour éviter bien des paralogismes.
L'équation ? d t = d u, donne ? d e = u d u, à cause de ; donc uu = 2 s ? d e ; autre équation entre les vitesses & les espaces pour les forces accélératrices. Donc si, par exemple, ? est constant, on aura uu = 2 ? e ; c'est l'équation entre les espaces & les vîtesses, dans le mouvement des corps que la pesanteur anime.
Forces centrales & centrifuges. Nous avons donné la définition des forces centrales au mot Central [2], & nous y renvoyons, ainsi qu'à la division des forces centrales en centripetes & centrifuges, selon qu'elles tendent à approcher ou à éloigner le corps du point fixe ou mobile auquel on rapporte l'action de la force centrale. Ce même mot de force centrifuge signifie encore plus ordinairement cette force par laquelle un corps mu circulairement tend continuellement à s'éloigner du centre du cercle qu'il décrit. Cette force se manifeste aisément à nos sens dans le mouvement d'une fronde ; car nous sentons que la fronde est d'autant plus tendue par la pierre, que cette pierre est tournée avec plus de vîtesse ; & cette tension suppose dans la pierre un effort pour s'éloigner de la main, qui est le centre du cercle que la pierre décrit. En effet la pierre mue circulairement tend continuellement à s'échapper par la tangente, en vertu de la force d'inertie, comme on l'a prouvé au mot Centrifuge. Or l'effort pour s'échapper par la tangente, tend à éloigner le corps du centre, comme cela est évident, puisque si le corps s'échappoit par la tangente, il s'éloigneroit toûjours de plus en plus de ce même centre. Donc l'effort de la pierre, pour s'échapper par la tangente, doit tendre la fronde. Veut-on le voir d'une maniere encore plus distincte ? Le corps arrivé au point A (fig. 24. Méchaniq.) tend à se mouvoir par la tangente ou portion de tangente infiniment petite AD. Or par le principe de la décomposition des forces (voyez Décomposition & Composition), on peut regarder ce mouvement suivant AD comme composé de deux mouvemens, l'un suivant l'arc AE du cercle, l'autre suivant la ligne ED, qu'on peut supposer dirigée au centre. De ces deux mouvemens, le corps ne conserve que le mouvement suivant AE ; donc le mouvement suivant ED est détruit ; & comme ce mouvement est dirigé du centre à la circonférence, c'est en vertu de la tendance à ce mouvement que la fronde est bandée.
Un corps qui se meut sur toute autre courbe que sur un cercle, fait effort de même à chaque instant pour s'échapper par la tangente ; ainsi on a nommé en général cet effort force centrifuge, quelle que soit la courbe que le corps décrit.
Pour calculer la force centrifuge d'un corps sur une courbe quelconque, il suffit de la savoir calculer dans un cercle ; car une courbe quelconque peut être regardée comme composée d'une infinité d'arcs de cercle, dont les centres sont dans la développée. Voyez Développée & Osculateur. Ainsi connoissant la loi des forces centrifuges dans le cercle, on connoîtra celle des forces centrifuges dans une courbe quelconque. Or il est facile de calculer la force centrifuge dans un cercle ; car suivant ce que nous avons dit ci-dessus, si on nomme ? la force centrifuge, & dt le tems employé à parcourir AE ou DE (fig. 24. Méchaniq.), on aura , en regardant le cercle comme rigoureux. Or dans cette hypothèse on a par la propriété du cercle ; donc .
Dans le cercle polygone on a ; parce que regardant AD comme le prolongement d'un petit côté du cercle, on a DE : AE ? AE est au rayon ; & dans cette même hypothèse on a ; donc on aura ; équation qui est la même que la précédente. On voit donc qu'en s'y prenant bien, la valeur de la force centrifuge se trouve la même dans les deux cas.
Si on appelle u la vîtesse du corps, & si on suppose u égale à la vitesse que le corps auroit acquise en tombant de la hauteur h, en vertu de la pesanteur p, on aura uu = 2ph. Voyez Accélération, Pesanteur, & ce que nous avons dit ci-dessus à l'occasion de l'équation ?de = udu. De plus on aura par la même raison
pour la vîtesse que le corps acquerroit en tombant de la hauteur a pendant le tems ? ; & comme cette vîtesse feroit parcourir uniformément l'espace 2a pendant le même tems ? (voyez Accélération & Descente), on aura
Trésor de la Langue Française informatisé
FORCE, subst. fém.
Force au Scrabble
Le mot force vaut 10 points au Scrabble.
Informations sur le mot force - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot force au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
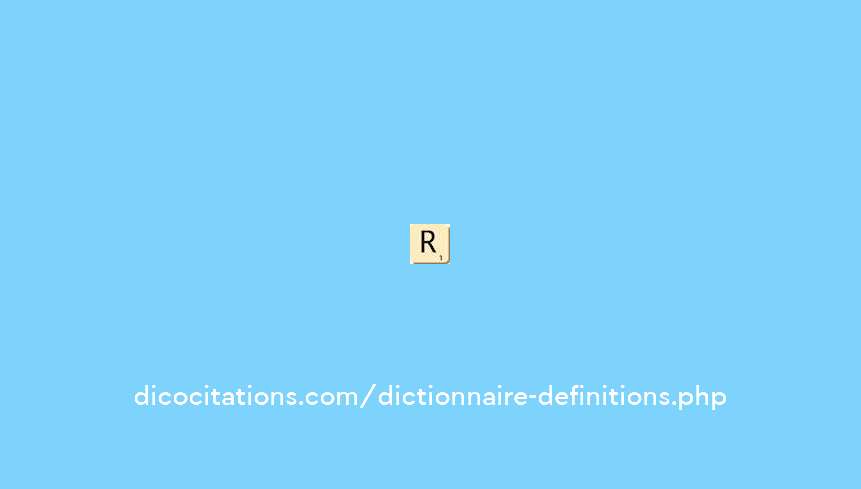
Les mots proches de Force
For Forage Forain, aine Foral, ale Forbannir Forçable Forcade ou fourcade Forçage Forçat Force Forcé, ée Forcement Forcément Forcené, ée Forcènement Forcener Forcènerie Forcer Forcerie Forces Forceur Force-vivier Forclore Forclos, ose Forer Forestage Forestier, ière Foret Forêt Forfaire Forfait Forfait Forfaiteur Forfante Forfanterie Forfantier Forge Forgement Forge-mètre Forger Forgerie Forgeron Forgeur Forhuer ou forhuir Forjet Forjeter Forlignement Forligner Forlonger Formable for forage forages foraient forain forain foraine foraine foraines foraines forains forains forait foramen foraminifères forant Forbach Forbach Forbach forban forbans força forçage forçai forçaient forçais forçait Forcalqueiret Forcalquier forçant forçat forçât forçats force force force forcé forcé Force Force Forcé forcée forcée forcées forcées Forcelles-Saint-Gorgon Forcelles-sous-Gugney forcement forcément forcenéMots du jour
-
francisation attriste socioculturelles tandoori indiqués quintolet foutus affamée persuader tabasser
Les citations avec le mot Force
- Le caractère est une force de la nature, l'absence de caractère d'autant plus.Auteur : Anton Tchekhov - Source : Platonov (1878)
- A force de me planter je vais bien finir par pousser.Auteur : Grégoire Lacroix - Source : Les euphorismes de Grégoire (2007)
- La cinquantaine, c'est l'adolescence qui revient de l'autre côté de la vie adulte - le serre-livres correspondant - avec ses troubles de l'identité, ses mauvaises surprises physiques et la force qu'il faut pour s'en accommoder.Auteur : Nuala O'Faolain - Source : J'y suis presque (2005)
- L'amnistie était une mesure de puissance. C'était la porte de la clémence ouverte par la force.Auteur : Victor Hugo - Source : Choses vues (1887-1900)
- Eviter la vindicte divine ou, au contraire, se soumettre à la volonté des forces inconnues: quel bain de suprême inconscience!Auteur : Anatole Bisk, dit Alain Bosquet - Source : Les Bonnes intentions (1975)
- Mais il y a autre chose. À force, le métier vous apprend aussi cette vérité : on n’est jamais sûr de rien. Auteur : Mary Higgins Clark - Source : Je t'ai donné mon coeur (2009)
- Toutes les occupations des hommes sont à avoir du bien; et ils n'ont ni titre pour le posséder justement, ni force pour le posséder sûrement.Auteur : Blaise Pascal - Source : Pensées (1670), 436 bis
- S'il y a de l'ombre, il y a forcément de la lumière.Auteur : Albert II de Monaco - Source : Dans Paris-Match, juillet 2006.
- Alors, forcément si on me vole un lapin toutes les nuits, forcément que j'en aurai bientôt plus.Auteur : René Fallet - Source : Le triporteur (1951)
- Par dureté j'entends force, résistance, volonté. Ne pas confondre dur et endurci, ce sont des mots différents, presque opposés. Une femme forte peut être également sensible, féminine, douce et aimante…Auteur : Barbara Taylor Bradford - Source : Les femmes de sa vie
- Mais voici qu'il me vient un autre antagoniste,
Un franc célibataire, égoïste achevé,
Aimable, jeune encor, dans l'aisance élevé
Je suis libre, dit-il, et la loi juste et sage
N'a forcé jusqu'ici personne au mariage.Auteur : Jean-François Ducis - Source : Epître contre le célibat - Les craintifz medecins, estimans que la consomption des forces fust diminution de la maladie.Auteur : Jacques Amyot - Source : Marcellus, 39
- Chaleur, mélodie pénétrante, voilà la magie de Rousseau. Sa force, comme elle est dans l'Emile et le Contrat Social, peut-être discutée, combattue. Mais par ses Confessions, ses Rêveries, par sa faiblesse il a vaincu; tous ont pleuré.Auteur : Jules Michelet - Source : Histoire de la Révolution française (1847-1853)
- La douceur et le charme d'une personne, à force de vivre auprès d'elle, nous ne les sentons plus. S'habituer, c'est oublier.Auteur : Nicolas Grimaldi - Source : Proust, les horreurs de l'amour (2008)
- Si tu es un chef, l'un de ceux qui conduisent la multitude, efforce-toi toujours d'être bienveillant, afin que ta propre conduite soit sans reproche.Auteur : Ptah-Hotep - Source : Livre des Maximes de Ptahhotep
- Le problème, c'est qu'à force de parler pour ne rien dire exprès, on ne fait plus exprès de ne plus rien avoir à dire en vrai.Auteur : Alain Zannini, dit Marc-Edouard Nabe - Source : L'Homme qui arrêta d'écrire (2010)
- Un mot est un mot, sans plus. Tout manque. Tenir une phrase est un tour de force. Le malheur commence quand les mots ne se suffisent pas à eux-mêmes.Auteur : Alain Veinstein - Source : Cent quarante signes (2013)
- Quand on abandonne un enfant, qu'on soit riche ou pauvre, c'est forcément qu'on est malheureux. Auteur : Yann Apperry - Source : Farrago (2003)
- Qu'est-ce qu'un dieu pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire de toutes mes forces, aujourd'hui, est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi.Auteur : Albert Camus - Source : Caligula (1944)
- L'amour durable est celui qui tient toujours les forces de deux êtres en équilibre.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Physiologie du Mariage (1830)
- La force du corps dans l'homme se mesure par ce qu'il exécute; celle de l'âme par ce qu'elle entreprend.Auteur : Paul-Louis Courier - Source : Eloge de Buffon
- Le signe distinctif de l'homme d'Athènes était de posséder à un degré de force unique, ce par quoi les hommes sont hommes, la raison.Auteur : Charles Maurras - Source : Anthinéa: d'Athènes à Florence (1901)
- L'Algérie est un homme. L'Algérie est une forêt d'hommes. Ici, les hommes sont noirs à force d'être serrés. Ici, les hommes sont seuls à force d'être ensemble. Ici, les hommes sont violents à force de désir.Auteur : Nina Bouraoui - Source : Garçon manqué (2000)
- – Il paraît qu'au bout de quelques années d'expérience, les flics réussissent à repérer la vérité du mensonge.
– Non. C'est à force d'entendre des mensonges que la vérité sonne différemment, c'est tout.Auteur : Olivier Norek - Source : Code 93 (2014) - C'est dur de lutter contre une telle couche d'aliénation. Pendant ces treize siècles, on a arabisé le pays mais on a en même temps écrasé le tamazight, forcément. Ça va ensemble. L'arabisation ne peut jamais être autre chose que l'écrasement du tamazight. L'arabisation, c'est imposer à un peuple une langue qui n'est pas la sienne, et donc combattre la sienne, la tuer.
Comme les Français quand ils interdisaient aux écoliers algériens de parler arabe ou tamazight parce qu'ils voulaient faire l'Algérie française. L'Algérie arabo-islamique, c'est une Algérie contre elle-même, une Algérie étrangère à elle-même. C'est une Algérie imposée par les armes, parce que l'islam ne se fait pas avec des bonbons et des roses. Il s'est fait dans les larmes et le sang, il s'est fait par l'écrasement, par la violence, par le mépris, par la haine, par les pires abjections que puisse supporter un peuple. On voit le résultat.Auteur : Yacine Kateb - Source : « Aux origines des cultures du peuple : entretien avec Kateb Yacine » (1987), dans Revue Awal, n° 9/1992 - Hommage à Kateb Yacine, Kateb Yacine, éd. MSH, 1992, p. 125
Les citations du Littré sur Force
- Les pensées, à force d'être vraies, sont quelquefois trivialesAuteur : ROLLIN - Source : Traité des Ét. III, 3
- Tant que de son corps soit desvorce L'ame à qui donna si grant bonde [limite] Charité qui en lui habonde Que jusqu'au ciel monter l'efforceAuteur : J. DE MEUNG - Source : Tr. 1162
- Pour mon appartement cinq chambres parquetées à force de miroirs semblaient être enchantéesAuteur : BOURSAULT - Source : Fabl. d'Ésope, IV, 3
- Quand les fourniers avoient cuit, il convenoit garder leurs maisons à force de gens ; autrement le menu peuple, qui mouroit de faim, eust efforcé les lieuxAuteur : Jean Froissard - Source : II, II, 148
- Expressions dont on ne peut tirer de bon sens que par de bénignes interprétations, ou, pour parler nettement, que par des gloses forcéesAuteur : BOSSUET - Source : Ét. d'orais. I, 1
- Il est force que nous tentions encore la fortuneAuteur : AMYOT - Source : Pomp. 105
- Ses vers naistront inutis, Ainsi qu'enfans abortis Qui ont forcé leur naissanceAuteur : RONS. - Source : 363
- Mais puisque dans un mal si doux et si cuisant Votre vertu combat et son charme et sa forceAuteur : Corneille - Source : Cid, I, 4
- Celui qui les conduisait [les éléphants] était forcé, pour éviter un malheur [quand ils devenaient furieux], de leur enfoncer un poinçon qui les faisait tomber morts dans l'instantAuteur : ROLLIN - Source : Hist. anc. Oeuv. t. XI, 1re part. p. 389, dans POUGENS.
- Il leur defendit aussi de soy esgratigner ny meurtrir à force de se battre ès enterremens des mortsAuteur : AMYOT - Source : Solon, 41
- L'accommodation consiste en ce que le voisinage d'une lettre force la lettre voisine à changer d'une certaine façon, pour rendre la prononciation du mot plus facileAuteur : BAUDRY - Source : Gramm. comp. des langues classiques, § 79
- Il n'y a raison, ny prescription, ny force qui puisse contre son inclination [de la nature]Auteur : MONT. - Source : I, 304
- On ne doit pas se précipiter dans le plaisir, parce qu'on le rend plus agréable à force de le désirerAuteur : MÉRÉ - Source : dans RICHELET
- Il trepigne, il trotigne, il s'efforceAuteur : François Rabelais - Source : IV, Prol. de l'aut.
- Mieulx qu'un luicteur, avec toute sa force, Ne lui sçauroit donner la moindre entorse [croc en jambe]Auteur : AMYOT - Source : Com. refréner la colère, 37
- Ceux qui en furent deslogez à force par nostre arméeAuteur : MONT. - Source : I, 26
- L'un grave en bronze, et dans le marbre à force Veut le naïf de nature imiterAuteur : RONS. - Source : Odes, III, 18
- Les autres forces sont devenues iniques et usurpatoiresAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Ém. v.
- Je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objectionsAuteur : Voltaire - Source : Candide, 13
- La moindre force est capable de les séparer [les deux moitiés de la sphère d'Otto de Guericke], lorsque l'air, étant rentré dans la sphère de cuivre, pousse les surfaces concaves et intérieures, autant que l'air de dehors presse les surfaces extérieures et convexesAuteur : MALEBR. - Source : Rech. vér. VI, II, 9
- Le tonnerre n'est qu'un grand phénomène électrique ; Franklin le force à descendre tranquillement sur la terre ; et, s'il foudroya Ajax Oïlée, ce n'est pas assurément parce que Minerve était irritée contre luiAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Tonnerre, 1
- La valeur de son père, en son temps sans pareille, Tant qu'a duré sa force, a passé pour merveilleAuteur : Corneille - Source : Cid, I, 1
- On arrêta une proclamation invitative à la paix, une députation au roi, pour invoquer sa clémence en faveur de ceux qui avaient forcé les portes des prisonsAuteur : MIRABEAU - Source : Collection, t. I, p. 282
- Ah ! l'on s'efforce en vain de me fermer la boucheAuteur : Jean Racine - Source : Brit. III, 3
- On perd toujours en vitesse ce que l'on gagne en force, et réciproquementAuteur : BRISSON - Source : Traité de phys. t. I, p. 395
Les mots débutant par For Les mots débutant par Fo
Une suggestion ou précision pour la définition de Force ? -
Mise à jour le vendredi 6 février 2026 à 22h48

- Facilite - Faible - Faiblesse - Faim - Faire - Fait - Famille - Fanatique - Fatalite - Fatigue - Faute - Faveur - Felicitations - Femme - Femme_homme - Ferocite - Fete - Fête des mamans - Fête des papas - Fête des mères - Fête des pères - Fidele - Fidèle - Fidelite - Fidélité - Fierte - Fille - Fils - Finalite - Finance - Flamme - Flatter - Flatterie - Fleur - Foi - Folie - Fonctionnaire - Foot - Football - Force - Fortune - Fou - Foule - Français - Française - France - Franchise - Fraternite - Frustation - Fuir - Futur
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur force
Poèmes force
Proverbes force
La définition du mot Force est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Force sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Force présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.























