La définition de Franc du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Franc
Nature : s. m.
Prononciation : fran
Etymologie : Lat. Francus, nom de cette peuplade germanique, qui devint aussi l'appellation de l'homme libre ; dans l'anc. h. allem. il est sous la forme franco. Ce mot de francus est d'origine obscure. Diefenbach, le trouvant aussi dans le celtique, croit qu'il vient de là ; J. Grimm y voit un dérivé de la racine gothique freis, allem. mod. frei, libre ; d'autres le rattachent à l'anglo-saxon. franca, javelot.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de franc de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec franc pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Franc ?
La définition de Franc
Nom d'un peuple germain qui habitait les bords du Rhin, qui envahit les Gaules et y fonda une monarchie.
Toutes les définitions de « franc »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Unité monétaire du système métrique, laquelle se divise en dix parties appelées décimes et en cent appelées centimes. La pièce d'un franc est faite d'un alliage d'argent et de cuivre. La pièce d'un franc pèse cinq grammes. Une pièce d'un franc, de deux francs, de cinq francs. Un franc trente centimes. Payer le décime pour franc. La hausse, la baisse du franc. Au marc le franc. Voyez MARC. Centime le franc. Voyez CENTIME.
Littré
- Nom d'un peuple germain qui habitait les bords du Rhin, qui envahit les Gaules et y fonda une monarchie.
Les Francs commençaient alors à se faire craindre?; c'était une ligue de peuples germains qui habitaient le long du Rhin?; leur nom montre qu'ils étaient unis par l'amour de la liberté
, Bossuet, Hist. I, 10.Adj. Franc, franque, qui appartient aux Francs. Période franque. La monarchie franque.
Au milieu du VIe siècle, la race franque s'était répandue et dominait dans toute la Gaule
, Guizot, Hist. de la civil. en France, 8e leçon.
Encyclopédie, 1re édition
* FRANC, FRANCHE, adjectif dont on fait l'article Franchise. Voyez cet article. Il se compose avec un grand nombre de mots. Voyez les articles suivans.
Franc, (greffer sur) Jardinage. Voyez Greffer.
Franc ou Sauvageon, c'est ainsi qu'on appelle le sujet sur lequel on a dessein de greffer quelque bonne espece de fruit.
Franc, (Peint.) Peindre franc, c'est peindre facilement, hardiment, sans tâtonner, & à pleine couleur, sans le secours des glacis. Voyez Glacis.
Franc, (Jurispr.) ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes, & s'applique à différens objets.
Franc signifie quelquefois une personne libre, c'est-à-dire qui n'est point dans l'esclavage.
Loysel, liv. I. tit. j. régl. 6. dit que toutes personnes sont franches en ce royaume, & que si-tôt qu'un esclave a atteint les marches d'icelui en se faisant baptiser, il est affranchi.
Ce que dit cet auteur n'a pas lieu néanmoins à l'égard des esclaves negres qui viennent des colonies françoises en France avec leurs maîtres, pourvû que ceux ci ayent fait leur déclaration en arrivant à l'amirauré, qu'ils entendent renvoyer ces negres aux îles. Voyez Esclaves & Negres. (A)
Franc est aussi quelquefois opposé à serf ; car quoiqu'en France il n'y ait point d'esclaves proprement dits, il y a des serfs de main-morte qui ne joüissent pas d'une entiere liberté. Ceux qui sont exempts de cette espece de servitude sont appellés francs, ou personnes de condition franche. Voyez Main-morte & Serfs. (A)
Franc, Frankis, ou Franquis, (Hist. mod.) est le nom que les Turcs, les Arabes & les Grecs donnent à tous les Européens occidentaux.
On croit que ce nom a commencé dans l'Asie, au tems des croisades, les François ayant eu une part distinguée dans ces entreprises ; & depuis les Turcs, les Sarrasins, les Grecs & les Abyssins, l'ont donné à tous les Chrétiens européens, & à l'Europe celui de Frankistan.
Les Arabes & les Mahométans, dit M. d'Herbelot, appellent Francs, les François, les Européens, les Latins en général.
Franc signifie encore libre & exempt de quelque charge ; par exemple, un noble est par sa qualité franc & exempt de taille. Il y a des lieux qui sont francs, c'est-à-dire exempts de tailles & de certaines autres impositions ; d'autres qu'on appelle francs à cause de la liberté que la coûtume du pays accorde pour tester, comme dans le comté de Bourgogne. Voyez le glossaire de Lauriere, au mot Franc. (A)
Franc ou Frent est un françois, & par extension un européen, ou plûtôt un latin ; à cause, dit M. d'Herbelot, que la nation françoise s'est fait connoître & distinguer entre toutes les autres qui ont porté les armes dans l'Orient au tems des croisades. Voyez Croisade.
Le P. Goar, dans ses notes sur Codin, c. v. n. 43. nous fournit une autre origine du mot franc beaucoup plus ancienne que la premiere. Il observe que les Grecs n'appelloient d'abord Francs que les François, c'est-à-dire les Allemands établis en France ; ensuite ils donnerent le même nom aux habitans de la Pouille & de la Calabre, après que les Normands eurent conquis ces provinces. Dans la suite ils ont donné ce nom à tous les Latins.
Ainsi Anne Comnene & Curopalate, pour distinguer les François des autres nations de l'Europe, les appellent les Francs occidentaux.
Du Cange ajoûte que vers le tems de Charlemagne on distinguoit la France en orientale & en occidentale, en latine ou romaine, & en allemande, qui étoit l'ancienne France appellée depuis Franconie. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)
Franc ou Livre, étoit autrefois une monnoie du poids d'une livre ; présentement le franc n'est plus qu'une valeur numéraire. Le franc est composé de 20 sous tournois, qui font une livre numéraire ou de compte. Voyez Livre. (A)
Franc-aleu naturel, est celui qui a lieu en vertu de la loi, coûtume ou usage du pays, où tous les héritages sont de droit réputés tenus en franc-aleu, s'il n'appert du contraire, sans que les possesseurs des héritages soient tenus de justifier le droit de franc-aleu. C'est au seigneur qui prétend quelque devoir sur les héritages, à l'établir. (A)
Franc-aleu noble, est celui qui a une justice, ou un fief, ou une censive mouvante de lui. (A)
Franc-aleu par privilége, est opposé au franc-aleu naturel ; c'est celui qui est fondé en concession & titre particulier. (A)
Franc-aleu roturier, est celui qui n'a ni justice, ni fief, ni censive qui en dépende. (A)
Franc-aleu par titre. Voyez ci-dev. Franc-aleu par privilége. (A)
Franc d'amble, (Manége.) cheval ambulant naturellement, ou dont l'alure la plus familiere est l'amble. Elle a été avec raison bannie de nos écoles & de nos manéges. Voyez Manége.
Francs Angevins, c'étoit une monnoie qui se fabriquoit à Angers, de la valeur d'une livre. (A)
Francs-Archers, c'est ainsi qu'on appella une nouvelle milice d'infanterie, établie en France par Charles VII. en 1448. Ce prince pour avoir toûjours une troupe d'infanterie sur pié, ordonna que chaque paroisse de son royaume lui fournît un des meilleurs hommes qu'il y auroit pour aller en campagne, & servir en qualité d'archer avec l'arc & la fleche. « Le privilége qu'il accorda à ceux qui seroient choisis, fit qu'il y eut de l'empressement pour l'être, car il les affranchit presque de tous subsides ; & c'est de cet affranchissement qu'on les appella francs-archers ou francs-taupins. Ce nom de taupins leur fut donné sans doute, parce qu'on le donnoit alors aux paysans, à cause des taupinieres dont les clos des gens de la campagne sont ordinairement remplis ». Hist. de la milice franç.
Les francs-archers étoient distribues en quatre compagnies de quatre mille hommes chacune ; ainsi ils composoient un corps de seize mille hommes prêts à servir au premier commandement. C'est-là le premier corps réglé de l'infanterie françoise. Avant sa création l'infanterie n'étoit composée, ainsi que s'exprime Brantome dans le discours des colonels, que de marauts, bellistres, mal-avinés, mal-complexionnés, fainéans, pilleurs & mangeurs de peuples, &c.
Les francs-archers ne subsisterent pas long-tems ; ils furent supprimés dans les dernieres années du regne de Louis XI. Mais ce prince qui sentoit le besoin d'entretenir toûjours un corps d'infanterie sur pié, commença, pour suppléer aux francs-archers, par faire lever six mille Suisses ; il leur ajoûta ensuite un corps de dix mille hommes d'infanterie françoise pour être à sa solde, & pour cela il mit, dit le pere Daniel, un grand impôt sur le peuple.
L'établissement des francs-archers peut avoir servi de modele à celui des milices qu'on leve également dans toutes les paroisses du royaume, à-peu-près de la même maniere qu'on y choisissoit les francs-archers. Voyez Milice. Voyez aussi sur ce sujet l'histoire de la milice françoise du P. Daniel, dont cet article est tiré. (Q)
Franc argent, en la chatellenie de Montereau ressort de Meaux, signifie la même chose que francs deniers ; c'est lorsque le vendeur accorde avec l'acheteur que le prix de la vente lui sera franc, & qu'il n'en payera aucun droit au seigneur féodal ou censuel, de maniere que l'acheteur doit l'en acquitter. (A)
Francs d'argent, étoient une monnoie de la valeur de 20 sous tournois. Le roi Henri III. en fit forger en l'an 1575. (A)
Franc d'or, étoit une monnoie d'or de la valeur d'une livre ; en l'an 1400 & auparavant, une livre, à cause de la forte monnoie, valoit un franc d'or : sur quoi Ragueau, en son glossaire au mot franc ou livre, dit que le franc d'or vaudroit à-présent autant qu'un écu sou & plus. (A)
Franc-Barrois, sorte de monnoie fictive, en usage dans la Lorraine & le Barrois, où les droits de seigneurie, cens, peines, amendes, & même des contrats de rente, sont en cette monnoie. Il en est parlé dans le mémoire sur la Lorraine & le Barrois, pag. 10. à la fin. Le franc-barrois se divise en 12 gros, le gros en 4 blancs, le blanc en 4 deniers barrois. Sept francs-barrois font exactement trois livres cours de Lorraine : ainsi le franc-barrois fait 8 sous den. de Lorraine.
Franc-batir, (Jurispr.) est un droit dont jouissent quelques communautés, de prendre du bois dans une forêt pour l'entretien & le rétablissement de leurs bâtimens. On ne peut user de ce droit que pour les bâtimens qui étoient déjà construits ou qui devoient l'être, lors de la concession qui a été faite de ce droit. Il ne s'étend point aux autres bâtimens que l'on peut construire dans la suite. (A)
Francs blancs, c'étoient des monnoies d'argent de la valeur d'une livre, ainsi appellées pour les distinguer des francs d'or. Voyez ci-après Francs d'or. (A)
Francs-Bourdelois, étoient des monnoies que l'on frappoit à Bourdeaux, de la valeur d'une livre. (A)
Francs-Bourgeois, nom de faction parmi les ligueurs d'Orléans, pendant le tems de la ligue.
Franc du collier, (Manege.) Tout cheval franc du collier est celui qui donne hardiment dans les traits, qui tire franchement, naturellement, & sans en être sollicité par les châtimens. Cette expression est indistinctement en usage pour désigner la franchise de tous les chevaux destinés ou employés à être attelés à une voiture quelconque, quoiqu'ils ne soient pas tous généralement attelés avec un collier.
Francs-deniers, cette clause apposée dans la vente d'un fief ou d'une roture, signifie que la totalité du prix doit demeurer franche au vendeur, & que l'acquéreur se charge d'acquitter les droits seigneuriaux. Cette clause est assez usitée dans quelques coûtumes, où sans cela le vendeur seroit tenu de payer les droits seigneuriaux ; comme dans les coûtumes de Meaux, art. 131 & 119 ; Melun, artic. 67 ; Troyes, 27 ; Chaumont, 17 ; Saint-Paul sous Artois, art. 64. (A)
Franc-devoir, est une redevance annuelle en laquelle le seigneur a converti l'hommage qui lui étoit dû pour le fief mouvant de lui. Ces sortes de conversions d'hommage en franc-devoir, qu'on appelle aussi abonnement ou abrégement de fief, furent principalement introduites lorsque les roturiers, ou ceux qui ne faisoient pas profession des armes, commencerent à posséder des fiefs ; ce qui arriva, dit-on, dans le tems des croisades. Le devoir annuel que le seigneur imposa sur le fief fut appellé franc, comme représentant l'hommage auquel il étoit subrogé ; il étoit comme l'hommage même la marque de la noblesse & de la franchise de l'héritage, lequel se partageoit toûjours noblement, même entre roturiers, quand il étoit une fois échû en tierce-main.
Quelques uns confondent mal-à-propos le franc-devoir avec le franc-aleu. Voyez l'article 258 de la coûtume d'Anjou, & l'ordonnance de Philippe III. touchant les accroissemens, in fine.
Franc-devoir est aussi lorsque l'héritage du roturier est donné par le seigneur du fief à franc-devoir, soit que la redevance soit annuelle, ou dûe à chaque mutation d'homme ou de seigneur, au moyen de quoi l'héritage ainsi tenu ne doit point de rachat ; mais il est dû des ventes dans les cas où elles ont lieu par la coûtume. Voyez Lodunois, chap. xjv. art. 21. & 145. (A)
Franc-devoir dans les anciennes chartes, signifie aussi les charges que les hommes de franche & libre condition, doivent pour usage de bois, pour pacage, panage ou autrement. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot franc-devoir. (A)
Franc-d'Eau, (Marine.) rendre le navire franc-d'eau, c'est tirer l'eau qui peut être dans le navire, & le vuider par le moyen de la pompe. (Z)
Franc-Etable. (Marine.) voyez Etable.
Franc et quitte, est une clause qui signifie que les biens dont il s'agit ne sont grevés d'aucunes hypotheques ni autres charges. On peut faire la déclaration de franc & quitte, par rapport à un héritage que l'on vend ; ordinairement on le déclare franc & quitte des arrérages, de cens, & autres charges réelles du passé, jusqu'au jour de la vente.
On peut aussi déclarer l'héritage que l'on vend franc & quitte de toutes charges & hypotheques.
Quelquefois un homme qui s'oblige déclare tous ses biens francs & quittes, c'est-à-dire qu'il ne doit rien ; ou bien il les déclare francs & quittes à l'exception d'une certaine somme qu'il spécifie.
Lorsque la déclaration de franc & quitte se trouve fausse, il faut distinguer si c'est par erreur qu'elle a été faite, ou si c'est de mauvaise foi.
L'erreur peut arriver lorsque celui qui a fait la déclaration de franc & quitte ignoroit les hypotheques qui avoient été constituées sur les biens par ses auteurs, & en ce cas il est seulement tenu civilement de faire décharger les biens des hypotheques, ou de souffrir la résiliation du contrat avec dommages & intérêts.
Mais si la déclaration de franc & quitte a été faite de mauvaise foi, c'est un stellionat : & celui qui a fait cette déclaration est tenu de souffrir la résolution du contrat avec dommages & intérêts ; & l'on peut le faire condamner par corps, quand même il auroit des biens suffisans pour répondre de ses engagemens. Voyez Stellionat. (A)
Franc-Funin, (Marine.) c'est une longue corde plus ronde que le cordage ordinaire ; elle est blanche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas goudronnée, & sert dans un vaisseau à plusieurs usages. Le franc-funin est composé de cinq torons, tellement serrés que le cordage en paroisse plus arrondi que le cordage ordinaire. Il sert pour les plus rudes man?uvres, comme pour embarquer le canon, mettre en carene, &c.
Franc-Homme, c'étoit tout homme noble ou roturier, qui étant propriétaire d'un fief, demeuroit au-dedans de ce fief ; car anciennement les fiefs communiquoient leur noblesse aux roturiers tant qu'ils y demeuroient. Voyez de Fontaines en son conseil, & M. de Lauriere en ses notes sur l'ort. 248. de la coût. de Paris. (A)
Francs-Maçons, (Hist. mod.) ancienne société ou corps qu'on nomme de la sorte, soit parce qu'ils avoient autrefois quelque connoissance de la Maçonnerie & des bâtimens, soit que leur société ait été d'abord fondée par des maçons.
Elle est actuellement très-nombreuse, & composée de personnes de tout état. On trouve des francs-maçons en tous pays. Quant à leur ancienneté, ils prétendent la faire remonter à la construction du temple de Salomon. Tout ce qu'on peut pénétrer de leurs mysteres ne paroît que loüable, & tendant principalement à fortifier l'amitié, la société, l'assistance mutuelle, & à faire observer ce que les hommes se doivent les uns aux autres. Chambers.
Francs-mançais, c'étoient des monnoies de la valeur d'une livre, que l'on frappoit au Mans de l'autorité de l'évéque. (A)
Francs-Meix, ou Mex, dont il est parlé en la coutume locale de Saint-Piat de Seclin sous Lille, sont des héritages mortaillables qui ont été affranchis. (A)
Franc-Mariage, c'est un mariage noble ; donner en franc-mariage, c'est marier noblement. Il en est parlé au traité des tenures, liv. I. ch. ij. liv. II. ch. vj. liv. III. ch. ij. (A)
Franc parisis, étoit la monnoie d'une livre parisis, qui valoit un quart en sus plus que le franc tournois. Voyez Monnoie parisis. (A)
Franc-Pris ou prisage, c'est-à-dire prisée dans la coûtume de Bretagne, art. 261. (A)
Franc-Quartier, s. m. terme de Blason. Le premier quartier de l'écu, qui est à la droite du côte du chef, ou l'on a coûtume de mettre quelques autres armes que celles du reste de l'écu. Il est un peu moindre qu'un vrai quartier d'écartelage.
Franc-Salé, (Jurisprud.) Ce mot s'entend de deux manieres.
Il y a des provinces & des villes qu'on appelle pays de franc-salé, c'est-à-dire où chacun a la liberté d'acheter & revendre du sel sans payer au Roi aucune imposition : tels sont le Poitou, l'Aunis, la Saintonge, le Périgord, Angoumois, haut & bas Limosin, haute & basse Marche, qui on acquis ce droit du roi Henri II. moyennant finance. La ville de Calais & les pays reconquis ont aussi obtenu ce droit lorsqu'ils sont sortis des mains des Anglois & rentrés sous la domination de France.
Le franc-salé ou droit de franc-salé qui appartient à certains officiers royaux & autres personnes, est une certaine provision de sel qui leur est accordée pour leur provision. Autrefois ceux qui avoient ce droit avoient le sel gratis, & ne payoient que la voiture. Présentement ils payent une pistole par minot. Voyez Gabelle. (A)
Francs-Taulpins, voyez Francs Archers.
Franc-Tenant, c'est celui qui possede noblement & librement. Voyez le liv. des tenures, liv. II. ch. j. & ij. (A)
Franc-Tenement, est un héritage possédé noblement & librement, sans aucune charge roturiere. Voyez le même livre des tenures, liv. I. ch. vj. & jx. liv. III. ch. ij. (A)
Franc-Tillac, (Marine.) c'est le pont le plus proche de l'eau, qu'on appelle le premier pont dans les vaisseaux à deux ponts & à trois ponts. C'est sur ce pont qu'on place les canons de plus fort calibre. (Z)
Franc tournois, étoit la monnoie d'une livre que l'on frappoit à Tours de l'autorité de l'archevêque. Cette livre valoit sou tournois ; présentement le franc tournois n'est plus qu'une valeur numéraire. Voyez Livre Tournois. (A)
Franc viennois, c'étoit une monnoie d'une livre, qui se frappoit à Vienne en Dauphiné de l'autorité des dauphins de Viennois. Il y a encore dans ce pays & dans les provinces voisines, des redevances fixées en francs sous & deniers viennois ; ce qui s'évalue en monnoie de France. Voyez ci-dev. Denier viennois. (A)
Wiktionnaire
Adjectif - ancien français
franc \frãnk\
-
Français.
- Dist Blancandrins : « Pa ceste meie destre E par la barbe ki al piz me ventelet, L'ost des Franceis verrez sempres desfere. Francs s'en irunt en France, la lur tere. ? (Anonyme, Chanson de Roland, 1040-1115)
-
Libre.
- Et toz les autres homes dou chief seignor dou reiaume pevent estre jugiés par les homes de la Haute Court dou reiaume et par ciaus des autres cours qui ont faite la ligece au chief seignor, par l'assise, fors que tant que home qui n'est chevalier et de bone renomée et né en leau mariage, ne peut franc home jugier des choses dessus diites, se les frans homes ne le veulent soufrir de leur gré. ? (Jean d'Ibelin, Assises de Jérusalem, 1200-1300)
-
Noble, d'ascendance noble.
-
La dame aveit une meschine,
ki mult esteit de franche orine ? (Marie de France, Le Fraisne, édition de Warnke et Niemeyer)- La dame avait une domestique
Qui était d'origine noble (? voir orine)
- La dame avait une domestique
-
La dame aveit une meschine,
-
Brave, vaillant.
-
Mut par esteit bons chevaliers
Francs, hardiz, curteis e fiers ? (Milun, Marie de France, f. 145v, 1re colonne de ce manuscrit de 1275-1300)
-
Mut par esteit bons chevaliers
Nom commun - français
franc \f???\ masculin
-
(Numismatique) Unité monétaire utilisée par plusieurs pays.
- Ma femme aurait désiré être riche, et voilà que j'étais pauvre, avec mes petits appointements de deux mille francs. ? (Octave Mirbeau, La Tête coupée)
- Si tu me rembourses pas les cinq cents francs que je t'ai prêtés pour acheter ta vache, je te fous l'huissier dans les pattes. ? (Louis Pergaud, « Deux Électeurs sérieux », dans Les Rustiques, nouvelles villageoises, 1921)
- Nous n'avons pas un franc en poche, parce que nous n'avons pas pris d'argent avant notre départ. ? (Dieudonné Costes et Maurice Bellonte, Paris-New-York, 1930)
- Nous sommes de beaux Jacques, allez, de gratifier de plus de trois mille francs ce mauvais docteur là. [?] Qui tombe jamais malade ici ? ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
- Après plusieurs années de nouveaux francs, la monnaie française retrouva son appellation officielle de francs, sans aucun adjectif les précédant ou les suivant. Mais un pourcentage important de personnes, pas obligatoirement âgées, continua à tout calculer en anciens francs, tandis qu'une autre partie parlait de nouveaux francs ou francs lourds, et de centimes pour les anciens francs. ? (Claude Chaminas, La Cité Joseph Staline 1941-1959, L'Harmattan, 2009, page 114)
-
(Par ellipse) Scion d'arbre franc.
- Enter franc sur franc : Enter un scion d'arbre franc sur un autre arbre franc.
- Enter franc sur sauvageon : Enter un scion d'arbre franc sur un sauvageon.
Adjectif 2 - français
franc \f???\
- Relatif aux Francs.
- Une lampe de cristal, qui, le soir du meurtre de la princesse franque, s'était détachée d'elle-même des chaînes d'or où elle était suspendue à la place de l'actuelle abside. ? (Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, 1913, Éditions Gallimard, Folio n° 1924, 1987, page 61)
- Peut-être étais-je aussi rêveur que tous les Celtes réunis. Mais mes rêves, mes rêves de fils de la race franque, étaient des rêves d'action. ? (Maurice Constantin-Weyer, Un homme se penche sur son passé, 1928, réédition Nelson, page 190)
- Fais le donc approcher, répondit le Roi? le bédouin en question pénétra dans le tref royal, saluant respectueusement le souverain franc. ? (Sylvie Dinnat, Le Serment de la Licorne, Éditions Publibook, 2005, page 155)
- Relatif aux Européens du Levant.
- L'ancien quartier franc de Constantinople.
- Langue franque, ou lingua franca, jargon mêlé de turc, d'arabe et de langues romanes (français, italien, espagnol?) en usage parmi les marins, les négociants des ports du Levant.
- La langue franque, parlée sur les côtes d'Afrique, est née de pièces rapportées des langues riveraines de la Méditerrannée. ? (Charles Victor de Bonstetten, L'Homme du midi et l'homme du nord, 1824)
Adjectif 1 - français
franc \f???\
-
Libre de ses mouvements et de son action, en opposition au statut d'esclave ou de serf.
- Il a fait cette action de sa pure et franche volonté.
- Franc arbitre.
- Franc de toute passion, franc d'ambition, libre et exempt de toute passion, d'ambition, etc.
- Franc-bord, espace de terrain laissé libre sur le bord d'une rivière, d'un canal ; se dit aussi, en termes de marine, du bordage extérieur d'un bâtiment, depuis la quille jusqu'à la première préceinte.
- Corps francs, corps de troupes, composés ordinairement de volontaires commissionnés pour la durée de la guerre et qui ne font pas partie de l'armée. On dit, dans un sens très rapproché, francs-tireurs.
- Exempt de charges, d'impôts ou de dettes.
- Zones franches, zones où les droits de douane ne sont pas perçus.
- Villes franches, celles qui ne payaient pas la taille au Moyen Âge.
- Port franc, port où les marchandises jouissent de la franchise des droits d'entrée et de sortie.
- Franc de port, se dit d'une lettre, d'un paquet, etc., dont le port est payé par celui qui en fait l'envoi. Dans cette expression, franc est invariable quand il précède le nom.
- Le Cévenol donna une telle extension à l'affaire qu'en trois ans il eut payé les Lalouette, et se trouva, franc de toute redevance, à la tête d'une belle boutique admirablement achalandée? ? (Alphonse Daudet, Le petit Chose, 1868, réédition Le Livre de Poche, page 161)
- Franche lippée, repas qui ne coûte rien ou repas où l'on mange tout son soûl.
-
Sincère, loyal, honnête.
- Les indigènes se montraient très sympathiques, aimables et complaisants ; leurs figures du type mongol caractérisé, souriaient, intelligentes et franches. ? (Jean-Baptiste Charcot, Dans la mer du Groenland, 1928)
- La plus franche cordialité régnait entre nous. Je passai là d'excellentes heures. ? (Alain Gerbault, À la poursuite du soleil ; tome 1 : De New-York à Tahiti, 1929)
- Ce qui me frappait le plus en lui, c'était le sourire ? le plus franc, le plus engageant que j'aie jamais vu sur aucune face humaine. ? (Henry Miller, L'Ancien Combattant alcoolique au crâne en planche à lessive, dans Max et les Phagocytes, traduction par Jean-Claude Lefaure, éditions du Chêne, 1947)
- Un homme, un c?ur franc.
- Sa conduite dans cette affaire a été franche et droite.
-
(Par extension) Naturel et sans mélange, vrai, pur.
- Couleur franche.
- Une franche bêtise, une franche coquette, une franche canaille, une franche bévue.
- Un franc imbécile, un franc animal, un franc scélérat.
-
Net, en parlant d'un acte, d'un sentiment, etc.
- Une franche aversion.
- Manière, touche franche.
- (Physique) Fusion franche, passage brusque de l'état solide à l'état liquide, par opposition au terme de « fusion » qui définit un état pâteux.
-
Plein, entier, en parlant d'une durée.
- Quatre jours francs, quatre jours complets.
- Ils y arrivèrent le lundi et en partirent le jeudi : ils n'y ont donc été que deux jours francs.
- Dans les assignations à huitaine, il faut huit jours francs, sans compter celui de l'assignation, ni celui de l'échéance.
-
(Botanique) Qualifie les arbres qui portent des fruits doux et mangeables sans avoir été greffés.
- Noisetier franc, franc pêcher.
-
(Par extension) Qualifie ces fruits eux-mêmes.
- Noisettes franches, pêche franche.
Trésor de la Langue Française informatisé
FRANC1, FRANQUE; FRANK, FRANKE, adj. et subst.
FRANC2, subst. masc.
FRANC3, FRANCHE, adj.
Franc au Scrabble
Le mot franc vaut 10 points au Scrabble.
Informations sur le mot franc - 5 lettres, 1 voyelles, 4 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot franc au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
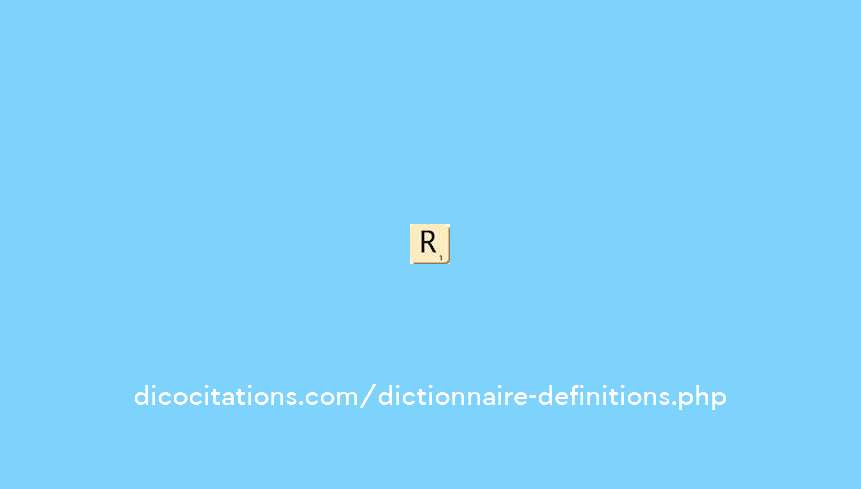
Les mots proches de Franc
Frac Fracas Fracassé, ée Fracassement Fracasser Fraction Fractionnement Fractionner Fracture Fracturer Fragile Fragilité Fragment Fragmentaire Fragon Fragrance Fragrant, ante Frai Fraîche Fraîchement Fraîcheur Fraîchir Frairie Frais, fraîche Frais Fraise Fraise Fraise Fraisé, ée Fraiser Fraiser Fraisette Framboise Framboisement Framboisier Franc Franc Franc, franche Français, aise Franc-alleu Francatu Franchement Franchir Franchise Franchissable Franchissement Franciser Francisme Francolin Franc-salé fra frac fracas fracassa fracassaient fracassait fracassant fracassant fracassante fracassantes fracassants fracassât fracasse fracassé fracassé fracassée fracassée fracassées fracassées fracassent fracasser fracassera fracasserait fracassés fracassés fracassez fracs fractal fractale fractales fraction fractionnait fractionnant fractionne fractionné fractionnée fractionnée fractionnées fractionnées fractionnel fractionnelles fractionnement fractionner fractions fractura fracturant fracture fracture fracturé fracturéMots du jour
-
rumination lourdé expérimentiez asociabilité encadrerai antinazis bouilleur soufflant ensuit récusais
Les citations avec le mot Franc
- Ils sont encadrés par cinquante types du Corps franc qui ont passé la frontière hier soir et qui les ont massés sur la place.Auteur : Jean-Paul Sartre - Source : Les chemins de la liberté (1945), le sursis
- C'est un phénomène classique, observable dans de nombreux pays, que la déchéance des études s'accompagne de l'inflation des diplômes et des titres. Rien ni personne ne peut plus empêcher cela en France.Auteur : Jean-François Ricard, dit Jean-François Revel - Source : La cabale des dévots
- Il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, Sodome et Gomorrhe (1922-1923)
- La souffrance sécrète du noir, l'inconnu engendre la lumière.Auteur : Christian Bobin - Source : Autoportrait au radiateur
- Pour bien écrire, il faut beaucoup lire. J’ai lu et relu les journalistes les plus cotés de France, j’ai lu également les grands classiques. A travers cette lecture massive, j’ai recherché, par-delà mon plaisir de lecteur, ce qui allait me servir dans le journalisme, le rythme, le vocabulaire, la fluidité.Auteur : Pape Diouf - Source : C'est bien plus qu'un jeu (2013)
- Au temps de Clovis, la langue était le franc-parler.Auteur : Claude Schnerb - Source : L'Humour vert (sous le pseudonyme de Claude Sergent), Éditions Buchet-Chastel, (1964)
- Ils ne peuvent pas cracher deux mille francs sans emmerder personne vos philanthropes? - Ils cracheront une fois, mais pas dix.Auteur : Simone de Beauvoir - Source : Les Mandarins (1954)
- Je suis toujours très prudent avec le sujet de “l'identité” parce que beaucoup de candidats à droite et à l'extrême-droite utilisent ce terme pour replier la France sur, en quelque sorte, la haine de l'autre, le fantasme d'un passé qui parfois n'a jamais été. Je crois beaucoup plus au concept d'appartenance à une nation, ce qui n'est pas la même chose qu'une identité. L'Histoire nous l'apprend d'ailleurs.Auteur : Emmanuel Macron - Source : Interview d'Emmanuel Macron dans La Fabrique de l'Histoire - France Culture, 9 mars 2017
- La France, c'est la Tour Eiffel et Jacques Chirac.Auteur : Michèle Alliot-Marie - Source : Prix de l'humour politique 2007.
- En France, tout le monde est un peu de Tarascon.Auteur : Alphonse Daudet - Source : Tartarin de Tarascon (1872), Epigraphe
- Gérard de Nerval revenant d'Italie, absolument désargenté, rapportait pour quatre mille francs de marbres de cheminées.Auteur : Les frères Goncourt - Source : Journal
- Je ne suis pas français, je suis breton.Auteur : Patrick Le Lay - Source : Août 2005.
- La souffrance transformait parfois les victimes au point de les rendre plus violentes que leurs bourreaux.
Auteur : Nicolas Tackian - Source : Toxique
- Dans un monde qui n'est qu'une foire et un bal masqué, il est dur de ne pas même conserver les franchises des foires et les libertés du carnaval.Auteur : Johann Paul Friedrich Richter, dit Jean-Paul - Source : Pensées extraites de tous les ouvrages de Johann Paul Friedrich Richter dit Jean-Paul
- Il m'importe peu que le nom Sárközy de Nagy-Bócsai soit devenu, pour la majorité des Français, Sarko. Il vaut mieux raccourcir les noms que les destinées ou les têtes. Il vaut mieux être un roi républicain qu'un républicain royal.Auteur : Pál de Nagy-Bocsa Sarkozy - Source : Tant de Vie (2010)
- C'est dans un char à boeufs, s'il faut parler franc,
Tiré par les amis, poussé par les parents,
Que les vieux amoureux firent leurs épousailles
Après long temps d'amour, long temps de fiançailles.Auteur : Georges Brassens - Source : La Marche nuptiale - Ici à Ceylan, les bêtes sont aimées, l'eau est franciscaine. Comparée à cette foule, toute autre est aux aguets.Auteur : André Malraux - Source : Antimémoires (1967)
- L'obscénité, si elle devait se comparer à une vertu, est bien celle qui vous affranchit de la niaiserie. Auteur : Philippe Pollet-Villard - Source : Mondial nomade
- C'est une vérité incontestable qu'il y a en France sept millions d'hommes qui demandent l'aumône, et douze millions hors d'état de la leur faire.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Maximes et Pensées, Caractères et Anecdotes (1795)
- Nous savons tous, quand nous n'aimons plus, que l'oubli, même le souvenir vague ne causent pas tant de souffrances que l'amour malheureux.Auteur : Marcel Proust - Source : A la recherche du temps perdu, A l'ombre des jeunes filles en fleurs (1919)
- La cuisine française est en pleine décadence qui, sur des tables fort réputées, substitue de plus en plus souvent à la traditionnelle purée, morceau de bravoure de Joël Robuchon, des pommes de terre écrasées par un tracteur perdant son huile.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Attends, sois, comme tous, patient et muet;
Mais si la haine sainte en nous diminuait
Rugis pour rappeler son devoir à la France.Auteur : François Coppée - Source : Le Cahier rouge (1874), Au Lion de Belfort - La solidarité, l’entraide, voilà la véritable voie. Comprendre que nous sommes fondamentalement liés, et que cette solidarité passe par le respect du vivant, de tous les vivants. Quand on voit comment sont traités les animaux en élevage intensif, c’est franchement dégueulasse. J’admire le combat de Greta Thunberg, j’admire son indignation.Auteur : Juliette Binoche - Source : Entretien, numéro 823 de Marie Claire, avril 2021.
- Le permis à points est une jolie trouvaille puisqu'il propose un crédit d'imprudences à des gens qui n'ont souvent plus un franc à la banque.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Nous avons généralement en France un gouvernement d'hommes qui savent ce qu'ils veulent. Ils veulent y rester.Auteur : André Frossard - Source : Les Pensées
Les citations du Littré sur Franc
- Vous cheez par une recrue souffrance en leur servitute, comme les perdris qui, en fuiant à despourveue negligence le perdrieur qui les chevale [poursuit], cheent en sa tonnelleAuteur : A. CHARTIER - Source : l'Espérance, p. 272, dans LACURNE
- À l'égard de la cour de France, tout y était comme à l'ordinaire ; il y a un certain train qui ne change point ; toujours les mêmes plaisirs, toujours aux mêmes heures, et toujours avec les mêmes gensAuteur : LA FAY. - Source : Mém. cour de France, Oeuv. t. II, p. 396, dans POUGENS.
- Permettez-moi de penser que, si la fortune vous était entièrement contraire, vous trouveriez une ressource dans la France, garante de tant de traitésAuteur : Voltaire - Source : Lett. roi de Prusse, octob. 1757
- L'os qu'on appelle en latin os pubis, en français l'os du penil ou l'os barréAuteur : PARÉ - Source : IV, 34
- Dix mille francs, dix mille francs d'amende ! Dieu ! quel loyer pour neuf mois de prison !Auteur : BÉRANGER - Source : Dix m. f.
- La couverture de mon second fils se fit le 1er février, jour pour jour, précisément quatre vingt-sept ans depuis la réception de mon père au parlement, comme duc et pair de FranceAuteur : SAINT-SIMON - Source : 589, 81
- Une méridienne que M. Bianchini voulait tracer dans toute l'étendue de l'Italie, à l'exemple de la méridienne de la France, unique jusqu'à présentAuteur : FONTEN. - Source : Bianchini.
- On ne voit point, dans les faubourgs ni hors des murs, ces guinguettes où nos artisans et le bas peuple vont oublier leurs travaux et se livrer à une joie franche, sans souci pour le lendemainAuteur : DUCLOS - Source : Voy. Ital. Oeuv. t. VII, p. 94, dans POUGENS
- Le roi de France nomme à tous les bénéfices consistoriaux de son royaume, c'est-à-dire aux bénéfices qui sont de fondation royale et qui étaient électifs avant le concordatAuteur : FEVRET - Source : De l'abus, I, 8, dans RICHELET
- La légèreté française danse sur le tombeau des malheureux ; pour moi, je n'ai jamais mis ma légèreté à oublier ce qui fait frémir la natureAuteur : Voltaire - Source : Lett. Mme du Deffant, 1er juin 1771
- Toi [Mlle Clairon] qui ressuscitas sous mes rustiques toits L'Électre de Sophocle aux accents de ta voix, Non l'Électre française à la mode soumise, Pour le galant Itys si galamment épriseAuteur : Voltaire - Source : Épît. LXXXV
- Je dout [crains] qu'à ce viegne [vienne], Que France s'en plaigne, Et chascuns, gros et menu, Et li jeune et li chenuAuteur : HUES DE LA FERTÉ - Source : Romanc. p. 190
- Ung quartier [de pension] montant neuf mil francsAuteur : COMM. - Source : I, 1
- Henriette, digne fille de saint Louis, y animait [dans la chapelle royale] tout le monde par son exemple, et y soutenait l'ancienne réputation de la très chrétienne maison de FranceAuteur : BOSSUET - Source : Reine d'Anglet.
- Je suis un franc provincial qui croit qu'on peut s'occuper à Paris de ce qui se passe dans son villageAuteur : Voltaire - Source : Lett. d'Argental, 27 janv. 1766
- Celle vertu que l'en seult en françoys appeller proesceAuteur : ORESME - Source : Eth. 79
- Des recherches statistiques sur l'état actuel du travail de tous les métaux dans les ateliers françaisAuteur : DE VILLEFOSSE - Source : Instit. Mém. scienc. t. IX, p 145
- La rareté de ces oiseaux en Europe, jointe au bon goût de leur chair, a donné lieu aux défenses rigoureuses qui ont été faites en plusieurs pays de les tuer ; et de là on prétend qu'ils ont eu le nom de francolin, comme jouissant d'une sorte de franchise sous la sauvegarde de ces défensesAuteur : BUFF. - Source : Ois. t. IV, p. 227, dans POUGENS
- On sait que le roi François Ier dormit sur l'affût d'un canon, à cinquante pas d'un bataillon suisse [à la bataille de Marignan]Auteur : Voltaire - Source : Moeurs, 122
- La reine remue en vain la France, la Hollande, la Pologne même, et les puissances du Nord les plus éloignéesAuteur : BOSSUET - Source : Reine d'Anglet.
- Quintilien n'est franc ni dans sa critique ni dans son éloge ; on y sent la gêneAuteur : DIDEROT - Source : Claude et Nér. II, 103
- Le roi est mené de captivité en captivité, et la reine remue en vain la France, la Hollande, la Pologne même et les puissances du Nord les plus éloignéesAuteur : BOSSUET - Source : Reine d'Anglet.
- Le pape, traîné d'exil en exil, et toujours durement traité par l'empereur, meurt enfin parmi les souffrances, sans se plaindre ni se relâcher de ce qu'il doit à son ministèreAuteur : BOSSUET - Source : Hist. I, 11
- Moi, je leur soutiens qu'un homme qui n'a pas l'air que nous avons en France, est un homme qui fait tout de mauvaise grâce, qui ne sait ni marcher, ni s'asseoir, ni se lever, ni tousser, ni cracher, ni éternuer, ni se moucher ; qu'il est par conséquent un homme sans manièresAuteur : BOISSY - Source : Français à Lond. sc. 1
- Je me suis mis à revoir ce que de longtemps j'avoye traduit de grec en françois des Vies de PlutarqueAuteur : AMYOT - Source : Épît.
Les mots débutant par Fra Les mots débutant par Fr
Une suggestion ou précision pour la définition de Franc ? -
Mise à jour le mardi 10 février 2026 à 22h41

- Facilite - Faible - Faiblesse - Faim - Faire - Fait - Famille - Fanatique - Fatalite - Fatigue - Faute - Faveur - Felicitations - Femme - Femme_homme - Ferocite - Fete - Fête des mamans - Fête des papas - Fête des mères - Fête des pères - Fidele - Fidèle - Fidelite - Fidélité - Fierte - Fille - Fils - Finalite - Finance - Flamme - Flatter - Flatterie - Fleur - Foi - Folie - Fonctionnaire - Foot - Football - Force - Fortune - Fou - Foule - Français - Française - France - Franchise - Fraternite - Frustation - Fuir - Futur
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur franc
Poèmes franc
Proverbes franc
La définition du mot Franc est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Franc sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Franc présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.

