La définition de An du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
An
Nature : s. m.
Prononciation : an
Etymologie : Provenç. an ; espagn. ano ; ital. anno ; de annus. On a rapproché annus du terme grec signifiant l'année, du dorien et aussi d'un terme laconien, comme du gothique athn, année ; mais ces rapprochements ne paraissent pas s'accorder avec l'osque amnud, équivalent de anno. Amnud appuie ceux qui disent que annus est pour am-nus, et qui y voient un radical commun aux langues celtiques : cornouail. amser ; bas-bret. amzer ; irland. am ; gaél. âm, le temps ; sanscrit, amati, même signification. L'osque amnud empêche de confondre annus, an, et annus, anneau.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de an de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec an pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de An ?
La définition de An
Le temps que met la terre à faire sa révolution autour du soleil.
Toutes les définitions de « an »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Temps que met la terre à accomplir une révolution autour du soleil et qui se divise en douze mois. Après un an entier. Après un an révolu. Au bout de l'an il arriva que... Le premier jour de l'an. Le nouvel an. L'an passé. L'an dernier. L'an prochain. Il y a deux ans, trois ans, etc. Au bout de cinquante ans. Il n'a pas encore vingt-cinq ans accomplis. Il a dix ans de service.
AN tend de plus en plus à être remplacé par son synonyme ANNÉE (Voyez ce mot). Il n'existe plus que dans quelques expressions. Dès ses jeunes ans, Dès sa première jeunesse. Dans ses vieux ans, sur ses vieux ans, Dans sa vieillesse. On dit quelquefois absolument Les ans, L'âge en général. La fleur des ans. Le poids, le fardeau des ans. L'injure, l'outrage des ans. Service de bout de l'an, ou simplement Bout de l'an, Le service qu'on fait dans une église pour une personne, un an après sa mort. L'an du monde; l'an de grâce, l'an du salut, l'an de Notre-Seigneur, l'an de l'Incarnation, Formules dont on se sert, suivant qu'on suppute les temps par rapport à la création du monde ou à la naissance de JÉSUS-CHRIST. An premier, an deux, an trois, etc., se disait particulièrement des Années de l'ère républicaine des Français, commencée le 22 septembre 1792. La Constitution de l'an III, de l'an VIII. Le 16 floréal an IV ou de l'an IV. Prov. et fam., Je m'en soucie, je m'en moque comme de l'an quarante, Cela m'est complètement indifférent. Le Jour de l'An, Le premier jour de l'an. Bon jour et bon an. Façon de parler proverbiale et populaire, employée pour saluer les personnes, la première fois qu'on les voit, dans les premiers jours de chaque année. Bon an, mal an, Compensation faite des mauvaises années avec les bonnes. Bon an, mal an, ce pré lui rapporte tant de foin. Bon an, mal an, sa terre lui vaut dix mille francs de rente. Par an, Chaque année. Sa terre lui rapporte tant par an. En termes de Jurisprudence, An et jour, L'année révolue et un jour par delà. Prescription de l'an et jour.
Littré
- 1Le temps que met la terre à faire sa révolution autour du soleil.
- 2Le premier jour de l'an ou le premier de l'an, le premier jour de l'année.
-
3La fleur des ans, la première jeunesse.
Les jeunes ans, le temps de la jeunesse.
Les vieux ans, le temps de la vieillesse.
Les ans, la vieillesse.
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
, La Fontaine, Fab. I, 16.Approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause
, La Fontaine, ib. VII, 16.Dans la nuit du tombeau les ans l'ont fait descendre
, Voltaire, ?dipe, V, 2.Tithon n'a plus les ans qui le firent cigale
, Malherbe, Ode à Duperier. - 4An du monde, an de la création, de Notre-Seigneur?; l'an où l'on est depuis la création, depuis la naissance de Jésus-Christ.
- 5An I, an II, an VIII s'employaient pour indiquer les années de l'ère de la république française, commencée le 22 septembre 1792.
-
6Bon an mal an, compensation faite des bonnes et des mauvaises années.
Et l'on m'a assuré qu'elle portait d'ordinaire sur elle, bon an mal an, trente quintaux de chair
, Scarron, Rom. com. ch. VIII, 2e part.Nous payons [au gouvernement], bon an mal an, 900 millions
, Courier, I, 190. - 7Par an, chaque année. Il gagne 2000 fr. par an.
- 8Service du bout de l'an ou simplement bout de l'an, le service qu'on fait dans une église pour une personne un an après sa mort.
- 9Bon jour et bon an, façon de saluer populaire quand on voit une personne dans les premiers jours de l'année.
- 10 En termes de jurisprudence, an et jour, l'année révolue et un jour en plus.
SYNONYME
AN, ANNÉE. Ces deux termes s'emploient indifféremment l'un pour l'autre, sauf certaines locutions consacrées où l'on ne peut pas substituer année à an, comme bon an mal an, et sauf que, quand on veut qualifier l'année à l'aide d'une épithète, on se sert non de an, mais d'année. On ne dira pas un bon an, un an abondant, un an heureux, mais une bonne année, une année abondante, une année heureuse.
HISTORIQUE
XIe s. À tant cum la cense est de un an
, L. de Guill. 40. Set anz touz pleinz ad ested en Espaigne
, Ch. de Rol. I. Ensemble [nous] avons ested et ans et dis [jours]
, ib. CXLIX.
XIIe s. [Charlemagne] a bien passé cent ans
, Roncisv. p. 26. Puis fu set anz accomplis et entiers
, ib. p. 31. En vieille geste est escriz de lons ans
, ib. p. 86. Et pour son fil qu'il eut nourri tant ans
, ib. p. 142. L'an que rose ne feuille Ne fleur [je] ne voi paroir
, Couci, VIII. Je souferrai mon domage, Tant que l'an verrai passer
, Dame de Faiel dans Couci. Bien [tu] peuz conquerre France, or est entrez li ans [l'année en est venue]
, Sax. V.
XIIIe s. Trois ans [il] fut chevaliers, pleins fut de courtoisie
, Berte, II. Vingt ans avoit Pepins, ainsi [je] l'ouï esmer
, ib. III. Cinq cens livres par an à chascune [il] donra
, ib. CXXXI. Li an et li jour s'en vont aussi comme l'aigue qui court aval sans retourner
, Richard de Fournival, dans Hist. litt. t. XXIII, p. 723. Quant la terre est bien replenie de flors et de fruiz, lors est li anz coronez
, Psautier, f° 75. Ceste addition fu fete en l'an de grace mil?
, Liv. des mét. 360. Se baillage escheit à damoiselle qui ait douze ans ou plus d'aage, et le vueille aveir et tenir et user
, Ass. de Jér. I, 267. Il pot commander à l'eglise à qui li lais [legs] est fes, que il l'oste de se [sa] main et le mete en main laie dedans an et jour
, Beaumanoir, XII, 5.
XVe s. Si Monseigneur de Flandres vouloit, il auroit, tous les ans, un grand profit sur les navieurs dont il n'a maintenant rien
, Froissart, II, II, 52. Si fut cette chose si approchée que, droitement la nuit de l'an, la chose fut arrestée d'estre faite, et devoit le dit Aimery delivrer le chasteau de Calais en icelle nuit
, Froissart, LI, 326.
XVIe s. L'an passé est toujours le meilleur
, Génin, Récréat. t. II, p. 242.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
AN. - SYN. Ajoutez?: An ne s'emploie pas en astronomie.
Encyclopédie, 1re édition
AN, s. m. ou ANNÉE, s. f. (Hist. & Astr.) dans l'étendue ordinaire de sa signification, est le cycle ou l'assemblage de plusieurs mois, & communément de douze. Voyez Cycle & Mois.
D'autres définissent généralement l'année, une période ou espace de tems qui se mesure par la révolution de quelque corps céleste dans son orbite. Voyez Période.
Ainsi le tems dans lequel les étoiles fixes font leur révolution est nommé la grande année. Cette année est de 25920 de nos années vulgaires ; car on a remarqué que la section commune de l'écliptique & de l'équateur, n'est pas fixe & immobile dans le ciel étoilé ; mais que les étoiles s'en éloignent en s'avançant peu-à-peu au-delà de cette section, d'environ 50 secondes par an. On a donc imaginé que toute la sphere des étoiles fixes faisoit une révolution périodique autour des poles de l'écliptique, & parcouroit 50 secondes en un an ; ce qui fait 25920 ans pour la révolution entiere. On a appellé grande année ce long espace de tems, qui surpasse quatre à cinq fois celui que l'on compte vulgairement depuis le commencement du monde. Voyez l'article Précession des équinoxes.
Les tems dans lesquels Jupiter, Saturne, le Soleil, la Lune, finissent leurs révolutions, & retournent au même point du zodiaque, sont respectivement appellés années de Jupiter, de Saturne ; années Solaires & années Lunaires. Voyez Soleil, Lune, Planete , &c.
L'année proprement dite, est l'année solaire, ou l'espace de tems dans lequel le Soleil parcourt ou paroît parcourir les douze signes du zodiaque. Voyez Zodiaque & Ecliptique.
Suivant les observations de Messieurs Cassini, Bianchini, de la Hire, l'année est de 365 jours 5 heures 49 min. & c'est-là la grandeur de l'année fixée par les auteurs du Calendrier Grégorien. Cette année est celle qu'on appelle l'année Astronomique : quant à l'année civile, on la fait de 365 jours, excepté une année de quatre en quatre, qui est de 366 jours.
La vicissitude des saisons semble avoir donné occasion à la premiere institution de l'année ; les hommes portés naturellement à chercher la cause de cette vicissitude, virent bien-tôt qu'elle étoit produite par les différentes situations du Soleil par rapport à la terre, & ils convinrent de prendre pour l'année l'espace de tems que cet astre mettoit à revenir dans la même situation, c'est-à-dire, au même point de son orbite. Voyez Saison.
Ainsi comme ce fut principalement par rapport aux saisons que l'année fut instituée, la principale attention qu'on eut, fut de faire ensorte que les mêmes parties de l'année répondissent toûjours aux mêmes saisons, c'est-à-dire, que le commencement de l'année se trouvât toûjours dans le tems que le Soleil étoit au même point de son orbite.
Mais comme chaque peuple prit une voie différente pour arriver à ce but, ils ne choisirent pas tous le même point du zodiaque pour fixer le commencement de l'année, & ils ne s'accorderent pas non plus sur la durée de la révolution entiere. Quelques-unes de ces années étoient plus correctes que les autres, mais aucune n'étoit exacte, c'est-à-dire, qu'aucune ne marquoit parfaitement le tems précis de la révolution du Soleil.
Ce sont les Egyptiens, si on en croit Hérodote, qui ont les premiers fixé l'année, & qui l'ont fait de 360 jours, qu'ils séparerent en douze mois ; Mercure Trismegiste ajoûta cinq jours à l'année, & la fit de 365 jours. Thalès, à ce qu'on prétend, la fit du même nombre de jours parmi les Grecs : mais il ne fut suivi en ce point que d'une partie de la Grece. Les Juifs, les Syriens, les Romains, les Perses, les Ethiopiens, les Arabes, avoient chacuns des années différentes. Toute cette diversité est peu étonnante, si on fait attention à l'ignorance où l'on étoit pour lors de l'Astronomie. Nous lisons même dans Diodore de Sicile, liv. I. dans la vie de Numa par Plutarque, & dans Pline, Liv. VII. chapit. xlviij. que l'année Egyptienne étoit dans les premiers tems fort différente de celle que nous appellons aujourd'hui de ce nom.
L'année solaire est l'intervalle de tems dans lequel le soleil paroît décrire le zodiaque, ou celui dans lequel cet astre revient au point d'où il étoit parti. Voyez Soleil.
Ce tems, selon la mesure commune, est de 365 jours 5 heures 49 minutes. Cependant quelques Astronomes le font plus ou moins grand de quelques secondes, & vont même jusqu'à une minute de différence. Kepler, par exemple, faisoit l'année de 365 jours 5 heures 48 min. 57 sec. 39 tierces. Riccioli de 365 jours 5 heures 48 min. Tycho de 365 jours 5 heures 48 min. M. Euler a publié dans le premier tome des Mémoires François de l'Académie de Berlin, pag. 37, une table par laquelle on voit combien les Astronomes sont peu d'accord sur la grandeur de l'année solaire.
L'année solaire, comme nous l'avons déjà observé, est divisée en année astronomique & année civile.
L'année astronomique est celle qui est déterminée avec précision par les observations astronomiques : comme il est assez avantageux que cette année ait un commencement fixe, soit qu'on compte le tems en année écoulées depuis la naissance de J. C. soit qu'on le compte en années écoulées depuis le commencement de la période Julienne, les Astronomes sont enfin convenus que le commencement de l'année solaire soit compté du midi qui précede le premier jour de Janvier, c'est-à-dire, de maniere qu'à midi du premier Janvier, on compte déjà un jour complet ou 24 heures de tems écoulées.
On peut distinguer l'année astronomique en deux especes ; l'une syderéale, l'autre tropique.
L'année syderéale, qu'on appelle aussi anomalistique ou périodique, est l'espace de tems que le soleil met à faire sa révolution apparente autour de la terre, ou, ce qui revient au même, le tems que la terre met à revenir au même point du zodiaque. Ce tems est de 365 jours 6 heures 9 minutes 14 sec.
L'année tropique est le tems qui s'écoule entre deux équinoxes de printems ou d'automne ; on la nomme année tropique, parce qu'il faut que tout cet intervalle de tems s'écoule pour que chaque saison se rétablisse dans le même ordre qu'auparavant : cette année est de 365 jours 5 heures 48 min. 57 sec. & par conséquent elle est un peu plus courte que l'année syderéale. La raison de cela est que comme l'équinoxe, ou la section de l'écliptique & de l'équateur est rétrograde de 50 secondes par an, le soleil, après qu'il est parti d'un des équinoxes, doit paroître rencontrer ce même équinoxe l'année suivante dans un point un peu en-deçà de celui où il l'a quitté ; & par conséquent le soleil n'aura pas encore achevé sa révolution entiere lorsqu'il sera de retour aux mêmes points des équinoxes. Inst. Astr.
L'année civile est celle que chaque nation a fixée pour calculer l'écoulement du tems : ce n'est autre chose que l'année tropique, dans laquelle on ne s'arrête qu'au nombre entier de jours, en laissant les fractions des heures & des minutes, afin que le calcul en soit plus commode.
Ainsi l'année tropique étant d'environ 365 jours 5 heures 49 minutes, l'année civile est seulement de 365 jours : mais de crainte que la correspondance avec le cours du soleil ne s'altérât au bout d'un certain tems, on a réglé que chaque quatrieme année seroit de 366 jours pour réparer la perte des fractions qu'on néglige les trois autres années.
De cette maniere l'année civile est soûdivisée en commune & en bissextile.
L'année civile commune est celle qu'on a fixée à 365 jours ; elle est composée de 7 mois de 31 jours ; savoir, Janvier, Mars, Mai, Juillet, Août, Octobre, Décembre ; de quatre de 30 jours, Avril, Juin, Septembre & Novembre, & d'un de 28 jours, qui est Février. Il y a apparence que cette distribution bisarre a été faite pour conserver, autant qu'il étoit possible, l'égalité entre les mois, & en même tems pour qu'ils fussent tous à peu près de la grandeur des mois lunaires, dont les uns sont de 30 jours & les autres de 29. Une autre raison qui a pû y engager, c'est que le soleil met plus de tems à aller de l'équinoxe du printems à l'équinoxe d'automne, que de celui d'automne à celui du printems ; desorte que du premier Mars au premier Septembre, il y a quatre jours de plus que du premier Septembre au premier Mars : mais quelque motif qu'on ait eu pour faire cette distribution, on peut en général supposer l'année commune de 5 mois de 31 jours, & de 7 mois de 30 jours.
L'année bissextile est composée de 366 jours, & elle a par conséquent un jour de plus que l'année commune ; ce jour est appellé jour intercalaire ou bissextile.
L'addition de ce jour intercalaire, tous les quatre ans, a été faite par Jules César, qui, voulant que les saisons pussent toûjours revenir dans le même tems de l'année, joignit à la quatrieme année les six heures négligées dans chacune des années précédentes. Il plaça le jour entier formé par ces quatre fractions après le vingt-quatrieme de Février, qui étoit le sixieme des Calendes de Mars.
Or comme ce jour ainsi répété étoit appellé en conséquence bis sexto calendas, l'année où ce jour étoit ajoûté, fût aussi appellée bis sextus, d'où est venu bissextile.
Le jour intercalaire n'est plus aujourd'hui regardé comme la répétition du 24 Février, mais il est ajoûté à la fin de ce mois, & en est le vingt-neuvieme. Voyez Bissextile.
Il y a encore une autre réformation de l'année civile, établie par le pape Grégoire XIII. Voyez Grégorien.
L'année lunaire est composée de douze mois lunaires. Voyez Lunaire. Or il y a deux especes de mois lunaires ; savoir, le mois périodique, qui est de 27 jours 7 heures 43 min. 5 sec. c'est à peu près le tems que la lune employe à faire sa révolution autour de la terre : 2°. le mois synodique, qui est le tems que cette planete employe à retourner vers le soleil à chaque conjonction ; ce tems qui est l'intervalle de deux nouvelles lunes, est de 29 jours 12 heures 44 minutes 33 sec. Voyez à l'article Synodique la cause de la différence de ces deux mois. Le mois synodique est le seul dont on se serve pour mesurer les années lunaires ; or comme ce mois est d'environ 29 jours & 12 heures, on a été obligé de supposer, pour la commodité du calcul, les mois lunaires civils de 30 & de 29 jours alternativement ; ainsi le mois synodique étant de deux especes, astronomique & civil, il a fallu distinguer aussi deux especes d'années lunaires ; l'une astronomique, l'autre civile. Inst. Astr.
L'année astronomique lunaire est composée de douze mois synodiques lunaires, & contient par conséquent 354 jours 8 heures 48 min. 30 sec. 12 tierces. Voyez Synodique.
L'année lunaire civile est ou commune, ou embolismique.
L'année lunaire commune est de douze mois lunaires civils, c'est-à-dire de 354 jours.
L'année embolismique intercalaire est de treize mois lunaires civils, & de 384 jours. Voyez Embolismique. Voici la raison qui a fait inventer cette année : comme la différence entre l'année lunaire civile & l'année tropique est de 11 jours 5 heures 49 min. il faut, afin que la premiere puisse s'accorder avec la seconde, qu'il y ait 34 mois de 30 jours, & 4 mois de 31 insérés dans cent années lunaires ; ce qui laisse encore en arriere un reste de 4 heures 21 min. qui dans six siecles fait un peu plus d'un jour.
Jusqu'ici nous avons parlé des années & des mois, en les considérant astronomiquement. Examinons présentement les différentes formes d'années civiles que les Anciens ont imaginées, & celles que suivent aujourd'hui divers peuples de la terre. L'ancienne année romaine étoit l'année lunaire. Dans sa premiere institution par Romulus, elle étoit seulement composée de dix mois. Le premier, celui de Mars, contenoit 31 jours ; le second, celui d'Avril, 30. 3°. Mai 31 ; 4°. Juin 30 ; 5°. Quintilis ou Juillet 31 ; 6°. Sextilis ou Août 30 ; 7°. Septembre 30 ; 8°. Octobre 31 ; 9°. Novembre 30 ; 10°. Decembre 30 ; le tout faisant 304 jours. Ainsi cette année se trouvoit moindre de 50 jours que l'année lunaire réelle, & de 61 que l'année solaire.
De-là il résultoit que le commencement de l'année de Romulus étoit vague, & ne répondoit à aucune saison fixe. Ce Prince sentant l'inconvénient d'une telle variation, voulut qu'on ajoûtât à chaque année le nombre de jours nécessaires pour que le premier mois répondit toûjours au même état du ciel : mais ces jours ajoûtés ne furent point partagés en mois.
Numa Pompilius corrigea cette forme irréguliere de l'année, & fit deux mois de ces jours surnuméraires. Le premier fut le mois de Janvier ; le second celui de Février. L'année fut ainsi composée par Numa de douze mois, 1°. Janvier 29 jours, 2°. Février 28, 3°. Mars 31, 4°. Avril 29, 5°. Mai 31, 6°. Juin 29, 7°. Juillet 31, 8°. Août 29, 9°. Septembre 29, 10°. Octobre 31, 11°. Novembre 29, 12°. Decembre 29 ; le tout faisant 355 jours. Ainsi cette année surpassoit l'année civile lunaire d'un jour, & l'année astronomique lunaire de 15 heures 11 minutes 24 secondes : mais elle étoit plus courte que l'année solaire de 11 jours, ensorte que son commencement étoit encore vague, par rapport à la situation du soleil.
Numa voulant que le solstice d'hyver répondît au même jour, fit intercaler 22 jours au mois de Février de chaque seconde année, 23 à chaque quatrieme, 22 à chaque sixieme, & 23 à chaque huitieme. Mais cette regle ne faisoit point encore la compensation nécessaire ; car comme l'année de Numa surpassoit d'un jour l'année Greque de 354 jours, l'erreur devint sensible au bout d'un certain tems, ce qui obligea d'avoir recours à une nouvelle maniere d'intercaler ; au lieu d'ajoûter vingt-trois jours à chaque huitieme année, on n'en ajoûta que quinze ; & on chargea les grands Pontifes de veiller au soin du calendrier. Mais les grands Pontifes ne s'acquittant point de ce devoir, laisserent tout retomber dans la plus grande confusion. Telle fut l'année romaine jusqu'au tems de la réformation de Jules César. Voyez les articles Calendes, Nones & Ides, sur la maniere de compter les jours du mois chez les Romains.
L'année Julienne est une année solaire, contenant communément 365 jours, mais qui de quatre ans en quatre ans, c'est-à-dire, dans les années bissextiles, est de 366 jours.
Les mois de l'année Julienne étoient disposés ainsi : 1°. Janvier 31 jours, 2°. Février 28, 3°. Mars 31, 4°. Avril 30, 5°. Mai 31, 6°. Juin 30, 7°. Juillet 31, 8°. Août 31, 9°. Septembre 30, 10°. Octobre 31, 11°. Novembre 30, 12°. Decembre 31 ; & dans toutes les années bissextiles le mois de Février avoit comme à présent 29 jours. Suivant cet établissement la grandeur astronomique de l'année Julienne étoit de 365 jours 6 heures ; & elle surpassoit par conséquent la vraie année solaire d'environ 11 minutes, ce qui en 131 ans produisoit un jour d'erreur. L'année romaine étoit encore dans cet état d'imperfection, lorsque le Pape Grégoire XIII. y fit une réformation, dont nous parlerons un peu plus bas.
Jules César à qui l'on est redevable de la forme de l'année Julienne, avoit fait venir d'Egypte Sosigènes fameux Mathématicien, tant pour fixer la longueur de l'année, que pour en rétablir le commencement, qui avoit été entierement dérangé de 67 jours, par la négligence des Pontifes.
Afin donc de le remettre au solstice d'hyver, Sosigènes fut obligé de prolonger la premiere année jusqu'à quinze mois ou 445 jours ; & cette année s'appella en conséquence l'année de confusion, annus confusionis.
L'année établie par Jules César a été suivie par toutes les nations chrétiennes jusqu'au milieu du seizieme siecle, & continue même encore de l'être par l'Angleterre. Les Astronomes & les Chronologistes de cette nation comptent de la même maniere que le peuple, & cela sans aucun danger, parce qu'une erreur qui est connue n'en est plus une.
L'année Grégorienne n'est autre que l'année Julienne corrigée par cette regle, qu'au lieu que la derniere de chaque siecle étoit toûjours bissextile, les dernieres années de trois siecles consécutifs doivent être communes ; & la derniere du quatrieme siecle seulement est comptée pour bissextile.
La raison de cette correction, fut que l'année Julienne avoit été supposée de 365 jours 6 heures, au lieu que la véritable année solaire est de 365 jours 5 heures 49 minutes, ce qui fait 11 minutes de différence, comme nous l'avons déja remarqué.
Or quoique cette erreur de 11 minutes qui se trouve dans l'année Julienne soit fort petite, cependant elle étoit devenue si considérable en s'accumulant depuis le tems de Jules Cesar, qu'elle avoit monté à 10 jours, ce qui avoit considérablement dérangé l'équinoxe. Car du tems du Concile de Nicée, lorsqu'il fut question de fixer les termes du tems auquel on doit célébrer la Pâque, l'équinoxe du Printems se trouvoit au 21 de Mars. Mais cet équinoxe ayant continuellement anticipé, on s'est apperçû l'an 1582. lorsqu'on proposa de réformer le calendrier de Jules Cesar, que le soleil entroit déjà dans l'équateur dès le 11 Mars ; c'est-à-dire, 10 jours plûtôt que du tems du Concile de Nicée. Pour remédier à cet inconvénient, qui pouvoit aller encore plus loin, le Pape Grégoire XIII. fit venir les plus habiles Astronomes de son tems, & concerta avec eux la correction qu'il falloit faire, afin que l'équinoxe tombât au même jour que dans le tems du Concile de Nicée ; & comme il s'étoit glissé une erreur de dix jours depuis ce tems-là, on retrancha ces dix jours de l'année 1582, dans laquelle on fit cette correction ; & au lieu du 5 d'Octobre de cette année, on compta tout de suite le 15.
La France, l'Espagne, les pays Catholiques d'Allemagne, & l'Italie, en un mot, tous les pays qui sont sous l'obéissance du Pape, reçûrent cette réforme dès son origine : mais les Protestans la rejetterent d'abord.
En l'an 1700, l'erreur des dix jours avoit augmenté encore & étoit devenue de onze ; c'est ce qui détermina les protestans d'Allemagne à accepter la réformation Grégorienne, aussi-bien que les Danois & les Hollandois. Mais les peuples de la Grande-Bretagne & la plûpart de ceux du Nord de l'Europe, ont conservé jusqu'ici l'ancienne forme du calendrier Julien. Voyez Calendrier, Style. Inst. Astr.
Au reste il ne faut pas croire que l'année Grégorienne soit parfaite ; car dans quatre siecles l'année Julienne avance de trois jours, une heure & 22 minutes. Or comme dans le calendrier Grégorien on ne compte que les trois jours, & qu'on néglige la fraction d'une heure & 22 minutes, cette erreur au bout de 72 siecles produira un jour de mécompte.
L'année Egyptienne appellée aussi l'année de Nabonassar, est l'année solaire de 365 jours divisée en douze mois de trente jours, auxquels sont ajoûtés cinq jours intercalaires à la fin : les noms de ces mois sont ceux-ci. 1°. Thot, 2°. Paophi, 3°. Athyr, 4°. Chojac, 5°. Tybi, 6°. Mecheir, 7°. Phatmenoth, 8°. Pharmuthi, 9°. Pachon, 10°. Pauni, 11°. Epiphi, 12°. Mesori ; & de plus ?????? ??????????, ou les cinq jours intercalaires.
La connoissance de l'année Egyptienne, dont nous venons de parler, est de toute nécessité en Astronomie, à cause que c'est celle suivant laquelle sont dressées les observations de Ptolomée dans son Almageste.
Les anciens Egyptiens, suivant Diodore de Sicile, liv. I. Plutarque dans la vie de Numa, Pline, liv. VII. c. 48. mesuroient les années par le cours de la lune. Dans le commencement une lunaison, c. à. d. un mois lunaire faisoit l'année ; ensuite trois, puis quatre, à la maniere des Arcadiens. De-là les Egyptiens allerent à six, ainsi que les peuples de l'Acarnanie. Enfin ils vinrent à faire l'année de 360 jours, & de douze mois ; & Aseth, 32e Roi des Egyptiens, ajoûta à la fin de l'année les 5 jours intercalaires. Cette briéveté des premieres années Egyptiennes, est ce qui fait, suivant les mêmes Auteurs, que les Egyptiens supposoient le monde si ancien, & que dans l'Histoire de leurs Rois, on en trouve qui ont vécu jusqu'à mille & douze cens ans. Quant à Herodote, il garde un profond silence sur ce point ; il dit seulement que les années Egyptiennes étoient de douze mois, ainsi que nous l'avons déja remarqué. D'ailleurs l'Ecriture nous apprend que dès le tems du déluge l'année étoit composée de douze mois. Par conséquent Cham, & son fils Misraim, fondateur de la Monarchie Egyptienne, ont dû avoir gardé cet usage, & il n'est pas probable que leurs descendans y ayent dérogé. Ajoûtez à cela, que Plutarque ne parle sur cette matiere qu'avec une sorte d'incertitude, & qu'il n'avance le fait dont il s'agit, que sur le rapport d'autrui. Pour Diodore de Sicile, il n'en parle que comme d'une conjecture de quelques auteurs, dont il ne dit pas le nom, & qui probablement avoient crû par-là concilier la chronologie Egyptienne avec celle des autres nations.
Quoi qu'il en soit, le Pere Kircher prétend qu'outre l'année solaire, quelques provinces d'Egypte avoient des années lunaires, & que dans les tems les plus reculés quelques-uns des peuples de ces provinces prenoient une seule révolution de la lune pour une année ; que d'autres trouvant cet intervalle trop court, faisoient l'année de deux mois, d'autres de trois, &c. Ædip. Egypt. tom. II. p. 252.
Un Auteur de ces derniers tems assûre que Varron a attribué à toutes les nations ce que nous venons d'attribuer aux Egyptiens, & il ajoûte que Lactance le releve à ce sujet.
Nous ne savons pas sur quels endroits de Varron & de Lactance cet auteur se fonde ; tout ce que nous pouvons assûrer, c'est que Lactance, Divin. instit. Lib. II. c. xiij. en parlant de l'opinion de Varron suppose qu'il parle seulement des Egyptiens.
Au reste S. Augustin, de Civit. Dei, L. XV. c. xiv. fait voir que les années des patriarches rapportées dans l'Ecriture sont les mêmes que les nôtres ; & qu'il n'est pas vrai, comme beaucoup de gens se le sont imaginés, que dix de ces années n'en valoient qu'une d'à présent.
Quoi qu'il en soit, il est certain que l'année Egyptienne de 365 jours étoit une année vague ; car comme elle différoit d'environ 6 heures de l'année tropique, il arrivoit en négligeant cet intervalle de 6 heures, que de 4 ans en 4 ans, cette année vague anticipoit d'un jour sur la période solaire ; & que par conséquent en quatre fois 365 ans, c'est-à-dire, en 1460 ans, son commencement devoit répondre successivement aux différentes saisons de l'année.
Lorsque les Egyptiens furent subjugués par les Romains, ils reçûrent l'année Julienne, mais avec quelqu'altération ; car ils retinrent leurs anciens noms avec les cinq ?????? ??????????, & ils placerent le jour intercalé tous les quatre ans, entre le 28 & le 29 d'Août.
Le commencement de leur année répondoit au 29 Août de l'année Julienne. Leur année réformée de cette maniere, s'appelloit annus Actiacus, à cause qu'elle avoit été instituée après la bataille d'Actium.
L'ancienne année Greque étoit lunaire, & composée de douze mois, qui étoient d'abord tous de 30 jours, & qui furent ensuite alternativement de 30 & de 29 jours ; les mois commençoient avec la premiere apparence de la nouvelle lune ; & à chaque 3e, 5e, 8e, 11e, 14e, 16e & 17e année du cycle de 19 ans, on ajoûtoit un mois embolismique de trente jours, afin que les nouvelles & pleines lunes revinssent aux mêmes termes ou saisons de l'année. Voyez Embolismique.
Leur année commençoit à la premiere pleine lune d'après le solstice d'été. L'ordre de leurs mois étoit celui-ci, 1°. ??????????? de 29 jours, 2°. ????????????, 30 jours ; 3°. ?????????? 29 : 4°. ???????????? 30, 5°. ????????? 29, 6°. ????????? 30, 7°. ???????? 29, 8°. ???????????, 30 ; 9°. ???????????, 29 ; 10°. ?????????, 30 ; 11°. ?????????, 29 ; 12°. ???????????, 30.
Les Macédoniens avoient donné d'autres noms à leurs mois, ainsi que les Syro-Macédoniens, les Smyrniens, les Tyriens, les peuples de Chypre, les Paphiens, les Bithyniens, &c.
L'ancienne année Macédonienne étoit une année lunaire, qui ne différoit de la Greque que par le nom & l'ordre des mois. Le premier mois Macédonien répondoit au mois Mæmacterion, ou 4e mois Attique : voici l'ordre, la durée, & les noms de ces mois : 1°. ????, 30 jours : 2°. ?????????, 29 jours ; 3°. ?????????, 30 ; 4°. ????????, 29 ; 5°. ???????, 30 ; 6°. ????????, 30 ; 7°. ??????????, 30 ; 8°. ???????, 29 ; 9°. ???????, 30 ; 10°. ????, 29 ; 11°. ????????, 30 ; 12°. ?????????????, 29.
La nouvelle année Macédonienne est une année solaire, dont le commencement est fixé au premier Janvier de l'année Julienne, avec laquelle elle s'accorde parfaitement.
Cette année étoit particulierement nommée l'année Attique ; & le mois intermédiaire d'après Posideon, ou le 6e mois, étoit appellé ????????? ?, ou dernier Posideon.
L'ancienne année Juive étoit une année lunaire, composée ordinairement de 12 mois alternativement de 30 & de 29 jours. On la faisoit répondre à l'année solaire, en ajoûtant à la fin 11 & quelquefois 12 jours, ou en inserant un mois embolismique.
Voici les noms & la durée de ces mois : 1°. Nisan ou Abib, 30 jours ; 2°. Jiar ou Zius, 29 ; 3°. Siban ou Siivan, 30 ; 4°. Thamuz ou Tamuz, 29 ; 5°. Ab, 30 ; 6°. Elul, 29 ; 7°. Tisri ou Ethanim, 30 ; 8°. Marchesvam ou Bul, 29 ; 9°. Cisleu, 30 ; 10°. Thebeth, 29 ; 11°. Sabat ou Schebeth, 30 ; 12°. Adar dans les années embolismiques, 30 ; Adar, dans les années communes étoit de 29.
L'année Juive moderne est pareillement une année lunaire de 12 mois dans les années communes, & de 13 dans les années embolismiques, lesquelles font la 3e. la 6e. 8e. 11e. 14e. 17e. & 19e. du cycle de 19 ans. Le commencement de cette année est fixé à la nouvelle lune d'après l'équinoxe d'automne.
Les noms des mois & leur durée, sont 1°. Tisri, de 30 jours ; 2°. Marchesvan, 29 ; 3°. Cisleu, 30 ; 4°. Tebeth, 29 ; 5°. Schebeth, 30 ; 6°. Adar, 29 ; 7°. Veadar, dans les années embolismiques, 30 ; 8°. Nisan, 30 ; 9°. Jiar, 29 ; 10°. Silvan, 30 ; 11°. Thamuz, 29 ; 12°. Ab, 30 ; 13°. Elub, 29. Voyez.
L'année Syrienne est une année solaire, dont le commencement est fixé au commencement du mois d'Octobre de l'année Julienne, & qui ne differe d'ailleurs de l'année Julienne que par le nom des mois, la durée étant la même. Les noms de ses mois sont, 1°. Tishrin répondant au mois d'Octobre & contenans 31 jours ; 2°. le second Tishrin contenant ainsi que Novembre, 30 jours ; 3°. Canun, 31 ; 4°. le second Canun, 31 ; 5°. Shabar, 28 ; 6°. Adar, 31 ; 7°. Nisan, 30 ; 8°. Acyar, 31 ; 9°. Hariram, 30 ; 10°. Tamuz, 31 ; 11°. Ab, 31 ; 12°. Elul, 30.
L'année Persienne est une année solaire de 365 jours, & composée de douze mois de 30 jours chacun, avec 5 jours intercalaires ajoûtés à la fin. Voici le nom des mois de cette année. 1°. Atrudiameh ; 2°. Ardihasehlmeh ; 3°. Cardimeh ; 4°. Thirmeh ; 5°. Merdedmed ; 6°. Schabarirmeh ; 7°. Meharmeh ; 8°. Abenmeh ; 9°. Adarmeh ; 10°. Dimeh ; 11°. Behenmeh ; 12°. Affirermeh. Cette année est appellée année Jezdegerdique, pour la distinguer de l'année solaire fixe, appellée l'année Gelaleene, que les Persans suivent depuis l'année 1089.
Golius, dans ses notes sur Alsergan, pag. 27 & suiv. est entré dans un grand détail sur la forme ancienne & nouvelle de l'année Persienne, laquelle a été suivie de la plûpart des auteurs Orientaux. Il nous apprend particulierement, que sous le Sultan Gelaluddaulé Melicxa, vers le milieu du onzieme siecle, on entreprit de corriger la grandeur de l'année & d'établir une nouvelle époque ; il fut donc reglé que de quatre ans en quatre ans, on ajoûteroit un jour à l'année commune, laquelle seroit par conséquent de 366 jours. Mais parce qu'on avoit reconnu que l'année solaire n'étoit pas exactement de 365 jours 6 heures, il fut ordonné qu'alternativement (après 7 ou 8 intercalations) on intercaleroit la cinquieme, & non pas la quatrieme année ; d'où il paroît que ces peuples connoissoient déja fort exactement la grandeur de l'année, puisque selon cette forme, l'année Persienne seroit de 365 jours 5 heures 49 minutes 31 secondes, ce qui differe à peine de l'année Grégorienne, que les Européens ou Occidentaux se sont avisés de rechercher plus de 500 ans après les Asiatiques ou Orientaux. Or depuis la mort de Jezdagirde, le dernier des Rois de Perse, lequel fut tué par les Sarrasins, l'année Persienne étoit de 365 jours, sans qu'on se souciât d'y admettre aucune intercalation ; & il paroît que plus anciennement, après 120 années écoulées, le premier jour de l'an, qui avoit rétrogradé très-sensiblement, étoit remis au même lieu qu'auparavant, en ajoûtant un mois de plus à l'année, qui devenoit pour lors de 13 mois. Mais l'année dont tous les auteurs qui ont écrit en Arabe ou en Persan, ont fait usage dans leurs tables Astronomiques, est semblable aux années Égyptiennes, lesquelles sont toutes égales, étant de 365 jours sans intercalation. Inst. Astr. de M. le Monnier.
Au reste l'année Jezdegerdique, comme on peut le remarquer, est la même chose que l'année de Nabonassar. Quant à l'année Gelaleene, c'est peut-être la plus parfaite & la plus commode de toutes les années civiles, ainsi que nous venons de le dire ; car, comme on trouve par le calcul, les solstices & les équinoxes répondent constamment aux mêmes jours de cette année, qui s'accorde en tout point avec les mouvemens solaires ; & c'est une avantage qu'elle a même, selon plusieurs Chronologistes, sur l'année Grégorienne, parce que celle-ci, selon eux, n'a pas une intercalation aussi commode.
L'année Arabe ou Turque est une année lunaire, composée de 12 mois, qui sont alternativement de 30 & de 29 jours ; quelquefois aussi elle contient 13 mois. Voici le nom &c. de ces mois. 1°. Muharram, de 30 jours ; 2°. Saphar, 29 ; 3°. Rabia, 30 ; 4°. second Rabia, 29 ; 5°. Jomada, 30 ; 6°. second Jomada, 29 ; 7°. Rajab, 30 ; 8°. Shaaban, 29 ; 9°. Samadan, 30 ; 10°. Shawal, 29 ; 11°. Dulkaadah, 30 ; 12°. Dulheggia, 29, & de 30 dans les années embolismiques. On ajoûte un jour intercalaire à chaque 2e, 5e, 7e, 10e, 13e, 15e, 18e, 21e, 24e, 26e, 29e année d'un cycle de 29 ans.
L'année Ethiopique est une année solaire qui s'accorde parfaitement avec l'Actiaque, excepté dans les noms des mois. Son commencement répond à celui de l'année Egyptienne, c'est-à-dire au 29e d'Avril de l'année Julienne.
Les mois de cette année sont, 1°. Mascaram ; 2°. Tykympl ; 3°. Hydar ; 4°. Tyshas ; 5°. Tyr ; 6°. Jacatil ; 7°. Magabit, 8°. Mijaria ; 9°. Giribal ; 10°. Syne ; 11°. Hamle ; 12°. Hahase, & il y a de plus cinq jours intercalaires.
L'année Sabbatique, chez les anciens Juifs, se disoit de chaque septieme année. Durant cette année, les Juifs laissoient toûjours reposer leurs terres.
Chaque septieme année Sabbatique, c'est-à-dire chaque 49e. année étoit appellée l'année de Jubilé, & étoit célebrée avec une grande solemnité. Voyez Jubilé.
Le jour de l'an, ou le jour auquel l'année commence, a toûjours été très-différent chez les différentes Nations.
Chez les Romains, le premier & le dernier jour de l'an étoient consacrés à Janus ; & c'est par cette raison qu'on le représentoit avec deux visages.
C'est de ce peuple que vient la cérémonie de souhaiter la bonne année, cérémonie qui paroît très ancienne. Non-seulement les Romains se rendoient des visites, & se faisoient réciproquement des complimens avant la fin du premier jour : mais ils se présentoient aussi des étrennes, strenæ, & offroient aux Dieux des v?ux pour la conservation les uns des autres. Lucien en parle comme d'une coûtume très ancienne, même de son tems, & il en rapporte l'origine à Numa.
Ovide fait allusion à la même cérémonie au commencement de ses fastes.
Postera lux oritur, linguisque animisque favete ;
Nunc dicenda bono sunt bona verba die.
Et Pline dit plus expressément, L. xxviij. c. v. primum anni incipientis diem l?tis precationibus invicem faustum ominantur.
L'année civile ou légale, en Angleterre, commence le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire le 25 Mars ; quoique l'année chronologique commence le jour de la Circoncision, c'est-à-dire le premier jour de Janvier, ainsi que l'année des autres Nations de l'Europe. Guillaume le Conquérant ayant été couronné le premier de Janvier, donna occasion aux Anglois de commencer à compter l'année de ce jour-là pour l'histoire ; mais pour toutes les affaires civiles, ils ont retenu leur ancienne maniere, qui étoit de commencer l'année le 25 Mars.
Dans la partie de l'année qui est entre ces deux termes, on met ordinairement les deux dates à-la-fois, les deux derniers chiffres étant écrits l'un sur l'autre à la maniere des fractions ; par exemple, 172 4/5 est la date pour tout le tems entre le premier Janvier 1725 & le 25 Mars de la même année. Depuis Guillaume le Conquérant, les patentes des Rois, les chartres, &c. sont ordinairement datées de l'année du regne du Roi.
L'Eglise d'Angleterre commence l'année au premier Dimanche de l'Avent. Voyez Avent.
Les Juifs, ainsi que la plûpart des autres Nations de l'Orient, ont une année civile qui commence avec la nouvelle lune de Septembre, & une année ecclésiastique qui commence avec la nouvelle lune de Mars.
Les François, sous les Rois de la race Merovingienne, commençoient l'année du jour de la revûe des Troupes, qui étoit le premier de Mars ; sous les Rois Carlovingiens, ils commencerent l'année le jour de Noël ; & sous les Capétiens, le jour de Pâques ; de sorte que le commencement de l'année varioit alors depuis le 22 Mars, jusqu'au 25 Avril. L'année ecclésiastique en France commence au premier Dimanche de l'Avent.
Quant à l'année civile, Charles IX ordonna en 1564, qu'on la feroit commencer à l'avenir au premier de Janvier.
Les Mahométans commencent l'année au moment où le Soleil entre dans le Bélier.
Les Persans, dans le mois qui répond à notre mois de Juin.
Les Chinois, & la plûpart des Indiens commencent leur année avec la premiere lune de Mars. Les Brachmanes avec la nouvelle lune d'Avril, auquel jour ils célebrent une fête appellée Samwat saradi pauduga, c'est-à-dire, la fête du nouvel an.
Les Mexicains, suivant d'Acosta, commençoient l'année le 23 de Février, tems où la verdure commençoit à paroître. Leur année étoit composée de dix-huit mois de vingt jours chacun, & ils employoient les cinq jours qui restoient après ces dix-huit mois, aux plaisirs, sans qu'il fût permis de vaquer à aucune affaire, pas même au service des temples. Alvarez rapporte la même chose des Abyssins, qui commençoient l'année le 26 d'Août, & avoient cinq jours oisifs à la fin de l'année, qui étoient nommés pagomen.
A Rome, il y a deux manieres de compter les années ; l'une commence à la Nativité de Notre-Seigneur, & c'est celle que les Notaires suivent, datant à nativitate ; l'autre commence au 25 Mars, jour de l'Incarnation, & c'est de cette façon que sont datées les Bulles, anno incarnationis. Les Grecs commencent l'année le premier Septembre, & datent du commencement du monde.
Les années sont encore distinguées, eu égard aux époques d'où on les compte : lorsqu'on dit ans de grace ou années de notre Seigneur, on compte depuis la naissance de Jesus-Christ. Ans ou années du monde, se dit en comptant depuis le commencement du monde ; ces années, suivant Scaliger, sont au nombre de 5676. On dit aussi ans de Rome, de l'égire de Nabonassar, &c. Voyez l'article Epoque. (O)
Année séculaire, c'est la même chose qu'un Jubilé. Voyez Jubilé. (G)
Cet article traduit de Chambers, & augmenté, a été tiré par l'auteur Anglois des élémens de Chronologie de M. Wolf.
Wiktionnaire
Préposition - ancien français
an \Prononciation ?\
- Variante de en.
Nom commun - ancien français
an \Prononciation ?\ masculin
-
An.
- Iloc converse issi dis & set anz ? (La Vie de Saint Alexis, ms. 19525 de la BnF, f.28v., 1re colonne)
Nom commun - français
an \??\ masculin
-
Temps que met la Terre à accomplir une révolution autour du Soleil et qui se divise en douze mois. Année (voir Notes plus bas).
- Je ne suis pas arrivé à l'âge de quatre-vingt ans pour rétracter en rien les convictions de ma vie entière. ? (Réponse de M. Raspail père à l'avocat général, lors du procès de François-Vincent Raspail le 12 février 1874)
- Autour d'une table, un groupe d'hommes étaient rassemblés, et une femme de trente à trente-cinq ans s'accoudait sur le comptoir. ? (H.G. Wells, La Guerre dans les Airs, 1908, traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, 1921, page 385)
- J'avais neuf ans et j'attrapais avec mon frère des sauterelles que nous faisions griller dans le jardin pour les manger. ? (Francis Carco, Maman Petitdoigt, La Revue de Paris, 1920)
- J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. ? (Paul Nizan, Aden Arabie, chapitre I, Rieder, 1932 ; Maspéro, 1960)
- Céline Thiébault était alors une jeune fille « bienfaisante », une de ces grandes filles brunes qui paraissent vingt ans au lieu de quinze, de celles qu'à la campagne on compare volontiers à une pouliche et que les hommes, vieux et jeunes, détaillent avec une basse envie, un violent désir. ? (Jean Rogissart, Hurtebise aux griottes, L'Amitié par le livre, Blainville-sur-Mer, 1954, p. 19)
- C'est un long vieillard, mince comme un baliveau, un peu courbé par une bonne septantaine d'ans. ? (Jean Rogissart, Passantes d'Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958)
- Louis le Pieux meurt en 840 sur le Rhin. Un an plus tard, la flotte danoise embouque l'estuaire de la Seine. ? (Patrick Louth, La civilisation des Germains et des Vikings, Genève : éd. Famot, 1976, page 141)
- Au bout de cinquante ans.
- Il n'a pas encore vingt-cinq ans accomplis.
- Il a dix ans de service.
- De l'an de grâce? : Formule dont on se sert pour compter les années par rapport à la naissance de Jésus-Christ.
- An I, an II, an III, etc. : se dit ainsi des années de l'ère républicaine des Français, commencée le 22 septembre 1792.
- La Constitution de l'an III, de l'an VIII.
- Le 16 floréal an IV.
- Le temps qui passe.
- Le poids, le fardeau des ans.
- L'injure, l'outrage des ans.
- Anthime le savant, l'athée, celui dont le jarret perclus, non plus que la volonté insoumise, depuis des ans n'avait jamais fléchi (car il est à remarquer combien chez lui l'esprit allait de pair avec le corps), Anthime était agenouillé. ? (André Gide, Les Caves du Vatican, 1914)
-
(Proverbial) et (Familier)
- Je m'en soucie, je m'en fous, je m'en moque comme de l'an quarante : Cela m'est complètement indifférent. ? voir s'en foutre comme de l'an quarante
-
(Astronomie) (Par extension) Période de révolution d'une autre planète.
- L'an martien, vénusien, etc.
Trésor de la Langue Française informatisé
AN, subst. masc.
Temps de la révolution de la terre autour du soleil, servant d'unité de temps.An au Scrabble
Le mot an vaut 2 points au Scrabble.
Informations sur le mot an - 2 lettres, 1 voyelles, 1 consonnes, 2 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot an au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
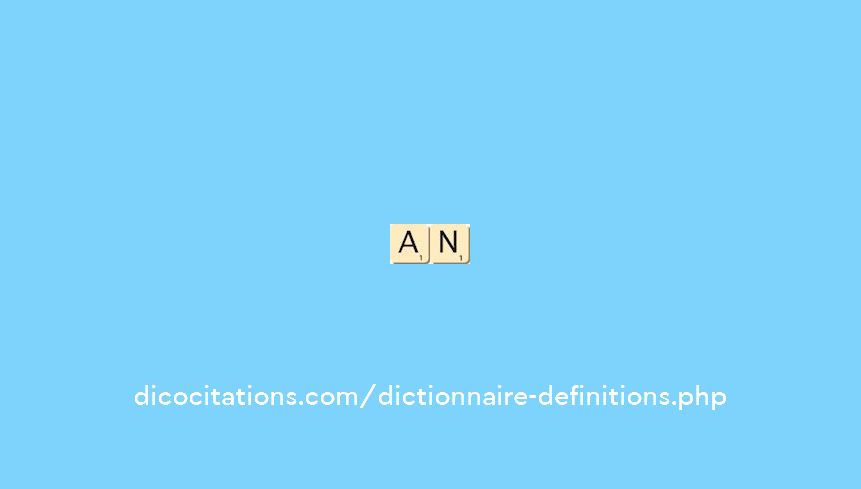
Les mots proches de An
An Ana Anabaptiste Anableps Anacarde Anachorète Anachronisme Anacréontique Anacréontisme Anaérobie Anafin Anagallis Anagnoste Anagogique Anagramme Anagrammé, ée Analogie Analyse Analyseur Analyste Analytique Anarchie Anarchique Anarchiser Anaryen, enne Anasarque Anastomose Anathématiser Anathématisme Anathème Anatomie Anatomique Anatomisé, ée Anatomiser Anatomiste Ancêtre Ancêtres Anche Anchois Ancien, ienne Anciennat Anciennement Ancienneté Ancolie Ancon Ancrage Ancre Ancré, ée Ancrer Andabate an ana anabaptiste anabaptistes anabaptistes anabase anabolisant anabolisant anabolisants anabolisants anachorète anachorètes anachronique anachroniquement anachroniques anachronisme anachronismes anacoluthe anaconda anacondas anadyomène anaérobie anaglyphe anagramme anagrammes anaïs Anais Anais anal anale analeptiques anales analgésie analgésique analgésique analgésiques analgésiques analogie analogies analogique analogiques analogue analogue analogues analogues analphabète analphabète analphabètes analphabètes analphabétismeMots du jour
Limnométrique Coulis Fraiser Porphyre Rouet Endosser Complies Estropié, ée Incorruptible Manoir
Les citations avec le mot An
- Un raffinement d'intempérance autant indigne de mes éloges qu'une artificieuse simplicité.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Discours contre les sciences
- Trop gouverner est le plus grand danger des gouvernements.Auteur : Mirabeau - Source : Collection
- Il était clair que Noguchi pensait avoir trouvé dans le mariage sa dernière demeure et que, de son côté, Kazu pensait y avoir découvert sa propre tombe. Mais l'on ne vit pas dans une tombe.Auteur : Kimitake Hiraoka, dit Yukio Mishima - Source : Après le banquet (1960)
- Estant tousjours prest à faire de bien en mieulx pour ceulx qui luy estoient redevables, à fin de les entretenir et garder tousjours en sa devotion.Auteur : Jacques Amyot - Source : Flaminius, 1
- Toi, Vénérable, tu es peut-être en effet un chercheur; mais le but que tu as devant les yeux et que tu essaies d'atteindre t'empêche justement de voir ce qui est tout proche de toi.Auteur : Hermann Hesse - Source : Siddhartha
- (En parlant du plaisir de mentir) - C'est l'une des plus grandes voluptés de la vie!Auteur : Sacha Guitry - Source : Mon père avait raison
- La liberté, c'est la possibilité de s'isoler. S'il t'est impossible de vivre seul, c'est que tu es né esclave. Tu peux bien posséder toutes les grandeurs de l'âme ou de l'esprit: tu es un esclave noble, ou un valet intelligent, mais tu n'es pas libre.Auteur : Fernando Pessoa - Source : Le Livre de l'intranquillité (1982)
- On ne peut faire qu'en faisant.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- N'étant pas trop connard de nature, j'arrivais jeune à distinguer un bon texte.Auteur : Georges Brassens - Source : Les Samedis de France-Culture, 17 février 1979.
- L'exploitation de l'antique par les peintres donnait l'impression d'un style parce qu'elle imitait non des peintures, toutes disparues, mais des statues. De la résurrection de la sculpture antique date la fin de la grande statuaire occidentale.Auteur : André Malraux - Source : Les Voix du silence (1951)
- Souviens-toi de conserver ton Ame égale à elle-même dans les mauvaises passes de la vie; et dans la prospérité, qu'elle reste modérée, éloignée d'une joie insolente.Auteur : Lucrèce - Source : De la nature des choses
- Les femmes sont toujours en dessous de l'amour dont on rêve et comme je suis assez romantique et sentimental, je ne m'en cache pas du tout, la femme est un peu à côté de l'amour, à côté du rêve que j'ai.Auteur : Jacques Brel - Source : Interview à la RTB, 1971.
- On croit que c'est un homme qu'on a devant nous, mais en fait ça n'est plus un homme, ça fait longtemps que ça n'est plus un homme. C'est comme un trou noir, et vous allez voir, ça va nous sautez à la gueule. Les gens ne savent pas ce que c'est, la folie. C'est terrible. C'est ce qu'il y a de plus terrible au monde.Auteur : Emmanuel Carrère - Source : L'Adversaire (2000)
- Je ne demande pas à la raison si j'ai raison.Auteur : Paul Nizan - Source : Les Chiens de garde (1932)
- Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la Santé?Auteur : Socrate - Source : Entretiens
- Montaigne doutant des dogmes de la sottise ancienne, voilà un grand mérite; il a entrevu quelques petites choses; enfin, son charmant style sans lequel personne ne parlerait de lui.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : Journal, septembre 1834
- Le bonheur entourait cette maison tranquille
Comme une eau bleue entoure exactement une île.Auteur : Francis Jammes - Source : Géorgiques chrétiennes (1911-1912), Chant I - Le divorce déplaît même dans les oiseaux. Buffon a diffamé les tourterelles.Auteur : Joseph Joubert - Source : Pensées (1774-1824)
- Ce dont je me juge digne, c'est d'être nourri au Prytanée !Auteur : Platon - Source : Apologie de Socrate, 37a
- Les métaphores sont une chose dangereuse. On ne badine pas avec les métaphores. L'amour peut naître d'une seule métaphore.Auteur : Milan Kundera - Source : L'insoutenable légèreté de l'être (1984)
- Les gens me disent souvent : "Dans tes chansons, il y a le cinéma." Je m'intéresse à la sculpture, la peinture, la photographie, mais le cinéma, c'est à part. J'en suis imprégné, jusque dans ma chair. Auteur : Daniel Bevilacqua, dit Christophe - Source : Interview Le JDD, propos recueillis par Eric Mandel, le 10 septembre 2019
- Un programme sans boucle et sans structure de donnée ne vaut pas la peine d'être écrit.Auteur : Alan Jay Perlis - Source : Epigrams on Programming (1982)
- La pulvérisation des idées était en lui à son comble. Ce qu'il pensait ne ressemblait pas à de la pensée. C'était une diffusion, une dispersion, l'angoisse d'être dans l'incompréhensible.Auteur : Victor Hugo - Source : L'Homme qui rit (1869)
- Tu ne peux imaginer cette délivrance après l'aveu, après le pardon ...Auteur : François Mauriac - Source : Thérèse Desqueyroux (1927)
- Ma santé, longtemps chancelante, sembalit s'affermir.Auteur : Georges Duhamel - Source : Lumières sur ma vie (1944-1953), Biographie de mes fantômes
Les citations du Littré sur An
- Quelle santé nous couvrait la mort que la reine portait dans le sein ! de combien près la menace a-t-elle été suivie du coup !Auteur : BOSSUET - Source : Mar.-Thér.
- Crois-moi, dût Auzanet t'assurer du succès, Abbé, n'entreprends point même un juste procèsAuteur : BOILEAU - Source : Ép. II
- Et travailloient d'y mettre gens [dans la ville] s'ilz en eussent peu finer à temps et la deffendre à bon essientAuteur : COMM. - Source : V, 15
- Le son des hauts-bois et sacqueboutes, jouans le branle de CupidonAuteur : DE BRACH - Source : Poemes, 181, verso.
- Ferant et batant de maces et d'espéesAuteur : JOINV. - Source : 227
- De servir un amant, je n'en ai pas l'adresseAuteur : BOILEAU - Source : Sat. I
- Qui peut ce qu'il lui plaît commande alors qu'il prieAuteur : Corneille - Source : Sertor. IV, 2
- Le ciel devant les temps avait marqué pour lui Ce trésor amoureux qu'il possède aujourd'huiAuteur : ROTROU - Source : Bélis. IV, 2
- Les catholiques ridiculisaient l'austérité affectée des protestants ; les protestants répliquaient en produisant en scène ce qu'ils appelaient les momeries des catholiquesAuteur : LAHARPE - Source : Cours de litt. t. VII, p. 43, dans POUGENS
- Les anciens avaient soupçonné la pesanteur de l'air ; Torricelli et Pascal l'ont démontréeAuteur : MARMONTEL - Source : Oeuv. t. VI, p. 227
- Partant prindrent ung chascun la picque morne en poingAuteur : François Rabelais - Source : Sciomachie
- Ne laisser germer dans mon coeur aucun levain de vengeanceAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Prom. 7
- Jean de Montluc, sous le règne de Philippe le Bel, fit le recueil qu'on appelle aujourd'hui les registres olimAuteur : Montesquieu - Source : Esp. XXVIII, 39
- Faillir à embrasser l'occasion de faire un grand exploitAuteur : AMYOT - Source : Pér. et Fab. comp. 7
- Il n'y eut plus de prodiges dès que la nature fut mieux connue ; on l'étudia dans ses productionsAuteur : Voltaire - Source : Louis XIV, 31
- Valet anciennement s'adaptoit fort souvent à titre d'honneur près des roys ; car non seulement on disoit valets de chambre ou garde robe, mais aussi valets trenchants et d'escurie ; et maintenant le mot de valet se donne dans nos familles à ceux qui entre nos serviteurs sont de moindre conditionAuteur : PASQUIER - Source : Rech. VIII, p. 663, dans LACURNE
- Seneschal, fist li roys, de teles tribulacions quant elles aviennent aus gens.... dient les sains que ce sont les menaces de nostre SeigneurAuteur : JOINV. - Source : 285
- Elle veut être seule ; et nous l'avons laissée Elevant vers le ciel sa dernière penséeAuteur : P. LEBRUN - Source : M. Stuart, V, I
- Lors il [la Boétie mourant] se teut, et attendit que les soupirs et les sanglots eussent donné loysir à son oncle de lui respondreAuteur : MONT. - Source : Lett. v.
- Qui bon conseil croit et quiert, Honneur et chevance acquiertAuteur : CHRIST. DE PISAN - Source : Charles V, I, ch. 15
- Les feuilles doivent leur lustre et leurs nuances à une membrane fine, lisse, transparente, lustrée et blanchâtre, qui revêt une substance parenchymateuse d'un vert toujours mat et d'une teinte plus ou moins forteAuteur : BONNET - Source : Contempl. nat. V, 11
- Ce parfait et divin amour Les avançait de jour en jour en ces progrès d'esprit où la vertu s'exciteAuteur : Corneille - Source : Imit. I, 18
- Laissant emporter son esprit, qui manque peut-être un peu d'assiette, au plaisir rapide de la surpriseAuteur : VAUVENARGUES. - Source : Alcippe.
- Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger ; s'il a soif, donnez-lui de l'eau à boireAuteur : SACI - Source : Bible, Prov. de Salomon, XXV, 21
- En vaisseaux de verre diaphanes et transparensAuteur : PARÉ - Source : Mumie, 3
Les mots débutant par An Les mots débutant par An
Une suggestion ou précision pour la définition de An ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 01h12
Abandon Abandonner Abattre Abdication Abdiquer Abîme Abnégation Abondance Abordable Abordable Abri Abrutissement Absence L'Absence Absence amour Absent Absolu Abstinent Absurde Absurdité Abus Accident Accord Accuser Achat Action Action amour Activité Adieu Administration Admiration Adolescent Adulte Adultère Adveristé Adversaire Affabilité Affaire Affaires Affamé Affectif Affection Affront Afrique Âge Âge amour Âge vie Âges Amour Âges vie Agonie Agressivite Agriculture Aide Aimable Aimer Aimer d'amour Aimer la vie Air Aisé Alcool Alcoolisme Algerie Aliment Alimentation L'Alimentation Altruisme Amant Amant amour Ambiguite Ambitieux Ambition Ambition amour Âme Âme soeur Amertume Ami Ami amour Amis Amis (faux) Amitié Ame L'Amitié Proverbe amitié Citations et Proverbes sur l'amitié Amitie amour Amitié Femmes Amitié Hommes Amnesie Amour 300 magnifiques citations sur l'Amour L'Amour infini Amour & Amitié Aime Aimer Amant Citation je t'aime Chagrin d'amour C'est quoi l'amour ? Amour (Premier) Amour amitié Amour amitie Amour amoureux Amour attaque Amour aveu Amour bonheur Amour brisé Amour caresse Amour coeur Amour concurrence Paroles chansons d'amour Proverbes d'amour Phrase d'amour Proverbes sur l'amour Message d'amour Mot d'amour Les plus belles citations d'amour Dictons d'amour Amour confiance Amour constance Amour coquetterie Amour délicatesse Amour désir Amour dupe Amour egalite Amour egoisme Amour eloquence Amour emportement Amour enfance Amour ennui Amour esclave Amour exces Amour experience Amour extreme Amour faveur Amour fidele Amour fidelite Amour habitude Amour histoire Amour infini Amour ingratitude Amour inquiet Amour inquietude Amour jalousie Amour jeunesse Amour jouissance Amour liens Amour louange Amour maladresse Amour malheur Amour maniere Amour mariage Amour mariage Amour miracle Amour mort Amour musique Amour mystere Amour nouveau Amour nuit Amour offense Amour oubli Amour paradis Amour passion Amour physique Amour plaisir Amour plaisir Amour platonique Amour portrait Amour presence Amour printemps Amour promesse Amour propre Amour prudence Amour raison Amour refus Amour religion Amour reproche Amour respect Amour richesse Amour sens Amour solitude Amour souffrance Amour souvenir Amour temps Amour tentation Amour tort Amour tourment Amour tristesse Amour tromperie Amour vertu Amour vie Amour vieillesse Amour violence Amour volonte Amoureux Anarchiste Anatomie Ange Angoisse Animal Animaux Année Année Anniversaire Proverbe anniversaire Anniversaire (Bon) L'anniversaire Joyeux anniversaire L'Anniversaire Antimatière Apéritif Aphorismes Apparence Appétit Apprentissage Appui Aptitude Arc en ciel Archéologue Ardeur Argent Argent L'Argent L'Art L'Artiste Arme Armee Arrogance Arrogance Art Art floral Artiste Arts Assassin Assistance Assurance Astronomie Attachement Attente Attention Attitude Au revoir Au-dela Audace Aumône Automate Automne Automobile Autorité Autrui Avance Avantage Avare Avarice Avenir Aventure Aveugle Aveux Avis Avocat Axiome
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur an
Poèmes an
Proverbes an
La définition du mot An est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot An sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification An présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
