Définition de « philosophe »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot philosophe de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur philosophe pour aider à enrichir la compréhension du mot Philosophe et répondre à la question quelle est la définition de philosophe ?
Une définition simple : (fr-rég|fi.l?.z?f) philosophe (mf)
Définitions de « philosophe »
Trésor de la Langue Française informatisé
PHILOSOPHE, subst.
Wiktionnaire
Adjectif - français
philosophe \fi.l?.z?f\ masculin et féminin identiques
- Qui est résigné, qui supporte avec sagesse et force d'âme les épreuves.
- Il s'est montré très philosophe en cette circonstance.
Nom commun - français
philosophe \fi.l?.z?f\ masculin et féminin identiques
-
Personne qui pratique la philosophie.
- C'est une Savante, & une Philosophe de profession. ? (Le babillard, ou Le nouvelliste philosophe, 1724, volume 1, page 413)
- Les philosophes, les théologiens et la plupart des héros d'arguments ont le génie de la nation française : ils attaquent vigoureusement, mais sont perdus s'ils sont réduits à la guerre défensive. ? (Frédéric II et Voltaire, L'anti-Machiavel, 1739, édition de 1947)
- Je suis sûr que j'ai rencontré depuis deux jours dans les rues les philosophes les plus illustres et les fonctionnaires les plus influents. C'est mon désespoir de ne pas les connaître. ? (Pierre Louÿs, Aphrodite, Mercure de France, Paris, 1896)
- Ces personnes ont craint, en pénétrant trop avant dans le système de l'homme, de voir disparaître ses plus brillantes attributions; et, si elles ont été portées à applaudir à la sagacité du philosophe, elles ont été sur le point de condamner la philosophie. ? (Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc, volume 35, 1816, page 376)
- [?], et c'est seulement après 1967 que le philosophe laïque syrien Sadiq Jalal al-Azm refusa hautement de voir dans la religion une voie d'avenir efficace. ? (Panayiotis Jerasimof Vatikiotis, L'Islam et l'État, 1987, traduction d'Odette Guitard, 1992, pages 108-109)
- La fonction du philosophe consiste exclusivement dans la profanation des idées. Aucune violence n'égale par ses effets la violence théorique. Plus tard, l'action vient? ? (Paul Nizan, La Conspiration, 1938, page 44)
- Autrement dit : un philosophe n'est pas quelqu'un qui parle en philosophe mais qui vit en philosophe, non pas un grand parleur, un habile conférencier, mais un être qui a décidé de mettre en pratique les pensées philosophiques qui sont les siennes. En regard de cette méthode, on comprend que Pierre Hadot prenne plaisir à citer souvent cette phrase de Thoreau : « Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais pas de philosophes. » ? (Michel Onfray, La résistance au nihilisme, Grasset, 2020, p. 449)
-
(En particulier) Écrivain du dix-huitième siècle épris d'idées de réforme en matière religieuse, politique, sociale et morale.
- Les philosophes ont favorisé la publication de l'Encyclopédie.
- (Par apposition) ? Frédéric II de Prusse se montra un roi philosophe
-
(Par extension) Celui qui cultive sa raison, qui conforme sa conduite à des principes et travaille à fortifier son âme contre les coups du sort ; personne qui a un comportement inspiré par la sagesse.
- Il a pris cette mauvaise nouvelle en philosophe.
- Il vécut et mourut en philosophe.
- Un vrai philosophe sait résister à ses passions et se vaincre lui- même.
-
Homme qui mène une vie tranquille et retirée, hors de l'embarras des affaires.
- Il s'est retiré pour toujours à la campagne; c'est un philosophe, un vrai philosophe.
- Étudiant qui étudie la philosophie.
-
(Péjoratif) Personnage rêveur, qui manque du sens des réalités.
- Les jurisconsultes civils donnèrent aussi leur avis et Valin dans son Commentaire sur l'Ordonnance de la Marine déclara « que les philosophes (sic) qui désapprouvaient la guerre de course étaient de mauvais citoyens. » ? (Étienne Dupont, Le vieux Saint-Malo : Les Corsaires chez eux, Édouard Champion, 1929, page 50)
Littré
-
1Dans l'ancienne Grèce, ami de la sagesse.
Il [Pythagore] est le premier qui se soit fait appeler philosophe?; avant lui, les hommes qui se livraient à la contemplation de la nature portaient le nom de sages?; il prit celui de philosophe par modestie
, Bailly, Hist. astr. anc. p. 209. -
2Celui qui s'applique à la recherche des principes et des causes.
Nulle religion que la nôtre n'a enseigné que l'homme naît en péché, nulle secte de philosophes ne l'a dit?; nulle n'a donc dit vrai
, Pascal, Pens. XI, 4 ter, édit. HAVET.La vanité est si ancrée dans le c?ur de l'homme qu'un soldat, un goujat, un cuisinier se vante et veut avoir ses admirateurs?; et les philosophes mêmes en veulent
, Pascal, ib. II, 3.Que je méprise ces philosophes qui, mesurant les conseils de Dieu à leurs pensées, ne le font auteur que d'un certain ordre général, d'où le reste se développe comme il peut?!
Bossuet, Mar.-Thér.En fait de découvertes nouvelles, il ne se faut pas trop presser de raisonner, quoiqu'on en ait toujours assez d'envie, et les vrais philosophes sont comme les éléphants, qui, en marchant, ne posent jamais le second pied à terre que le premier n'y soit bien affermi
, Fontenelle, Mondes, 6e soir.Il y a eu des philosophes de cabinet en France?; et tous, excepté Montaigne, ont été persécutés
, Voltaire, Dict. phil. Philosophe 1.Ce sentiment [que les bêtes ont de l'intelligence] est celui du vulgaire?: il n'est combattu que par des philosophes, c'est-à-dire par des hommes qui d'ordinaire aiment mieux une absurdité qu'ils imaginent, qu'une vérité que tout le monde adopte
, Condillac, Traité des anim. part. 2.Fig.
Je crois qu'il faut un peu modérer notre enthousiasme pour le Nord?; il produit d'étranges philosophes [à propos de l'assassinat d'Ivan]
, Voltaire, Lettres, d'Alembert, 7 septembre 1764.Absolument. Au moyen âge, le philosophe, Aristote.
Au féminin.
À propos, monsieur le conseiller, vous saurez que cette philosophe [Mme du Chatelet] a gagné un préliminaire de son procès, fort important et qui paraissait désespéré
, Voltaire, Lett. en vers et en prose, 72. -
3 Particulièrement. Celui qui s'applique à l'étude de l'homme et de la société, à l'effet de rendre ses semblables meilleurs et plus heureux.
Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule
, La Bruyère, I.Il est bon d'être philosophe, il n'est guère utile de passer pour tel
, La Bruyère, XII.Je n'accorde le titre de philosophe qu'à celui qui s'exerce constamment à la recherche de la vérité et à la pratique de la vertu
, Diderot, Claude et Nér. II, 6. -
4Celui qui cultive sa raison, conforme sa conduite aux règles de la saine morale, et affermit son âme contre les coups du sort.
Pour détromper ma s?ur, et lui faire connaître Ce que son philosophe à l'essai pouvait être
, Molière, Femm. sav. v, 5.Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux [les divertissements]?; et ceux qui font sur cela les philosophes? ne connaissent guère notre nature
, Pascal, Pens. IV, 1.Écoutez à ce propos [la vanité des choses humaines] le profond raisonnement non d'un philosophe qui dispute dans une école, ou d'un religieux qui médite dans un cloître?
, Bossuet, Duch. d'Orl.Qu'il y a de différence entre être philosophe et parler de philosophie?!
Voltaire, Lett. Mme Denis, 24 août 1751.Au féminin.
?à votre fille aînée On voit quelque dégoût pour les n?uds d'hyménée?; C'est une philosophe enfin?; je n'en dis rien
, Molière, F. sav. II, 8.J'apprends que l'on vient d'imprimer deux nouveaux mémoires sur la vie de cette philosophe [Ninon]
, Voltaire, Mél. litt sur Mlle de Lenclos.J'imagine que votre grand'maman [la duchesse de Choiseul] est une vraie philosophe
, Voltaire, Lett. à Mme du Deffant, 25 mai 1770. -
5Celui qui mène une vie tranquille et retirée, hors de l'embarras des affaires.
Il n'y a rien qui coûte moins à acquérir aujourd'hui que le nom de philosophe?: une vie obscure et retirée, quelques dehors de sagesse, avec un peu de lecture, suffisent pour attirer ce nom à des personnes qui s'en honorent
, Dumarsais, ?uv. t. VI, p. 25. -
6En un sens particulier, celui qui ne reconnaît pas la révélation.
Ce royaume autrefois le soutien de la foi, et la plus pure portion de son Église, devenu par la licence des discours et l'impiété des sentiments, le théâtre d'honneur des philosophes et des incrédules
, Massillon, Carême, Mot. de conv.Troisvilles fréquenta les toilettes?; le pied lui glissa?; de dévot il devint philosophe
, Saint-Simon, 133, 222.Nom donné, en particulier dans le XVIIIe siècle, à des hommes qui cultivaient la philosophie et la faisaient servir au renversement des anciennes opinions.
On avait assuré le roi de Danemark que les philosophes étaient mauvaise compagnie
, D'Alembert, Lett. au roi de Pr. 19 déc. 1768.Je suis quelquefois tenté de dire du titre de philosophe ce que Jacques Rosbif dit de celui de Monsieur, dans la comédie du Français à Londres?: Je ne veux point de ce titre-là, il y a trop de faquins qui le portent
, D'Alembert, ib. 8 juin 1770.Il y avait à l'Académie quatre hommes désignés sous le nom de philosophes, étiquette odieuse dans ce temps-là
, Marmontel, Mém. VII. - 7Dans les colléges et lycées, étudiant en philosophie.
-
8Alchimiste. Les principes des philosophes sont le sel, le soufre et le mercure.
Huile des philosophes, huile d'olive dont on imbibe des briques rougies au feu.
Poudre des philosophes, la poudre de projection.
-
9 Adj. Qui est philosophe.
La religion seule fait quelquefois des conversions surprenantes et des changements miraculeux, mais elle ne fait guère toute une vie égale et uniforme, si elle n'est entée sur un naturel philosophe
, Fontenelle, Des Billettes.La plupart des femmes et des courtisans n'observèrent autre chose dans cette reine philosophe [Christine], sinon qu'elle n'était pas coiffée à la française, et qu'elle dansait mal
, Voltaire, Louis XIV, 6.Je désirerais de voir cette question proposée à tous les philosophes de l'Europe par le plus philosophe des souverains
, D'Alembert, Lett. au roi de Pr. 27 nov. 1777.Le grand défaut de ce siècle philosophe est de ne l'être pas encore assez
, D'Alembert, Lett. à J. J. Rouss.Et sur le même plan l'amour nous voit rangés?; C'est un dieu philosophe, il est sans préjugés
, De Bièvre, Séducteur, I, 5. -
10Il se dit quelquefois pour philosophique, mais en ce sens il vieillit.
Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville Mon flegme est philosophe autant que votre bile
, Molière, Mis. I, 1.Qu'il a bien découvert son âme mercenaire?! Et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire?!
Molière, F. sav. V, 5.Quand ils [Platon et Aristote] se sont divertis à faire leurs Lois et leur Politique, ils l'ont fait en se jouant?; c'était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie?; la plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement
, Pascal, Pens. VI, 52.Il [Mazarin] mourut au bois de Vincennes avec une fermeté beaucoup plus philosophe que chrétienne
, La Fayette, Hist. de Mme Henriette, 1re part.Il me semble que la mort du roi d'Angleterre [Charles Il] devient plus philosophe et anglaise que chrétienne et catholique
, Sévigné, 7 mars 1685.D'un ?il philosophe et tranquille Tu vois les intrigues des cours
, Bernis, Ép. 2, M?urs.
HISTORIQUE
XIIIe s. Et si a en ceste cité moult de philosophes et moult de mires [médecins]
, Marc Pol, p. 489.
XIVe s. Le philosophe [Aristote] dist ou [au] premier des Elenches
, H. de Mondeville, f° 7.
XVe s. Jà tant ne montera la niceté du peuple, que nom de philosophe très honorable et très saint ne demeure
, Christine de Pisan, Hist. de Ch. V, III, 64. Ce bon mareschal se peut bien appeler philosophe d'armes, c'est à dire amateur de la science d'icelle
, Hist. de Bouciq. IV, 6.
XVIe s. Veistes vous oncques chien rencontrant quelque os medulaire?? c'est, comme dict Platon, la beste du monde plus philosophe
, Rabelais, Garg. Prol. Les femmes philosophes qui se mesloient à leur secte [des cyniques]
, Montaigne, II, 352. Vous verrez au long aller ce beau nom de poete venir au nonchaloir du peuple, ainsi que celuy de philosophe que l'on adapte maintenant à ces tireurs de quint-essence
, Pasquier, Lett. t. I, p. 26.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
PHILOSOPHE. Ajoutez?:Le public, frappé de la gravité de sa démarche et de l'air penseur de son crâne dénudé, lui a donné le nom plus pittoresque de philosophe ou d'adjudant, Journ. offic. 18 mars 1874, p. 2094, 2e col.
Encyclopédie, 1re édition
PHILOSOPHE, s. m. Il n'y a rien qui coute moins à acquérir aujourd'hui que le nom de philosophe ; une vie obscure & retirée, quelques dehors de sagesse, avec un peu de lecture, suffisent pour attirer ce nom à des personnes qui s'en honorent sans le mériter.
D'autres en qui la liberté de penser tient lieu de raisonnement, se regardent comme les seuls véritables philosophes, parce qu'ils ont osé renverser les bornes sacrées posées par la religion, & qu'ils ont brisé les entraves où la foi mettoit leur raison. Fiers de s'être défaits des préjugés de l'éducation, en matiere de religion, ils regardent avec mépris les autres comme des ames foibles, des génies serviles, des esprits pusillanimes qui se laissent effrayer par les conséquences où conduit l'irréligion, & qui n'osant sortir un instant du cercle des vérités établies, ni marcher dans des routes nouvelles, s'endorment sous le joug de la superstition.
Mais on doit avoir une idée plus juste du philosophe, & voici le caractere que nous lui donnons.
Les autres hommes sont déterminés à agir sans sentir, ni connoître les causes qui les font mouvoir, sans même songer qu'il y en ait. Le philosophe au contraire demêle les causes autant qu'il est en lui, & souvent même les prévient, & se livre à elles avec connoissance : c'est une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même. Ainsi il évite les objets qui peuvent lui causer des sentimens qui ne conviennent ni au bien-être, ni à l'être raisonnable, & cherche ceux qui peuvent exciter en lui des affections convenables à l'état où il se trouve. La raison est à l'égard du philosophe, ce que la grace est à l'égard du chretien. La grace détermine le chrétien à agir ; la raison détermine le philosophe.
Les autres hommes sont emportés par leurs passions, sans que les actions qu'ils font soient précédées de la réflexion : ce sont des hommes qui marchent dans les ténebres ; au lieu que le philosophe dans ses passions mêmes, n'agit qu'après la réflexion ; il marche la nuit, mais il est précédé d'un flambeau.
Le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulieres. Le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit : il croit que la maxime existe pour ainsi dire par elle-même ; mais le philosophe prend la maxime dès sa source ; il en examine l'origine ; il en connoît la propre valeur, & n'en fait que l'usage qui lui convient.
La vérité n'est pas pour le philosophe une maîtresse qui corrompe son imagination, & qu'il croie trouver par-tout ; il se contente de la pouvoir démêler où il peut l'appercevoir, Il ne la confond point avec la vraissemblance ; il prend pour vrai ce qui est vrai, pour faux ce qui est faux, pour douteux ce qui est douteux, & pour vraissemblable ce qui n'est que vraissemblable. Il fait plus, & c'est ici une grande perfection du philosophe, c'est que lorsqu'il n'a point de motif propre pour juger, il fait demeurer indéterminé.
Le monde est plein de personnes d'esprit & de beaucoup d'esprit, qui jugent toujours ; toujours ils devinent, car c'est deviner que de juger sans sentir quand on a le motif propre du jugement. Ils ignorent la portée de l'esprit humain ; ils croient qu'il peut tout connoître : ainsi ils trouvent de la honte à ne point prononcer de jugement, & s'imaginent que l'esprit consiste à juger. Le philosophe croit qu'il consiste à bien juger : il est plus content de lui-même quand il a suspendu la faculté de se déterminer que s'il s'étoit déterminé avant d'avoir senti le motif propre à la décision. Ainsi il juge & parle moins, mais il juge plus surement & parle mieux ; il n'évite point les traits vifs qui se présentent naturellement à l'esprit par un prompt assemblage d'idées qu'on est souvent étonné de voir unies. C'est dans cette prompte liaison que consiste ce que communément on appelle esprit ; mais aussi c'est ce qu'il recherche le moins, & il préfere à ce brillant le soin de bien distinguer ses idées, d'en connoître la juste étendue & la liaison précise, & d'éviter de prendre le change en portant trop loin quelque rapport particulier que les idées ont entr'elles. C'est dans ce discernement que consiste ce qu'on appelle jugement & justesse d'esprit : à cette justesse se joignent encore la souplesse & la netteté. Le philosophe n'est pas tellement attaché à un système, qu'il ne sente toute la force des objections. La plûpart des hommes sont si fort livrés à leurs opinions, qu'ils ne prennent pas seulement la peine de pénétrer celles des autres. Le philosophe comprend le sentiment qu'il rejette, avec la même étendue & la même netteté qu'il entend celui qu'il adopte.
L'esprit philosophique est donc un esprit d'observation & de justesse, qui rapporte tout à ses véritables principes ; mais ce n'est pas l'esprit seul que le philosophe cultive, il porte plus loin son attention & ses soins.
L'homme n'est point un monstre qui ne doive vivre que dans les abîmes de la mer, ou dans le fond d'une forêt : les seules nécessités de la vie lui rendent le commerce des autres nécessaire ; & dans quelqu'état où il puisse se trouver, ses besoins & le bien être l'engagent à vivre en société. Ainsi la raison exige de lui qu'il connoisse, qu'il étudie, & qu'il travaille à acquérir les qualités sociables.
Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde ; il ne croit point être en pays ennemi ; il veut jouir en sage économe des biens que la nature lui offre ; il veut trouver du plaisir avec les autres : & pour en trouver, il en faut faire : ainsi il cherche à convenir à ceux avec qui le hasard ou son choix le font vivre ; & il trouve en même tems ce qui lui convient : c'est un honnête homme qui veut plaire & se rendre utile.
La plûpart des grands à qui les dissipations ne laissent pas assez de tems pour méditer, sont féroces envers ceux qu'ils ne croient pas leurs égaux. Les philosophes ordinaires qui méditent trop, ou plûtôt qui méditent mal, le sont envers tout le monde ; ils fuient les hommes, & les hommes les évitent. Mais notre philosophe qui sait se partager entre la retraite & le commerce des hommes, est plein d'humanité. C'est le Chrémès de Térence qui sent qu'il est homme, & que la seule humanité intéresse à la mauvaise ou à la bonne fortune de son voisin. Homo sum, humani à me nihil alienum puto.
Il seroit inutile de remarquer ici combien le philosophe est jaloux de tout ce qui s'appelle honneur & probité. La société civile est, pour ainsi dire, une divinité pour lui sur la terre ; il l'encense, il l'honore par la probité, par une attention exacte à ses devoirs, & par un desir sincere de n'en être pas un membre inutile ou embarrassant. Les sentimens de probité entrent autant dans la constitution méchanique du philosophe, que les lumieres de l'esprit. Plus vous trouverez de raison dans un homme, plus vous trouverez en lui de probité. Au contraire où regne le fanatisme & la superstition, regnent les passions & l'emportement. Le tempérament du philosophe, c'est d'agir par esprit d'ordre ou par raison ; comme il aime extrèmement la société, il lui importe bien plus qu'au reste des hommes de disposer tous ses ressorts à ne produire que des effets conformes à l'idée d'honnête homme. Ne craignez pas que parce que personne n'a les yeux sur lui, il s'abandonne à une action contraire à la probité. Non. Cette action n'est point conforme à la disposition méchanique du sage ; il est paîtri, pour ainsi dire, avec le levain de l'ordre & de la regle ; il est rempli des idées du bien de la société civile ; il en connoît les principes bien mieux que les autres hommes. Le crime trouveroit en lui trop d'opposition, il auroit trop d'idées naturelles & trop d'idées acquises à détruire. Sa faculté d'agir est pour ainsi dire comme une corde d'instrument de musique montée sur un certain ton ; elle n'en sauroit produire un contraire. Il craint de se détonner, de se desacorder avec lui-même ; & ceci me fait ressouvenir de ce que Velleius dit de Caton d'Utique. « Il n'a jamais, dit-il, fait de bonnes actions pour paroître les avoir faites, mais parce qu'il n'étoit pas en lui de faire autrement ».
D'ailleurs dans toutes les actions que les hommes font, ils ne cherchent que leur propre satisfaction actuelle : c'est le bien ou plutôt l'attrait présent, suivant la disposition méchanique où ils se trouvent qui les fait agir. Or le philosophe est disposé plus que qui que ce soit par ses réflexions à trouver plus d'attrait & de plaisir à vivre avec vous, à s'attirer votre confiance & votre estime, à s'acquitter des devoirs de l'amitié & de la reconnoissance. Ces sentimens sont encore nourris dans le fond de son c?ur par la religion, où l'on conduit les lumieres naturelles de sa raison. Encore un coup, l'idée de mal-honnête homme est autant opposée à l'idée de philosophe, que l'est l'idée de stupide ; & l'expérience fait voir tous les jours que plus on a de raison & de lumiere, plus on est sûr & propre pour le commerce de la vie. Un sot, dit la Rochefoucault, n'a pas assez d'étoffe pour être bon : on ne péche que parce que les lumieres sont moins fortes que les passions ; & c'est une maxime de théologie vraie en un certain sens, que tout pécheur est ignorant.
Cet amour de la société si essentiel au philosophe, fait voir combien est véritable la remarque de l'empereur Antonin : « Que les peuples seront heureux quand les rois seront philosophes, ou quand les philosophes seront rois » !
Le philosophe est donc un honnête homme qui agit en tout par raison, & qui joint à un esprit de réflexion & de justesse les m?urs & les qualités sociables. Entez un souverain sur un philosophe d'une telle trempe, & vous aurez un parfait souverain.
De cette idée il est aisé de conclure combien le sage insensible des stoïciens est éloigné de la perfection de notre philosophe : un tel philosophe est homme, & leur sage n'étoit qu'un phantôme. Ils rougissoient de l'humanité, & il en fait gloire ; ils vouloient follement anéantir les passions, & nous élever au-dessus de notre nature par une insensibilité chimérique : pour lui, il ne prétend pas au chimérique honneur de détruire les passions, parce que cela est impossible ; mais il travaille à n'en être pas tyrannisé, à les mettre à profit, & à en faire un usage raisonnable, parce que cela est possible, & que la raison le lui ordonne.
On voit encore par tout ce que nous venons de dire, combien s'éloignent de la juste idée du philosophe ces indolens, qui, livrés à une méditation paresseuse, négligent le soin de leurs affaires temporelles, & de tout ce qui s'appelle fortune. Le vrai philosophe n'est point tourmenté par l'ambition, mais il veut avoir les commodités de la vie ; il lui faut, outre le nécessaire précis, un honnête superflu nécessaire à un honnête homme, & par lequel seul on est heureux : c'est le fond des bienséances & des agrémens. Ce sont de faux philosophes qui ont fait naître ce préjugé, que le plus exact nécessaire lui suffit, par leur indolence & par des maximes éblouissantes.
Philosophes, (Alchimie & Chimie.) Ce mot dans le langage alchimique signifie la même chose qu'adepte ou possesseur de la pierre philosophale. Les Alchimistes n'ont pas manqué de se décorer de ce grand nom, & de celui de sage.
Il existe dans la Chimie ordinaire plusieurs préparations & opérations, la plûpart assez communes, & qui sont apparemment des présens de l'Alchimie qui sont spécifiées par le nom de leurs inventeurs, qualifiés du titre de philosophes. Ainsi il y a une huile des Philosophes, appellée autrement huile de brique, oleum laterinum, qui n'est autre chose que de l'huile d'olive dont on a imbibé des briques rougies au feu, & qu'on a ensuite distillée à feu nud ; une édulcoration philosophique, qui est une distillation des sels métalliques à la violence du feu (Voyez Distillation) ; une pulvérisation philosophique, une calcination philosophique. Voyez Pulvérisation & Calcination. (b)
Philosophes, huile des, (Pharmacie.) c'est l'huile de brique. Ce nom lui a été donné par les Alchimistes qui se disent les véritables philosophes, à cause qu'ils emploient souvent de la brique dans la construction de leurs fourneaux, dont ils se servent pour faire ce qu'ils appellent le grand-?uvre, ou la pierre philosophale. Voyez Brique.
Étymologie de « philosophe »
Prov. philosophe?; espagn. et ital. filosofo?; du lat. philosophus?; grec, ?????????, composé de ?????, qui aime, et ?????, sagesse, lequel est de même radical que le lat. sapus, habile, sapere, savoir.
- Du grec ancien ?????????, philósophos (« celui qui aime la sagesse »).
philosophe au Scrabble
Le mot philosophe vaut 20 points au Scrabble.
Informations sur le mot philosophe - 10 lettres, 4 voyelles, 6 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot philosophe au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
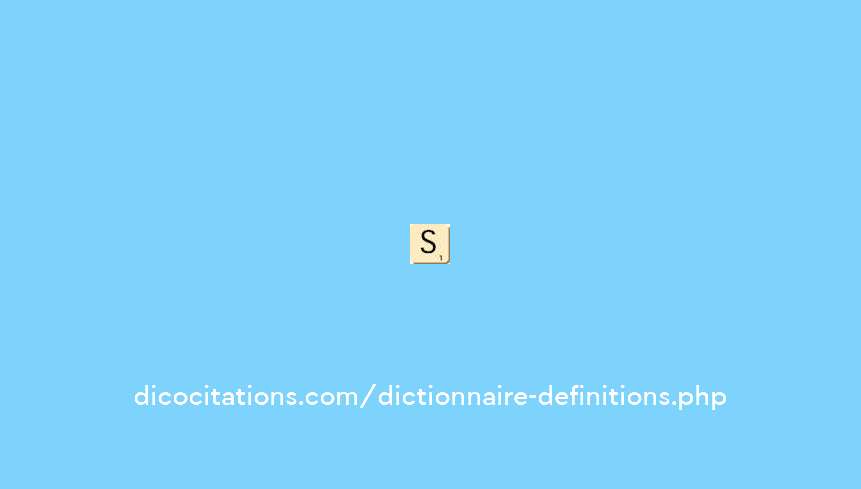
Les rimes de « philosophe »
On recherche une rime en OF .
Les rimes de philosophe peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en of
Rimes de apostrophes Rimes de bof Rimes de philosophes Rimes de kouglof Rimes de apostrophe Rimes de bischof Rimes de surchauffe Rimes de Bauffe Rimes de apostrophe Rimes de chauffe Rimes de beaufs Rimes de étoffes Rimes de philosophe Rimes de strophes Rimes de réchauffe Rimes de théosophes Rimes de sauf Rimes de apostrophent Rimes de profs Rimes de apostrophes Rimes de étoffes Rimes de take-off Rimes de Montignies-Saint-Christophe Rimes de voix-off Rimes de lofe Rimes de beauf Rimes de philosophe Rimes de lof Rimes de strophe Rimes de réchauffent Rimes de échauffe Rimes de best of Rimes de sauf Rimes de lofts Rimes de chauffes Rimes de catastrophes Rimes de philosophes Rimes de off Rimes de kugelhof Rimes de philosophes Rimes de sous-offs Rimes de échauffent Rimes de prof Rimes de surchauffe Rimes de limitrophe Rimes de saufs Rimes de étoffe Rimes de anti-beauf Rimes de chauffent Rimes de chauffeMots du jour
apostrophes bof philosophes kouglof apostrophe bischof surchauffe Bauffe apostrophe chauffe beaufs étoffes philosophe strophes réchauffe théosophes sauf apostrophent profs apostrophes étoffes take-off Montignies-Saint-Christophe voix-off lofe beauf philosophe lof strophe réchauffent échauffe best of sauf lofts chauffes catastrophes philosophes off kugelhof philosophes sous-offs échauffent prof surchauffe limitrophe saufs étoffe anti-beauf chauffent chauffe
Les citations sur « philosophe »
- Si un philosophe n'est pas un homme, c'est tout ce qu'on veut, sauf un philosophe.Auteur : Miguel de Unamuno - Source : Du sentiment tragique de la vie (1913)
- En suivant la règle qu'elle s'est fixé de construire un modèle mathématique, la science s'avère incapable d'expliquer pourquoi il devrait exister un Univers conforme à ce mode. Pourquoi l'Univers se donne-t-il tant de mal pour exister ? La théorie unifiée serait-elle dotée d'une telle force, qu'elle se mettrait au monde d'elle-même ? ou bien a-t-elle besoin d'un créateur , et, dans ce cas, joue-t-il un rôle dans l'Univers ? Et qui l'a créé, lui ? Jusqu'à présent, la plupart des scientifiques se sont trop attaché à décrire le comment de l'Univers pour se préoccuper du pourquoi. Par ailleurs, ceux dont le métier est de s'interroger sur le pourquoi, les philosophes, n'ont pas été capables de suivre les avancées théoriques de la science.Auteur : Stephen Hawking - Source : Une belle histoire du temps
- Il faut traduire, commenter, publier, imprimer, réimprimer, clicher, stéréotyper, distribuer, crier, expliquer, réciter, répandre, donner à tous, donner à bon marché, donner au prix de revient, donner pour rien, tous les poètes, tous les philosophes.Auteur : Victor Hugo - Source : William Shakespeare (1864)
- Il n'en est pas des reliques d'un philosophe comme de celles d'un saint; on les garde sans profit.Auteur : Frédéric-Melchior, baron de Grimm - Source : Dans la Gazette Littéraire, mai 1774.
- Il y a un philosophe français qui a dit « Je pense, donc je suis.» Horty est la quintessence de cet adage.
Auteur : Theodore Sturgeon - Source : Cristal qui songe (1952)
- Le premier devoir du philosophe est de dépoussiérer les vérités premières...Auteur : Gustave Thibon - Source : L'équilibre et l'harmonie (1976)
- Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités ou que ceux que l'on appelle aujourd'hui rois et souverains ne seront pas vraiment philosophes... il n'y aura de cesse aux maux des cités.Auteur : Platon - Source : La République, 473d
- Cléanthe et Spinoza étaient de très grands philosophes, mais ils étaient philosophes à leur loisir; et Cléanthe était porteur d'eau et Spinoza polisseur de lunettes astronomiques.Auteur : Emile Faguet - Source : Les dix commandements (1926), De la profession
- Un mur où on a mis la main soi-même nous en apprend plus long sur la liberté de l'homme que tous les philosophes.Auteur : Gilles Vigneault - Source : La petite heure
- Les philosophes se demandent qui a commencé: l'oeuf ou la poule. Et si c'était la plume?Auteur : Denis Langlois - Source : N'avouez jamais, on pourrait vous croire, Voix d'encre n° 34 (mars 2006)
- Apprendre l'amour, c'est d'abord apprendre à parler d'amour et on ne l'apprend jamais aussi bien que chez les poètes, les romanciers, les philosophes.Auteur : Pascal Bruckner - Source : La Tentation de l'innocence (1995)
- On a dit que le présent n'existait pas. Certains philosophes de l'Inde ont prétendu qu'il n'y a pas un moment où le fruit tombe. Le fruit va tomber ou est au sol mais il n'y a pas un moment où il tombe.Auteur : Jorge Luis Borges - Source : Conférences
- Etais-je un philosophe chinois en train de rêver qu'il était un papillon, ou bien un papillon en train de rêver qu'il était un philosophe chinois?Auteur : Dan Simmons - Source : La Chute d'Hypérion (1990)
- Ta grandeur morale, image de l'infini, est immense comme la réflexion du philosophe, comme l'amour de la femme, comme la beauté divine de l'oiseau, comme les méditations du poète.Auteur : Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont - Source : Les chants de Maldoror (1869)
- Un lendemain de fête, tout ivrogne devient philosophe.Auteur : Marion Zimmer Bradley - Source : Ténébreuse, 13. La Maison des Amazones (1983)
- Soyons philosophe, ayons de la philosophie et même une philosophie, mais ne faisons pas de la philosophie.Auteur : Charles-Augustin Sainte-Beuve - Source : Pensées et Maximes
- Peu de personnes peuvent aimer un philosophe.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Sans référence
- Un philosophe se laisse habiller par son tailleur: il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu'à l'affecter.Auteur : Jean de La Bruyère - Source : Les Caractères (1696), 11, I, De la mode
- Les philosophes du XVIIIe siècle ont été tous et trop orgueilleux et trop affairés pour être sérieux.Auteur : Emile Faguet - Source : Dix-huitième siècle (1890), Avant-propos
- Dieu créa l'homme à son image, dit la Bible ; les philosophes font le contraire, ils créent Dieu à la leur.Auteur : Georg Christoph Lichtenberg - Source : Aphorismes (1800-1806)
- Je n'entends rien du tout aux songes; et quant au raisonnement du mariage, vous avez deux savants, deux philosophes vos voisins, qui sont gens à vous débiter tout ce qu'on peut dire sur ce sujet.Auteur : Molière - Source : Le Mariage forcé (1664), 3, Géronimo
- Quand un homme se met à philosopher, cela donne de la philo-sophistique ou, disons, de la sophistique ; mais si c'est une femme qui se met à philosopher ou deux femmes, alors ça tourne au mords-moi-le-doigt.Auteur : Anton Tchekhov - Source : Les Trois Soeurs (1901), I
- Je suis de tradition grecque, comme tous les philosophes ; mais on oublie trop souvent qu'il y a au moins deux traditions, celle de Platon et celle d'Aristote. J'ai longtemps été, en raison de mon intérêt pour les mathématiques, pleinement platonicien. Il m'a fallu un certain âge pour « découvrir » la pensée d'Aristote. Je suis maintenant devenu plutôt aristotélicien… Il suffit de lire les Allemands pour se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes aristotéliciens, pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas eu nos Lumières ni la Révolution française, qui a supprimé chez nous la tradition aristotélicienne pour ne garder que la tradition platonicienne. La tradition aristotélicienne étant associée au Moyen Âge, à la scolastique, au christianisme… D'une certaine manière, Heidegger, c'est du Aristote… Du Aristote traduit en Allemand. Auteur : Michel Serres - Source : Une intensité de lumière, entretien avec Michel Serres , Cahier Simone Weil, Cahier dirigé par Emmanuel Gabellieri et François l'Yvonnet, éd. Éditions de l'Herne, 2014
- La vérité du journaliste n'est pas celle du philosophe. Le premier cherche les faits, le dernier s'intéresse à ce qui les dépasse.Auteur : Elie Wiesel - Source : Le cas Sonderberg (2008)
- Philosopher, c'est penser sans preuves, mais point penser n'importe quoi, ni n'importe comment.Auteur : André Comte-Sponville - Source : Sans référence
Les mots proches de « philosophe »
Philanthrope Philanthropie Philanthropique Philautie Philippin Philippique Philistin Philocratie Philodoxe Philologie Philologique Philologue Philomèle Philosophaillerie Philosophale Philosophâtre Philosophe Philosopher Philosopherie Philosophesque Philosophie Philosophique Philosophiquement Philosophisme Philosophiste Philosophiste Philosopho-théologique Philtre PhimosisLes mots débutant par phi Les mots débutant par ph
phi philanthrope philanthropes philanthropie philanthropique philanthropiques philarète philarète philatélie philatéliste philatélistes philbert philharmonie philharmonique philhellène philhellènes philibert philippe Philippeville philippin philippin philippine philippine philippines Philippines philippins philippins Philippsbourg philistin philistins philo philodendron philodendrons philologie philologique philologiques philologue philologues Philondenx philos philosémites philosémitisme philosophaient philosophaillerie philosophait philosophal philosophale philosophales philosophant philosophant
Les synonymes de « philosophe»
Les synonymes de philosophe :- 1. humaniste
2. lettré
3. sage
4. penseur
5. moraliste
6. contemplatif
7. méditatif
8. esprit
9. théoricien
10. logicien
11. dialecticien
12. métaphysicien
13. calme
14. placide
synonymes de philosophe
Fréquence et usage du mot philosophe dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « philosophe » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot philosophe dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Philosophe ?
Citations philosophe Citation sur philosophe Poèmes philosophe Proverbes philosophe Rime avec philosophe Définition de philosophe
Définition de philosophe présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot philosophe sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot philosophe notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 10 lettres.
