Définition de « forger »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot forger de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur forger pour aider à enrichir la compréhension du mot Forger et répondre à la question quelle est la définition de forger ?
Une définition simple :
Définitions de « forger »
Trésor de la Langue Française informatisé
FORGER, verbe trans.
Wiktionnaire
Verbe - français
forger \f??.?e\ transitif 1er groupe (voir la conjugaison)
-
Façonner le fer, ou quelque autre métal, par le moyen du feu et du marteau.
- On peut forger un fer à cheval, une barre de fer, une épée, des armes. - Je veux apprendre à forger.
-
(Équitation) Trotter, en touchant les fers des pieds de devant avec les fers des pieds de derrière, en parlant d'un cheval.
- Ma parole, ce cheval forge.
-
(Figuré) Inventer, fabriquer (un mot, une expression, une histoire), faire.
- Ils ont forgé de nouveaux mots, et ils ont donné droit de cité à des mots grecs. ? (D. S. Blondheim, Les parlers judéo-romans et la Vetus Latina, 2013)
- Si au contraire c'est une histoire forgée par quelque nouvel Auteur contenant des faits fabuleux, on ne doit plus faire aucun fond sur ces annales. ? (Louis Ellies Dupin, L'Histoire profane, 1714)
- Sa réputation n'a d'égale que celle qu'elle s'est forgée dans les forces de la Gendarmerie royale du Canada et du Service de police de Montréal. ? (Marc De Foy, « Danièle Sauvageau aurait aimé avoir une chance », Le journal de Montréal, 28 novembre 2020)
-
(Figuré) Controuver, falsifier, contrefaire.
- Un fanatique, qui eût forgé un document pour authentifier une trahison de la réalité de laquelle il eût été convaincu, ne se fût pas tué. ? (Joseph Caillaux, Mes Mémoires, I, Ma jeunesse orgueilleuse, 1942)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Façonner le fer, ou quelque autre métal, par le moyen du feu et du marteau. Forger un fer de cheval. Forger une barre de fer. Forger une épée. Forger des armes. Fer forgé. Absolument, Apprendre à forger. Forger à froid, Travailler un métal avec le marteau, sur une enclume, sur un tas, etc., sans le faire chauffer. On dit, par opposition, Forger à chaud, lorsqu'on veut parler de la manière ordinaire de forger. En termes de Manège, Ce cheval forge, se dit d'un Cheval, qui, en marchant, touche les fers des pieds de devant avec les fers des pieds de derrière. Il signifie figurément Inventer, controuver. Forger un mensonge. Forger une calomnie. Forger une histoire. Forger des nouvelles. Se forger des chimères, S'imaginer des choses sans fondement. Un mot forgé, Un mot inventé, nouvellement formé. Il se prend souvent en mauvaise part.
Littré
-
1Travailler le fer, l'argent, etc. au feu et au marteau. Forger un fer de cheval, une épée, des cuillers d'argent.
Où Vulcain forge des foudres pour le père des dieux
, Fénelon, Tél. XI.Se forger, forger pour soi.
Chacun de ces peuples ensuite se forgea son Dieu
, Sacy, Bible, Rois, IV, 17, 29.Absolument. Apprendre à forger.
Forger à froid, travailler un métal au marteau sans le faire chauffer, par opposition à forger à chaud, qui est la manière ordinaire de forger.
Forger le plomb, le frapper avec des masses.
Fig. Forger ses fers, se forger des fers, être cause de sa propre servitude.
[Le mondain] qui s'imagine être vraiment libre, parce qu'il est en effet trop libre à pécher, c'est-à-dire libre à se perdre, et qui ne s'aperçoit qu'il forge ses fers par l'usage de sa liberté prétendue
, Bossuet, IV, Vêture, 1.Fig. Forger des vers, les faire péniblement et comme avec le marteau.
-
2 Fig. Faire, produire.
Chacun à son gré forgeant des potentats
, Rotrou, Vencesl. I, 1.Ah?! Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelque machine, pour me tirer de la peine où je suis
, Molière, Fourber. I, 2.Un dieu, sans doute, un dieu m'a forgé ces malheurs, Comme des instruments qui peuvent à ma vue Ouvrir du c?ur humain les sombres profondeurs
, Gilbert, le Poëte malheureux.Imaginer, inventer.
Et sur un incident fortuit et véritable En forger un exprès de nature semblable
, Mairet, Soliman, II, 6.Un inconnu peut bien nous forger une histoire
, Scarron, D. Japhet d'Arm. I, 4.Ils dépeignent les académiciens comme des gens qui ne travaillent nuit et jour qu'à forger bizarrement des mots, ou bien à en supprimer d'autres plutôt par caprice que par raison
, Pellisson, Hist. de l'Acad. franç. I.Votre feinte douceur forge un amusement Pour divertir l'effet de mon ressentiment
, Molière, D. Garc. IV, 8.Je forgerai des systèmes, c'est-à-dire des erreurs, pour expliquer leur nature [des animaux]
, Voltaire, Trait. métaph. chap. 7.Se forger, forger à soi-même, s'imaginer, se figurer.
De femmes et d'enfants dont la crédulité S'est forgée à plaisir une divinité [forgée se rapporte ici, par archaïsme, à divinité?; on mettrait aujourd'hui forgé]
, Rotrou, St Genest, V, 2.Le loup déjà se forge une félicité?
, La Fontaine, Fabl. I, 5.Les images que l'imagination se forge au dedans
, Bossuet, Lett. abb. 64.Se forger des chimères, s'imaginer des choses sans fondement.
Il n'y a point d'accident pour ou contre que l'on n'imagine, point de chimère agréable ou fâcheuse qu'on ne se forge
, Marivaux, Marianne, 6e part.Se forger des monstres pour les combattre, se former des difficultés soit par crainte et faiblesse d'esprit, soit par vanité et pour avoir l'air d'en triompher.
-
3Supposer un écrit, l'attribuer à un auteur qui ne l'a pas écrit.
Le faux Énoch, que cite saint Jude, est reconnu pour être forgé par un Juif
, Voltaire, M?urs, Introd.Il [ce peuple] se forgea une histoire?
, Voltaire, Amabed, 2e lett. réponse. - 4 V. n. Terme d'hippiatrique. Frapper, dans les allures du pas et du trot, les pieds de devant avec la pince des fers des pieds postérieurs. Forger en voûte, atteindre la rive interne du fer fixé sous le pied antérieur?; on entend alors un bruit marqué résultant de la percussion.
-
5Se forger, v. réfl. Être forgé. Du fer qui se forge facilement.
Fig.
C'est là [dans les cours] que se forgent ces traits de feu, selon les termes de l'apôtre, dont l'ennemi se sert pour allumer les passions dans ces âmes vaines qui sont les idoles du monde et dont le monde est lui-même l'idole
, Fléchier, Marie-Thér.
HISTORIQUE
XIIe s. Dist li paiens?: mauvesement vos va?; Qui fist t'espée, mauvese la forga
, Bat. d'Aleschans, v. 1480. Tuens est li jurz, e tue est la nuiz?; tu forjas l'albe e le soleil
, Liber psalm. p. 99. Car li fol conseil furent en Bretaigne forgié
, Th. le mart. 165. Chascune des genz forjad et furmad sun Deu et sun ydle [idole]
, Rois, p. 404.
XIIIe s. Voire, sire?! car vous la feistes forgier [faire cette femme exprès pour vous]
, Berte, XXXVIII. ?Diex qui de ses biens reput Le monde, quant il l'ot forgié
, la Rose, 5263. [Venus] prise provée Es laz qu'il [Vulcain] ot d'airain forgiés
, ib. 14049. Comme li martiaus est faiz por le fevre, quiore forge une espée, or un hiaume?
, Latini, Trésor, p. 104. Pren ton tresor et ton avoir, Forge ton sens et ton savoir?; Là le tramet et là l'envoie ù [où] tu tous jors ieres [seras] en joie
, Gui de Cambrai, Barl. et Jos. p. 86.
XIVe s. Un anel d'or, à un saphir, lequel seint Dunstan forga de ses mayns
, De Laborde, Émaux, p. 479.
XVe s. Taisez-vous?; on forge en France les florins de quoi vous serez payés
, Froissart, II, III, 36. Et se trouva un cordelier forgé, qui de luy mesme prit debat audit frere Hieronime
, Commines, VIII, 19. Notre bonne mere avoit, le jour de devant, forgé [stylé] le medecin qui estoit tres bien averti de la reponse qu'il devoit faire
, Louis XI, Nouv. X. Tout en forgeant devient on fevre
, Perceforest, t. II, f° 71.
XVIe s. Elle se forge ainsin une prinse frivole
, Montaigne, I, 21. Forger un conte
, Montaigne, I, 205. J'aime mieulx forger mon ame que la meubler
, Montaigne, III, 276. Alcibiades se forgeoit desja en son entendement les conquestes de Libye et de Carthage
, Amyot, Alc. 30.
Encyclopédie, 1re édition
* FORGER, v. act. c'est battre sur l'enclume un métal avec un marteau. On forge à froid & à chaud mais plus souvent à chaud. Ce mot varie d'acception. Voici, par exemple, un cas ou il est presque synonyme à planer ; c'est chez les Potiers-d'étain. Forger, c'est, après que la vaisselle est tournée, la battre, avec différens marteaux, sur le tas. Pour cet effet on a des morceaux de cuivre jaune en plaques de largeur, longueur & épaisseur convenables, bien écroüies ou serrées & polies au marteau ; on les nomme platines. Les platines sont planes pour les fonds des vaisselles, contournées pour les côtés. On commence par frotter legerement sa piece de vaisselle, avec un linge enduit de suif en-dedans & en-dehors : cela s'appelle ensuifer. On pose ensuite une platine sur l'enclume, qui est couverte d'une peau de castor gras. On fait tenir la platine sur la peau, avec une colle faite de poix-résine grasse & de suif ; on frappe là-dessus sa piece à coups de marteau, & on lui fait prendre une forme plus réguliere que celle qu'elle a reçue des moules ; on atteint les inégalités du tour ; on rend l'ouvrage compact, uni, brillant, & d'un meilleur service ; on le dégraisse & on le polit avec un linge & du blanc d'Espagne en poudre. Mais ce travail n'a lieu que sur l'étain fin. L'étain commun se forge autrement. On ensuife sa piece ; on la monte, c'est-à-dire qu'on la bat sur l'enclume nue. Les coups de marteau paroissent en-dedans & en-dehors ; ils s'étendent du milieu en ligne spirale, mais empiétant toûjours les uns sur les autres, jusqu'à la circonférence de l'ouvrage : c'est pourquoi à chaque coup de marteau que donne l'ouvrier d'une main, de l'autre il fait un peu tourner sa piece sur elle-même. Cette opération s'appelle monter. Après avoir monté une piece, on la renfonce ; la renfoncer, c'est avec le marteau frapper le fond à faux sur les genoux, afin de rendre à l'ouvrage sa concavité. On finit en couvrant l'enclume de peaux de castor gras, & en repassant le marteau sur tous les coups qui paroissent au-dedans & au-dehors de la piece. Cette opération les efface en-dedans, mais non en-dehors. C'est sur la différence du forger & du planer. On dégraisse de même : dans ce travail, l'ouvrier est assis devant son enclume, le billot de l'enclume est entre ses jambes, l'enclume n'est guere qu'à la hauteur de ses genoux ; il tient son marteau de la main droite, sa piece de la main gauche : cette main fait tourner la piece à mesure qu'elle est frappée ; elle est aidée dans cette action par le genou qui soûtient la piece toutes les fois que la main est obligée de la quitter pour la reprendre.
Forger un Fer, (Manége & Maréch.) action du maréchal qui donne à du fer quelconque la forme qu'il doit avoir, pour être placé sous le pié du cheval.
Le fer que les Maréchaux doivent employer, doit être doux & liant ; un fer aigre soûtiendroit avec peine les épreuves qu'ils lui font subir à la forge, & ne resisteroit point à celles auxquelles le met le travail de l'animal.
Ces ouvriers nomment loppin, un bout coupé d'une bande de fer, ou un paquet formé de morceaux de vieux fers de cheval. Celui qu'ils coupent à la bande en est séparé au moyen de la tranche.
Un compagnon prend un loppin de l'une ou de l'autre espece, proportionné aux dimensions qu'il prétend donner à son fer, & le chauffe jusqu'à blanc tout-au-plus, à moins que la qualité du fer dont il se sert lorsqu'il est question d'en souder les parties, n'exige qu'il pousse la chaude au-delà. Le fer ainsi chauffé, il le prend avec les tenailles les plus appropriées à la forme actuelle du loppin ; les tenailles dont sa forge doit être abondamment pourvue, devant être de différentes grandeurs & de différentes figures. Il le présente à plat sur la table de l'enclume. Un apprenti ou un autre compagnon armé du marteau à frapper devant, frappe toûjours de maniere à alonger & à élargir le loppin, & chacun de ses coups est suivi de celui du premier forgeur, dont la main droite saisie du ferretier ne frappe que sur l'épaisseur du fer. Pour cet effet, comme leurs coups se succedent sans interruption, celui-ci après avoir posé le loppin à plat pour l'exposer au marteau de l'apprenti, le retourne promptement de champ pour l'exposer à son ferretier ; & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une des branches soit suffisamment ébauchée : du reste les coups du ferretier tendent comme ceux du marteau au prolongement du loppin, mais ils le retrécissent en même tems, & lui donnent la courbure qui caractérise le fer du cheval ; c'est ce que les Maréchaux appellent dégorger. Pour la lui procurer plus promptement, le forgeur adresse quelques-uns de ses coups sur la pointe non-chauffée du loppin, tandis que l'autre porte sur l'enclume ; car il doit avoir eu l'attention de ne faire chauffer de ce même loppin qu'environ les deux tiers, afin que la partie saisie par la tenaille ait assez de solidité pour rejetter sur la partie chauffée tout l'effet des coups de ferretier qui sont diriges sur elle. Cette branche dans cet état, le forgeur quitte son ferretier & prend le refouloir, avec lequel il la refoule à son extrémité, pour commencer à en façonner l'éponge.
Il remet au feu ; & par une seconde chaude conduite comme la premiere, il ébauche au même point la seconde branche & la courbure, ou la tournure, pour me servir de l'expression du Maréchal ; après quoi lui seul façonne le dessus, le dessous, les côtés extérieurs & intérieurs des branches, en se servant au besoin de l'un & de l'autre bras de la bigorne, pour soûtenir le fer lors des coups de ferretier qu'il adresse sur l'extérieur, ce fer étant tenu de champ sur le bras rond, quand il s'agit de former l'arrondissement de sa partie antérieure, & sur le bras quarré, quand il est question d'en contourner les branches. Il employe de même que ci-devant le refouloir.
Il seroit à souhaiter que tous les Maréchaux s'en tinssent à ces opérations, jusqu'à ce que l'inspection du pié auquel le fer sera destiné, les eût déterminés sur le juste lieu des étampures. Ce n'est qu'alors qu'ils devroient passer à la troisieme chaude, & profiter des indications qu'ils auroient tirées. Cette chaude donnée, le forgeur, à l'effet d'étamper, pose le fer à plat sur l'enclume, ce fer étant retourné de maniere que sa face inférieure est en-dessus ; il tient l'étampe de la main gauche ; il en place successivement la pointe sur tous les endroits ou il veut percer, sans oublier que l'une de ses faces doit être toûjours parallele au bord du fer ; & le compagnon ou l'apprenti frappe sur la tête de cet outil, jusqu'à ce qu'il ait pénétré proportionnément à l'épaisseur de ce même fer. L'étampure faite, le forgeur le rapproche avec son ferretier de la forme que ce dernier travail a altéré ; & après l'avoir retourné, il applique la pointe du poinçon sur les petites élévations apparentes à la face supérieure ; & frappant du ferretier sur la tête de ce poinçon, il chasse en dedans & détache par les bords la feuille à laquelle le quarré de l'étampe a réduit l'épaisseur totale du fer. Cette action avec le poinçon se nomme contre-percer. Enfin il refoule & il rétablit dans ce premier contour, avec ce même ferretier, les bords que l'étampure a forcés, & il porte l'ajusture du fer à sa perfection.
Ces trois seules chaudes seroient insuffisantes dans le cas où il s'agiroit de forger un fer à crampons, & à plus forte raison dans celui où le fer seroit plus composé. Lorsque l'ouvrier se propose de former des crampons quarrés, il a soin de refouler plus fortement les éponges, & de tenir les branches plus longues de tout ce qui doit composer le crampon. La propreté de l'ouvrage exige encore deux chaudes, une pour chaque branche. Le forgeur doit commencer à couder celle qui est chauffée avec le ferretier sur la table de l'enclume, ou sur le bras rond de la bigorne ; sur la table de l'enclume, en portant un coup de son outil sur le dessous de l'éponge à quelques lignes de distance de sa pointe, qui seule repose sur la table, tandis que le reste de la branche est soûtenu par la tenaille dans une situation oblique, ou inclinée ; sur le bras rond, en posant cette même face inférieure de façon que le bout de l'éponge déborde la largeur de ce bras, & en adressant son coup sur l'extrémité saillante. Il s'aide ensuite du bras quarré de la bigorne pour façonner les côtés du crampon.
C'est par la différente maniere dont l'ouvrier présente son fer sur les différentes parties de la bigorne, & dont il dirige ses coups, qu'il parvient à former exactement un crampon quarré, ou un crampon à oreille de lievre ou de chat : celui-ci ne differe du premier, que parce qu'il diminue à mesure qu'il approche de son extrémité, & qu'il est tellement tordu dans sa longueur & des sa naissance, qu'il présente un de ses angles dans la direction de la longueur de la branche dont il émane. Il est encore des crampons postiches, terminés supérieurement en une vis, dont la longueur n'excede pas l'épaisseur de l'éponge. Cette partie du fer est percée d'un trou taraudé, qui comme écrou reçoit cette vis. Par ce moyen le crampon est assez fermement assemblé avec le fer, & facilement mis en place quand il est utile. On l'en sépare aussi sans peine en le dévissant : mais comme l'écrou qui resteroit vuide lorsqu'on jugeroit à-propos de supprimer le crampon, ne pourroit que se remplir de terre ou de gravier qui s'opposeroient à une nouvelle introduction de la vis du crampon, on substitue toûjours à cette vis une autre vis semblable, à cela près qu'elle ne déborde aucunement l'épaisseur du fer dans laquelle elle est noyée, & qu'elle est refendue pour recevoir le tourne-vis, au moyen duquel on la met en place ou on l'ôte avec aisance.
Quant aux pinçons, on les tire de la pince sur la pointe de la bigorne, au moyen de quelques coups de ferretier.
S'il est question d'appliquer aux fers quelques pieces par soudure, il faut de nouvelles chaudes. Les encoches se travaillent à la lime, &c.
Un ouvrier seul pourroit forger un fer ; mais ce travail coûteroit plus de peine, & demanderoit plus de tems.
Il est nombre de boutiques ou de forges où l'on en employe deux, & même quelquefois trois, à frapper devant, sur-tout quand les loppins font d'un volume énorme. (e)
Forger, (Manége & Maréch.) Cheval qui forge, cheval qui dans l'action du pas, & le plus souvent dans celle du trot, atteint ou frappe avec la pince des piés de derriere les éponges, le milieu, ou la voûte de ses fers de devant. Ce défaut que l'on distingue aisément à l'oüie d'une infinité de heurts répétés, est d'autant plus considérable, que communément il annonce la foiblesse de l'animal : aussi ne doit-on pas être étonné de rencontrer des poulains qui forgent. Il provient aussi de la ferrure, quelquefois de l'ignorance du cavalier, qui, bien loin de soûtenir son cheval, le précipite indiscretement en-avant & sur les épaules, & le met par conséquent dans l'impossibilité de lever les piés de devant assez tôt, pour qu'ils puissent faire place à ceux de derriere qui les suivent. La premiere de ces causes ne nous laisse l'espoir d'aucune ressource : l'art en effet ne nous en offre point, quand il s'agit d'un vice qui procede de la débilité naturelle de la machine. A l'égard de ceux que notre impéritie occasionne, il est aisé d'y remédier. Voyez Soûtenir & Ferrure. (e).
Étymologie de « forger »
Wallon, fôrgî?; provenç. fargar?; espagn. et portug. forjar?; du latin fabricare, fabriquer (voy. FORGE).
- (XIIe siècle) Du latin fabricare qui donne aussi fabriquer.
forger au Scrabble
Le mot forger vaut 10 points au Scrabble.
Informations sur le mot forger - 6 lettres, 2 voyelles, 4 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot forger au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
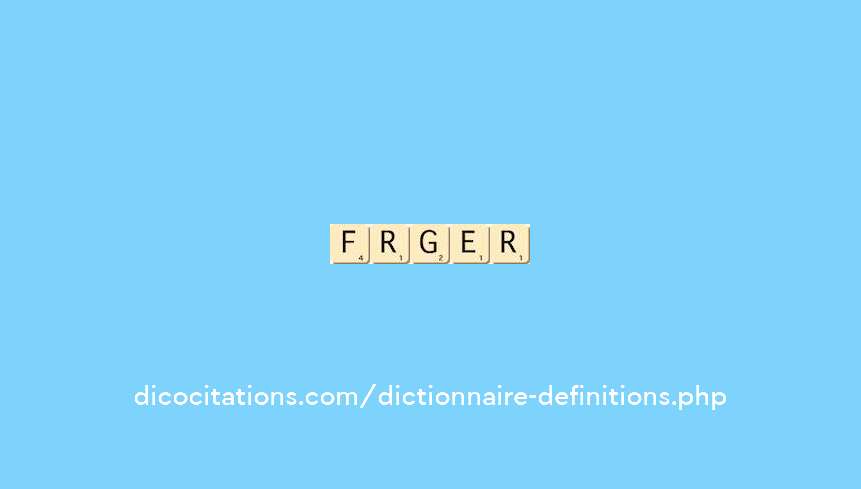
Les rimes de « forger »
On recherche une rime en ZE .
Les rimes de forger peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en Ze
Rimes de étrangers Rimes de exploser Rimes de improvisé Rimes de séduisez Rimes de épuisé Rimes de divergeait Rimes de standardisé Rimes de aspergé Rimes de francisés Rimes de monopoliser Rimes de agrégé Rimes de envisagez Rimes de aisés Rimes de manageait Rimes de usée Rimes de chargez Rimes de corrigeai Rimes de usagé Rimes de reprisée Rimes de détruisaient Rimes de juxtaposais Rimes de stigmatisés Rimes de posé Rimes de sodomisé Rimes de réengagé Rimes de ébouzer Rimes de magnétisée Rimes de sécurisait Rimes de hiérarchisait Rimes de transposez Rimes de fromager Rimes de grisai Rimes de grisé Rimes de toiser Rimes de catégorisé Rimes de défavorisées Rimes de hypnotiser Rimes de susvisée Rimes de électrisé Rimes de orangé Rimes de enragés Rimes de submergé Rimes de anti-fusées Rimes de potager Rimes de automatisées Rimes de effrangée Rimes de dépaysaient Rimes de excisée Rimes de spécialisée Rimes de convergezMots du jour
étrangers exploser improvisé séduisez épuisé divergeait standardisé aspergé francisés monopoliser agrégé envisagez aisés manageait usée chargez corrigeai usagé reprisée détruisaient juxtaposais stigmatisés posé sodomisé réengagé ébouzer magnétisée sécurisait hiérarchisait transposez fromager grisai grisé toiser catégorisé défavorisées hypnotiser susvisée électrisé orangé enragés submergé anti-fusées potager automatisées effrangée dépaysaient excisée spécialisée convergez
Les citations sur « forger »
- Armure: Sorte d'habit porté par un homme dont le tailleur est un forgeron.Auteur : Ambrose Bierce - Source : Le Dictionnaire du Diable (1911)
- La révolution se fait grâce à l'homme, mais l'homme doit forger jour après jour son esprit révolutionnaire.Auteur : Ernesto Guevara, dit Che Guevara - Source : Le Socialisme et l'Homme; écrits politiques (2006)
- Ce n'est pas en mangeant que l'on devient forgeron. Même si on ne veut pas devenir forgeron.Auteur : Francis Blanche - Source : Les Pensées de Francis Blanche (2012)
- Une femme doit apprendre à se forger le caractère, elle doit apprendre à ne compter sur personne.Auteur : Isabelle Sorente - Source : La Faille (2015)
- Certaines personnes ont du mal à s'endormir ou souffrent carrément d'insomnie quand elles sont contrariées. Or il suffit d'un peu d'entraînement et on parvient à dormir sans peine. Cela peut même devenir une seconde nature. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Auteur : James Brown - Source : Les carnets de L.A
- J'aime mieux forger mon âme que la meubler.Auteur : Michel de Montaigne - Source : Essais
- De leurs épées ils forgeront des socs, - Et de leurs lances des serpes. - Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, - Et l'on ne s'entraînera plus à la guerre.Auteur : La Bible - Source : Isaïe, II, 4
- Le maniement des grandes affaires vous fait voir la puissance des actions infâmes : il suffit de limer la dent d'un engrenage pour arrêter tout un mouvement. Les forgerons le cèdent aux horlogers.Auteur : Jean Mallard, comte de La Varende - Source : Le Centaure de Dieu (1938)
- Le capital du forgeron doit être en charbon.Auteur : Proverbes turcs - Source : Proverbe
- C'est en forgeant qu'on devient forgeron; et c'est en saignant qu'on devient exsangue ou professeur.Auteur : Philippe Geluck - Source : Le tour du chat en 365 jours (2006)
- Créer le navire ce n’est point tisser les toiles, forger les clous, lire les astres, mais bien donner le goût de la mer qui est un, et à la lumière duquel il n’est plus rien qui soit contradictoire mais communauté dans l’amour.Auteur : Antoine de Saint-Exupéry - Source : Citadelle (1948)
- Vieillir est un naufrage. Qui a tué en moi ce qui faisait ma force, cette allure innocente, ce don sacré que j'avais de dire oui à la vie? Ce chant joyeux. Celui du forgeron face à l'enclume, du boxeur sur le ring, de Jésus sur sa croix.Auteur : Guy Boley - Source : Quand Dieu boxait en amateur
- Qui donc a pu forger de semblables sornettes ?Auteur : Honoré de Balzac - Source : Ursule Mirouet (1842)
- On rencontre beaucoup d'hommes parlant de liberté, mais on en voit très peu dont la vie n'ait pas été principalement consacrée à se forger des chaînes.Auteur : Gustave Le Bon - Source : Hier et Demain
- Le proverbe empirique qui dit: «C'est en forgeant qu'on devient forgeron» est un proverbe de vérité, car il est plutôt rare, en effet, qu'en forgeant, un forgeron devienne petit télégraphiste ou mannequin de haute-couture.Auteur : Pierre Dac - Source : Proverbes
- On rencontre beaucoup d'hommes parlant de libertés, mais on en voit très peu dont la vie n'ait pas été principalement consacrée à se forger des chaînes.Auteur : Gustave Le Bon - Source : Hier et demain. Pensées brèves (1918)
- Être parent, ça ne s'arrête jamais. Vos enfants le restent pour toujours, leur vulnérabilité requiert sans cesse votre attention, leur lutte pour forger quelque chose qui ressemble à du bonheur... ou pas. Auteur : Douglas Kennedy - Source : Mirage (2015)
- L’être humain est un animal grégaire qui a besoin des autres pour se forger. Auteur : Alexis Aubenque - Source : Souviens-toi de River Falls (2019)
- Forger l'Europe nouvelle, c'est forger une nouvelle conception de l'identité, pour elle, pour chacun des pays qui la composent, et un peu aussi pour le reste du monde.Auteur : Amin Maalouf - Source : Les Identités meurtrières (1998)
- Selon le poignet du forgeron, le gain de la journée.Auteur : Proverbes allemands - Source : Proverbe
- J'ai été fier lorsqu'à la fin d'un stage en prison un condamné à vingt-cinq ans de réclusion a déclaré à un journaliste qui l'interrogeait sur l'apport de l'aventure : " Mais, monsieur, je suis plus riche de deux cent cinquante mots ! " Alors, qu'on ne me demande pas si je fais du social ou du politique ! Notre entreprise est bien au-delà ! Elle vise à forger une fierté d'homme, d'artiste. Elle vise à faire de ces pauvres des Dieux.Auteur : Armand Gatti - Source : Entretien d'Armand Gatti, Télérama 1995
- A force de forger l'on devient forgeron.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Mais ce sont là de ces imitations inconscientes auxquelles personne n'échappe. Il n'est pas défendu, en littérature, de ramasser une arme rouillée ; l'important est de savoir aiguiser la lame et d'en reforger la poignée à la mesure.Auteur : Alphonse Daudet - Source : Trente ans de Paris (1888)
- Et par contre, si je communique à mes hommes l’amour de la marche sur la mer, et que chacun d’eux soit ainsi en pente à cause d’un poids dans le cœur, alors tu les verras bientôt se diversifier selon leurs mille qualités particulières. Celui-là tissera des toiles, l’autre dans la forêt par l’éclair de sa hache couchera l’arbre. L’autre, encore, forgera des clous, et il en sera quelque part qui observeront les étoiles afin d’apprendre à gouverner. Et tous cependant ne seront qu’un. Créer le navire ce n’est point tisser les toiles, forger les clous, lire les astres, mais bien donner le goût de la mer qui est un, et à la lumière duquel il n’est plus rien qui soit contradictoire mais communauté dans l’amour.Auteur : Antoine de Saint-Exupéry - Source : Citadelle (1948)
- La France n'est pas un pays comme les autres. Elle a des responsabilités particulières, héritées de son histoire et des valeurs universelles qu'elle a contribué à forger. Ainsi, face au risque d'un choc des civilisations, face à la montée des extrémismes notamment religieux, la France doit défendre la tolérance, le dialogue et le respect entre les hommes et entre les cultures. L'enjeu : c'est la paix, c'est la sécurité du monde.Auteur : Jacques Chirac - Source : Allocution radiotélévisée du président de la République, Jacques Chirac, prononcée dimanche 11 mars 2007
Les mots proches de « forger »
For Forage Forain, aine Foral, ale Forbannir Forçable Forcade ou fourcade Forçage Forçat Force Forcé, ée Forcement Forcément Forcené, ée Forcènement Forcener Forcènerie Forcer Forcerie Forces Forceur Force-vivier Forclore Forclos, ose Forer Forestage Forestier, ière Foret Forêt Forfaire Forfait Forfait Forfaiteur Forfante Forfanterie Forfantier Forge Forgement Forge-mètre Forger Forgerie Forgeron Forgeur Forhuer ou forhuir Forjet Forjeter Forlignement Forligner Forlonger FormableLes mots débutant par for Les mots débutant par fo
for forage forages foraient forain forain foraine foraine foraines foraines forains forains forait foramen foraminifères forant Forbach Forbach Forbach forban forbans força forçage forçai forçaient forçais forçait Forcalqueiret Forcalquier forçant forçat forçât forçats force force force forcé forcé Force Force Forcé forcée forcée forcées forcées Forcelles-Saint-Gorgon Forcelles-sous-Gugney forcement forcément forcené
Les synonymes de « forger»
Les synonymes de forger :- 1. controuver
2. inventer
3. falsifier
4. mentir
5. fabuler
6. affabuler
7. arranger
8. broder
9. fabriquer
10. feindre
11. insinuer
12. façonner
13. modeler
14. former
15. aménager
16. assembler
17. bâtir
18. composer
19. conformer
20. constituer
21. mouler
22. pétrir
23. sculpter
synonymes de forger
Fréquence et usage du mot forger dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « forger » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot forger dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Forger ?
Citations forger Citation sur forger Poèmes forger Proverbes forger Rime avec forger Définition de forger
Définition de forger présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot forger sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot forger notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 6 lettres.
