La définition de Gale du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Gale
Nature : s. f.
Prononciation : ga-l'
Etymologie : Bourguign, gaule. Dérivation incertaine Plusieurs sources se présentent : 1° le latin callus, cal, durillon, la permutation du c en g ne faisant pas un obstacle absolu, mais le sens n'étant pas satisfaisant ; 2° l'allemand Galle, endroit vicieux ou malade, pourriture ; danois, gall, vicieux ; 3° l'angalis to gall, excorier ; 4° le celtique : irlandais, galar, maladie en général ; bas-breton et kimry, gâl, éruption ; 5° le latin galla, galle des arbres, maladie des végétaux qu'on a transportée aux hommes et aux animaux. C'est cette dernière étymologie qui semble la plus vraisemblable.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de gale de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec gale pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Gale ?
La définition de Gale
Maladie cutanée et contagieuse caractérisée par de petites vésicules, la présence d'un insecte nommé acarus ou acare, et de grandes démangeaisons. Avoir la gale. Couvert de gale.
Toutes les définitions de « gale »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. de Médecine. Maladie cutanée et contagieuse, caractérisée par une éruption de vésicules transparentes à leur sommet, qui se développent principalement au pli des articulations, et qui sont toujours accompagnées de démangeaison. Prendre, avoir, donner la gale. Pop., Être méchant comme une gale, Être très méchant. C'est une gale. Il se dit aussi d'une Maladie des végétaux, caractérisée par des rugosités qui s'élèvent sur l'écorce des branches, sur les feuilles et sur les fruits. La gale du pommier, de l'orme.
Littré
-
1Maladie cutanée et contagieuse caractérisée par de petites vésicules, la présence d'un insecte nommé acarus ou acare, et de grandes démangeaisons. Avoir la gale. Couvert de gale.
Qu'on me fouettât pour voir si j'avais point la gale
, Régnier, Sat. X.Populairement. Être méchant comme la gale, être fort méchant.
On dit aussi?: C'est une véritable gale. C'est la gale que cette femme-là.
Fig. Défiez-vous de lui, il a la gale.
Fig. et populairement. Il n'a pas la gale aux dents, il est gros mangeur
Gale des épiciers, eczéma et ecthyma aigus des mains, auxquels les épiciers sont sujets.
-
2La gale existe aussi chez la plupart des animaux et y est causée et caractérisée par différentes variétés d'acares.
C'est un limier boiteux de gales damassé
, Régnier, Sat. x.Gale du porc, nommée vulgairement rogne.
Donner la gale à son chien?: maxime d'ingrat
, Diderot, Princ. de polit. 8. -
3 Terme de botanique. Maladie des végétaux caractérisée par des rugosités qui se forment sur l'écorce, sur les feuilles, sur les fruits.
Le bois de bergamote et des petits muscats est sujet à avoir de la gale
, Quintinye, Jardins, t. I, dans RICHELET. - 4 Terme de menuiserie. Trous de vers, nodosités qui défigurent la surface d'un arbre, d'un bois.
-
5Inégalités qui se trouvent sur les étoffes.
PROVERBE
La gale ni l'amour ne se peuvent cacher.
HISTORIQUE
XVIe s. Si c'est humeur, en se grattant on luy donne issue, ?dont quelquefois s'ensuivent petites pustules et galles [croûtes], et souvent ulceres
, Paré, Introd. 17. Qui a la galle se gratte et galle
, Leroux de Lincy, Prov. t. I, p. 245. Il est galant homme, il a apporté la galle en France [se disait par une mauvaise allusion de gale à galant pour faire entendre qu'une personne n'était guère habile ou honnête]
, Oudin, Curios. fr. Gale de Naples [le mal vénérien]
, Cartheny, Voy. du chev. errant, f° 66, dans LACURNE.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
GALE. Ajoutez?:Arbre à la gale, le rhus toxicodendron, L.,Baillon, Dict. de bot. p. 247.
Encyclopédie, 1re édition
GALE, s. f. (Medecine.) maladie qui corrompt la peau par l'écoulement de certaines humeurs acres & salines, qui s'amassent en forme de pustules, & occasionnent des demangeaisons.
Il y a deux especes de gale, la seche & l'humide : la premiere est appellée gale canine, scabies canina, parce que les chiens y sont sujets ; ou seche, sicca, à cause qu'elle suppure peu ; prurigineuse, prunginosa, à pruritù, demangeaison ; car elle en cause une qui est très-importune ; gratelle, parce qu'on se gratte sans cesse : on lui donne encore les noms d'impetigo, lichen, mentagara : la seconde est nommée grosse gale ou gale humide, scabies crassa & humida, parce qu'elle est plus grosse que la premiere, & qu'elle forme des pustules circonscrites qui suppurent comme autant de petits phlegmons qui dégenerent en abcès. On attribue ordinairement la premiere à une humeur atrabilaire, & la derniere à une pituite saline ; elles sont toutes deux contagieuses. Voyez l'art. suiv.
Le docteur Bononio prétend avoir beaucoup mieux expliqué la cause de cette maladie, qu'aucun de ceux qui l'ont précédé : voici son hypothese.
Il examina plusieurs globules de matiere, qu'il fit sortir avec une épingle des pustules d'une personne qui étoit attaquée de cette maladie, avec un microscope, & les trouva remplis de petits animaux vivans semblables à une tortue, fort agiles, ayant six piés, la tête pointue, & deux petites cornes au bout du museau. Fondé sur cette découverte, il ne craint pas d'attribuer la cause de cette maladie contagieuse aux morsures continuelles que ces animaux font à la peau, & qui donnant passage à une partie de la sérosité, occasionne de petites vessies, dans lesquelles ces insectes continuant à travailler, ils obligent le malade à se gratter, & à augmenter par-là le mal, en déchirant non-seulement les petites pustules, mais encore la peau & quelques petits vaisseaux sanguins ; ce qui occasionne la gale, les croûtes, & les autres symptomes desagréables dont cette maladie est accompagnée.
On voit par-là d'où vient que la gale se communique si aisément ; car ces animaux peuvent passer d'un corps dans un autre avec beaucoup de facilité, par le simple attouchement. Comme leur mouvement est extrèmement rapide, & qu'ils se glissent aussi-bien sur la surface du corps que sous l'épiderme ; ils sont très-propres à s'attacher à tout ce qui les touche ; & il suffit qu'il y en ait un petit nombre de logés, pour se multiplier en peu de tems.
On voit donc par-là d'où vient que les lixiviels, les bains, & les onguens faits avec les sels, le soufre, le mercure, &c. ont la vertu de guérir cette maladie ; car ils ne peuvent que tuer la vermine qui s'est logée dans les cavités de la peau ; ce qu'on ne sauroit faire en se grattant, à cause de leur extrème petitesse, qui les dérobe aux ongles. Que s'il arrive quelquefois dans la pratique que cette maladie revienne lorsqu'on la croit tout-à-fait guérie par les onctions, on n'en doit pas être surpris : car quoique les onguens puissent avoir tué tous ces animaux, il n'est pas cependant probable qu'ils ayent détruit tous les ?ufs qu'ils ont laissés dans la peau, comme dans un nid ou ils éclosent de nouveau pour renouveller la maladie. Chambers.
On peut, sans manquer à la Medecine, ne pas se déclarer partisan de cette opinion, & regarder la gale comme une indisposition de la peau, par l'altération de l'humeur séreuse des glandes de cette partie, dont le vice se communique bien-tôt à toute la masse du sang. L'humeur cutanée peut être viciée par contagion, en couchant avec un galeux, ou dans le même lit où il a couché : on a même des exemples de personnes qui ont gagné la gale parce que leur linge avoit été lavé avec celui d'un galeux.
La stagnation de l'humeur cutanée peut acquérir par son séjour la nature d'un levain acre & en quelque sorte corrosif, qui cause non-seulement la gale, mais souvent des éruptions ulcéreuses. De-là vient que sans communiquer avec des galeux, ceux qui ont été détenus long-tems en prison, ceux qui ont mené une vie sédentaire, les personnes mal-propres, celles enfin qui ont été exposées aux ordures, &c. sont sujets à contracter cette maladie.
Les principales indications se réduisent à corriger le vice de l'humeur des glandes de la peau, & à rectifier cet organe. Les applications locales peuvent l'effectuer ; & lorsque la maladie est récente ou nouvellement contractée, elle est souvent guérie avec sûreté par les seuls topiques : mais si le vice a pénétré, & qu'il ait été transmis dans le sang par les voies de la circulation, il y a du danger à guérir la gale sans les préparations convenables : il faut d'abord travailler à la dépuration du sang par la saignée, les purgatifs, & les altérans convenables, tels que le petit-lait avec le suc de fumeterre, la creme de tartre mêlée avec la fleur de soufre, les bouillons de vipere, &c. Dans les gales opiniâtres, on est quelquefois obligé, après l'usage des bains, de faire usage des remedes mercuriels.
La gale scorbutique demande l'administration des remedes propres à détruire le vice du sang dont elle est un symptome.
Il y a beaucoup de bons auteurs qui ont traité de la gale ; on ne peut faire trop d'attention aux observations qu'ils rapportent ; & quoique cette maladie soit souvent confiée sans danger aux soins de personnes peu éclairées, les suites fâcheuses d'un traitement mauvais ou négligé devroient avoir appris par de tristes expériences, à se mettre en garde contre les gens qui conseillent & administrent des remedes sans connoissance de cause.
Les remedes qui dessechent les pustules de gale, sans prendre de précautions par l'usage des medicamens intérieurs, peuvent n'avoir aucun inconvénient, lorsque le caractere de la maladie est doux, qu'elle est récente & gagnée par contagion : il n'en est pas de même, lorsque la gale est occasionnée ou entretenue par quelque disposition cacochymique du sang & des humeurs : dans ce cas, la répercussion de l'humeur nuisible peut causer plusieurs indispositions mortelles, parce qu'elle se porte sur le poumon, sur le cerveau, & autres parties nobles. Plusieurs personnes ont eu le genre nerveux attaqué par l'usage de la ceinture mercurielle.
Les pauvres gens se traitent & se guérissent de la gale en se faisant saigner & purger ; ils prennent ensuite de la fleur de soufre dans un ?uf ou dans du petit lait ; & ils en mêlent dans du beurre ou de la graisse, pour se frotter les pustules galeuses : on sait qu'elles se manifestent principalement entre les doigts, où est le siége propre & patognomonique de la maladie, aux jarrets, sur les hanches, & autres parties du corps, où l'humeur acre retenue, produit des tubercules qui excitent une demangeaison qui porte à se gratter jusqu'à la douleur. (Y)
Gale, (Manége & Maréchallerie.) maladie prurigineuse & cutanée ; elle se manifeste par une éruption de pustules plus ou moins volumineuses, plus ou moins dures, précédées & accompagnées d'une plus ou moins grande demangeaison.
Nous pouvons admettre & adopter ici la distinction reçûe & imaginée par les Medecins du corps humain, c'est-à-dire reconnoître deux especes de gale ; l'une que nous nommerons, à leur imitation, gale seche, & l'autre que nous appellerons gale humide.
Les productions pustuleuses qui annoncent la premiere, sont en quelque façon imperceptibles ; leur petitesse est extrème ; elles suppurent peu & très rarement ; elles provoquent néanmoins la chûte des poils dans les lieux qu'elles occupent & qui les environnent ; & le prurit qu'elles excitent est insupportable.
Les exanthèmes qui décelent la seconde sont toûjours sensibles ; ils sont plus ou moins élevés, & paroissent comme autant de petits abcès contigus, d'où suinte une matiere purulente, dont le desséchement forme la sorte de croûte qui les recouvre : dans celle-ci, le sentiment incommode qui résulte de l'irritation des fibres nerveuses répandues dans le tissu de la peau, n'affecte pas aussi vivement l'animal que dans la gale seche, & la demangeaison est beaucoup moindre.
Nous ne voyons point en général que cette maladie s'étende sur toute l'habitude du corps du cheval ; elle se borne communément à de certaines parties : la gale seche n'en épargne cependant quelquefois aucune : mais cet évenement n'est pas ordinaire ; & le plus souvent ses progrès sont limités, tantôt dans un espace & tantôt dans un autre.
La gale humide attaque l'encolure, la tête, les épaules, les cuisses, elle se fixe aussi dans la criniere. Voyez Rouvieux ; & dans le tronçon de la queue. Voyez Eaux, maladie.
Dès que la gale n'est point universelle dans les chevaux, comme dans l'homme, il est assez inutile de multiplier les divisions, & d'assigner, à l'exemple des auteurs en Chirurgie, le nom particulier de dartre à telle ou telle gale, sous le prétexte d'un local, qui d'ailleurs doit nous être d'autant plus indifférent, que toutes ces productions psoriques ne sont, à proprement parler, qu'une seule & même maladie, que les mêmes causes occasionnent, & dont le même traitement triomphe.
Bononius séduit par le raisonnement de quelques écrivains, a crû devoir s'efforcer d'accréditer leur opinion sur le principe essentiel de cette affection cutanée. Nous trouvons dans les Transactions philosophiques, n°. 283. une description singulierement exacte des petits animaux qu'on a supposés y donner lieu ; ils y sont représentés sous la forme & sous la ressemblance d'une tortue ; le micrographe se flatte même d'en avoir découvert & distingué les ?ufs : mais tous les détails auxquels il s'abandonne, bien loin de mettre le fait hors de doute, n'offrent qu'une preuve très évidente de la foiblesse de ses sens, de la force de ses préjugés, & de son énorme penchant à l'erreur.
La source réelle & immédiate de la gale réside véritablement dans l'acreté & dans l'épaississement de la lymphe : l'un & l'autre de ces vices suffisent à l'explication de tous les phénomenes qui assûrent l'existence de cette maladie, & qui en différentient les especes.
Si l'on suppose d'abord que cette humeur soit imprégnée d'une quantité de particules salines qui ne peuvent que la rendre acre & corrosive, mais qui noyées dans le torrent de la circulation, sont, pour ainsi dire dans l'inertie & sans effet : on doit présumer que lorsqu'elle sera parvenue dans les tuyaux destinés à l'issue de l'insensible transpiration & de la sueur, ces mêmes particules qu'elle y charrie s'y réuniront en masse ; de-la l'engorgement des tuyaux à leurs extrémités ; de-là les exanthèmes ou les pustules. Plus la lymphe sera ténue, moins les exanthèmes seront volumineux & les exulcérations possibles ; l'évaporation en sera plus prompte, elle ne laissera après elle nul sédiment, nulle partie grossiere ; les sels plus libres & plus dégagés s'exerceront sans contrainte sur les fibriles nerveuses ; & tous les symptomes d'une gale seche se manifesteront d'une maniere non équivoque. La viscosité est-elle au contraire le défaut prédominant ? les engorgemens seront plus considérables, les pustules plus saillantes & plus étendues ; & conséquemment le nombre des tuyaux sanguins qui éprouveront une compression, & des canaux blancs qui seront dilatés & forcés, sera plus grand. La lymphe arrêtée dans ceux-ci, & subissant d'ailleurs un froissement résultant du jeu & de l'oscillation de ceux-là, acquerra inévitablement plus ou moins d'acrimonie ; elle corrodera les vaisseaux qui la contiennent : cette corrosion sera suivie du suintement d'une matiere purulente, qui jointe à beaucoup de parties sulphureuses, sera bien-tôt desséchée par l'air, & ces mêmes parties embarrassant les sels & s'opposant à leur activité, leur impression sera plus legere. C'est ainsi que la gale humide se forme & se montre avec tous les signes qui la caractérisent.
Le virus psorique est contagieux ; il se communique par l'attouchement immédiat, par les couvertures, les harnois, les étrilles, les brosses, les époussettes, &c. de quelque maniere qu'il soit porté à la surface du cuir d'un cheval sain ; il s'y unit, il s'y attache, soit par l'analogie qu'il a avec l'humeur perspirante, soit par sa ténuité & sa disposition à s'introduire dans les pores. A peine s'y est-il insinué, qu'il fomente l'épaississement de la matiere qu'il y rencontre ; il y séjourne néanmoins quelque tems sans s'y développer sensiblement ; mais la chaleur naturelle & le mouvement des vaisseaux artériels excitant ensuite son action, nous appercevons bien-tôt des pustules qui se renouvellent & se reproduisent, selon qu'il a pénétré dans la masse. Nous devons donc regarder les parties salines exhalées du corps du cheval galeux par la transpiration & par la sueur, ou contenues dans l'humeur suppurée qui flue des exanthèmes, comme la cause prochaine externe de la maladie dont il s'agit.
Tout ce qui peut troubler la dépuration des sucs vitaux, donner lieu à la corruption des humeurs, & leur imprimer des qualités plus ou moins pernicieuses, doit être mis au rang de ses causes éloignées : ainsi de mauvais fourrages, qui ne fournissent qu'un chyle crud & mal digéré ; des travaux qui occasionnent une dissipation trop forte ; le défaut des alimens nécessaires à la réparation des fluides & à l'entretien de la machine ; un air humide & froid qui rallentit la marche circulaire ; l'omission du pansement ; & en conséquence le séjour d'une crasse épaisse qui obstrue & bouche les pores cutanés, sont autant de circonstances auxquelles on peut rapporter ces différentes éruptions.
Quoiqu'elles nous indiquent toûjours un vice dans la masse, elles ne présagent néanmoins rien de dangereux ; & les suites n'en sont point funestes, pourvû que le traitement soit méthodique, & que l'on attaque le mal dans sa source & dans son principe.
Il est quelquefois critique & salutaire ; car il débarrasse le sang de quantité de parties salines & héterogenes qui auroient pû donner lieu à des maux plus formidables : nous remarquons même très-souvent dans les chevaux qui n'ont jetté qu'imparfaitement, que la nature cherche à suppléer & supplée en effet par cette voie à l'impuissance dans laquelle elle a été d'opérer une dépuration entiere & nécessaire, par les émonctoires qui dans l'animal semblent particulierement destinés à l'écoulement de l'humeur & de la matiere dont le flux décele communément la gourme.
La gale seche est plus rébelle & plus difficile à dompter que la gale humide ; des sucs acres & lixiviels ne sont point aisément délayés, corrigés, emportés : elle attaque plus ordinairement les chevaux d'un certain âge & les chevaux entiers, que les chevaux jeunes & que les chevaux hongres ; les premiers à raison de la prédominance des sels, de la plus grande force & de la plus grande rigidité de leurs fibres ; les seconds conséquemment sans doute au repompement de l'humeur séminale, qui passant en trop grande abondance dans le sang, peut l'échauffer & exciter l'acrimonie, lorsqu'ils ne servent aucune jument ; ou à raison de l'acreté qui est une suite de l'apauvrissement de la masse, lorsqu'ils en servent un trop grand nombre. Nous dirons aussi que dans la jeunesse elle cede plus facilement aux remedes, parce qu'il est certain qu'alors la transpiration est plus libre, les pores de la peau plus ouverts & les fibres plus souples.
La gale humide résiste moins à nos efforts : sa principale cause consistant dans l'épaississement, & non dans un vice capable d'entretenir un levain, une salure qui pervertit les nouveaux sucs à mesure qu'il en aborde & qu'il s'en forme : si les jeunes chevaux y sont réellement plus sujets, c'est qu'en eux le tissu des solides est moins fort & moins propre à atténuer les fluides.
Nous observerons encore que toute maladie exanthémateuse prise par contagion, qui n'adhere qu'à la surface du corps, & qui n'a pas poussé, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, de profondes racines, n'est point aussi opiniâtre que celle qui doit son existence à la dépravation du sang & des humeurs ; & l'expérience prouve qu'une gale récente est plus susceptible de guérison qu'une gale ancienne & invéterée.
Pour ne point errer dans la maniere de traiter l'affection cutanée dont il est question, il est important d'en considérer l'espece, & de n'en pas perdre de vûe la cause & le principe.
Dans la gale seche notre objet doit être d'adoucir, de briser, d'évacuer les sels, de relâcher le tissu de la peau. Dans la gale humide, nous devons chercher à atténuer les particules salines & sulphureuses dont elle se charge, à favoriser enfin la transpiration. Si la maladie participe en même tems & de l'épaississement & de l'acrimonie, le maréchal y aura égard & tiendra un juste milieu dans le choix & dans l'administration des médicamens.
Son premier soin sera de séparer le cheval malade des autres chevaux, & de le placer dans une écurie particuliere ; non que j'imagine que le virus psorique soit assez subtil pour s'étendre de lui-même d'un lieu à un autre, & pour se communiquer ainsi : mais cette précaution devient essentielle, lorsque l'on réfléchit sur la facilité de la contagion par les harnois & par les couvertures, & sur la paresse ainsi que sur l'imprudence des palefreniers.
La saignée est nécessaire dans tous les cas : elle sera même répétée dans le besoin : dans tous les cas aussi on doit tenir l'animal au son & à l'eau blanche, & jetter dans cette même eau une décoction émolliente faite avec les feuilles de mauve, de guimauve, pariétaire, &c. Ce régime sera observé plus long-tems par le cheval atteint d'une gale seche, que par celui qui sera atteint d'une gale humide : on purgera ensuite l'animal une ou plusieurs fois avec le séné, l'aloës, l'aquila alba ou le mercure doux, après l'avoir néanmoins préparé à cette purgation par des lavemens émolliens : on en reviendra à l'usage de la décoction émolliente ; & s'il s'agit de la premiere espece de gale, on humectera soir & matin le son, que l'on donnera au cheval avec une tisanne composée dans laquelle entreront les racines de patience, de chicorée sauvage, d'althæa, & les feuilles de scabieuse, de fumeterre, &c. S'il refuse de manger le son ainsi humecté, on pourra lui donner cette boisson avec la corne : j'y ai plusieurs fois heureusement substitué des feuilles de grosse laitue que je trempois dans du lait, & que l'animal mangeoit avec avidité. Dans la circonstance d'une gale humide, on mouillera le son avec une décoction de gayac & de salsepareille, en mêlant à cet aliment des fleurs de genêt, & une demi-once de crocus metallorum. Le soufre, le cinnabre naturel, l'æthiops minéral, les poudres de viperes, de cloportes, de chamædris & de fumeterre donnés à tems & administrés avec circonspection, sont d'une très-grande ressource contre toutes sortes de gales : celles qui sont les plus rébelles & les plus invétérées disparoissent souvent lorsque l'on abandonne l'animal dans les prairies, & qu'il est réduit au vert pour tout aliment ; les plantes différentes qu'il y rencontre & dont il le nourrit excitant d'abord des évacuations copieuses & salutaires, & fournissant ensuite à la masse des sucs plus doux capables d'amortir l'acreté des humeurs.
La plûpart des Maréchaux ne font que trop souvent un usage très-mal entendu des topiques, sans doute parce qu'ils n'en connoissent pas le danger : il est inutile néanmoins de chercher dans Agendornius, dans Hoechstellerus & dans une foule d'auteurs qui traitent des maladies de l'homme, quels en sont les funestes effets. La matiere morbifique répercutée & poussée de la circonférence au centre, produit dans le corps de l'animal des desordres terribles, & dont ils ont sûrement été les témoins sans s'en appercevoir & sans s'en douter : j'ai vû ensuite d'une pareille répercussion des chevaux frappés d'apoplexie, de phthisie, atteints d'un abcès dans les reins, & de plusieurs autres maux qui les conduisoient à la mort. On ne doit donc recourir aux remedes extérieurs qu'avec prudence, & qu'après avoir combattu la cause.
Je ne ferai point une ample énumération des onguens, des lotions, des linimens que l'on peut employer ; il suffira de remarquer ici que le soufre & ses préparations sont d'une efficacité non moins merveilleuse en cosmétiques que donnés intérieurement. On peut faire un mélange de ses fleurs avec la chaux, & incorporer le tout avec suffisante quantité d'huile d'olive : ces mêmes fleurs, l'onguent de nicotiane, l'aquila alba, & l'huile d'hypéricon, composeront un liniment dont on retirera de très-grands avantages ; l'æthiops minéral mêlé avec du sain-doux, ne sera pas moins salutaire, &c. on en met sur toutes les parties que les exanthèmes occupent.
On doit encore avoir attention que le cheval ne se frotte point contre les corps quelconques qui l'environnent ; ce qui exciteroit une nouvelle inflammation, obligeroit le sang de s'insinuer dans les petits canaux lymphatiques, & donneroit bien-tôt lieu à une suppuration. Du reste, si le tems & la saison sont propices, on menera, après la disparition des pustules, l'animal à la riviere ; les bains ne pouvant que relâcher & détendre les fibre cutanées ; & il importe extrèmement de l'éloigner par un régime convenable, de tout ce qui peut susciter & reproduire en lui cette maladie. (e)
Gale, s. f. en latin galla, (Physique.) excroissance contre nature qui se forme en divers pays, sur divers chênes, & entr'autres sur le rouvre, à l'occasion de la piquûre de quelques insectes : ces sortes d'excroissances s'appellent plus communément, quoiqu'improprement, noix de galle ; mais comme c'est l'usage, & que l'usage fait la loi, voyez Noix de Galle. (D. J.)
* Gale, (Rubannier.) s'entend de toutes les inégalités qui se trouvent tant sur l'ouvrage qu'aux lisieres, & qui sont occasionnées par les bourres, n?uds, &c. qui sont dans les soies de chaîne ou de trame, si l'ouvrier n'a soin de les nettoyer : ces gales sont encore le plus souvent occasionnées, sur-tout aux lisieres, par le mauvais travail ou la négligence de l'ouvrier.
Wiktionnaire
Nom commun - français
gale \?al\ féminin
-
(Médecine) Maladie parasitaire causée par le sarcopte, cutanée et contagieuse de l'homme et des animaux, caractérisée chez l'homme par une éruption de vésicules transparentes à leur sommet, qui se développent principalement au pli des articulations, et qui sont toujours accompagnées de démangeaison.
-
? Combien avez-vous de malades à l'infirmerie ?
? Un chiffre normal? une trentaine, je crois.
? Pas de maladies contagieuses ?
? La gale, monsieur le Ministre.
? Beaucoup de cas ?
? Oh ! non? cinq ou six.
? On connaît l'origine de cette infection ?
? Ils attrapent ça en ville? vous savez ! ? (Jules Romains, Les Copains, 1922, réédition Le Livre de Poche, page 129) - La gale peut affecter tous les animaux, y compris les volailles. Elle est particulièrement grave chez les jeunes animaux. Elle s'observe parfois chez l'homme, mais dans ce cas la contamination n'est pas toujours directement d'origine animale. ? (Bill Forse, Christian Meyer, et al., Que faire sans vétérinaire ?, Cirad / CTA / Kathala, 2002, page 167)
- Prendre, avoir, donner la gale.
-
? Combien avez-vous de malades à l'infirmerie ?
-
(Québec) (Familier) Croûte qui se forme sur une blessure, une plaie en voie de guérison.
- N'enlève pas la gale : si tu l'enlèves, tu vas saigner !
-
(Populaire) Teigne, personne méchante et nocive.
- Être méchant comme une gale, être très méchant.
- ? C'était la s?ur Théotime, dit Octavie. Oui, je l'ai bien connue. Une vraie gale, et qui vous tapait sur les doigts, ça saignait. ? (Marcel Arland, Terre natale, 1938, réédition Le Livre de Poche, page 155)
-
(Botanique) Maladie des végétaux, caractérisée par des rugosités sur l'écorce des branches, sur les feuilles et sur les fruits.
- La gale du pommier, de l'orme.
-
(Figuré)
- Il serre contre ses côtes un portefeuille qui rappelle celui d'un huissier ou d'un professeur de collège communal. L'usure y a plaqué des gales blanches sur la peau noire, mais, tout de même, le peuple regarde cette serviette avec respect. ? (Jules Vallès, L'Insurgé, G. Charpentier, 1908)
Trésor de la Langue Française informatisé
GALE, subst. fém.
PATHOLOGIEGale au Scrabble
Le mot gale vaut 5 points au Scrabble.
Informations sur le mot gale - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot gale au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
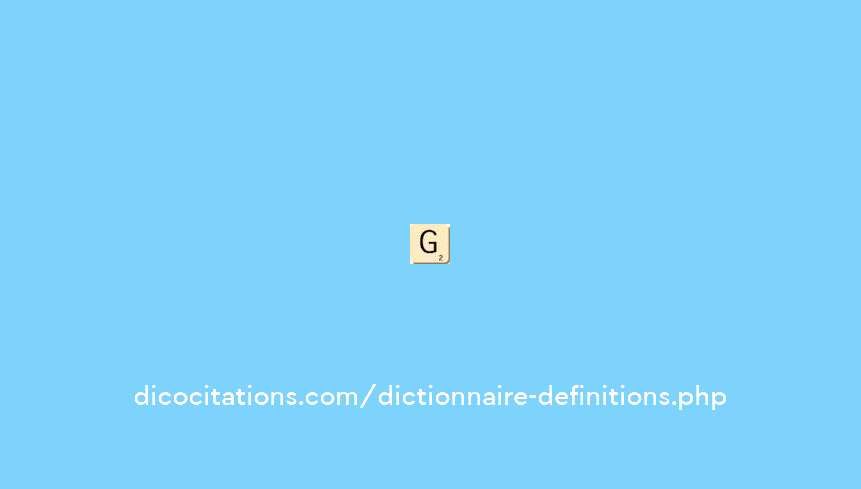
Les mots proches de Gale
Gala Galactite Galamment Galanga Galant, ante Galanterie Galanthe Galanthine ou galantine Galantine Galantisé, ée Galantiser Galbanum Galbe Gale Galé Galéace ou galéasse Galée Galefretier Galéopithèque Galéopsis Galer Galère Galerie Galérien Galerne Galet Galetas Galette Galette Galeux, euse Galgal Galibi Galimafrée Galimatias Galion Galiote Galipe Galipée Galle Gallican, ane Gallicisme Gallique Gallon Galoche Galochier Galon Galonner Galop Galope Galope gal gal gala galactique galactiques galactophore galago galalithe Galametz galamment Galan galant galant galante galante galanterie galanteries galantes galantes galantine galantines galantins galantisait galantisé galants galants Galapian galapiat galapiats Galargues galas galate galates galates galathée galaxie galaxies galbait galbe galbé galbé galbée galbée galbées galbées galber galbes galbés galbés galeMots du jour
Transitif, ive Moulu, ue Iceberg Imagerie Commenté, ée Colisa ou colise Rébellion Diablement Travers Tricolorer
Les citations avec le mot Gale
- Eloquence: Art de convaincre les imbéciles par la parole de ce que le cheval blanc d'Henri IV est effectivement blanc. Cela inclut le talent de prouver que le cheval blanc est également de n'importe quelle autre couleur.Auteur : Ambrose Bierce - Source : Le Dictionnaire du Diable (1911)
- Voilà bien les hommes! Tous également scélérats dans leurs projets, ce qu'ils mettent de faiblesse dans l'exécution, ils l'appellent probité.Auteur : Pierre Choderlos de Laclos - Source : Les Liaisons dangereuses (1782)
- Le délire de mentir et de croire s'attrape comme la gale.Auteur : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline - Source : Voyage au bout de la nuit (1932)
- Amusez-le du moins à débattre avec vous:
Faites-lui perdre temps, tandis qu'en assurance
La galère s'éloigne avec son espérance.Auteur : Pierre Corneille - Source : Nicomède (1651), V, 5, Arsinoé - Une goutte de pluie est l'égale d'une goutte de sang.Auteur : Jean Chalon - Source : Les Petites Solitudes
- Au delà d'un optimisme et d'un pessimisme également sans fondement, la vie a toujours été et sera toujours une souffrance, et elle est un miracle: Elle est une fête en larmes.Auteur : Jean d'Ormesson - Source : C'était bien (2003)
- L'honnête homme tient le milieu entre l'habile homme et l'homme de bien, quoique dans une distance inégale de ces deux extrêmes.Auteur : Jean de La Bruyère - Source : Les Caractères (1696)
- Combien de mois, combien de vies faut-il pour écrire une phrase qui égale en puissance la beauté des choses?Auteur : Christian Bobin - Source : Le huitième jour de la semaine
- Je réalise beaucoup de croquis avant de créer un personnage définitif, je le mets en situation un peu avant également. Après, chaque personnage c’est plus ou moins un peu de moi indirectement. Auteur : Hiro Mashima - Source : Interview d'Hiro Mashima - Journal du Japon (2016)
- La joie et le tourment me menacent également de la mort après une longue épreuve, car le mal nuit davantage que le bien ne profite.Auteur : Michel-Ange - Source : Poésies (1503-1560), Madrigal XXII
- Le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses. La vertu inhérente au socialisme consiste en une égale répartition de la misère.Auteur : Winston Churchill - Source : Sans référence
- Seuls les dieux disposent d'assez de temps pour donner un nom à chaque galet d'une plage, mais c'est la patience qui leur manque.Auteur : Terry Pratchett - Source : Procrastination (2005)
- Quand pour toi la fortune est la plus libérale,
Redoute en ses faveurs quelque revers fatal;
Elle change souvent, et sa course inégale
Commençant bien, peut finir mal.Auteur : Denys Caton - Source : Distiques de Caton, Livre premier, XVIII - Le désir qui naît de la joie est plus fort, toutes choses égales d'ailleurs, que le désir qui naît de la tristesse.Auteur : Baruch Spinoza - Source : L'Ethique, Livre IV
- Les idées d'un homme qui n'a plus de bretelles ni de bottes ne sont plus celles d'un homme qui porte ces deux tyrans de notre esprit. Remarquez que ceci n'est un axiome que dans la vie conjugale. En morale, c'est ce que nous appelons un théorème relatif.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Petites Misères de la vie conjugale (1845)
- Il est plaisant qu'aujourd'hui on offense presque également les gens si on leur dit qu'ils sont du monde et si on leur dit qu'ils n'en sont point.Auteur : Abel Hermant - Source : Le Bourgeois (1924), VI
- Ils ont fait de leurs lois un dédale immense où la mémoire et la raison se perdent également.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Considérations sur le gouvernement de Pologne (1770-1771)
- Ue foule n'est rien moins qu'une société; une multitude de visages n'est tout au plus qu'une galerie de portraits, et une conversation entre des personnes qui n'ont que de l'indifférence les unes pour les autres n'est guère plus agréable que le son d'une cymbale. Cet adage latin : « Grande ville, grande solitude, » a trait à ce que nous disons; car assez ordinairement dans une grande ville des amis se trouvent écartés les uns des autres et ne peuvent se rejoindre que rarement. Auteur : Francis Bacon - Source : Essais , XXVII. De l'amitié
- La restauration de la femme eut lieu principalement au XIIe siècle. Esclave dans l'Orient, enfermée encore dans le gynécée grec, émancipée par la jurisprudence impériale, elle fut dans la nouvelle religion l'égale de l'homme.Auteur : Jules Michelet - Source : Histoire de France, tome II (1833), livre IV, 4
- Ces galeres avoient esté très bien faites et devisées par Themistocles, tant pour cingler legerement, que pour tournoyer facilement.Auteur : Jacques Amyot - Source : Cimon, 19
- Ni tous les rossignols ne chantent également bien, ni toutes les roses ne sentent également bon.Auteur : Joseph Joubert - Source : Carnets tome 1, 7 août 1803
- Les sots devraient avoir pour les gens d'esprit une méfiance égale au mépris que ceux-ci ont pour eux.Auteur : Antoine Rivaroli, dit Rivarol - Source : Maximes et Pensées
- La beauté et la laideur disparaissent également sous les rides de la vieillesse; l'une s'y perd, l'autre s'y cache.Auteur : Jean Antoine Petit, dit John Petit-Senn - Source : Bluettes et boutades (1846)
- Qui que vous soyez, inconnu ou célèbre, faible ou puissant, vous détenez une part égale du destin de notre pays.Auteur : Valéry Giscard d'Estaing - Source : Discours, Verdun-sur-le-Doubs, 27 janvier 1978.
- La vie conjugale est une longue partie de bowling. Année après année, les illusions sont renversées l'une après l'autre.Auteur : Dominique Muller - Source : Les filles prodigues
Les citations du Littré sur Gale
- Ce serait une contestation bien inégale, que des paroles d'un pauvre gentilhomme comme je suis, avec les effets d'un prince tel que vous êtes, renommé par la voix générale de tout le mondeAuteur : MALH. - Source : Lettres, I, 4
- De mon rang descendue, à mille autres égale, Ou la première esclave enfin de ma rivaleAuteur : Jean Racine - Source : Baj. V, 4
- La cubature de la sphère ou la cubature des coins et des pyramides sphériques que l'on démontre égales à des pyramides rectilignes est encore un morceau de M. de Lagny, neuf, singulier et qui seul prouverait un grand géomètreAuteur : FONTEN. - Source : Lagny.
- Un chacun la desire [une belle femme] ; et vouloir l'empescher, C'est egaler Sisiphe et monter son rocherAuteur : DESPORTES - Source : Diverse amours, XLI, Stances du mariage, 18
- Celle qui est d'un usage plus universel et qui est plus particulière au Bengale, c'est la mousseline unie rayée ou brodéeAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. III, 30
- Hipparque reconnut que les deux intervalles d'un équinoxe à l'autre étaient inégaux entre eux et inégalement partagés par les solstices, de manière qu'il s'écoulait 94 jours et demi de l'équinoxe du printemps au solstice d'été, et 92 jours et demi de ce solstice à l'équinoxe d'automneAuteur : LAPLACE - Source : Expos. v, 2
- Lorsqu'un père de famille aura été condamné aux galères perpétuelles, soit pour avoir donné retraite chez soi à un prédicant, soit pour avoir écouté son sermon dans quelques cavernesAuteur : Voltaire - Source : Pol. et lég. Comm. délits et peines, 27
- Il y a plaisir à travailler pour des personnes.... qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et, par de chatouillantes approbations, vous régaler de votre travailAuteur : Molière - Source : Bourg. gent. I, 1
- Si, d'après l'examen des comptes, une subvention nouvelle était indispensable, ils consentiraient que l'imposition en fût égale sur tous les biensAuteur : MARMONTEL - Source : Mém. XII
- La galère s'éloigne avec son espéranceAuteur : Corneille - Source : Nicom. V, 5
- Le comble de la galerie tumba sur les garsons qui estoient demourés dessous, et les accabla tousAuteur : AMYOT - Source : Cimon, 29
- Dans les festins d'Homère, on tue un boeuf pour régaler ses hôtes, comme on tuerait de nos jours un cochon de lait ; en lisant qu'Abraham servit un veau à trois personnes, qu'Eumée fit rôtir deux chevreaux pour le dîner d'Ulysse, et qu'autant en fit Rébecca pour celui de son mari, on peut juger quels terribles dévoreurs de viande étaient les hommes de ce temps-làAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : dans LAVEAUX
- Tout cela renverse également les idées de l'honneur, celles de la morale et celles de la religionAuteur : Montesquieu - Source : Esp. XXIX, 16
- La cigale ayant chanté Tout l'étéAuteur : Jean de La Fontaine - Source : ib. I, 1
- Galérius semble porter sur son front la marque ou plutôt la flétrissure de ces vices [ambition, débauche]Auteur : Chateaubriand - Source : Mart. IV
- .... qu'on pourrait avoir des galères sur l'Océan, qu'elles y serviraient à remorquer les vaisseaux, qu'enfin elles les rendraient indépendants du vent et par conséquent beaucoup plus agissants que ceux des ennemisAuteur : FONTEN. - Source : Chazelles.
- Il faut, perdant le jour, esprit, sens et vigueur, Mourir comme Enguerrand ou comme Jacques Coeur, Et descendre là-bas où, sans choix de personnes, Les écuelles de bois s'égalent aux couronnesAuteur : RÉGNIER - Source : Sat. XVI
- Puisque la mort, qui égale tout, les domine [les princes] de tous côtés avec tant d'empire, et que, d'une main si prompte et si souveraine, elle renverse les têtes les plus respectéesAuteur : BOSSUET - Source : ib.
- Le génie poétique anglais ressemble jusqu'à présent à un arbre touffu, planté par la nature, jetant au hasard mille rameaux, et croissant inégalement avec forceAuteur : Voltaire - Source : Mél. litt. trag. angl.
- Les politiques ne se mêlent plus de deviner ses desseins [de Louis XIV] ; quand il marche, tout se croit également menacé ; un voyage tranquille devient tout à coup une expédition redoutable à ses ennemisAuteur : BOSSUET - Source : Mar.-Thér.
- Au moment que j'ouvre la bouche pour célébrer la gloire immortelle de Louis de Bourbon, prince de Condé, je me sens également confondu et par la grandeur du sujet et, s'il m'est permis de l'avouer, par l'inutilité du travailAuteur : BOSSUET - Source : Louis de Bourbon.
- Le calcul des probabilités est appuyé sur cette supposition, que toutes les combinaisons différentes d'un même effet sont également possiblesAuteur : D'ALEMB. - Source : Quest. calc. Probab. Oeuv. t. IV, p. 291, dans POUGENS
- Les Corinthiens esquipperent une galereAuteur : AMYOT - Source : Timoléon, 10
- Et vogue la galée, puisque la panse est pleineAuteur : François Rabelais - Source : Garg. I, 3
- Vous pouviez l'assurer de la foi conjugaleAuteur : Jean Racine - Source : Baj. III, 4
Les mots débutant par Gal Les mots débutant par Ga
Une suggestion ou précision pour la définition de Gale ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 03h47

- Gendarme - Generosite - Genie - Génie - Gentillesse - Gentleman - Geographie - Gloire - Golf - Goût - Gout - Gouvernement - Grâce - Grammaire - Grandeur - Grandir - Gratitude - Gratuit - Gravite - Gregaire - Guerre
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur gale
Poèmes gale
Proverbes gale
La définition du mot Gale est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Gale sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Gale présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
