La définition de Hâle du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Hâle
Nature : s. m.
Prononciation : hâ-l'
Etymologie : Voy. .
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de hâle de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec hâle pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Hâle ?
La définition de Hâle
Certaine constitution d'air sec qui dessèche et flétrit.
Toutes les définitions de « hâle »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. de Marine. Tirer à soi avec force à l'aide d'un cordage. Haler une manœuvre. Haler un palan. Haler une bouée à bord. Par extension, il signifie, en termes de Batellerie, Faire avancer un bateau le long d'une rivière, d'un canal, etc., au moyen d'une corde tirée ordinairement à force de bras ou par des chevaux. Haler un bateau. Les bateliers criaient : hale, hale. Se haler dans le vent, ou, elliptiquement, Haler le vent, Se diriger le plus près qu'il est possible vers l'endroit d'où vient le vent. Absolument, Le vent hale de l'avant, Le vent change en prenant la direction de l'avant. Il signifie encore Attacher avec une corde quelque objet embarrassant que l'on veut élever.
Littré
-
Cordage servant à haler,
Journ. offic. 14 avril 1872, p. 2545, 1re col.
Encyclopédie, 1re édition
* HALE, s. m. (Physiq.) qualité de l'atmosphere, dont l'effet est de sécher le linge & les plantes, & de noircir la peau de ceux qui y sont exposés. Le hale est l'effet de trois causes combinées, le vent, la chaleur, & la sécheresse.
* Hale à bord, (Marine.) corde qui approche une chaloupe du vaisseau, quand elle est amarrée à l'arriere.
Hale, (Géog. anc.) ville de Thessalie sur le fleuve Amphryse, & près du mont Othrys, entre Pharsale & Thebes de Phtiotide. Cette ville est écrite Alos dans le dictionnaire de la Martiniere. Philippe s'en empara, la remit aux Pharsaliens, & emmena les habitans esclaves ; elle s'appelloit constamment ????, & les habitans ?????. (D. J.)
Wiktionnaire
Nom commun - français
hale (h aspiré)\al\ masculin ou féminin (l'usage hésite)
- (Marine) Cordage servant à haler.
-
(Pêche) (Vieilli) Corde fixe sur le sable, portant des lignes latérales et garnie d'hameçons.
- Commentaire historique : Ces cordes, appelée « harouelles » ou encore « hales » sont utilisées pour la pêche aux poissons de fond comme la morue sur les bancs de Terre-Neuve, à bord d'un doris, ou les congres à la côte.? (Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France - Bretagne, Côtes-d'Armor-Pléneuf-Val-André, Dahouët, Outil de pêche : harouelles, hale)
- (Marine) Déformation, creusement de la voile due à l'action du vent.
Trésor de la Langue Française informatisé
HÂLE, subst. masc.
HALER1, verbe
HALER2, verbe trans.
Vx, CHASSE. Exciter (un chien) à courir après (un autre chien ou une personne). Haler les chiens après quelqu'un (Ac. 1835, 1878).HÂLER, verbe trans.
Hâle au Scrabble
Le mot hâle vaut 7 points au Scrabble.
Informations sur le mot hale - 4 lettres, 2 voyelles, 2 consonnes, 4 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot hâle au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
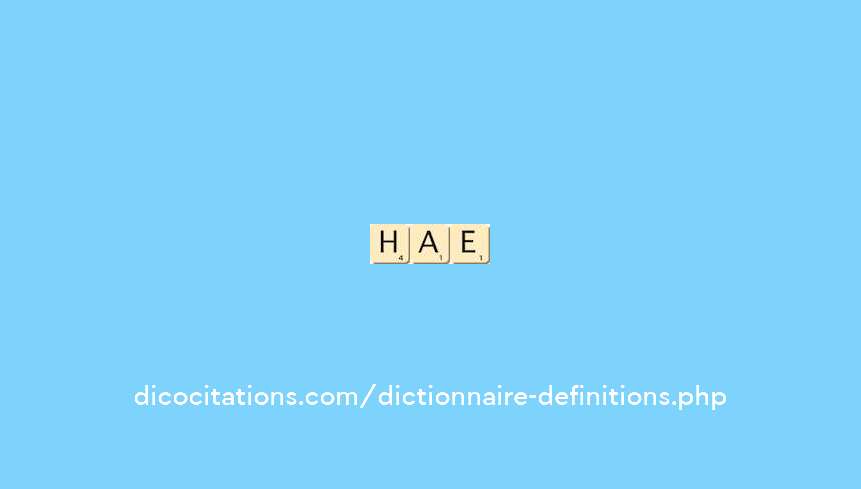
Les mots proches de Hâle
Halage Halbourg Halbran Halbrené, ée Hâle Hâlé, ée Hale-boulines Halecret Haleine Halenée Halener Haler Haler Hâler Haletant, ante Halètement Haleter Halibut Halitueux, euse Hallage Halle Hallebarde Hallebardier Hallebreda Hallier Hallier Hallope Hallucination Hallucinatoire Halo Halte hala halage halages halaient hâlait halait halal hâlant halant Halanzy halcyon hale hâle hâlé hâlé halé hâlée hâlée halée hâlées hâlées haleine Haleine haleines Halen halent haler halèrent hâles hâlés hâlés halés haleta haletaient haletais haletait haletant haletant haletante haletantes haletants halète haleté halètement halètements halètent haleter halètes haleur haleursMots du jour
-
pardonnerez orin pisses pochette-surprise étourdissements prestigieuses placé courbe picole débarquâmes
Les citations avec le mot Hâle
- Il semble que ce soient les habillemens qui eschauffent l'homme, et toutefois ce ne sont ils pas qui l'eschauffent ne qui luy donnent la chaleur.Auteur : Jacques Amyot - Source : Du vice et de la vertu, 1
- Il en arrivait maintenant à une passion exclusive, une de ces passions d'hommes qui n'ont pas eu de jeunesse. Il aimait Nana avec un besoin de la savoir à lui seul, de l'entendre, de la toucher, d'être dans son haleine.Auteur : Emile Zola - Source : Nana (1880)
- Dois-je espérer que mes plaintes feront
Ce que mon amour n'a pu faire?
Contre moi ce serait l'armer:
Exhaler son dépit contre un mari coupable,
C'est, en voulant se faire aimer,
S'efforcer d'être moins aimable.Auteur : Barthélemy Imbert - Source : Le Jaloux sans amour (1781) - O flamme ardente et attirante, qui échauffe, et de nous éloigne toute la froideur du vice, du péché, du propre amour de nous-mêmes. Cette chaleur réchauffe et enflamme le bois sec de notre volonté.Auteur : Sainte Catherine de Sienne - Source : Lettre à un abbé.
- Je rêve qu'un jour, même l'Etat du Mississippi, un Etat où l'injustice et l'oppression créent une chaleur étouffante, sera transformé en une oasis de liberté et de justice.Auteur : Martin Luther King - Source : Au Lincoln Memorial pendant la marche vers Washington pour le travail et la liberté, 28 août 1963
- Brouillard de mai, chaleur de juin, - Amènent la moisson à point.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- La haine, ça donne à l'âme une haleine empoisonnée, c'est comme un marigot de boue verte, de bile cuite, d'humeurs rances et macérées.Auteur : Jacques Roumain - Source : Gouverneurs de la rosée (1944)
- Midi, roi des étés, épandu sur la plaine, - Tombe en nappes d'argent des hauteurs du ciel bleu. - Tout se tait. L'air flamboie et brûle sans haleine. - La terre est assoupie en sa robe de feu.Auteur : Charles Marie René Leconte de Lisle - Source : Poèmes antiques (1852), Midi
- Les fleurs qui vont fleurir vont toutes naître de moi ; le vent qui souffle est mon haleine ; toutes les étoiles sont dans mes yeux.Auteur : Pierre Louÿs - Source : Les Chansons de Bilitis (1894), Hymne à la nuit
- De Sainte-Pharailde la chaleur, - C'est la colère et notre malheur.Auteur : Dictons - Source : 4 janvier
- Forte chaleur en septembre, - A pluie d'octobre, il faut s'attendre.Auteur : Dictons - Source : Dicton
- De grands hêtres s'élevaient presque aussi haut que ces rochers dont l'ombre donnait une fraîcheur délicieuse à trois pas des endroits où la chaleur des rayons du soleil eût rendu impossible de s'arrêter.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : Le Rouge et le Noir (1830)
- Cette vie d'homme qui est si courte pour les plus frivoles entreprises est pour les amitiés humaines une épreuve difficile et de longue haleine.Auteur : Eugène Delacroix - Source : Journal, 22 décembre 1823
- Je me souvins d'un matin où j'avais découvert un cocon dans l'écorce d'un arbre, au moment où le papillon brisait l'enveloppe et se préparait à sortir. J'attendis un long moment, mais il tardait beaucoup, et moi j'étais pressé. Énervé je me penchai et me mis à le réchauffer de mon haleine. Je le réchauffais, impatient, et le miracle commença à se derouler devant moi, à un rythme plus rapide que nature. L'enveloppe s'ouvrit, le papillon sortit en se traînant, et je n'oublierai jamais l'horreur que j'éprouvai alors: ses ailes n'étaient pas encore écloses et de tout son petit corps tremblant il s'efforçait de les déplier. Penché au-dessus de lui, je l'aidais de mon haleine. En vain. Une patiente maturation était nécessaire et le déroulement des ailes devait se faire lentement au soleil, maintenant il était trop tard. Mon souffle avait contraint le papillon à se montrer, tout froissé, avant terme. Il s'agita, désespéré, et, quelques secondes après, mourut dans la paume de ma main. Ce petit cadavre , je crois que c'est le plus grand poids que j'aie sur la conscience. Car, je le comprends bien aujourd'hui, c'est un péché mortel que de forcer les grandes lois. Nous ne devons pas nous presser, ne pas nous impatienter, suivre avec confiance le rythme éternel.Auteur : Níkos Kazantzákis - Source : Alexis Zorba (1946)
- L'express de Lyon, peuplé comme un village, entrait en gare avec des halètements espacés.Auteur : Louis Farigoule, dit Jules Romains - Source : Les Hommes de bonne volonté (1932-1946)
- Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon.
Nous marchions sans parler, dans l'humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. -- Ni le bois, ni la plaine
Ne poussait un soupir dans les airs ; Seulement
La girouette en deuil criait au firmament ;
Car le vent élevé bien au dessus des terres,
N'effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d'en-bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête
A regardé le sable en s'y couchant ; Bientôt,
Lui que jamais ici on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous allions pas à pas en écartant les branches.
Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient,
J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse ;
Mais les enfants du loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi,
Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa louve reposait comme celle de marbre
Qu'adoraient les romains, et dont les flancs velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s'assied, les deux jambes dressées
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante
Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang ;
Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.Auteur : Alfred de Vigny - Source : Poèmes philosophiques (1843), La mort du loup - Le brouillard: haleine de l'aube après une mauvaise nuit.Auteur : Sylvain Tesson - Source : Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008)
- Le son est au vent ce que la flamme est à la chaleur.Auteur : Joseph Joubert - Source : Carnets tome 1
- L'instinct est accordé au devenir, il assure la durée. L'intelligence consciente, le néocéphale humain connaît à la fois trop et trop peu du réel.Auteur : Jean Joseph Hubert Fourastié - Source : Ce que je crois (1981)
- Il ne faut pas montrer une chaleur qui ne sera pas partagée; rien n'est plus froid que ce qui n'est pas communiqué.Auteur : Joseph Joubert - Source : Pensées (1774-1824)
- Ainsi des violettes, sous des buissons épineux, exhalent au loin leurs doux parfums, quoiqu'on ne les voie pas.Auteur : Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre - Source : Paul et Virginie (1787)
- Que vous êtes excessifs en Provence ! Tout est extrême, vos chaleurs, vos sereins, vos bises ... il n'y a rien de doux ni de tempéré.Auteur : Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné - Source : Lettres (1646-1696), 1er novembte 1679
- Je deviens un corps mort, pâle, exsangue et glacé,
Que l'âme son hôtesse en sortant a laissé
Sans esprit, sans chaleur, sans puissance ni force.Auteur : Pierre de Ronsard - Source : Elégies - A l'origine des découvertes, il y a toujours un Eldorado, une route des Indes, une pierre philosophale, une question trop grande, un mythe dont seuls des illuminés osent parler sans sourire.Auteur : Roland Omnès - Source : Dans l'Encyclopaedia Universalis, Conquête de l'espace.
- Dans sa généralité le son se définit: le choc que, par l'intermédiaire des oreilles, l'air communique à l'encéphale et au sang et qui se transmet jusqu'à l'âme.Auteur : Platon - Source : Timée, 67b
Les citations du Littré sur Hâle
- Quand l'astre à son midi, suspendant sa carrière, M'inonde de chaleur, de vie et de lumièreAuteur : LAMART. - Source : Médit. I, 16
- La glace et le feu sont les éléments de la mort ; la chaleur tempérée est le premier germe de la vieAuteur : BUFF. - Source : Quadrup. t. IV, XXIX, dans POUGENS
- Et je meurs ! de sa froide haleine Le vent funeste m'a touché ; Mon printemps commençait à peine, Et mon hiver s'est approchéAuteur : MILLEV. - Source : Chute des feuilles.
- Avec quelle chaleur s'intéressait-il à leurs satisfactions [de ses amis], ou à leurs peines ?Auteur : FLÉCH. - Source : duc de Mont.
- Ce droit d'accusation non-seulement tiendrait les grands en respect, mais servirait encore à exhaler les murmures du peuple qui, sans ce secours, pourraient se tourner en séditionAuteur : VERTOT - Source : Révol. rom. II, 170
- La maréchale de Clérembaut est ici : elle soutient stoïquement sa disgrâce, et ne se fera point ouvrir les veinesAuteur : Madame de Sévigné - Source : 27 déc. 1679
- Embaumé d'une haleine Plus douce que l'oeilletAuteur : RÉGNIER - Source : Dial.
- Pour ce terrain poreux où l'air trouve un passage, Qui pompe sa vapeur et l'exhale en nuageAuteur : DELILLE. - Source : Géorg. II
- S'il est vrai qu'il soit très dangereux de s'endormir en traversant les marais Pontins, l'invincible sommeil qu'ils inspirent dans la chaleur est encore une des impressions perfides que ce lieu fait éprouverAuteur : STAËL - Source : ib.
- Verre volcanique qui ressemble à du verre de bouteille ; il raie le verre, se change en émail gris à la chaleur du chalumeau, et fait feu sous le briquet ; la couleur en est verte foncée et noire ; on l'emploie en parures de deuil, comme le jais, auquel il est supérieur en dureté, en ténacité, en poliAuteur : DE LABORDE - Source : Émaux, p. 407
- Un vent aigre et violent coupe leur respiration ; il s'en empare au moment où ils l'exhalent et en forme des glaçons qui pendent par leur barbe autour de leur boucheAuteur : SÉGUR - Source : ib. IX, 11
- Quelquefois seulement, quand mon âme oppressée Sent en rhythmes nombreux déborder ma pensée, Au souffle inspirateur du soir, dans les déserts, Ma lyre abandonnée exhale encor des versAuteur : LAMART. - Source : ib. I, 20
- J'ai critiqué la composition de l'ouvrage et l'odeur un peu rancie qu'il exhaleAuteur : L. RATISBONNE - Source : J. Débats, 14 févr. 1867
- Cilz jours estoit un mondain paradis ; Car maint firent des arbres chalemeaulx [chalumeaux] Et flojolez, dont floustoient toudis [toujours]Auteur : EUST. DESCH. - Source : Poésies mss. f° 75, dans LACURNE
- La maréchale de Rochefort, qui croyait honorer fort sa place de dame d'honneur de Mme la duchesse d'Orléans, la désolait de plaintes et de reproches ; et, puisque je voyais la chose devenir un faire le faut....Auteur : SAINT-SIMON - Source : 273, 196
- Pourquoy ne pourra estre affoiblie la chaleur de mes reins, si qu'ils ne puissent plus petrifier mon flegme [former des calculs] ?Auteur : MONT. - Source : IV, 273
- Pourquoi ces sels se coagulent-ils dans un air que la chaleur dilate ?Auteur : Voltaire - Source : Feu, III, 1
- Quand les sauniers ont mis l'eau de la mer en leurs parquetages, pour la faire congeler à la chaleur du soleil et du ventAuteur : PALISSY - Source : 163
- Le gentilhomme françois qui suit les bandes, desdaigne la halebarde, c'est-à-dire, faire l'estat de sergent, encore moins d'estre appelé capporal, alleguant que sont charges mecaniques [à cause du service de police et d'exécution des arrêts]Auteur : CARLOIX - Source : IV, 13
- ....Courant tout d'une halenéeAuteur : DESPÉR. - Source : Contes, LXV
- Ils partent : des zéphyrs l'haleine printanière Souffle, et vient se jouer dans leur riche bannièreAuteur : DELILLE - Source : Pit. IV
- Pour le bon d'Hacqueville, il a eu le paquet d'aller, à trente lieues d'ici, annoncer cette nouvelle à la maréchale de Grammont [la mort de son fils]Auteur : Madame de Sévigné - Source : 8 déc. 1673
- Cette chaleur ou se communique aux auditeurs, ou du moins les préserve d'une langueur involontaire qui aurait pu les gagnerAuteur : FONTEN. - Source : Du Verney.
- Une chaleur ou complexion chaleureuseAuteur : MONT. - Source : II, 289
- Comme il disait ces mots, arrive frère Coutu en hâte, tout courant, tout essoufflé, tout suant, tout haletantAuteur : Voltaire - Source : Facéties, Rel. appar. Bertier.
Les mots débutant par Hal Les mots débutant par Ha
Une suggestion ou précision pour la définition de Hâle ? -
Mise à jour le dimanche 8 février 2026 à 00h43
H
- Habit - Habitat - Habitude - Haine - Haïr - Hair - Hasard - Hate - Hebergement - Heresie - Heritage - Heroisme - Heros - Heure - Heure - Heureux - Hierarchie - Histoire - Homme - Homme femme - Homme heureux - Homosexualite - Honnête - Honnêteté - Honnêteté - Honneur - Honte - Horizon - Hote - Hotel - Humain - Humanisme - Humanite - Humeur - Humiliation - Humilité - Humilite - Humoristique - Humour - Hypocrisie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur hâle
Poèmes hâle
Proverbes hâle
La définition du mot Hâle est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Hâle sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Hâle présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
