La définition de Coque du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Coque
Nature : s. f.
Prononciation : ko-k'
Etymologie : Anc. espagn. coca ; du latin concha, coquille (voy. ).
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de coque de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec coque pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Coque ?
La définition de Coque
Enveloppe extérieure de l'oeuf. Les perdreaux courent au sortir de la coque.
Toutes les définitions de « coque »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Enveloppe extérieure de l'œuf. Le poussin becquetait déjà la coque. Les poulets, les perdreaux courent au sortir de la coque. Œuf à la coque, Œuf légèrement cuit dans sa coque. Fig. et fam., Ne faire que sortir de la coque, Être encore très jeune. Il ne fait que sortir de la coque, et il ose déjà se permettre de parler sur ces choses-là. Il se dit pareillement de l'Enveloppe où se renferment le ver à soie et autres larves d'insectes qui filent. Ce ver à soie commence à faire sa coque. Par analogie, en termes de Mode, Coque de rubans, coque de cheveux, Rubans ou cheveux disposés en forme de coque. Il se dit également, en termes de Botanique de l'Enveloppe ligneuse de certains fruits où de certaines semences. Coque de noix. Coque du Levant, Fruit d'un arbuste de Malabar et des Moluques, d'un brun noirâtre et de la grosseur d'un pois, qui a la propriété d'enivrer les poissons, de manière qu'on peut les pêcher à la main. Coques de perles, ou simplement Coques, Demi-perles qu'on réunit ordinairement deux à deux, de manière qu'elles imitent des perles entières.
COQUE se dit aussi d'une Sorte de coquillage très commun et comestible. En termes de Marine, La coque d'un navire, Le corps d'un navire, abstraction faite du gréement et de la mâture.
Encyclopédie, 1re édition
COQUE, s. f. (Hist. nat. des ins.) pelote de fil & de glu, sous laquelle les vers à soie & certaines chenilles se renferment lorsqu'elles deviennent nymphes. Mais nous prenons ici le mot de coque, avec les Naturalistes, dans un sens plus étendu, pour désigner toute enveloppe ou nid de différente texture & figure, formé par les insectes à divers usages.
Ces petits animaux, après s'être choisis un endroit commode pour se garantir de tout accident, munissent ce lieu par toutes sortes de retranchemens également diversifiés & appropriés à leur nature. Les uns, soit à cause de la délicatesse de leur enveloppe, soit pour transpirer plus lentement, pour se développer dans leur juste saison, soit pour prendre la forme d'insecte parfait, se font des coques très-épaisses, & souvent impénétrables à l'eau & à l'air.
D'autres se filent des coques de soie, & d'autres font sortir dans ce dessein des pores de leurs corps, une espece de coton pour les couvrir. Tel est l'insecte du Kermès. Plusieurs fortifient leurs coques en y faisant entrer leurs poils, dont ils se dépouillent ; & ceux qui n'en ont point & qui manquent de soie, rongent le bois & employent les petits fils qu'ils en ont détaché, à affermir l'intérieur & l'extérieur de leur enveloppe. Ils humectent ces fils avec une espece de gomme qui sort de leur corps, & qui est très-propre à durcir leur travail. Si l'on prend une de ces coques séchée, & qu'on la fasse ensuite bouillir dans de l'eau, on la trouvera plus légere qu'elle n'étoit avant cette opération ; elle a donc perdu sa gomme dans l'eau bouillante.
Il y a quelques insectes qui se font deux & même trois coques les unes dans les autres, filées toutes avec un art remarquable par le même animal, & non par différens ichneumons : la chose arrive quelquefois, lorsqu'un ichneumon, après avoir causé la mort à un insecte qui avoit déjà filé sa coque, & après avoir ensuite filé la sienne, a été détruit à son tour par un second ichneumon qu'il renfermoit dans ses entrailles. Il est aisé de s'appercevoir du fait, parce qu'en ce cas les dépouilles de chaque animal consumé, se trouvent entre la coque qu'il s'est filée & celle de celui qu'il a détruit. Voyez Ichneumon.
Les coques ne sont pas moins différenciées par leur figure. La plûpart sont ovales, ou sphéroïdes ; d'autres de figure conique, cylindrique, angulaire, &c. Il y a des coques en bateau, d'autres en forme de navette, & d'autres en larme de verre, dont le corps seroit fort renflé, & la pointe recourbée. Un curieux naturaliste, M. Lionnet dit qu'il en connoît même qui sont composées de deux plans ovales convexes, collées l'une à l'opposite de l'autre sur un plan qui leur est perpendiculaire, qui est partout d'égale largeur, & qui suit la courbure de leur contour ; ce qui donne à ces coques une forme approchante de nos tabatieres ovales applaties par les côtés.
On feroit un volume, si l'on vouloit entrer dans le détail sur la diversité de figure des coques des insectes, sur les matériaux dont ils les forment, sur l'art & l'industrie qui y est employé ; tout en est admirable. Mais il faut ici renvoyer le lecteur aux ouvrages de Malpighi, de Leeuwenhoëk, de Swammerdam, de M. de Reaumur, & de M. Frisch ; je me borne à dire en peu de mots d'après l'ingénieux M. Lionnet, le but de la fabrique de ces nids.
Le premier usage pour lequel les insectes se construisent des coques, & qui est même le plus fréquent, c'est pour y subir leur transformation. L'insecte s'y renferme, & n'y laisse presque jamais d'ouverture apparente : c'est-là qu'il se change en nymphe ou en chrysalide. Ces coques paroissent servir principalement à trois fins. La premiere est de fournir par leur concavité intérieure à la chrysalide ou à la nymphe, dès qu'elle paroît, & lorsque son enveloppe est encore tendre, un appui commode, & de lui faire prendre l'attitude un peu recourbée en avant, qu'il lui faut pour que ses membres (sur-tout ses ailes) occupent la place où ils doivent demeurer fixés jusqu'à ce que l'insecte se dégage de son enveloppe : elles servent en second lieu à garantir l'animal dans cet état de foiblesse, des injures de l'air, & de la poursuite de ses ennemis ; enfin elles empêchent que ces chrysalides ou ces nymphes ne se dessechent par une trop forte évaporation. Les coques qui n'ont presque aucune consistance, n'ont probablement que la premiere de ces fins pour objet ; celles qui sont plus fermes, sans être pourtant impénétrables à l'air & à l'eau, paroissent aussi servir pour la seconde ; & les autres semblent être destinées à satisfaire à ces trois fins différentes, selon les différens besoins que les insectes paroissent en avoir.
Le second usage des coques des insectes est lorsqu'ils en bâtissent pour y demeurer dans le tems qu'ils sont encore insectes rampans, qu'ils mangent, & qu'ils croissent. Ces coques sont alors ordinairement des étuis ouverts par les deux bouts. L'insecte y loge, il les aggrandit à mesure qu'il croît, ou bien il s'en fait de nouvelles. Ce ne sont pas celles que les insectes font en roulant des feuilles qui sont les plus dignes de notre admiration. M. de Reaumur, qui a donné lui-même un mémoire très-curieux sur ce sujet, convient dans un autre que les fourreaux que se font les teignes aquatiques & terrestres, de différens genres & de différentes especes, l'emportent sur les coques des chenilles. Ce sont en effet des chefs-d'?uvre, où l'art & l'arrangement paroissent avec bien plus d'éclat.
Le troisieme usage des coques ou des nids que se font les insectes, est pour servir d'enveloppe à leur couvée. Mais il faut convenir que cet usage est extrèmement rare, & les araignées nous en fournissent presque le seul exemple : je ne dis pas le seul exemple qui existe, ce qui seroit du dernier ridicule. Plus on étudie l'Histoire naturelle, plus les exemples qu'on croyoit rares ou uniques se multiplient ; les exceptions deviennent enfin des regles générales. Art. de M. le Chevalier de Jaucourt.
* Coque, s. f. (Marine & Corderie.) faux pli ou boucle qui se fait à une corde qui a été trop tordue en la fabriquant. Une corde sujette à faire des coques est d'un mauvais service, soit par le retard que ce défaut apporte aux man?uvres courantes, lorsque les coques se présentent pour passer dans les mouffles, soit par la fraction même des mouffles, si on ne s'est pas apperçu à tems qu'une coque se présentoit.
Coque, (Jardinage.) est une enveloppe forte & dure, particuliere à certains fruits, tels que la noix & autres. (K)
* Coques & Vanons, (Pêche.) sorte de coquillage qui renferme un poisson.
Voici la maniere d'en faire la pêche ou récolte, telle qu'elle se pratique à Rincheville dans le ressort de l'amirauté de Carentan & à Issigni, &c.
Pour prendre des coques, les pêcheurs attendent que la marée soit presqu'au plus bas de l'eau ; ce coquillage se tient à la superficie des sables, dont il ne reste couvert que de l'épaisseur d'un écu au plus. On connoît qu'il y a des coques sur les fonds où l'on est, par les petits trous qu'on remarque au sable, & que les coques font avec la partie que l'on nomme leur langue, qu'elles baissent sur le sable pour paître. On connoît encore qu'il y a des coques, en roulant sur le sable quelque chose de lourd qui fait craquer les coquillages qui sont au-dessous ; alors les pêcheurs foulent, piétinent le sable encore mouillé de la marée, l'émeuvent, & les coques viennent alors d'elles-mêmes au-dessus du sable, où l'on les ramasse avec une espece de rateau de bois ; on les désable aussi quelquefois avec une petite faucille ou autre semblable instrument de fer.
Les pêcheurs riverains qui font cette pêche, la commencent vers la fin de Février & la continuent jusqu'à la S. Jean ; elle ne se pratique aisément que de jour, à cause de la difficulté de connoître les trous que les coques font au sable : lorsque le tems est tempéré, les coques tirées hors de l'eau peuvent vivre jusqu'à sept à huit jours ; en été elles ne durent pas seulement trois jours, encore faut-il qu'elles soient mises dans un lieu frais.
France Terme
Emballage thermoformé assurant la présentation et la protection d'un produit.
Wiktionnaire
Nom commun - ancien français
coque \Prononciation ?\ féminin
-
Coque de navire.
- Exemple d'utilisation manquant. (Ajouter)
- Salicoque.
Nom commun 2 - français
coque \k?k\ féminin
- Petite boule réalisée à partir des feuilles du pastel (Isatis tinctoria) dont on extrait une teinture de couleur bleue.
- Du commerce des « coques » de pastel est née l'appellation de « Pays de Cocagne ». Ces coques transitaient dans les ports français de Bordeaux, Marseille et Bayonne. ? (Bibliothèque nationale de France, Le bleu de pastel : note technique, par Karine Garcia et Andrée Rigaux, BnF, Atelier du département des Estampes et de la Photographie, 2008)
- (Pâtisserie) Dans le sud-ouest de la France, sorte de brioche traditionnelle pour l'Épiphanie.
Nom commun 1 - français
coque \k?k\ féminin
-
Enveloppe extérieure de l'?uf.
- Les perdreaux courent au sortir de la coque.
- Le poussin becquetait déjà la coque.
-
(Figuré) Symbole de la naissance.
- Ce couplet sortait de sa coque [venait d'être fait] le jour que je partis de Paris. ? (Marquise de Sévigné, 426)
-
Ensemble lentement tous [des poèmes] couvés sous mes ailes,
Tous ensemble quittant leurs coques maternelles,
Sauront d'un beau plumage ensemble se couvrir,
Ensemble sous le bois voltiger et courir. ? (André Chénier, Épitres, chapitre II, 1819)
-
(Entomologie, Soierie) Cocon où se renferment le ver à soie et autres chrysalides d'insectes qui filent.
- Ce ver à soie commence à faire sa coque.
-
(Zoologie) (Cuisine) Nom donné à diverses espèces de coquillages (en particulier, en France, la coque commune, ou coque comestible).
- Pour les fruits de mer, c'étaient les moules, les coques et les « sauterelles » ou crevettes grises. ? (Jean-François Leblond & Yvan Brohard, Vie et traditions populaires en Picardie: Oise, Somme, Aisne, Éditions Horvath, 1994, page 103)
-
(Par extension) Enveloppe protectrice.
- Le carburateur est enveloppé d'une coque protectrice.
-
(Marine) Enveloppe des bordages, corps du bateau, abstraction faite du gréement et de la mâture.
- Lorsque le cuivre fut ôté, la coque fut complétement recalfatée à neuf, [?]. ? (Alain Gerbault, À la poursuite du soleil; tome 1 : De New-York à Tahiti, 1929)
- Elle était demeurée longtemps debout devant ces hautes coques dont les hublots laissaient voir l'intérieur des cabines éclairées. ? (Francis Carco, Brumes, Éditions Albin Michel, Paris, 1935, page 52)
- Le vice-amiral français à la retraite Jean-Louis Vichot a expliqué à l'AFP que la coque en acier d'un submersible pouvait se briser "comme un accordéon qui se plie" si elle atteignait des profondeurs bien au-delà de ses limites. ? (AFP, L'Indonésie a retrouvé le sous-marin disparu et les 53 membres d'équipage morts, Le Journal de Montréal, 25 avril 2021)
- (Serrurerie) Petites pièces de fer qui servent à conduire le pêne d'une serrure. Crampon sur la platine d'un verrou à ressort ou d'un loqueteau.
-
(Botanique) Enveloppe ligneuse de certains fruits.
- Coque de noix, d'amande.
- ?ufs de poisson de mer que l'on emploie pour amorcer les filets avec lesquels on pêche les sardines.
- (Botanique) (Par ellipse) Coque du Levant, drupe dont la déhiscence a lieu avec élasticité, à cause d'un ressort membraneux situé à sa base.
- Faux pli qui se fait à une corde trop forte et qu'on n'a pas pris soin de détordre.
-
(Vieilli) (Habillement) Arrangement de rubans ou de cheveux disposés en forme de coque.
- Une large figure de femme, coiffée de coques grisonnantes, et des bras s'agitaient, et tout cela disait : « [?] ». ? (Alphonse de Châteaubriant, Monsieur des Lourdines, chap. 1, 1910)
- [?] elles quittaient la livrée conventuelle, revêtaient les robes de gala, les ballons et les coques, les vertugadins et les fraises à la mode dans ce temps-là, et elles se rendaient au salon où affluaient les visites. ? (Joris-Karl Huysmans, La Cathédrale, Plon-Nourrit, 1915)
- Quand je serai mariée, j'habiterai une maison rose, dont les tapisseries seront pittoresques et les meubles pimpants. Aux rideaux, je nouerai des rubans clairs avec de larges coques. ? (Germaine Acremant, Ces dames aux chapeaux verts, 1922, collection Le Livre de Poche, page 53)
- Fernande en blouse blanche et jupe claire, coiffée d'un de ces énormes chapeaux à coques de ruban qu'elle affectionnait, se promenant, un livre à la main, dans quelque sombre forêt germanique, et, de toute évidence, lisant à haute voix des vers. ? (Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux, 1974, collection Folio, page 357)
- Georgette avait le visage rond comme le mien, des joues roses bien marquées, en forme de petites pommes luisantes, des cheveux foncés, nattés et noués d'un ruban jaune dont les coques ressemblaient aux ailes d'un grand papillon. ? (Édouard Bled, J'avais un an en 1900, 1987, Le Livre de Poche, page 202)
- (Commerce) Emballage thermoformé assurant la présentation et la protection d'un produit.
Nom commun 2 - ancien français
coce \Prononciation ?\ féminin
- Variante de coquesse.
Trésor de la Langue Française informatisé
COQUE, subst. fém.
Coque au Scrabble
Le mot coque vaut 14 points au Scrabble.
Informations sur le mot coque - 5 lettres, 3 voyelles, 2 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot coque au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
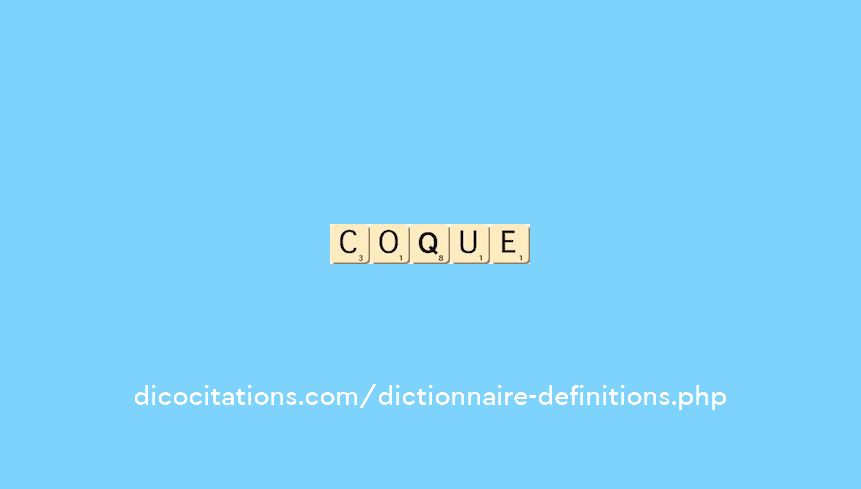
Les mots proches de Coque
Coq Coq-à-l'âne Coquard Coque Coquecigrue Coquefredouille Coquelicot Coqueliner Coquelineux, euse Coquelourde Coqueluche Coqueluchonné, ée Coquemar Coqueplumet Coquerelle Coqueret Coquerie Coqueron Coquet, ette Coquet Coqueter Coquetier Coquettement Coquetterie Coquettisme Coquillage Coquille Coquillé, ée Coquiller Coquilleux, euse Coquin, ine Coquiner Coquinerie Coquinet coq coq-à-l'âne coqs Coquainvilliers coquard coquards coquart coquarts coque coquebin coquebin coquelet coquelicot coquelicots coquelle Coquelles coqueluche coqueluches coquemar coquerelle coquerie coqueron coques coquet coquetel coqueter coquetier coquetiers coquets coquette coquette coquettement coquetterie coquetteries coquettes coquettes coquillage coquillages coquillard coquillards coquillart coquille Coquille coquilles coquillettes coquilleux coquin coquin coquine coquineMots du jour
Scolasticisme Trémoussoir Assa Orpiment Brimbalant, ante Islamisme Crible Respectivement Désirable Impassable
Les citations avec le mot Coque
- On craint toujours de voir ce qu'on aime, quand on vient de faire des coquetteries ailleurs.Auteur : François de La Rochefoucauld - Source : Réflexions ou Sentences et Maximes morales (1664)
- Et dans les champs les coquelicots se fanent en se violaçant
Et en répandant une odeur opiacée.Auteur : Guillaume Apollinaire - Source : Ombre de mon amour (1947), LV - La coquetterie, sans amour, est la maladie des femmes d'esprit, qui ont un amour-propre excessif avec peu de sensibilité.Auteur : André Ernest Modeste Grétry - Source : Mémoires ou essais sur la musique (1797)
- Coquet dans son vêtement, facile dans ses moeurs.Auteur : Proverbes danois - Source : Proverbe
- La coquetterie la plus maîtresse de ses ressources, la flatterie la plus accomplie, ne sont pas aussi ingénieuses qu'un coeur aimant; comme il n'a qu'une pensée, il n'a aucune distraction; l'esprit parfois sommeille, l'amour jamais.Auteur : Henri-Frédéric Amiel - Source : Grains de mil (1854)
- L'amour serait une suite de joies sans mélange des sens, de l'esprit et du coeur. C'est faux. Deux êtres humains amarrés l'un près de l'autre sont comme deux vaisseaux secoués par les vagues; les coques se heurtent et gémissent.Auteur : André Maurois - Source : Sans référence
- Quand nous nous serons prouvé l'un à l'autre que je suis une coquette et vous un libertin, uniquement parce qu'il est minuit et que nous sommes en tête à tête, voilà un beau fait d'armes que nous aurons à écrire dans nos Mémoires!Auteur : Alfred de Musset - Source : Un caprice (1837), 8
- Je fus coquette, séduisante, comme auprès d'un homme, caressante et perfide. J'affolai cet enfant.Auteur : Guy de Maupassant - Source : Clair de Lune (1883)
- La coquetterie qui veut inspirer des sentiments qu'elle n'éprouve pas est un vice affreux et détestable; mais vouloir plaire innocemment, c'est une manière d'aimer son prochain.Auteur : Ernest Legouvé - Source : Histoire morale des femmes (1848)
- Le regard est la grande arme de la coquetterie vertueuse. On peut tout dire avec un regard, et cependant on peut toujours nier un regard.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : De l'amour (1822)
- Chez une jolie femme, la coquetterie est de la conscience. Auteur : Honoré de Balzac - Source : Pensées, Sujets, Fragments (1910)
- Une femme qui n'a qu'un amant croit n'être point coquette; celle qui a plusieurs amants croit n'être que coquette.Auteur : Jean de La Bruyère - Source : Les Caractères (1696)
- Il y avait sous mes fenêtres un grand voilier de Norvège aux mâts blancs, à la coque de chêne peinte en bleu, qui débarquait paisiblement des bois du Nord.Auteur : Henri Bosco - Source : Un rameau de la nuit (1950)
- Pour atténuer cette vanité inopportune il ajouta : — La coquetterie est un défaut nécessaire.Auteur : Madeleine Ferron - Source : Le Baron écarlate (1971)
- Eh! mon enfant, la bonté est le seul charme qui soit permis aux vieillards; c'est la coquetterie des cheveux blancs.Auteur : Octave Feuillet - Source : Rédemption (1860)
- Coquette qui querelle est sur le point d'aimer.Auteur : Claude Henri de Fuzée, abbé de Voisenon - Source : La Coquette fixée (1746)
- Chez moi, la coquetterie, la séduction, c’est de naissance. À peine ai-je réussi à me tenir debout que je m’accrochais déjà au premier pantalon venu, le plus souvent c’était celui du facteur, et j’ondulais du derrière, un gros derrière plein de couches. Sans compter que j’exigeais de changer de robe trois fois par jour. Auteur : Claude Sarraute - Source : Encore un instant (2017)
- Car enfin, tu as beau dire, une certaine coquetterie maligne et railleuse désoriente encore plus les soupirants que le silence ou le mépris.Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Julie, ou la Nouvelle Héloïse (1761)
- Sans la première coquetterie, qui fait naître une première espérance, l'amour ne s'éveille guère chez la plupart des hommes.Auteur : André Maurois - Source : Lettres à l'Inconnue (1956)
- On ne sait jamais ces choses-là. Tenez même le coq... Il chante! Oui, mais aussi il coquerique...Auteur : Claude Mauriac - Source : Le Dialogue intérieur, Le Dîner en ville (1959)
- Je ne m'attife pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet; ...Auteur : Edmond Rostand - Source : Cyrano de Bergerac (1897), I, 4, Cyrano
- C'est d'ailleurs l'un des pièges de la coquetterie: soigner ses cheveux, c'est se préoccuper de l'aspect que l'on a de dos.Auteur : Michel Tournier - Source : Petites proses
- Une des conséquences positives de l'amour est la coquetterie. Tous les efforts qu'on fait pour attirer l'attention de l'autre nous améliorent.Auteur : Charles Dantzig - Source : Encyclopédie capricieuse du tout et du rien (2009)
- La coquetterie tue la gourmandise.Auteur : Honoré de Balzac - Source : La Comédie humaine (1842-1852)
- Sans la vanité, sans la coquetterie, sans la curiosité, sans la chute en un mot, la femme n'est pas la femme. Il y a dans sa grâce beaucoup de sa faiblesse.Auteur : Victor Hugo - Source : Post-Scriptum de ma vie (1901)
Les citations du Littré sur Coque
- Un certain homme avait trois filles, Toutes trois de contraire humeur : Une buveuse, une coquette, La troisième, avare parfaiteAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fab. II, 20
- Contrefaisant la coquelourde Soubz un malicieux abitAuteur : CH. D'ORL. - Source : Rondel. 29
- Il me semble raisonnable que meshui je m'appile et me recueille en ma coque, comme les tortuesAuteur : MONT. - Source : IV, 117
- Je suis un peu coquet, tu n'es pas mal coquette.... Nous chassons tous de race et le mal n'est pas grandAuteur : REGNARD - Source : le Distr. III, 3
- Je suis un peu coquet, tu n'es pas mal coquette : Notre mère l'était, dit-on, en son vivant ; Nous chassons tous de race, et le mal n'est pas grandAuteur : REGNARD - Source : le Distr. IV, 3
- Suborner par discours une femme coquetteAuteur : RÉGNIER - Source : Sat. III
- La coquetterie est le fond et l'humeur des femmes ; mais toutes ne la mettent pas en pratique, parce que la coquetterie de quelques-unes est retenue par la crainte ou par la raisonAuteur : LAROCHEF. - Source : ib. 241
- Quant [je] suis sans verre et breuvage, C'est sans coque un limaçonAuteur : BASSEL. - Source : LVI
- Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines, Dont par toute la ville on chante les fredainesAuteur : Molière - Source : Éc. des f. III, 2
- Un nègre qui.... ramassa par terre un de ses cocos, et se mit à faire un lampion avec sa coque, une mèche avec son caireAuteur : BERNARDIN DE ST-PIERRE - Source : le Café de Surate
- C'est un oeuf de serpent qui, s'il était couvé, Serait aussi méchant que tous ceux de sa race ; Il le faut, dans sa coque, écraser sans pitiéAuteur : Voltaire - Source : Jules César (trad. de Shakspeare), II, 1
- Parvenu à son parfait accroissement, le fourmi-lion quitte le métier de chasseur qui lui est devenu inutile ; il ne tend plus de piége, et, après s'être promené quelque temps près de la surface de la terre, il s'y construit une petite coque de forme sphérique, qu'il revêt intérieurement d'une tapisserie de satin du plus beau gris de perle où il se transforme dans une de ces mouches qu'on a nommées demoisellesAuteur : BONNET - Source : ib.
- Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences que le dissolu ; celui-ci cache son commerce et ses liaisons, et l'on ne sait souvent par où aller jusqu'à luiAuteur : LA BRUY. - Source : XIV
- Belle Rochebonne, grondez-le pour moi [Mme de Grignan] ; j'aimerais mieux qu'elle coquetât avec M. de Vardes, comme vous me le mandez, que de profaner une santé qui fait notre vie à tousAuteur : Madame de Sévigné - Source : 20 oct. 1677
- Un moineau fort coquet Et le plus amoureux de toute la province Faisait aussi sa part des délices du princeAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. X, 12
- Les vers à soie se font de leur coque une espèce de tombeauAuteur : FÉN. - Source : Exist. 19
- Adonc regnoit par toutes les parties du royaume une maladie generale qui se tenoit en la teste, de la quelle moururent plusieurs personnes, tant vieux que jeunes, et se nommoit icelle la coquelucheAuteur : MONSTRELET - Source : ch. 118
- Le public dédaigneux hait ce vain artifice ; Il siffle la coquette, il applaudit l'actriceAuteur : DORAT - Source : la Déclamation, ch. I
- La coquette tendit ses lacs tous les matins ; Et, mettant la céruse et le plâtre en usage, Composa de sa main les fleurs de son visageAuteur : BOILEAU - Source : Épît. IX.
- Il y eut entre Madame et le roi [Louis XIV] beaucoup de ces coquetteries d'espritAuteur : Voltaire - Source : Louis XIV, 25
- C'est la spéculation privée, et non l'État, qui doit pourvoir aux nécessités culinaires des bâtiments de commerce, dans des coqueries ou cookery-houses, comme on voit sur les quais de nos ports de commerce de France et d'AngleterreAuteur : BOUËT-WILLAUMEZ - Source : Rapport au Sénat, séance du 3 janv. 1868
- .... Il a épousé une jeune nymphe de quinze ans, fille de M. et de Mme de la Bazinière, façonnière et coquette en perfectionAuteur : Madame de Sévigné - Source : à Mme de Grignan, 28 oct. 1671
- La plate turlupinade sur la création qu'on avait mise sous son nom [de M. de Boufflers].... est d'un M. Coqueley de ChaussepierreAuteur : LAHARPE - Source : Corresp. t. IV, p. 64
- Fi des coquettes maniérées ! Fi des bégueules du grand ton !Auteur : BÉRANG. - Source : Jeannette.
- Arbre à enivrer, la coque du Levant, quelques phyllanthusAuteur : BAILLON - Source : Dict. de bot. p. 247
Les mots débutant par Coq Les mots débutant par Co
Une suggestion ou précision pour la définition de Coque ? -
Mise à jour le lundi 9 février 2026 à 04h20
Dictionnaire des citations en C +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur coque
Poèmes coque
Proverbes coque
La définition du mot Coque est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Coque sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Coque présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
