La définition de B du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
B
Nature : s. m.
Prononciation : bé
Etymologie : Le b latin, grec bêta, du phénicien ou hébreu beth.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de b de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec b pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de B ?
La définition de B
Seconde lettre de l'alphabet. Un B majuscule ; un petit B.
Toutes les définitions de « b »
Trésor de la Langue Française informatisé
B, subst. masc.
B au Scrabble
Le mot b vaut 3 points au Scrabble.
Informations sur le mot b - 1 lettres, 0 voyelles, 1 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot b au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
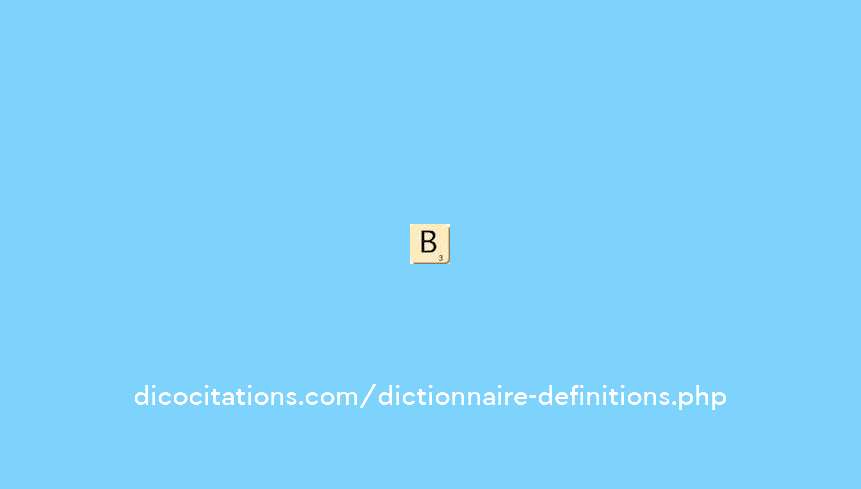
Les mots proches de B
B Baal Bab Babélique Baberi Babiche ou babichon Babil Babillard, arde Babiller Babillerie Babine ou babouine Babiole Bablah Bâbord Bâbordais Babouche Babouin Baby Baby Babysme Bac Bacchanal Bacchanale Bacchante Bacchus Bacha Bachelette Bachelier Bâcheur Bachique Bachlick ou bachelick Bâcler Bacologique Bactérique Badamier Badaud, aude Badaudage Badauderie Badelaire Badiane Badin, ine Badinage Badinement Badiner Badinerie Bafoué, ée Bafouer Bâfrée Bâfrer Bagage b B?rsch B?senbiesen B?urs-en-Othe Baaigem Baal Baâlon Baâlons Baardegem Baarle-Hertog Baasrode Bab?uf baba baba baballe babas babasse Babeau-Bouldoux babel babélienne babeurre babi babil babillage babillages babillaient babillait babillant babillard babillard babillarde babille babillé babillent babiller babilles babils babine babines babiole babioles babiroussa bâbord babouche babouches babouchka babouchkas babouin babouine babouinesMots du jour
-
réinventant revendicateur subtils rosissant affectassent cantonneraient chétives restaurant philosophant remix
Les citations avec le mot B
- La langue parle à son aise,
Mais il en cuit au cou.Auteur : Proverbes espagnols - Source : Proverbe - Monsieur,
Je sais ce que vous allez dire: un retard ça va, trois retards bonjour les dégâts.
Désolé donc pour Yohan, merci de votre compréhension, un peu d'humour ça ne fait de mal à personne.Auteur : Patrice Romain - Source : Mots d'excuse - Les parents écrivent aux enseignants (2010), Les retards - Les animaux de boucherie sont généralement tués par procuration avant d'être mangés par des hypocrites qui s'évanouiraient à la vue du sang.Auteur : Tomi Ungerer - Source : Nos années de boucherie
- Rire et être bien aise, sont deux.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- La poésie est ici une vertu, plus qu'ailleurs, informulée, exclusive et générale à la nation ; les poètes seront en fait des devins. Nous explorons les gouffres légers de l’enfance, décelant comme la chouette des Écritures les ordres sacrés aujourd’hui pareils à des débris fanés.Auteur : Maurice Chappaz - Source : Testament du Haut-Rhône (2003)
- Et notre monde d'abondance est si pauvre que toute créature vivante y attache le plus grand prix à la nourriture, lutte pour elle et, encore aveugle, cherche les mamelles de sa mère.Auteur : Guéorgui Vladimov - Source : Fidèle Rouslan : Histoire d' un chien de garde (1978)
- PS : Ne laissez pas les chats vous convaincre que les bonnets péruviens vous vont bien.Auteur : Gilles Legardinier - Source : Demain j'arrête ! (2011)
- Nous saurons tout de même bien ce qu'ils ont dans leur sac. Aussi marioles qu'ils se croient, ils parlent trop: c'est des grandes gueules.Auteur : François Carcopino-Tusoli, dit Francis Carco - Source : Les Belles Manières
- Le lien qui t'unit à ta vraie famille n'est pas le lien du sang, mais celui du respect et de la joie, dans la vie de chacun de ses membres. Il est rare que les membres d'une même famille grandissent sous le même toit.Auteur : Richard Bach - Source : Le Messie récalcitrant
- On quitte un homme on croit l'oublier, jusqu'à ce qu'un souvenir nous rappelle à lui alors comment imaginer se défaire de l'amour que nous portons à nos parents.Auteur : Marc Lévy - Source : Vous revoir (2005)
- Je préfère viser l'intelligence du public que sa bêtise, parce que la bêtise est si vaste que je ne sais où frapper.Auteur : Tristan Bernard - Source : Sans référence
- Il y a des sottises bien habillées, comme il y a des sots très bien vêtus.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Maximes et Pensées, Caractères et Anecdotes (1795)
- Et pour une raison qui a échappé à tous : la haine, comme l'amour, se nourrit de paroles. Elle a besoin de mots, c'est sa faille, il faut qu'elle se raconte, nul ne peut se soustraire à cette loi, pas même les êtres les plus dissimulés. Auteur : Irène Frain - Source : La forêt des 29 (2011)
- Parmi toutes les organisations internationales, l'Eglise catholique est la plus riche et la CIA, la plus puissante. Quant à savoir laquelle, des deux, est la plus corrompue, le débat reste toujours ouvert.Auteur : Roger Jon Ellory - Source : Les Anonymes (2008)
- L'on ne peut presque faire semblant d'aimer que l'on ne soit bien près d'être amant, ou du moins que l'on n'aime en quelque endroit ; car il faut avoir l'esprit et les pensées de l'amour pour ce semblant, et le moyen de bien parler sans cela ?Auteur : Blaise Pascal - Source : Discours sur les passions de l'amour (1652-1653)
- Quelle culpabilité atroce, pour un parent, que d’aimer un autre plus que son propre enfant ! Et quelle condamnation cruelle, pour ce fils, que de se savoir au deuxième rang dans le coeur de son père...Auteur : Paolo Giordano - Source : Dévorer le ciel (2019)
- Un bon repas doit commencer par la faim.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe
- Tenez toujours vos réunions commerciales dans des pièces trop petites pour le nombre de participants, même s'il faut pour cela, les tenir dans les WC. Les salles bourrées créent une atmosphère de succès, comme dans les théatres et les restaurants ...Auteur : David Ogilvy - Source : La publicité selon Ogilvy (1993)
- A force d'être victime, on devient bourreau.Auteur : Charles Dollfus - Source : De la Nature humaine (1868)
- Ce que l'on n'a point assez dit, c'est que c'est un devoir aussi envers les autres que d'être heureux. On dit bien qu'il n'y a d'aimé que celui qui est heureux ; mais on oublie que cette récompense est juste et méritée ; car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous ; aussi nous devons reconnaissance et couronne d'athlète à ceux qui digèrent les miasmes, et purifient en quelque sorte la commune vie par leur énergique exemple. Auteur : Emile-Auguste Chartier, dit Alain - Source : Propos sur le bonheur (1928)
- Pourquoi cette Europe, qui a conquis les cinq parties du monde, a-t-elle honte de les avoir colonisées? Nous nous reprochons d'avoir bâti Casablanca, alors que les Romains étaient tout fiers d'avoir détruit Carthage.Auteur : Emmanuel Berl - Source : Le Virage (1972)
- Voici des burnous de cachemire ondoyants comme des flots de clarté, puis des haillons superbes de misère.Auteur : Guy de Maupassant - Source : La Vie errante (1890)
- ... vous devrez aller un peu à l'aveuglette pour atteindre ce que vous cherchez. Le véritable obstacle, c'est nous-mêmes.Auteur : Lawrence Durrell - Source : Sans référence
- Le bon facteur soumis à l'observance,
Ayant des temps divine apercevance,
Ouvre d'un coeur et tranquille et fervent,
Comme celui qui Gloire desservant,
Sait le voirdit des siècles qu'il devance.Auteur : André Mary - Source : Le Livre Nocturne (1943), Rondeau du bon facteur - Le règlement des ball-trap finlandais est très strict: on n'a pas le droit de tirer sur le skieur, tant qu'il est sur le tremplin.Auteur : Patrick Sébastien - Source : Carnet de notes (2001)
Les citations du Littré sur B
- Il n'avoit que cette maison de bien logée et accommodéeAuteur : MONT. - Source : II, 77
- Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, Il met bas son fagotAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. I, 16
- Penser et laisser penser, c'est la consolation de nos faibles esprits dans cette courte vieAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. âme.
- Je ne souffrirai pas qu'on trompe ma maîtresse.... Qu'elle épouse un joueur, un petit brelandierAuteur : REGNARD - Source : le Joueur, I, 2
- Aussitôt qu'on a été vue de toute la salle, que le rouge se raye, que la coiffure se dérange, on bâille, on se plaint du chaud, et l'on va se coucherAuteur : GENLIS - Source : Ad. et Th. t. III, p. 417, dans POUGENS
- Charles, cardinal de Lorraine, esprit sans borne, très chiche et craintif de sa vie, prodigue de celle d'autruiAuteur : D'AUB. - Source : Hist. II, 143
- Tous chevaliers bannieres et estendart Ont les pluseurs ; saiges est qui depart à tels barons le sien, et fait grenier De tel tresor ; des mauvais n'a regart ; Veuillez tousjours tel gent accompaignerAuteur : E. DESCHAMPS - Source : Poésies mss. f° 300
- Dépendre, c'est selon la plus claire notion et la plus évidente être tenu d'obéirAuteur : BOURD. - Source : Exhortation sur l'obéissance relig. t. I, p. 262
- Que tout homme soit obligé de la suivre sous peine de damnationAuteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Ém. IV
- Ce riche métal [l'or] est si commun dans la contrée [de Bambouk en Afrique], qu'on en peut ramasser presque indifféremment partout, en raclant seulement la superficie d'une terre argileuse, légère et mêlée de sableAuteur : RAYNAL - Source : Hist. phil. XI, 16
- Sa santé ou plutôt sa vie ne se soutenait que par une extrême sobriété, par un régime presque superstitieux, et il pouvait donner pour preuve de son habileté qu'il vivaitAuteur : FONT. - Source : Fagon.
- Cependant, comme si le christianisme et la croix de Jésus étaient une fable, nous n'avons d'ambition que pour la gloire du siècle ; l'humilité chrétienne nous paraît une niaiserieAuteur : BOSSUET - Source : Sermons, Vertu de la croix, 2
- ....Mais que il [Édouard III] prit bon conseil et sage entour lui et fealAuteur : Jean Froissard - Source : I, I, 26
- Je vous vois prêt, monsieur, à tomber en faiblesseAuteur : Molière - Source : Sgan. 11
- Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende Quelques dehors civils que l'usage demandeAuteur : Molière - Source : le Mis. I, 1
- ....D'un refus cruel l'insupportable injure N'était qu'un faible essai des tourments que j'endureAuteur : Jean Racine - Source : Phèd. IV, 6
- Il n'est point raisonnable, que celuy qui ne tire point attaigne au blancAuteur : AMYOT - Source : P. Aem. 32
- Reconnaissez le héros qui, toujours égal à lui-même, sans se hausser pour paraître grand, sans s'abaisser pour être civil et obligeant, se trouve naturellement tout ce qu'il doit être en vers tous les hommesAuteur : BOSSUET - Source : Louis de Bourbon.
- L'occasion nous rit dans un si grand dessein, Mais tel bras n'est à nous que jusques à demainAuteur : Corneille - Source : Sertor. I, 1
- Et si la curiosité me prenait de savoir si ces propositions sont dans Jansénius, son livre n'est pas si rare ni si gros que je ne le puisse lire tout entier pour m'en éclaircir, sans en consulter la SorbonneAuteur : Blaise Pascal - Source : Prov. 1
- Et s'il est fet autrement, que partie voie venir en cort les escris desseelés, il pot debatre que li jugemens ne soit pas fes susAuteur : BEAUMANOIR - Source : XL, 31
- Et tant prospere son territoire, que ilz ne peuvent de present avenger à boyreAuteur : François Rabelais - Source : Pant. Progn. Préf.
- Vous devriez était de deux syllabes : Mais vous devriez, ma fille, en l'âge où je vous voy....Auteur : RÉGNIER - Source : Sat. XIII
- Moins je l'ai trouvé naturel, dans ma situation présente, de la part d'un bienveillant....Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Lett. à Dussaulx, 16 février 1771
- Le chêne, dans son noeud la retenant [la hache] de force, Et recouvrant le fer de son bourlet d'écorce, Grandissait....Auteur : LAMART. - Source : Joc. IX, 354
Les mots débutant par B Les mots débutant par B
Une suggestion ou précision pour la définition de B ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 04h55
Dictionnaire des citations en B +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur b
Poèmes b
Proverbes b
La définition du mot B est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot B sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification B présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
