Définition de « dénouement »
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions du mot denouement de manière claire et concise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre le sens du mot.
Il comprend des informations supplémentaires telles que des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes et bien sûr des citations littéraires sur dénouement pour aider à enrichir la compréhension du mot Dénouement et répondre à la question quelle est la définition de denouement ?
Une définition simple : (fr-rég|de.nu.m??) dénouement (m)
Définitions de « dénouement »
Trésor de la Langue Française informatisé
DÉNOUEMENT, DÉNOÛMENT, subst. masc.
Action de dénouer; résultat de cette action.Wiktionnaire
Nom commun - français
dénouement \de.nu.m??\ masculin
- (Absolument) Action de dénouer.
-
(Figuré) (Scénario) (Littérature) Ce qui termine une pièce de théâtre, en démêlant le n?ud de l'action.
- Dénouement ingénieux, forcé, imprévu.
- Préparer le dénouement.
- Amener le dénouement.
- Ils étaient déçus par le récit du facteur, surtout les enfants, qui avaient espéré un dénouement plus corsé. Par exemple, songeait Gustave, un taureau furieux aurait pu sortir de l'écurie des Viard, le grand-père l'aurait saisi par la queue et, après l'avoir fait tourner au-dessus de sa tête à la manière d'une fronde, l'aurait envoyé jusque dans l'étang du Chat-Bleu. On se serait même contenté de moins que ça. ? (Marcel Aymé, La jument verte, Gallimard, 1933, réédition Le Livre de Poche, page 140)
-
(Par extension) Manière dont une affaire, une intrigue se termine.
- Les habitants de l'île attendirent donc avec plus de patience et surtout plus de confiance que jamais. Ils sentaient bien, ces pauvres gens tant éprouvés, qu'ils touchaient au dénouement [?]. ? (Jules Verne, Le Pays des fourrures, J. Hetzel et Cie, Paris, 1873)
- Sans doute sa mère était venue constater les dégâts et voir si l'on ne touchait pas bientôt au dénouement. ? (Émile Zola, Le Docteur Pascal, G. Charpentier, 1893, chapitre IV)
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Action de dénouer. Il n'est guère employé qu'au figuré et signifie Ce qui termine une pièce de théâtre, en démêlant le nœud de l'action. Dénouement ingénieux, forcé, imprévu. Préparer le dénouement. Amener le dénouement. Par extension, Le dénouement d'une affaire, d'une intrigue, La manière dont une affaire, une intrigue se termine.
Littré
- Voy. DÉNOÛMENT.
Encyclopédie, 1re édition
DÉNOUEMENT, s. m. (Belles-Lettres.) c'est le point où aboutit & se résout une intrigue épique ou dramatique.
Le dénouement de l'épopée est un événement qui tranche le fil de l'action par la cessation des périls & des obstacles, ou par la consommation du malheur. La cessation de la colere d'Achille fait le dénouement de l'Iliade, la mort de Pompée celui de la Pharsale, la mort de Turnus celui de l'Enéide. Ainsi l'action de l'Iliade finit au dernier livre, celui de la Pharsale au huitieme, celui de l'Enéide au dernier vers. Voyez Epopée.
Le dénouement de la tragédie est souvent le même que celui du poëme épique, mais communément amené avec plus d'art. Tantôt l'évenement qui doit terminer l'action, semble la noüer lui-même : voyez Alzire. Tantôt il vient tout-à-coup renverser la situation des personnages, & rompre à la fois tous les n?uds de l'action : voyez Mithridate. Cet évenement s'annonce quelquefois comme le terme du malheur, & il en devient le comble : voyez Inès. Quelquefois il semble en être le comble, & il en devient le terme : voyez Iphigénie. Le dénouement le plus parfait est celui où l'action long-tems balancée dans cette alternative, tient l'ame des spectateurs incertaine & flotante jusqu'à son achevement ; tel est celui de Rodogune. Il est des tragédies dont l'intrigue se résout comme d'elle-même par une suite de sentimens qui amenent la derniere révolution sans le secours d'aucun incident ; tel est Cinna. Mais dans celles-là même la situation des personnages doit changer, du moins au dénouement.
L'art du dénouement consiste à le préparer sans l'annoncer. Le préparer, c'est disposer l'action de maniere que ce qui le précéde le produise. Il y a, dit Aristote, une grande différence entre des incidens qui naissent les uns des autres, & des incidens qui viennent simplement les uns après les autres. Ce passage lumineux renferme tout l'art d'amener le dénouement : mais c'est peu qu'il soit amené, il faut encore qu'il soit imprévû. L'intérêt ne se soûtient que par l'incertitude ; c'est par elle que l'ame est suspendue entre la crainte & l'espérance, & c'est de leur mêlange que se nourrit l'intérêt. Une passion fixe est pour l'ame un état de langueur, l'amour s'éteint, la haine languit, la pitié s'épuise si la crainte & l'espérance ne les excitent par leurs combats. Or plus d'espérance ni de crainte, dès que le dénouement est prévû. Ainsi, même dans les sujets connus, le dénouement doit être caché, c'est-à-dire, que quelque prévenu qu'on soit de la maniere dont se terminera la piece, il faut que la marche de l'action en écarte la réminiscence, au point que l'impression de ce qu'on voit ne permette pas de réflechir à ce qu'on sait : telle est la force de l'illusion. C'est par-là que les spectateurs sensibles pleurent vingt fois à la même tragédie ; plaisir que ne goûtent jamais les vains raisonneurs & les froids critiques.
Le dénouement, pour être imprévû, doit donc être le passage d'un état incertain à un état déterminé. La fortune des personnages intéressés dans l'intrigue, est durant le cours de l'action comme un vaisseau battu par la tempête : ou le vaisseau fait naufrage ou il arrive au port : voilà le dénouement.
Aristote divise les fables en simples, qui finissent sans reconnoissance & sans péripétie ou changement de fortune ; & en implexes, qui ont la péripétie ou la reconnoissance, ou toutes les deux. Mais cette division ne fait que distinguer les intrigues bien tissues, de celles qui le sont mal. Voyez Intrigue.
Par la même raison, le choix qu'il donne d'amener la péripétie ou nécessairement ou vraissemblablement, ne doit pas être pris pour regle. Un dénouement qui n'est que vraissemblable, n'en exclut aucun de possible, & entretient l'incertitude en les laissant tous imaginer. Un dénouement nécessité ne peut laisser prévoir que lui ; & l'on ne doit pas attendre qu'un succès assûré, qu'un revers inévitable, échappe aux yeux des spectateurs. Plus ils se livrent à l'action, & plus leur attention se dirige vers le terme où elle aboutit ; or le terme prévû, l'action est finie. D'où vient que le dénouement de Rodogune est si beau ? c'est qu'il est aussi vraissemblable qu'Antiochus soit empoisonné, qu'il l'est que Cléopatre s'empoisonne. D'où vient que celui de Britannicus a nui au succès de cette belle tragédie ? c'est qu'en prévoyant le malheur de Britannicus & le crime de Néron, on ne voit aucune ressource à l'un, ni aucun obstacle à l'autre ; ce qui ne seroit pas (qu'on nous permette cette réflexion), si la belle scene de Burrhus venoit après celle de Narcisse.
Un défaut capital, dont les anciens ont donné l'exemple & que les modernes ont trop imité, c'est la langueur du dénouement. Ce défaut vient d'une mauvaise distribution de la fable en cinq actes, dont le premier est destiné à l'exposition, les trois suivans au n?ud de l'intrigue, & le dernier au dénouement. Suivant cette division le fort du péril est au quatrieme acte, & l'on est obligé pour remplir le cinquieme, de dénoüer l'intrigue lentement & par degrés. ce qui ne peut manquer de rendre la fin traînante & froide ; car l'intérêt diminue dès qu'il cesse de croître. Mais la promptitude du dénouement ne doit pas nuire à sa vraissemblance, ni sa vraissemblance à son incertitude ; conditions faciles à remplir séparément, mais difficiles à concilier.
Il est rare, sur-tout aujourd'hui, qu'on évite l'un de ces deux reproches, ou du défaut de préparation ou du défaut de suspension du dénouement. On porte à nos spectacles pathétiques deux principes opposés, le sentiment qui veut être émû, & l'esprit qui ne veut pas qu'on le trompe. La prétention à juger de tout, fait qu'on ne jouit de rien. On veut en même tems prévoir les situations & s'en pénétrer, combiner d'après l'auteur & s'attendrir avec le peuple, être dans l'illusion & n'y être pas : les nouveautés sur-tout ont ce desavantage, qu'on y va moins en spectateur qu'en critique. Là chacun des connoisseurs est comme double, & son c?ur a dans son esprit un incommode voisin. Ainsi le poëte qui n'avoit autrefois que l'imagination à séduire, a de plus aujourd'hui la réflexion à surprendre. Si le fil qui conduit au denouement échappe à la vûe, on se plaint qu'il est trop foible ; s'il se laisse appercevoir, on se plaint qu'il est trop grossier. Quel parti doit prendre l'auteur ? celui de travailler pour l'ame, & de compter pour très-peu de chose la froide analyse de l'esprit.
De toutes les péripéties, la reconnoissance est la plus favorable à l'intrigue & au dénouement : à l'intrigue, en ce qu'elle est précédée par l'incertitude & le trouble qui produisent l'intérêt : au dénouement, en ce qu'elle y répand tout-à-coup la lumiere, & renverse en un instant la situation des personnages & l'attente des spectateurs. Aussi a-t-elle été pour les anciens une source féconde de situations intéressantes & de tableaux pathétiques. La reconnoissance est d'autant plus belle, que les situations dont elle produit le changement sont plus extrèmes, plus opposées, & que le passage en est plus prompt : par-là celle d'?dipe est sublime. Voyez Reconnoissance.
A ces moyens naturels d'amener le dénouement, se joint la machine ou le merveilleux, ressource dont il ne faut pas abuser, mais qu'on ne doit pas s'interdire. Le merveilleux a sa vraissemblance dans les m?urs de la piece & dans la disposition des esprits. Il est deux especes de vraissemblance, l'une de réflexion & de raisonnement ; l'autre de sentiment & d'illusion. Un évenement naturel est susceptible de l'une & de l'autre : il n'en est pas toûjours ainsi d'un évenement merveilleux. Mais quoique ce dernier ne soit le plus souvent aux yeux de la raison qu'une fable ridicule & bisarre, il n'est pas moins une vérité pour l'imagination séduite par l'illusion & échauffée par l'intérêt. Toutefois pour produire cette espece d'enivrement qui exalte les esprits & subjugue l'opinion, il ne faut pas moins que la chaleur de l'enthousiasme. Une action où doit entrer le merveilleux demande plus d'élevation dans le style & dans les m?urs, qu'une action toute naturelle. Il faut que le spectateur emporté hors de l'ordre des choses humaines par la grandeur du sujet, attende & souhaite l'entremise des dieux dans des périls ou des malheurs dignes de leur assistance.
C'est ainsi que Corneille a préparé la conversion de Pauline, & il n'est personne qui ne dise avec Polieucte :
On ne s'intéresse pas de même à la conversion de Félix. Corneille, de son aveu, ne savoit que faire de ce personnage ; il en a fait un chrétien. Ainsi tout sujet tragique n'est pas susceptible de merveilleux : il n'y a que ceux dont la religion est la base, & dont l'intérêt tient pour ainsi dire au ciel & à la terre qui comportent ce moyen ; tel est celui de Polieucte que nous venons de citer ; tel est celui d'Athalie, où les prophéties de Joad sont dans la vraissemblance, quoique peut-être hors d'?uvre ; tel est celui d'?dipe, qui ne porte que sur un oracle. Dans ceux-là, l'entremise des dieux n'est point étrangere à l'action, & les Poëtes n'ont eu garde d'y observer ce faux principe d'Aristote : Si l'on se sert d'une machine, il faut que ce soit toûjours hors de l'action de la tragédie ; (il ajoûte) ou pour expliquer les choses qui sont arrivées auparavant, & qu'il n'est pas possible que l'homme sache, ou pour avertir de celles qui arriveront dans la suite, & dont il est nécessaire qu'on soit instruit. On voit qu'Aristote n'admet le merveilleux, que dans les sujets dont la constitution est telle qu'ils ne peuvent s'en passer, en quoi l'auteur de Semiramis est d'un avis précisément contraire : Je voudrois sur-tout ; dit-il, que l'intervention de ces êtres surnaturels ne parût pas absolument nécessaire ; & sur ce principe l'ombre de Ninus vient empêcher le mariage incestueux de Semiramis avec Ninias, tandis que la seule lettre de Ninus, déposée dans les mains du grand-prêtre, auroit suffi pour empêcher cet inceste. Quel est de ces deux sentimens le mieux fondé en raisons & en exemples ? Voyez Merveilleux.
Le dénouement doit-il être affligeant ou consolant ? nouvelle difficulté, nouvelles contradictions. Aristote exclut de la tragédie les caracteres absolument vertueux & absolument coupables. Le dénouement, à son avis, ne peut donc être ni heureux pour les bons, ni malheureux pour les méchans. Il n'admet que des personnages coupables & vertueux à demi, qui sont punis à la fin de quelque crime involontaire ; d'où il conclut que le dénouement doit être malheureux. Socrate & Platon vouloient au contraire que la tragédie se conformât aux lois, c'est-à-dire qu'on vît sur le théâtre l'innocence en opposition avec le crime ; que l'une fût vengée, & que l'autre fût puni. Si l'on prouve que c'est là le genre de tragédie, non-seulement le plus utile, mais le plus intéressant, le plus capable d'inspirer la terreur & la pitié, ce qu'Aristote lui refuse, on aura prouvé que le dénouement le plus parfait à cet égard est celui où succombe le crime & où l'innocence triomphe, sans prétendre exclure le genre opposé. V. Tragédie.
Le dénouement de la comédie n'est pour l'ordinaire qu'un éclaircissement qui dévoile une ruse, qui fait cesser une méprise, qui détrompe les dupes, qui démasque les fripons, & qui acheve de mettre le ridicule en évidence. Comme l'amour est introduit dans presque toutes les intrigues comiques, & que la comédie doit finir gaiement, on est convenu de la terminer par le mariage : mais dans les comédies de caractere, le mariage est plûtôt l'achevement que le dénouement de l'action. Voyez le Misantrope & l'Ecole des Maris, &c.
Le dénouement de la Comédie a cela de commun avec celui de la Tragédie, qu'il doit être préparé de même, naître du fond du sujet & de l'enchaînement des situations. Il a cela de particulier, qu'il exige à la rigueur la plus exacte vraissemblance, & qu'il n'a pas besoin d'être imprévû ; souvent même il n'est comique, qu'autant qu'il est annoncé. Dans la Tragédie, c'est le spectateur qu'il faut séduire : dans la Comédie, c'est le personnage qu'il faut tromper ; & l'un ne rit des méprises de l'autre, qu'autant qu'il n'en est pas de moitié. Ainsi lorsque Moliere fait tendre à Georges Dandin le piége qui amene le dénouement, il nous met de la confidence. Dans le Comique attendrissant, le dénouement doit être imprévû comme celui de la Tragédie, & pour la même raison. On y employe aussi la reconnoissance ; avec cette différence que le changement qu'elle cause est toûjours heureux dans ce genre de Comédie, & que dans la Tragédie il est souvent malheureux. La reconnoissance a cet avantage, soit dans le comique de raractere, soit dans le comique de situation, qu'elle laisse un champ libre aux méprises, sources de la bonne plaisanterie, comme l'incertitude est la source de l'intérêt. Voyez Comédie, Comique, Intrigue, &c.
Après que tous les n?uds de l'intrigue comique ou tragique sont rompus, il reste quelquefois des éclaircissemens à donner sur le sort des personnages, c'est ce qu'on appelle achevement ; les sujets bien constitués n'en ont pas besoin. Tous les obstacles sont dans le n?ud, toutes les solutions dans le dénouement. Dans la Comédie l'action finit heureusement par un trait de caractere. Et moi, dit l'Avare, je vais revoir ma chere cassette. J'aurois mieux fait, je crois, de prendre Célimene, dit l'Irrésolu. La tragédie qui n'est qu'un apologue devroit finir par un trait frappant & lumineux, qui en seroit la moralité ; & nous ne craignons point d'en donner pour exemple cette conclusion d'une tragédie moderne, où Hécube expirante dit ces beaux vers :
Je me meurs : rois, tremblez, ma peine est légitime ;
J'ai chéri la vertu, mais j'ai souffert le crime.
Article de M. Marmontel.
Étymologie de « dénouement »
- (Date à préciser) Dérivé du verbe dénouer avec le suffixe -ment.
dénouement au Scrabble
Le mot dénouement vaut 12 points au Scrabble.
Informations sur le mot denouement - 10 lettres, 5 voyelles, 5 consonnes, 7 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot dénouement au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
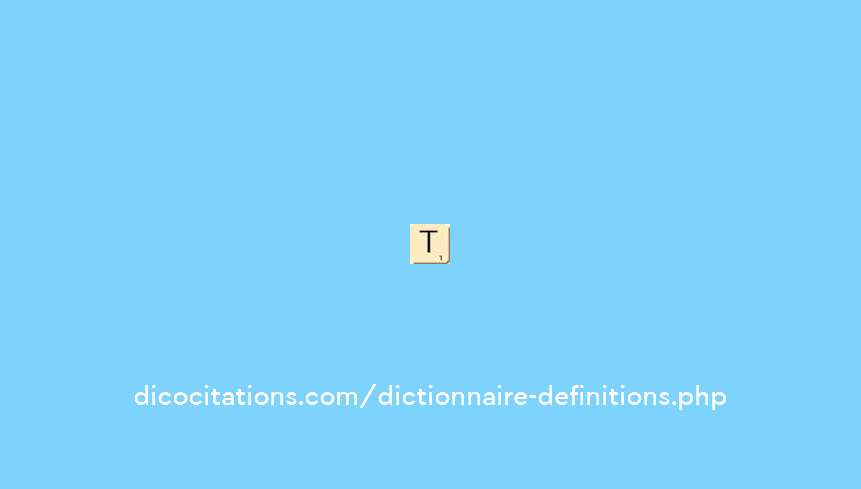
Les rimes de « dénouement »
On recherche une rime en M@ .
Les rimes de dénouement peuvent aider les poètes et les paroliers à trouver des mots pour former des vers avec une structure rythmique cohérente, mais aussi pour jouer avec les mots et les sons, découvrir de nouvelles idées et perspectives ce qui peut être amusant et divertissant.
Les rimes en m@
Rimes de emplacement Rimes de grésillements Rimes de adroitement Rimes de chrétiennement Rimes de thématiquement Rimes de cliniquement Rimes de ensemencements Rimes de empalement Rimes de clamant Rimes de fameusement Rimes de scientifiquement Rimes de épouvantement Rimes de électivement Rimes de fielleusement Rimes de ottomans Rimes de birmans Rimes de littéralement Rimes de chairman Rimes de structurellement Rimes de soubassements Rimes de entrecroisement Rimes de vaillamment Rimes de affranchissement Rimes de applaudissements Rimes de loyalement Rimes de lamentablement Rimes de échappement Rimes de regroupement Rimes de augment Rimes de savamment Rimes de détraquement Rimes de continûment Rimes de téléchargement Rimes de héroïquement Rimes de stationnements Rimes de talentueusement Rimes de enveloppements Rimes de bienveillamment Rimes de durement Rimes de zézaiement Rimes de lancements Rimes de acclimatement Rimes de insatiablement Rimes de crachotement Rimes de supprimant Rimes de envahissement Rimes de modérément Rimes de pertinemment Rimes de sommairement Rimes de bâillementMots du jour
emplacement grésillements adroitement chrétiennement thématiquement cliniquement ensemencements empalement clamant fameusement scientifiquement épouvantement électivement fielleusement ottomans birmans littéralement chairman structurellement soubassements entrecroisement vaillamment affranchissement applaudissements loyalement lamentablement échappement regroupement augment savamment détraquement continûment téléchargement héroïquement stationnements talentueusement enveloppements bienveillamment durement zézaiement lancements acclimatement insatiablement crachotement supprimant envahissement modérément pertinemment sommairement bâillement
Les citations sur « dénouement »
- La vie est courte, l'art difficile, précis le bon moment, l'expérience trompeuse, le dénouement difficile.Auteur : Hippocrate - Source : Aphorismes, I, 1
- En fait, il n'y a que trois dénouements possibles - n'est-ce pas ? - pour une histoire : la vengeance, la tragédie ou le pardon. C'est tout. Les histoires se dénouent toutes ainsi.Auteur : Jeanette Winterson - Source : Pourquoi être heureux quand on peut être normal (2012)
- Une histoire d'amour au dénouement vraiment poétique ne s'achève pas par des excuses, un pardon ou une enquête sur ce qui a mal tourné - l'option saint-bernard, avec bave et paupières tombantes - mais tout simplement dans un silence digne.Auteur : Marisha Pessl - Source : La Physique des catastrophes (2007)
- Il est fort curieux que les liens du mariage soient considérés comme un heureux dénouement. Le mariage divise le fardeau en le multipliant. Avant le mariage, tout a été dit. Après, on ne trouve qu'à redire.Auteur : Robert Sabatier - Source : Le livre de la déraison souriante (1991)
- Le bel âge est à plus de cinquante ans, et moins de soixante: tout y est tragique, la mort est derrière la toile pour faire le dénouement.Auteur : André Suarès - Source : Trois Hommes: Pascal, Ibsen, Dostoïevski (1913)
- Si Corneille a manqué à son art dans les détails, il a rempli le grand projet de tenir les esprits en suspens, et d'arranger tellement les événements, que personne ne peut deviner le dénouement de cette tragédie.Auteur : Voltaire - Source : Commentaires sur Corneille, Remarques sur Rodogune
- Trop souvent, la disparition brutale kidnappe l'ensemble d'une existence qui ne doit pourtant pas se réduire à son dénouement. Auteur : Delphine Horvilleur - Source : Vivre avec nos morts (2021)
- La caractéristique la plus remarquable du suspense, ce n'est pas le plaisir qu'il est susceptible de procurer, mais bien son potentiel de frustration. Il n'y a rien de plus désagréable pour un lecteur de roman qui a cherché sa voie dans le mystère que de devoir se satisfaire, lors du dénouement, d'une explication bancale qui tombe à plat. Auteur : Jean-Marcel Erre, dit J.M. Erre - Source : Prenez soin du chien (2006)
- Un des axiomes favoris d'Edgard Poe, dit Baudelaire, était celui-ci : Tout, dans un poème comme dans un roman, dans un sonnet comme dans une nouvelle, doit concourir au dénouement. Un bon auteur a déjà sa dernière ligne en vue quand il écrit la première.Auteur : Antoine Albalat - Source : Comment on devient écrivain (1925)
- Feuilletons: Cause de démoralisation. Se disputer sur le dénouement probable. Ecrire à l'auteur pour lui fournir des idées. Fureur quand on y trouve un nom pareil au sien.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- L'avare jusqu'au bout dans ses bras entend serrer son trésor
Il ne peut pas imaginer autre dénouement à son sort
Comme lui je vois clairement le visage de mon destin
O mon or entre mes bras dans la blancheur du dernier matinAuteur : Louis Aragon - Source : Elsa - Beaucoup de gens aiment mieux nier les dénouements que de mesurer la force des liens, des noeuds, des attaches qui soudent secrètement un fait à un autre dans l'ordre moral.Auteur : Honoré de Balzac - Source : Eugénie Grandet (1833)
- Souvent, la fin de l'histoire n'est pas une fin, la boucle n'est pas bouclée du coup le sens de l'histoire est à chercher non dans son dénouement mais dans son déroulement... tout comme le sens de la vie.Auteur : Nancy Huston - Source : L'Espèce fabulatrice (2008)
- J'ai toujours pensé que l'histoire demande le même art que la tragédie, une exposition, un noeud, un dénouement.Auteur : Voltaire - Source : Lettre à Schouvalof, 1758
- L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui, maintenant que je l'ai retrouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as du pensée que je te ferais mourir. Et cela te paraissait une dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse !Auteur : Jean Anouilh - Source : Antigone (1942)
Les mots proches de « denouement »
Dénaire Dénantir Dénaturant, ante Dénaturé, ée Dénaturer Dendrite Dendrologique Dendrométrie Dendrophide Dénégation Dénéral Déni Déniaisé, ée Déniaiser Déniaiseur Dénichement Dénicher Denier Dénier Dénigrant, ante Dénigré, ée Dénigrement Dénigrer Dénigreur Dénivellation Dénivellement Dénoircir Dénombrement Dénombrer Dénominateur Dénomination Dénommement Dénommer Dénoncer Dénonciateur, trice Dénonciatif, ive Dénonciation Dénotation Dénoter Dénouable Dénoué, ée Dénouer Dénoûment Denrée Dense Densement Densité Dent Denté, ée DentéeLes mots débutant par den Les mots débutant par de
Denain dénanti Dénat dénatalité dénaturaient dénaturait dénaturation dénature dénaturé dénaturé dénaturé dénaturée dénaturée dénaturée dénaturées dénaturées dénaturées dénaturent dénaturer dénaturés dénaturés dénaturés Denazé dénazification dénazifier Denderbelle Denderhoutem Denderleeuw Dendermonde Denderwindeke dendrite Denée Denée dénégateurs dénégation dénégations déneigé déneigement déneiger dénervation dénervé Dénestanville Deneuille-lès-Chantelle Deneuille-les-Mines Deneuvre Denèvre Dénezé-sous-Doué Dénezé-sous-le-Lude Denezières dengue
Les synonymes de « denouement»
Les synonymes de dénouement :- 1. conclusion
2. fin
3. terme
4. terminaison
5. issue
6. solution
7. épilogue
8. résultat
9. péroraison
10. moralité
11. leçon
12. enseignement
13. limite
14. terminus
15. queue
16. mort
17. aboutissement
18. délicat
19. joli
20. plaisant
21. ravissant
22. mince
23. élancé
24. émincé
25. filiforme
26. étroit
27. svelte
28. finale
29. règlement
synonymes de dénouement
Fréquence et usage du mot dénouement dans le temps
Évolution historique de l’usage du mot « denouement » avec Google Books Ngram Viewer qui permet de suivre l’évolution historique de l'usage du mot dénouement dans les textes publiés.
Classement par ordre alphabétique des définitions des mots français.
Une précision sur la définition de Dénouement ?
Citations dénouement Citation sur dénouement Poèmes dénouement Proverbes dénouement Rime avec dénouement Définition de dénouement
Définition de dénouement présentée par dicocitations.com. Les définitions du mot dénouement sont données à titre indicatif et proviennent de dictionnaires libres de droits dont Le Littré, le Wiktionnaire, et le dictionnaire de l'Académie Française.
Les informations complémentaires relatives au mot dénouement notamment les liens vers les citations sont éditées par l’équipe de dicocitations.com. Ce mot fait partie de la catégorie des mots français de 10 lettres.
