La définition de Délit du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Délit
Nature : s. m.
Prononciation : dé-li
Etymologie : Dé.... préfixe, et lit : ce qui est hors de son lit, de sa position régulière.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de délit de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec délit pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Délit ?
La définition de Délit
Terme de maçon. Côté d'une pierre opposé à celui qu'elle avait naturellement dans la carrière. Mettre une pierre en délit.
Toutes les définitions de « délit »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
T. de Jurisprudence. Toute infraction, consciente ou non, aux lois. Commettre un délit. La peine n'était pas proportionnée au délit. Prendre quelqu'un en flagrant délit. Voyez FLAGRANT. Corps du délit. Voyez CORPS. Il se dit, dans un sens plus restreint, d'une Infraction que la loi punit de peines correctionnelles. Les crimes, les délits et les contraventions. Délits de chasse. Délit de presse. Délit civil se dit d'un Fait illicite, dommageable à autrui, volontaire, mais non puni par la loi pénale. Le Quasi-délit est un fait de même nature, mais non volontaire.
Littré
-
1 Terme de jurisprudence. Infraction quelconque de la loi. Commettre un délit. Les plus graves délits.
Ma propre femme enfin trempant dans ce délit Perdrait sa part au jour et sa place en mon lit
, Rotrou, Bélis. II, 13.Le corps du délit, l'action même du crime qui a été commis?: se dit par opposition aux circonstances.
Flagrant délit, le délit aperçu au moment où il se commet. Prendre en flagrant délit.
-
2Infraction que la loi punit d'une peine correctionnelle. Un délit de presse.
Délit forestier, rural, infraction aux lois sur les forêts, sur la police rurale.
Terme d'eaux et forêts. Arbres de délit, ceux qui ont été coupés contre les ordonnances.
- 3 Terme de droit civil. Fait illicite qui cause du dommage à autrui avec intention de nuire. Les obligations qui naissent d'un délit. Ce fait constitue un simple délit civil.
HISTORIQUE
XVIe s. Tous delits sont personnels [le répondant n'est tenu que civilement, non corporellement]?; et en crime n'y a point de garant [l'auteur et l'instrument sont également punis]
, Loysel, 797.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
1. DÉLIT. Ajoutez?:Délit politique, infraction aux lois politiques.
Délit forestier, délit relatif à la police des forêts.
Délit maritime, délit déféré aux tribunaux maritimes.
Délit militaire, délit commis par des militaires sous les drapeaux.
Délit d'audience, délit commis à l'audience publique ou non.
Encyclopédie, 1re édition
DÉLIT, s. m. (Jurisprud.) du latin delinquere, delictum, signifie en général une faute commise au préjudice de quelqu'un.
On comprend quelquefois sous ce terme de délits toutes sortes de crimes, soit graves ou légers, même le dommage que quelqu'un cause à autrui, soit volontairement ou par accident, & sans qu'il y ait eu dessein de nuire ; mais plus ordinairement on n'employe ce terme de délit que pour exprimer les crimes légers ou le dommage causé par des animaux.
Les principes généraux en matiere de délits sont que tous délits sont personnels, c'est-à-dire que chacun est tenu de subir la peine & la réparation dûe pour son délit, & que le délit de l'un ne nuit point aux autres. Cette derniere maxime reçoit néanmoins trois exceptions : la premiere est que le délit du défunt nuit à son héritier pour les amendes, la confiscation, & autres peines pécuniaires qui sont à prendre sur ses biens : la seconde exception est que les peres sont tenus civilement des délits commis par leurs enfans étant en bas âge & sous leur puissance ; les maîtres sont pareillement tenus des délits de leurs esclaves & domestiques, & du délit ou dommage causé par leurs animaux : la troisieme exception est qu'il y a quelques exemples qu'en punissant le pere pour certains crimes très-graves, on a étendu l'ignominie jusques sur les enfans, afin d'inspirer plus d'horreur de ces sortes de crimes.
Tous délits sont publics ou privés ; ils sont réputés de la derniere espece, à moins que la loi ne déclare le contraire. Voyez ci-après Délit public & Délit privé.
Personne ne doit profiter de son délit, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de rendre par un délit sa condition meilleure.
La gravité du délit se considere eu égard à la qualité de celui qui le commet, à l'habitude où il peut être de le commettre, à la qualité de celui envers lequel il est commis, eu égard au lieu où les choses se sont passées, aux personnes qui étoient présentes, & autres circonstances qui peuvent mériter attention.
Les délits ne doivent point demeurer impunis ; il est du devoir des juges d'informer des délits publics, dont la vengeance est réservée au ministere public. La peine doit être proportionnée au délit ; & les particuliers ne peuvent point poursuivre la peine d'un délit, mais seulement la réparation civile & pécuniaire.
On dit communément qu'il n'y a point de compensation en matiere de délits ; ce qui doit s'entendre quant à la peine afflictive qui est dûe pour la vindicte publique, mais non quant aux peines pécuniaires & aux dommages & intérêts qui en peuvent résulter. Il y a même certains délits privés qui peuvent se compenser ; par exemple, la négligence ou le dol commis réciproquement par des associés, liv. II. ff. de compens. & liv. XXXVI. ff. dolo malo. Il en est de même des injures & autres délits légers qui ne méritent point la peine afflictive, on les compense ordinairement en mettant les parties hors de cour.
Le délit n'est point excusé sous prétexte de colere ou de premier mouvement, ni sous prétexte d'exemple ou de coûtume ; l'erreur même ne peut l'excuser que dans les cas où il n'y a point de délit sans dol.
Il y a certains délits dont l'action est annale, tels que les injures.
La peine des autres délits en général se prescrivoit autrefois par dix ans suivant le droit du digeste ; mais par le droit du code, auquel notre usage est à ces égards conforme, il faut présentement vingt années.
La poursuite du délit est éteinte par la mort naturelle du coupable, quant à la peine, mais non quant aux réparations pécuniaires.
Il y a même certains délits graves que la mort n'éteint point, tels que le crime de lése-majesté divine & humaine, le duel, l'homicide de soi-même, la rébellion à justice à force armée. (A)
Délit d'animaux, est de deux sortes ; savoir le dommage qu'ils peuvent causer à autrui en blessant quelqu'un, ce que les Romains appelloient pauperiem facere ; & le dommage qu'ils peuvent faire en paissant sur l'héritage d'autrui, soit dans des grains ou dans des bois en défense, ce que les Romains appelloient depastionem. Chez les Romains le maître du bétail qui avoit commis le délit en étoit quitte en abandonnant la bête a celui qui avoit souffert le dommage. Parmi nous le maître est obligé de réparer le dommage, lorsqu'il y a de sa part du dol ou de la négligence. Voyez au digeste, liv. IX. tit. j. & aux instit. tit. si quadrupes. (A)
Délit capital ou Crime capital, est celui qui mérite peine de mort : on dit plus ordinairement un crime capital. Voyez au mot Crime. (A)
Délit commis ou commun. La coûtume d'Angoumois, ch. j. art. 23. dit que le clerc pour le délit commis sera renvoyé pardevant son ordinaire. Voyez la note de M. Angevin sur cet article, dans le coûtumier général. (A)
Délit commun, ne signifie pas un délit qui se commet fréquemment, mais un délit ordinaire & non privilégié, c'est-à-dire qui n'est point d'une nature particuliere, & dont la connoissance n'appartient point au juge par privilége, mais de droit commun.
Ce terme délit commun est opposé à délit privilégié, c'est-à-dire dont la connoissance appartient au juge par privilége.
Ces termes sont usités lorsqu'il s'agit de délits commis par des ecclésiastiques. On distingue le délit commun & le délit ou cas privilégié, pour régler la compétence du juge d'église & celle du juge séculier ; la connoissance du délit commun appartient au juge d'église, & celle du délit privilégié au juge royal.
Telles sont les notions vulgaires que l'on a de ces termes délit commun & délit privilégié ; mais pour bien entendre leur véritable signification & l'abus que l'on en a fait, il faut remonter jusqu'à l'origine de la distinction du délit commun & du cas privilégié.
On appelloit délits communs, chez les Romains, tous ceux dont la punition appartenoit aux juges ordinaires ; & délits propres à une certaine profession, ceux qui étoient commis contre les devoirs de cette profession.
Ainsi pour les gens de guerre on appelloit délits communs, ceux dont la vengeance étoit reglée par les lois communes à tous les autres hommes ; & délits propres ceux qui étoient contre les devoirs du service militaire, comme d'avoir quitté son poste.
On peut appliquer aux ecclésiastiques la même distinction, d'autant mieux que les lois romaines les appellent la milice sacrée.
Ce n'est pas ici le lieu de traiter de la jurisdiction ecclésiastique en général ; cependant pour l'éclaircissement de ces termes, délits communs & cas privilégiés, on ne peut s'empêcher de remonter jusqu'aux premiers siecles de l'Eglise, pour voir de quelles causes les juges d'église ont connu selon les différens tems.
Dans la primitive église où les ecclésiastiques n'avoient point de jurisdiction extérieure contentieuse, les prêtres & les diacres concilioient charitablement les différends qui s'élevoient entre les fideles, lesquels se faisoient un scrupule de recourir à des juges payens ; ce qui n'empêchoit pas que les Chrétiens, & même les ecclésiastiques, ne fussent soûmis à la justice séculiere.
Constantin fut le premier qui fit un reglement entre les officiers ecclésiastiques & les séculiers ; il ordonna que les causes légeres & celles qui concernoient la discipline ecclésiastique, se traiteroient dans les assemblées synodales, qu'à l'égard des causes ecclésiastiques, l'évêque en seroit juge entre ecclésiastiques, qu'en fait de crimes les ecclésiastiques seroient jugés par les évêques, excepté pour les crimes graves dont la connoissance étoit réservée aux juges séculiers ; ce qui s'observoit même pour les évêques accusés. On distinguoit à leur égard, de même que pour les autres ecclésiastiques, le délit civil & commun, d'avec celui que l'on appelloit ecclésiastique.
Cette distinction des délits communs d'avec les délits ecclésiastiques, fut observée dans le jugement d'Athanase évêque d'Alexandrie : il étoit accusé par deux évêques ariens d'avoir conspiré contre l'empereur Constantin ; il étoit aussi accusé d'un homicide, & d'avoir voulu violer son hôtesse : l'empereur le renvoya pour ces crimes devant des juges séculiers qui l'interrogerent. Mais lorsqu'il fut accusé d'avoir rompu des calices, d'avoir malversé dans la visite de ses églises, & d'avoir usé de violence envers les prêtres de son diocèse, il fut renvoyé au synode assemblé à Tyr.
Le même ordre fut observé sous les empereurs Constans & Constantius. En effet Etienne évêque d'Antioche, qui étoit arien, ayant fait un complot contre les ambassadeurs de Constans, ils demanderent à l'empereur que le procès fût fait à cet évêque ; & celui-ci ayant demandé son renvoi au synode des évêques, on lui soûtint qu'étant accusé de crimes capitaux, il devoit être jugé en cour séculiere ; ce qui fut ainsi ordonné.
Il est vrai que les mêmes empereurs accorderent par faveur spéciale aux évêques, de ne pouvoir pour quelque crime que ce fût être jugés que par les évêques ; mais cela ne changea rien pour les autres ecclésiastiques ; & depuis, les empereurs Valens, Gratien, & Valentinien, révoquerent l'exception qui avoit été faite pour les évêques, & ordonnerent que pour crimes ecclésiastiques tous clercs, soit évêques ou autres, seroient jugés dans le synode de leur diocèse ; mais que pour les crimes communs & civils, qui sont précisément ceux que l'on appelle aujourd'hui improprement cas privilégiés, ils seroient poursuivis devant les juges séculiers.
Les empereurs Honorius & Théodose rétablirent le privilége qui avoit été accordé aux évêques, & l'étendirent même à tous ecclésiastiques en général pour quelque délit que ce fût.
Le tyran nommé Jean qui essaya d'usurper l'empire d'Occident, révoqua tous ces priviléges, & soûmit les ecclésiastiques à la justice séculiere, tant pour le civil que pour toutes sortes de crimes indistinctement.
Mais Théodose & Valentinien II. qui succéderent à Honorius, rendirent aux ecclésiastiques le privilége de ne pouvoir être jugés qu'en la jurisdiction ecclésiastique, tant pour le civil que pour le criminel.
Tel fut l'état de la jurisdiction ecclésiastique pour les matieres criminelles jusqu'au tems de Justinien, lequel par sa novelle 83 distingua expressément les délits civils des délits ecclésiastiques. Par les délits civils il entend les délits communs, c'est-à-dire ceux qui sont commis contre les lois civiles, & dont la punition est reservée aux lois civiles. C'est ce que le docte Cujas a remarqué sur cette novelle, où il employe comme synonymes ces deux mots civil & commun, & les oppose au délit ecclésiastique.
Justinien ordonna donc que si le crime étoit ecclésiastique, & sujet à quelqu'une des peines que l'Eglise peut infliger, la connoissance en appartiendroit à l'évêque seul ; que si au contraire le crime étoit civil & commun, le président si c'étoit en province, ou le préfet du prétoire si c'étoit dans la ville, en connoîtroient, & que s'ils jugeoient l'accusé digne de punition, ils le livreroient aux ministres de la justice après qu'il auroit été dégradé de l'état de prêtrise par son évêque.
Peu de tems après, Justinien changea lui-même cet ordre par sa novelle 123, où il permit à celui qui accuseroit un ecclésiastique de se pourvoir, pour quelque délit que ce fût, devant l'évêque : si le crime se trouvoit ecclésiastique, l'évêque punissoit le coupable selon les canons ; si au contraire l'accusé se trouvoit convaincu d'un crime civil, l'évêque le dégradoit, après quoi le juge laïc faisoit le procès à l'accusé.
L'accusateur pouvoit aussi se pourvoir devant le juge séculier ; auquel cas si le crime civil étoit prouvé, avant de juger le procès on le communiquoit à l'évêque, & si celui-ci trouvoit que le délit fût commun & civil, il dégradoit l'accusé, qui étoit ensuite remis au juge séculier : mais si l'évêque ne trouvoit pas le délit suffisamment prouvé, ou que la qualité du délit lui parût équivoque, il suspendoit la dégradation, & les deux juges s'adressoient à l'empereur, qui en connoissance de cause ordonnoit ce qu'il croyoit convenable.
En France sous les deux premieres races de nos rois, & même encore assez avant sous la troisieme, les ecclésiastiques qui avoient beaucoup empiété sur la jurisdiction séculiere, ne la reconnoissoient aucunement pour les matieres criminelles, de telle nature que fût le délit ; c'est pourquoi Prétextat archevêque de Rouen étant accusé par Chilperic de crime de lése-majesté, le roi permit qu'il fût jugé par les évêques & prélats du royaume ; il leur observa néanmoins en même tems que les juges royaux auroient pû le condamner pour un tel crime.
Grégoire de Tours rapporte plusieurs exemples semblables, entre autres que Salonius & Sagittarius accusés d'homicide, d'adultere, & autres crimes énormes, furent renvoyés au jugement des évêques.
On trouve aussi dans Monstrelet qu'en 1415, 1460, & (aux additions) en 1467, des clercs accusés de lése-majesté, sortiléges, homicides, étoient renvoyés au juge d'église, qui les condamnoit à une prison perpétuelle, & à jeûner au pain & à l'eau.
Les capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, & autres princes leurs successeurs, contiennent plusieurs défenses de poursuivre les ecclésiastiques dans les tribunaux séculiers pour quelque crime que ce fût.
Philippe III. ordonna en 1274 qu'on auroit recours au droit écrit, pour savoir si un clerc accusé d'homicide seroit poursuivi devant le juge ecclésiastique ou laïc.
De tous ces différens faits il résulte que l'on n'ignoroit point dès-lors en France la distinction des délits civils & communs d'avec les délits ecclésiastiques, qui se trouve établie par les lois romaines, & notamment par les novelles de Justinien qui forment le dernier état du droit romain sur cette matiere ; que si l'on renvoyoit aux évêques la connoissance de tous les délits commis par les ecclésiastiques, c'étoit par déférence pour les évêques, & par respect pour les anciens decrets des conciles.
Mais bientôt après les gens d'église commencerent à reconnoître l'autorité des juges séculiers pour les délits graves : on en trouve un exemple sous le regne de Charles V. Pierre d'Estaing évêque de Saint-Flour, & depuis archevêque de Bourges & cardinal, ayant fait décider dans un synode qu'il convoqua à Bourges, que les clercs ne pouvoient être poursuivis en la justice séculiere pour aucun crime, fut contraint de révoquer ce decret, & d'en donner sa déclaration par écrit en 1369, qui fut reçûe par Jean duc de Berri, & ensuite acceptée par le roi.
Il paroît donc par-là que les ecclésiastiques se reconnoissoient dès-lors sujets à la justice séculiere quant aux crimes graves, qu'ils appellerent improprement délits privilégiés ; comme si les juges séculiers n'en connoissoient que par privilége, quoique ce fût tout le contraire, les juges séculiers connoissant par droit commun de tous les délits, & les juges d'église seulement par privilége des délits ecclésiastiques.
L'exercice de la jurisdiction séculiere sur les ecclésiastiques accusés de cas privilégiés, c'est-à-dire de crimes graves & dont la punition n'appartient qu'à la justice séculiere, n'est même point un usage particulier à la France, mais un droit commun à toutes les nations chrétiennes.
En Espagne autrefois les ecclésiastiques ne pouvoient être poursuivis, pour quelque crime que ce fût, que devant le juge d'église ; mais l'impunité qui résultoit de ce privilége fut cause que les rois d'Espagne le révoquerent par rapport aux crimes atroces, tels que les assassinats, adulteres, concubinages publics, & autres semblables, dont Philippe II. par un édit de 1597 donna pouvoir à ses juges d'informer contre toutes sortes de personnes sans exception.
La même chose est arrivée en Angleterre, où les ecclésiastiques accusés de crimes étoient aussi exempts de la justice séculiere : ce privilége occasionnoit un tel desordre, que sous le regne d'Henri II. il y eut plus de cent assassinats commis par des clercs ; ce qui engagea Henri II. à donner un édit portant que les clercs accusés de crimes ecclésiastiques répondroient devant les juges d'église, & devant les juges séculiers pour les crimes graves & qualifiés ; ce qui fut confirmé par Edouard II.
Damhoudere en sa pratique de Flandre, observe aussi que les ecclésiastiques y sont soûmis à la justice séculiere pour les crimes graves, tels que l'homicide, l'assassinat, port d'armes, & autres semblables.
Il est donc étrange que l'on traite de délits & cas privilégiés, des faits dont la connoissance appartient de droit commun au juge royal, & dont il est le juge naturel, & de traiter de délits communs ceux dont le juge d'église connoît seulement par exception & par privilége.
Cependant l'usage a prévalu au contraire, même dans les tribunaux séculiers, pour l'application de ces termes délit commun & délit ou cas privilégié ; & si nous avons relevé cette erreur, c'est moins pour reclamer la véritable signification de ces termes, que pour soûtenir les vrais principes par rapport à la jurisdiction que le Roi a de droit commun sur les ecclésiastiques, & non pas seulement par exception & par privilége.
Au reste, selon la façon commune de parler, on met dans la classe des délits privilégiés tous ceux qui se commettent contre le bien & le repos public, & que le Roi a intérêt de faire punir pour l'exemple & la sûreté de ses sujets, comme sont les crimes de lése-majesté divine & humaine, l'incendie, la fausse monnoie, l'homicide de guet-à-pens, le vol sur les grands-chemins, le vol nocturne, le port d'armes défendues, la force & la violence publique, la contravention aux défenses faites par un juge royal, & autre, délits semblables.
Les délits communs sont tous ceux qui ne sont point privilégiés, tels que le simple larcin, l'homicide sait sans dessein prémédité, les injures faites à des particuliers, & autres semblables délits dont les juges d'église connoissent quand ils sont commis par des ecclésiastiques.
Il y a aussi des délits purement ecclésiastiques, c'est-à-dire qui sont des contraventions aux saints decrets & constitutions canoniques, tels que la simonie, la confidence, le sacrilége commis sans violence ; tels sont aussi les délits commis par des ecclésiastiques, tant en omettant à faire ce qui est de leur devoir ou en faisant ce qui leur est défendu, comme si un curé omettoit malicieusement de dire la messe & faire le service divin les jours de fêtes & dimanches, s'il refusoit d'administrer les sacremens à ses paroissiens, s'il célebroit les saints mysteres d'une maniere indécente, s'il exerçoit quelqu'art ou métier indigne de son caractere. Quoique ces délits soient de la compétence du juge d'église, le juge royal en peut aussi connoître lorsqu'il y a scandale public, & que l'ordre public y est intéressé.
Un ecclésiastique peut donc pour un même fait être justiciable du juge d'église & du juge royal, lorsque le fait participe tout à la fois du délit commun & du délit privilégié.
Les juges des seigneurs ne peuvent connoître d'aucuns délits commis par les ecclésiastiques, mais seulement en informer, & ensuite renvoyer l'information au greffe royal.
Suivant l'ordonnance de Moulins, quand il y avoit délit commun & privilégié, le juge royal devoit d'abord faire le procès à l'ecclésiastique pour le cas privilégié, & ensuite le renvoyer au juge d'église pour le délit commun ; & en attendant le jugement de l'official, l'accusé devoit tenir prison pour la peine du cas privilégié, dont le juge d'église étoit responsable supposé qu'il élargît le prisonnier.
Mais depuis par l'édit de Melun il a été ordonné que le procès pour le délit commun & le délit privilégié sera fait par le juge d'église & par le juge royal conjointement ; & en ce cas le juge royal doit se transporter au siége du juge d'église, ils y instruisent conjointement le procès, mais ils rendent chacun séparément leur sentence.
La forme de cette procédure a encore été réglée par deux déclarations des mois de Février 1682 & Juillet 1684, & par l'art. 38 de l'édit de 1693, qui ordonne l'exécution des précédentes ordonnances, notamment de l'édit de Melun & de la déclaration de 1684.
La déclaration du 4 Février 1711 ordonne que dans les procès qui seront faits conjointement par le juge d'église pour le délit commun, & par le juge royal pour le cas privilégié, le juge d'église aura la parole, prendre le serment des accusés & des témoins, & fera en présence du juge royal les interrogatoires, recollemens & confrontations.
Quand l'ecclésiastique est jugé par le juge d'église seul, & condamné pour le délit commun, il peut, quoiqu'il ait satisfait à la condamnation, être encore repris par le juge royal, & puni de nouveau par lui pour le cas privilégié.
Il en seroit de même si l'ecclésiastique avoit été absous par le juge d'église ; le juge royal pourroit néanmoins encore lui faire son procès.
Mais si l'ecclésiastique avoit été renvoyé absous par le juge royal, ou qu'il eût obtenu grace du Roi qui eût été entérinée, le juge d'église ne pourroit plus intenter procès à l'accusé pour le délit commun ; & s'il le faisoit il y auroit abus.
Les peines que le juge d'église peut infliger pour le délit commun sont la suspension, l'interdit, l'excommunication, les jeûnes, les prieres, la privation pour un tems du rang dans l'église, de voix délibérative dans le chapitre, des distributions manuelles ou d'une partie des gros fruits, la privation des bénéfices, la prison pour un tems, & la prison perpétuelle. L'Eglise n'a point de punition qui puisse aller au-delà. Voyez Juge d'Eglise.
Voyez la loi xxiij. au code Théod. de episcop. & cleric. la novel. 123. de Justinien ; le tr. du délit commun & cas privilégié ; celui de l'abus par Fevret, livre VIII. ch. j. ij. iij. & jv. Bouchel, biblioth. du droit franç. au mot Cas ; & la bibliot. canon. au mot . Leprêtre, cent. 20. Henrys, tome II. liv. I. quest. 16. Le tr. de l'abus par Fevret, liv. VIII. ch. j. (A)
Délit ecclésiastique, est celui qui est commis singulierement contre les saints decrets & constitutions canoniques, comme la simonie, la confidence, l'hérésie. Voyez ce qui en est dit ci-devant au mot Délit commun. (A)
Délit, (flagrant.) est le moment même où le coupable vient de commettre le crime ou le dommage dont on se plaint. On dit qu'il est pris en flagrant délit, lorsqu'il est saisi & arrêté, ou du moins surpris en commettant le fait dont il s'agit. Voyez l'art. jx. du tit. 10. de l'ordonnance criminelle ; Julius Clarus, lib. V. sentent. quæst. viij. n. 5. (A)
Délit grave. est celui qui mérite une punition sévere : on dit en ce cas plutôt crime que délit. (A)
Délit imparfait, est celui que l'on a eu dessein de commettre, ou même qui a été commencé, mais qui n'a pas été achevé. Pour savoir comment on punit ces sortes de délits, voyez ce qui en est dit au mot Crime. (A)
Délit leger, est celui qui ne mérite pas une punition bien rigoureuse : telles sont la plûpart des injures, lorsqu'elles n'ont pas causé d'ailleurs un préjudice notable. (A)
Délit militaire, est une faute commise contre la discipline militaire. Voyez le titre de re militari, au digeste xljx. tit. 16. & au code liv. XII. tit. 36. & le code militaire du baron de Sparre. (A)
Délit monachal, ce sont les fautes commises par un religieux contre sa regle. Voy. la nov. cxxxiij. ch. 5. & Moines & Religieux. (A)
Délit personnel, est celui que l'on prétend avoir été commis par celui auquel on en demande raison, à la différence de certains délits dont un tiers peut être tenu, comme le pere est tenu civilement du délit de son fils, &c. (A)
Délit privé est opposé à délit public ; c'est celui dont la réparation n'intéresse point le public, mais seulement le plaignant, comme des injures ou une rixe. (A)
Délit privilégié, ou Cas privilégié, est opposé à délit commun. Voyez ci-dev. Délit commun. (A)
Délit, (quasi) est le dommage que l'on fait à quelqu'un sans qu'il y ait eu dessein de nuire, comme quand il tombe par accident quelque chose d'un toît ou d'une fenêtre, qui blesse les passans ou qui gâte leurs habits.
Ces sortes de quasi-delits engendrent une obligation de la part de celui qui a causé le dommage, en vertu de laquelle il est tenu de le réparer. Voy. aux institutes le titre de obligationibus quæ ex quasi-delicto nascuntur.
Les lois romaines mettent aussi au nombre des quasi-délits, l'action d'un juge qui litem suam fecit ; & la conduite d'un maître de navire ou d'une hôtellerie, chez lequel il s'est commis quelque dol ou larcin : elles le rendent responsable de ces évenemens, parce que quoiqu'il n'ait pas eu dessein de nuire, il y a toûjours de sa faute de n'avoir pas pris les précautions convenables pour prévenir le délit, & cette négligence est ce que l'on appelle quasi-délit. (A)
Délit, ou simplement Lit, s. m. (Coupe des pierres) est une division naturelle qui se trouve dans les pierres par couches, comme aux feuilles d'un livre. Poser en lit, c'est donner à une pierre une situation différente de l'horisontale dans les piés droits, & de lit en joint dans les voutes.
Il y a des pierres si compactes qu'elles n'ont ni lit ni délit ; tels sont la plûpart des marbres que l'on peut poser comme on veut, observant cependant de mettre quelque chose entre les joints d'assise, comme une lame de plomb, pour conserver les arrêtes, & empêcher qu'il ne s'y fasse des balevres. (D)
Délit, (Bois de) Comm. c'est ainsi qu'on appelle ceux qui dans les forêts ont été ou coupés, ou maltraités clandestinement & contre les ordonnances.
Wiktionnaire
Nom commun 2 - français
délit \de.li\ masculin
-
(Maçonnerie) Position d'une pierre employée dans un sens différent de celui de la stratification.
- Poser une pierre en délit.
-
Fente qui se produit dans une pierre dans le sens de son lit.
- Les granits n'ont ni lit ni délit.
Nom commun 1 - français
délit \de.li\ masculin
-
(Droit) Toute infraction, consciente ou non, aux lois.
- Commettre un délit.
- La peine n'était pas proportionnée au délit.
- Prendre quelqu'un en flagrant délit.
- Corps du délit. Voyez « corps ».
-
(En particulier) Infraction que la loi punit de peines correctionnelles.
- Individuellement ou en "petty sessions", les Magistrats procèdent à la recherche, dans leur voisinage, des contraventions, délits et crimes de toute espèce. ? (Anonyme, Angleterre. - Administration locale, Revue des Deux Mondes, 1829, tome 1)
- Mais le chantage est un délit, Monsieur le juge. Il faut l'établir. ? (Victor Méric, Les Compagnons de l'Escopette, Éditions de l'Épi, Paris, 1930, page 240)
- Mentir devant la représentation nationale, et pas seulement dans une enceinte judiciaire, est un délit. ? (Stéphane Mandard, La condamnation pour « faux témoignage » du pneumologue Michel Aubier confirmée en appel, Le Monde. Mis en ligne le 9 novembre 2018)
-
Acte de justice ?
Suite au délit de violence
psychologique et émotionnelle
en parole,
vous allez verser
un dédommagement
à votre
?
assistant personnel virtuel.
? (Cornéliu Tocan, Chutes microscopiques. 50 micronouvelles illustrées, Créatique, Québec, 2020, pages 15-16)
Trésor de la Langue Française informatisé
DÉLIT1, subst. masc.
DÉLIT2, subst. masc.
Délit au Scrabble
Le mot délit vaut 6 points au Scrabble.
Informations sur le mot delit - 5 lettres, 2 voyelles, 3 consonnes, 5 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot délit au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
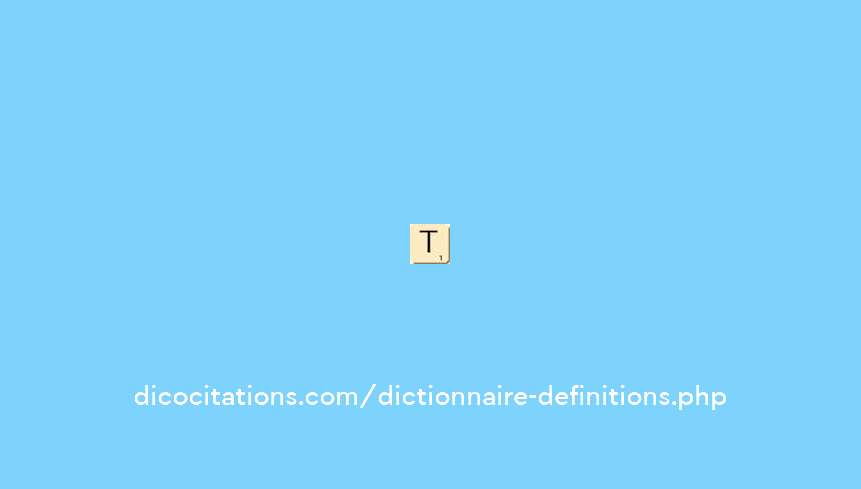
Les mots proches de Délit
Delà Délabré, ée Délabrement Délabrer Délacer Délai Délaissé, ée Délaissement Délaisser Délampourdage Délassé, ée Délassement Délasser Délateur Délation Délatter Délaver Délayer Délayer Délectabilité Délectable Délectablement Délectation Délecté, ée Délecter Délégation Déléguer Déliaison Délibératif, ive Délibération Délibérativement Délibéré, ée Délibéré Délibéré, ée Délibérément Délibérer Délicat, ate Délicatement Délicater Délicatesse Délice Délicieusement Délicieux, euse Délié, ée Délié, ée Délier Délimitation Délinéament Délinéation Délinquant, ante delà délabre délabré délabré délabrée délabrée délabrées délabrées délabrées délabrement délabrer délabrés délabrés délabyrinthez délaça délaçais délaçait délaçant délace délacé délacées délacer délacèrent délai délaie Delain délais délaissa délaissaient délaissais délaissait délaissant délaisse délaissé délaissé délaissé délaissée délaissée délaissée délaissées délaissées délaissées délaissement délaissements délaissent délaisser délaisserait délaissèrent délaisses délaissésMots du jour
-
concitoyens maître-chanteur croupies synapse rabotin roulure frappantes punissable évacuaient vandalisent
Les citations avec le mot Délit
- Les gens qu'on honore ne sont que des fripons qui ont eu le bonheur de n'être pas pris en flagrant délit.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : Le Rouge et le Noir (1830)
- Au procès de Bobigny, je décidai de tout dire de l’action des femmes et de ma propre expérience. Je commençai par un aveu-provocation : j’ai avorté, j’ai commis ce délit.Auteur : Gisèle Halimi - Source : Le lait de l'oranger (1988)
- Une jolie femme est un casus belli ; une jolie femme est un flagrant délit. Toutes les invasions de l'histoire sont déterminées par des cotillons. La femme est le droit de l'homme.Auteur : Victor Hugo - Source : Les Misérables (1862)
- L'infidélité des femmes est-elle autre chose que l'abandon de celui qui en peut les mener plus loin que le point où elles sont rendues?Auteur : Hélène Ouvrard - Source : Le coeur sauvage
- ... il y a des plaisirs d'infidélité et l'infidélité à l'égard d'un auteur est un innocent libertinage.Auteur : Emile Faguet - Source : L'Art de lire
- Réussite et échec sont des mots piège du langage humain tout comme le sont fidélité et pardon.Auteur : Daniel Desbiens - Source : Maximes d'Aujourd'hui
- Le temps calme les ivresses, même celle de l'amitié;
Une longue fidélité a ses dernières admirations.Auteur : Joseph Joubert - Source : Pensées, Maximes et Essais - Je rêvasse. Rien d’autre à faire. Le temps se délite. Au Lager, le temps a perdu ses références habituelles de travail, ses balises de douceur, ses points fixes faits d’amis, de visages, d’obligations, de rencontres. Disparue, aussi, sa chronologie guerrière qui dure depuis cinq ans. Auteur : Joseph Bialot - Source : C'est en hiver que les jours rallongent (2002)
- Ce qui me gêne dans l'infidélité de ma femme, c'est que les autres voient de quoi je me contente.Auteur : Sacha Guitry - Source : Sans référence
- Le riche commet le délit, et le pauvre paie l'amende.Auteur : Proverbes espagnols - Source : Proverbe
- Il y a une hypocrisie considérable dans le formalisme. Toute personne qui pense est consciente de ce paradoxe, mais dans nos rapports avec les gens conventionnels il est avantageux de les traiter comme s'ils n'étaient pas des hypocrites. Ce n'est pas une question de fidélité à tes propres conceptions, c'est une question de compromis afin de pouvoir demeurer un individu sans la menace constante de pressions conventionnelles. Auteur : Truman Capote - Source : De sang-froid (1965)
- La fidélité de la femme est comme le vent : elle reste la même, mais elle peut changer de direction.Auteur : Mika Toimi Waltari - Source : Sinouhé, l'Egyptien (1945)
- Flagrant délit: Prononcer flagrante delicto. Ne s'emploie que pour les cas d'adultère.Auteur : Gustave Flaubert - Source : Dictionnaire des idées reçues (1913)
- Fidélité: Vertu particulière de ceux qui ne sont pas loin d'être trompés.Auteur : Ambrose Bierce - Source : Le Dictionnaire du Diable (1911)
- Dans des sujets où les mots se délitent, où les expressions s'émiettent, elle parvient à se faire comprendre.Auteur : Joris-Karl Huysmans - Source : En route (1895)
- Il y a pourtant quelque chose de plus fort que la tradition : c’est la vie et son mouvement. Pourquoi les héros de roman passent-ils leur temps à se révolter ? Pour la même raison qui oblige les grands hommes à faire bouger l’histoire. À la splendeur du souvenir et de la fidélité répond l’ardeur de l’annonce, de l’attente, de la promesse. L’histoire est une continuité ; elle est aussi une impatience. Elle regarde vers demain comme elle regarde vers hier. Tournées vers l’avenir autant que vers le passé, les traditions ? comme les femmes ? sont faites pour être à la fois respectées et bousculées. Elles sont faites pour que le souvenir ne soit que la préface de l’espérance. Auteur : Jean d'Ormesson - Source : Réponse au discours de réception de Marguerite Yourcenar, Le 22 janvier 1981
- Penser à l'autre, savoir être présent quand il le faut, avoir les mots et les gestes qu'il faut, faire preuve de constance dans la fidélité, c'est cela l'amitié, et c'est rare.Auteur : Tahar Ben Jelloun - Source : Eloge de l'amitié (1996)
- Fidélité vivante à des morts, fidélité morte à des vivants.Auteur : Gilbert Cesbron - Source : Journal sans date (1963)
- Il y a dans la fidélité de la paresse, de la peur, du calcul, du pacifisme, de la fatigue, et quelquefois de la fidélité.Auteur : Etienne Rey - Source : De l'amour de Stendhal
- S'il n'existait la fidélité pour les départager on aurait aujourd'hui bien de la peine à distinguer un homme d'un chien: ils dissimulent tous les deux leurs traits sous les poils.Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)
- Ne te méprends donc pas, sceptique charmante, sur la cause de mon émotion! Le doute ne saurait pénétrer dans le coeur de ton amant; chacun de tes regards est pour sa fidélité l'objet d'un culte pieux; un sourire le charme, une larme le dissuade.Auteur : George Gordon, lord Byron - Source : Heures de loisirs, poésies originales et traduites (1807), A Caroline
- Si vous dites: je vous aime, c'est déjà le langage que vous vous mettez à aimer, c'est donc déjà une forme de rupture et d'infidélité.Auteur : Jean Baudrillard - Source : Cool Memories (1980-1985)
- Si encore la douleur était un antiseptique des délits futurs ou un détersif des fautes passées, on comprendrait.Auteur : Joris-Karl Huysmans - Source : En route (1895)
- Quelle confiance accorder à une femme qui se laisse surprendre en flagrant délit de fidélité! Aujourd'hui c'est à toi, demain c'est à un autre qu'elle est fidèle.Auteur : Karl Kraus - Source : Dits et contredits (1975)
- La fidélité des femmes dans le mariage lorsqu'il n'y a pas d'amour, est probablement une chose contre nature.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : De l'amour (1822)
Les citations du Littré sur Délit
- Pris en flagrant délit, affaire criminelleAuteur : Jean Racine - Source : Plaid. II, 5
- Trouveriez-vous le maître que vous servez avec tant de zèle et de valeur, équitable, si là-dessus la fidélité d'un chacun de vous lui devenait suspecte ?Auteur : MASS. - Source : Car. Inj. du monde.
- Son trouble avouait-il son infidélité ?Auteur : Jean Racine - Source : Andr. V, 2
- Ces êtres [collectifs, constitués en personnes civiles] jouent en ce qui concerne le droit civil le rôle d'une personne.... cette personnification se continuera-t-elle jusque dans le droit pénal ? est-il possible que l'être collectif soit lui-même un agent pénalement responsable des délits ?Auteur : ORTOLAN - Source : Éléments de droit pénal, 4e éd. t. I, n° 491-492
- Cette parole, messieurs, ne se traite guère dans les chaires, parce que cette inviolable fidélité ne se trouve guère dans les moeursAuteur : BOSSUET - Source : Mar.-Thér.
- Là-dessus, mû de zèle et de fidélité, J'en viens donner avis à Votre MajestéAuteur : TRISTAN - Source : Mariane, II, 4
- Le chien est le seul animal dont la fidélité soit à l'épreuve ; le seul qui entende son nom et qui reconnaisse la voix domestiqueAuteur : BUFF. - Source : Chien.
- Il y a une nature de délits qui se commettent fréquemment en France, et qui, faute d'une juridiction qui les comprenne, restent impunis et même, en définitive, impoursuivisAuteur : DUFAURE - Source : Journ. offic. 29 déc. 1875, p. 10870, 2e col.
- La fidélité de l'âme a été parfaite [dans les épreuves de la mort]Auteur : BOSSUET - Source : Duch. d'Orl.
- Je mettrais mon devoir dans l'infidélité !Auteur : Voltaire - Source : Tancr. I, 6
- Un honneste gentilhomme avoit rapporté à une damoiselle de la cour quelque chose en fidelité [en confidence] d'une très grande dameAuteur : BRANT. - Source : Dames gal. t. II, p. 460, dans LACURNE
- Je vous envoie six exemplaires de la deuxième édition du Commentaire [sur les délits et les peines] ; je ne risque que cette demi-douzaine, crainte des écornifleursAuteur : Voltaire - Source : Lett. Christin, 25 févr. 1767
- Quand cette crainte sera effacée dans les sujets comme dans le prince, où sera la fidélité et l'obéissance ?Auteur : ROLLIN - Source : Hist. anc. Oeuvres, t. II, p. 476, dans POUGENS
- Rois Avenir en sa couronne Se delite molt et opose, Car il cuide que nule chose Ne li puist nuire ne retraire Nes [même] un voloir de son affaireAuteur : G. DE CAMBRAI - Source : Barl. et Jos. p. 3
- La fidelité du chien, la puanteur du bouc, la docilité du barbetAuteur : PARÉ - Source : Anim. 1
- Cette fidélité qu'il garde à ses serviteursAuteur : BOSSUET - Source : Hist. II, 6
- Vous voulez vous guérir de l'infidélité, et vous en demandez les remèdes ? apprenez-les de ceux qui ont été liés comme vousAuteur : Blaise Pascal - Source : Moyens d'arriver à la foi, I, édit. FAUGÉRE
- Fidelité, vertu peu frequentée, Rend ceux qui l'ont comparables aux dieuxAuteur : ST-GELAIS - Source : 60
- La populace de Toulouse égorgea le premier président Duranti et l'avocat général Raffis, deux magistrats connus par leur fidélité pour le roi, et par l'intégrité de leur vieAuteur : Voltaire - Source : Hist. parl. ch. 31
- Le duc de Bourgogne alla en la duché de Luxembourg pour renouveler les hommages et les fidelités de ceux de Luxembourg, dont le duc estoit nouvellement seigneurAuteur : OL. DE LA MARCHE - Source : liv. I, p. 332, dans LACURNE
- L'accusateur peut demander qu'on applique à la question les esclaves de la partie adverse ; conçoit-on qu'on exerce une pareille barbarie contre des hommes dont il ne faudrait que tenter la fidélité ?Auteur : BARTHÉL. - Source : Anach. ch. 18
- Les rois, comme ministres de Dieu qui en exercent l'empire, sont avec raison menacés, pour une infidélité particulière, d'une justice plus rigoureuse et de supplices plus exquis....Auteur : BOSSUET - Source : Polit. X, VI, 3
- Hélas ! nous sommes si délicats sur la fidélité de nos amis ! Le moindre refroidissement nous blesse ; le plus léger défaut d'attention nous aigritAuteur : MASS. - Source : Car. Passion.
- Ce qui donnait prétexte aux protestants de préférer leur fidélité à celle des catholiques, c'était la prétention des papes sur la temporalité des roisAuteur : BOSSUET - Source : Déf. var. 1er disc. 55
- Cette lettre, remise aux mains de la police, avait révélé toutes les menées au moyen desquelles M. de Czernicheff était parvenu à corrompre la fidélité des bureauxAuteur : THIERS - Source : Hist. du Cons. et de l'Emp. XLIII
Les mots débutant par Del Les mots débutant par De
Une suggestion ou précision pour la définition de Délit ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 16h24
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur délit
Poèmes délit
Proverbes délit
La définition du mot Délit est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Délit sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Délit présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
