La définition de H du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
H
Nature : s. f.
Prononciation : a-ch'
Etymologie : H latin, H grec, heth phénicien. Le sens et la forme de heth sont d'accord pour signifier une haie, une clôture ; le signe hiéroglyphique de la haie est devenu le caractère de tous les mots commençant par le même son.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de h de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec h pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de H ?
La définition de H
ou, suivant l'épellation nouvelle H (he), s. m. La huitième lettre de l'alphabet. Une grande H. Une petite h.
Toutes les définitions de « h »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
La huitième lettre de l'alphabet. Elle représente une des consonnes. Une H majuscule. Une grande, une petite h. On distingue deux sortes d'H, l'H muette et l'H aspirée. L'H muette est un signe purement orthographique dans les mots tirés du latin qui, dans cette langue, s'écrivaient avec cette lettre : Herbe, Hiver, Héritier, Humble, Heure, Honneur; Appréhender, Exhiber, etc. Dans certains mots qui sont, eux aussi, d'origine latine, une H a été ajoutée pour des causes diverses : Hièble, Huile, Huit, Huître, Bonheur, Malheur. L'H aspirée est un son produit dans le larynx, qui a disparu peu à peu de la prononciation française et qui ne s'entend plus que rarement et surtout dans des interjections comme : Ohé! Hue! Halte! ou quelquefois dans des verbes comme Hennir, Hisser, Hurler. Partout ailleurs, elle est devenue, elle aussi, un signe orthographique, qui sert à empêcher la liaison de la consonne ou l'élision de la voyelle finale d'un mot avec la voyelle initiale du mot suivant. Elle se rencontre à l'initiale de mots qui sont pour la plupart d'origine germanique. C'est honteux. La honte. Un hasard. Le hasard. Des hangars. Le hangar. Une hache. Le héros. Des héros. Elle se rencontre aussi, exceptionnellement, à l'initiale de certains mots d'origine latine. Haut, Hérisson, Herse, Huppe. Dans l'intérieur de quelques mots comme Enhardir, Envahir, Trahir, Cahot, elle sert à maintenir l'hiatus entre deux voyelles. Pour CH, PH, TH, voyez les articles C, P, T.
Littré
- ou, suivant l'épellation nouvelle H (he), s. m. La huitième lettre de l'alphabet. Une grande H. Une petite h.
Dans la prononciation, h s'aspire ou est muette. H muette ne se prononce pas?: habile, huître, etc. dites?: abile, uître etc. H initiale aspirée se prononce et empêche l'élision des voyelles ou la liaison des consonnes, s, t, etc. avec la voyelle qui suit. Ainsi on écrit et on prononce?: le hasard, la haine, belle harangue, etc. Devant les noms féminins qui commencent par une h aspirée, l'adjectif possessif ne prend jamais la forme du masculin?: ma haine, ta hauteur, sa honte.
Je n'aime pas les h aspirées, cela fait mal à la poitrine, je suis pour l'euphonie?; on disait autrefois je hésite, et à présent on dit j'hésite?; on est fou d'Henri IV, et non plus de Henri IV
, Voltaire, Lett. Bordes, 10 juillet 1767. Cette boutade de Voltaire n'est qu'un caprice individuel, l'aspiration est un son qui ne mérite aucune condamnation et qui se trouve dans les langues les plus harmonieuses. Aujourd'hui, surtout à Paris, beaucoup n'aspirent pas l'h et se contentent de marquer l'hiatus?: le éros, la onte, etc.?; mais, dans plusieurs provinces, la Normandie entre autres, l'aspiration est très nettement conservée, et cela vaut mieux.H placée au milieu d'un mot composé est aspirée quand le mot qui entre en composition a, d'origine, une h aspirée?: aheurter, enhardir etc.?; mais elle n'est pas aspirée dans cohue, cohorte, etc.
Quand h est après un t ou une r, ce qui n'arrive que dans les mots tirés du grec, elle est muette?: théologie, rhéteur, rhythme, etc. dites?: téologie, réteur, ritme.
H précédée d'un c rend un son particulier et simple, qui pourrait être figuré par une seule lettre, et qui correspond au sh des Anglais et au sch des Allemands?: chose, chute, cacher, etc.
Mais h également précédée d'un c forme une articulation équivalente à k dans plusieurs mots dérivés du grec, de l'hébreu ou de l'arabe?: chaos, archange, etc. dites?: kaos, arkange, etc.
H, précédée de p, forme une articulation équivalente à f?: philosophie, Joseph, dites?: filosofie, josef.
H, sur les anciennes monnaies de France, indique qu'elles ont été frappées à la Rochelle.
H surmontée d'une couronne indique une pièce frappée sous Henri III et sous Henri IV.
En chimie, H désigne l'hydrogène.
En musique, H chez les Allemands désigne le si.
HISTORIQUE
XIIIe s. Après vous conterai de l'ache, Qui par dessous d'un pié se lace?; Li uns dit ache, l'autre ha?; Sans mouvoir langue dit on?: ha
, Senefiance de l'ABC, dans JUBINAL, t. II, p. 278.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
H. Ajoutez?:Encyclopédie, 1re édition
, substantif féminin, (Gramm.)
c'est la huitieme lettre de notre
alphabet. Voyez Alphabet.
Il n'est pas unanimement avoüé par tous les Grammairiens que ce caractere soit une lettre, & ceux qui en font une lettre ne sont pas même d'accord entre eux ; les uns prétendant que c'est une consonne, & les autres, qu'elle n'est qu'un signe d'aspiration. Il est certain que le plus essentiel est de convenir de la valeur de ce caractere ; mais il ne sçauroit être indifférent à la Grammaire de ne sçavoir à quelle classe on doit le rapporter. Essayons donc d'approfondir cette question, & cherchons-en la solution dans les idées générales.
Les lettres sont les signes des élémens de la voix, savoir des sons & des articulations. Voy. Lettres. Le son est une simple émission de la voix, dont les différences essentielles dépendent de la forme du passage que la bouche prête à l'air qui en est la matiere, voyez Son ; & les voyelles sont les lettres destinées à la représentation des sons. Voyez Voyelles. L'articulation est une modification des sons produite par le mouvement subit & instantané de quelqu'une des parties mobiles de l'organe de la parole ; & les consonnes sont les lettres destinées à la représentation des articulations. Ceci mérite d'être développé.
Dans une thèse soutenue aux écoles de Médecine le 13 Janvier 1757 (an ut cæteris animantibus, ita & homini, sua vox peculiaris ?), M. Savary prétend que l'interception momentanée du son est ce qui constitue l'essence des consonnes, c'est-à-dire en distinguant le signe de la chose signifiée, l'essence des articulations : sans cette interception, la voix ne seroit qu'une cacophonie, dont les variations mêmes seroient sans agrément.
J'avoue que l'interception du son caractérise en quelque sorte toutes les articulations unanimement reconnues, parce qu'elles sont toutes produites par des mouvemens qui embarrassent en effet l'émission de la voix. Si les parties mobiles de l'organe restoient dans l'état où ce mouvement les met d'abord, ou l'on n'entendroit rien, ou l'on n'entendroit qu'un sifflement causé par l'échappement contraint de l'air hors de la bouche : pour s'en assûrer, on n'a qu'à réunir les levres comme pour articuler un p, ou approcher la levre inférieure des dents supérieures, comme pour prononcer un v, & tâcher de produire le son a, sans changer cette position. Dans le premier cas, on n'entendra rien jusqu'à ce que les levres se séparent ; & dans le second cas, on n'aura qu'un sifflement informe.
Voilà donc deux choses à distinguer dans l'articulation ; le mouvement instantané de quelque partie mobile de l'organe, & l'interception momentanée du son : laquelle des deux est représentée par les consonnes ? ce n'est assûrément ni l'une ni l'autre. Le mouvement en soi n'est point du ressort de l'audition ; & l'interception du son, qui est un véritable silence, n'en est pas davantage. Cependant l'oreille distingue très-sensiblement les choses représentées par les consonnes ; autrement quelle différence trouveroit-elle entre les mots vanité, qualité, qui se réduisent également aux trois sons a-i-é, quand on en supprime les consonnes ?
La vérité est que le mouvement des parties mobiles de l'organe est la cause physique de ce qui fait l'essence de l'articulation ; l'interception du son est l'effet immédiat de cette cause physique à l'égard de certaines parties mobiles : mais cet effet n'est encore qu'un moyen pour amener l'articulation même.
L'air est un fluide qui dans la production de la voix s'échappe par le canal de la bouche ; il lui arrive alors, comme à tous les fluides en pareille circonstance, que sous l'impression de la même force, ses efforts pour s'échapper, & sa vîtesse en s'échappant, croissent en raison des obstacles qu'on lui oppose ; & il est très-naturel que l'oreille distingue les différens degrés de la vîtesse & de l'action d'un fluide qui agit sur elle immédiatement. Ces accroissemens d'action instantanés comme la cause qui les produit, c'est ce qu'on appelle explosion. Ainsi les articulations sont les différens degrés d'explosion que reçoivent les sons par le mouvement subit & instantané de quelqu'une des parties mobiles de l'organe.
Cela posé, il est raisonnable de partager les articulations & les consonnes qui les représentent en autant de classes qu'il y a de parties mobiles qui peuvent procurer l'explosion aux sons par leur mouvement : de-là trois classes générales de consonnes, les labiales, les linguales, & les gutturales, qui représentent les articulations produites par le mouvement ou des levres, ou de la langue, ou de la trachée-artere.
L'aspiration n'est autre chose qu'une articulation gutturale, & la lettre h, qui en est le signe, est une consonne gutturale. Ce n'est point par les causes physiques qu'il faut juger de la nature de l'articulation ; c'est par elle-même : l'oreille en discerne toutes les variations, sans autre secours que sa propre sensibilité ; au lieu qu'il faut les lumieres de la Physique & de l'Anatomie pour en connoître les causes. Que l'aspiration n'occasionne aucune interception du son, c'est une vérité incontestable ; mais elle n'en produit pas moins l'explosion, en quoi consiste l'essence de l'articulation ; la différence n'est que dans la cause. Les autres articulations, sous l'impression de la même force expulsive, procurent aux sons des explosions proportionnées aux obstacles qui embarrassent l'émission de la voix : l'articulation gutturale leur donne une explosion proportionnée à l'augmentation même de la force expulsive.
Aussi l'explosion gutturale produit sur les sons le même effet général que toutes les autres, une distinction qui empêche de les confondre, quoique pareils & consécutifs : par exemple, quand on dit la halle ; le second a est distingué du premier aussi sensiblement par l'aspiration h, que par l'articulation b, quand on dit la balle, ou par l'articulation s, quand on dit la salle. Cet effet euphonique est nettement désigné par le nom d'articulation, qui ne veut dire autre chose que distinction des membres ou des parties de la voix.
La lettre h, qui est le signe de l'explosion gutturale, est donc une véritable consonne, & ses rapports analogiques avec les autres consonnes, sont autant de nouvelles preuves de cette décision.
1°. Le nom épellatif de cette lettre, si je puis parler ainsi, c'est-à-dire le plus commode pour la facilité de l'épellation, emprunte nécessairement le secours de l'e muet, parce que h, comme toute autre consonne, ne peut se faire entendre qu'avec une voyelle ; l'explosion du son ne peut exister sans le son. Ce caractere se prête donc, comme les autres consonnes, au système d'épellation proposé dès 1660 par l'auteur de la Grammaire générale, mis dans tout son jour par M. Dumas, & introduit aujourd'hui dans plusieurs écoles depuis l'invention du bureau typographique.
2°. Dans l'épellation on substitue à cet e muet la voyelle nécessaire, comme quand il s'agit de toute autre consonne : de même qu'avec b on dit, ba, bé, bi, bo, bu, &c. ainsi avec h on dit, ha, hé, hi, ho, hu, &c. comme dans hameau, héros, hibou, hoqueton, hupé, &c.
3°. Il est de l'essence de toute articulation de précéder le son qu'elle modifie, parce que le son une fois échappé n'est plus en la disposition de celui qui parle, pour en recevoir quelque modification. L'articulation gutturale se conforme ici aux autres, parce que l'augmentation de la force expulsive doit précéder l'explosion du son, comme la cause précede l'effet. On peut reconnoître par-là la fausseté d'une remarque que l'on trouve dans la Grammaire françoise de M. l'abbé Regnier (Paris, 1706, in-12, p. 31.), & qui est répétée dans la Prosodie françoise de M. l'abbé d'Olivet, page 36. Ces deux auteurs disent que l'h est aspirée à la fin des trois interjections ah, eh, oh. A la vérité l'usage de notre orthographe place ce caractere à la fin de ces mots ; mais la prononciation renverse l'ordre, & nous disons, ha, hé, ho. Il est impossible que l'organe de la parole fasse entendre la voyelle avant l'aspiration.
4°. Les deux lettres f & h ont été employées l'une pour l'autre ; ce qui suppose qu'elles doivent être de même genre. Les Latins ont dit fircum pour hircum, fostem pour hostem, en employant f pour h ; & au contraire ils ont dit heminas pour feminas, en employant h pour f. Les Espagnols ont fait passer ainsi dans leur langue quantité de mots latins, en changeant f en h : par exemple, ils disent, hablar, (parler), de fabulari ; hazer, (faire), de facere ; herir, (blesser), de ferire ; hado, (destin), de fatum ; higo, (figue), de ficus ; hogar, (foyer), de focus, &c.
Les Latins ont aussi employé v ou s pour h, en adoptant des mots grecs : veneti vient de ??????, Vesta de ?????, vestis de ?????, ver de ??, &c. & de même super vient de ????, septem de ????, &c.
L'auteur des grammaires de Port-Royal fait entendre dans sa Méthode espagnole, part. I. chap. iij. que les effets presque semblables de l'aspiration h & du sifflement f ou v ou s, sont le fondement de cette commutabilité ; & il insinue dans la Méthode latine, que ces permutations peuvent venir de l'ancienne figure de l'esprit rude des Grecs, qui étoit assez semblable à f, parce que, selon le témoignage de S. Isidore, on divisa perpendiculairement en deux parties égales la lettre H, & l'on prit la premiere moitié I- pour signe de l'esprit rude, & l'autre moitié -I pour symbole de l'esprit doux. Je laisse au lecteur à juger du poids de ces opinions, & je me réduis à conclure tout de nouveau que toutes ces analogies de la lettre h avec les autres consonnes, lui en assûrent incontestablement la qualité & le nom.
Ceux qui ne veulent pas en convenir soûtiennent, dit M. du Marsais, que ce signe ne marquant aucun son particulier analogue au son des autres consonnes, il ne doit être considéré que comme un signe d'aspiration. Voyez Consonne. Je ne ferai point remarquer ici que le mot son y est employé abusivement, ou du moins dans un autre sens que celui que je lui ai assigné dès le commencement, & je vais au contraire l'employer de la même maniere, afin de mieux assortir ma réponse à l'objection : je dis donc qu'elle ne prouve rien, parce qu'elle prouveroit trop. On pourroit appliquer ce raisonnement à telle classe de consonne que l'on voudroit, parce qu'en général les consonnes d'une classe ne marquent aucun son particulier analogue au son des consonnes d'une autre classe : ainsi l'on pourroit dire, par exemple, que nos cinq lettres labiales b, p, v, f, m, ne marquant aucuns sons particuliers analogues aux sons des autres consonnes, elles ne doivent être considérées que comme les signes de certains mouvemens des levres. J'ajoûte que ce raisonnement porte sur un principe faux, & qu'en effet la lettre h désigne un objet de l'audition très-analogue à celui des autres consonnes, je veux dire une explosion réelle des sons. Si l'on a cherché l'analogie des consonnes ou des articulations dans quelque autre chose, c'est une pure méprise.
Mais, dira-t-on, les Grecs ne l'ont jamais regardée comme telle ; c'est pour cela qu'ils ne l'ont point placée dans leur alphabet, & que dans l'écriture ordinaire ils ne la marquent que comme les accens au-dessus des lettres : & si dans la suite ce caractere a passé dans l'alphabet latin, & de-là dans ceux des langues modernes, cela n'est arrivé que par l'indolence des copistes qui ont suivi le mouvement des doigts & écrit de suite ce signe avec les autres lettres du mot, plûtôt que d'interrompre ce mouvement pour marquer l'aspiration au-dessus de la lettre. C'est encore M. du Marsais (ibid.) qui prête ici son organe à ceux qui ne veulent pas même reconnoître h pour une lettre ; mais leurs raisons demeurent toujours sans force sous la main même qui étoit la plus propre à leur en donner.
Que nous importe en effet que les Grecs ayent regardé ou non ce caractere comme une lettre, & que dans l'écriture ordinaire ils ne l'ayent pas employé comme les autres lettres ? n'avons-nous pas à opposer à l'usage des Grecs celui de toutes les Nations de l'Europe, qui se servent aujourd'hui de l'alphabet latin, qui y placent ce caractere, & qui l'employent dans les mots comme toutes les autres lettres ? Pourquoi l'autorité des modernes le céderoit-elle sur ce point à celle des anciens, ou pourquoi ne l'emporteroit-elle pas, du-moins par la pluralité des suffrages ?
C'est, dit-on, que l'usage moderne ne doit son origine qu'à la négligence de quelques copistes malhabiles, & que celui des Grecs paroît venir d'une institution réfléchie. Cet usage qu'on appelle moderne est pourtant celui de la langue hébraique, dont le hé ?, n'est rien autre chose que notre h ; & cet usage paroît tenir de plus près à la premiere institution des lettres, & au seul tems où, selon la judicieuse remarque de M. Duclos (Remarq. sur le v. chap. de la I. part. de la Grammaire générale.), l'orthographe ait été parfaite.
Les Grecs eux-mêmes employerent au commencement le caractere ?, qu'ils nomment aujourd'hui ???, à la place de l'esprit rude qu'ils introduisirent plus tard ; d'anciens grammairiens nous apprennent qu'ils écrivoient ????? pour ???, ??????? pour ??????, & qu'avant l'institution des consonnes aspirées, ils écrivoient simplement la ténue & ? ensuite, ????? pour ????. Nous avons fidélement copié cet ancien usage des Grecs dans l'orthographe des mots que nous avons empruntés d'eux, comme dans rhétorique, théologie ; & eux-mêmes n'étoient que les imitateurs des Phéniciens à qui ils devoient la connoissance des lettres, comme l'indique encore le nom grec ???, assez analogue au nom hé ou heth des Phéniciens & des Hébreux.
Ceux donc pour qui l'autorité des Grecs est une raison déterminante, doivent trouver dans cette pratique un témoignage d'autant plus grave en faveur de l'opinion que je défens ici, que c'est le plus ancien usage, &, à tout prendre, le plus universel, puisqu'il n'y a guere que l'usage postérieur des Grecs qui y fasse exception.
Au surplus, il n'est pas tout-à-fait vrai qu'ils n'ayent employé que comme les accens le caractere qu'ils ont substitué à h. Ils n'ont jamais placé les accens que sur des voyelles, parce qu'il n'y a en effet que les sons qui soient susceptibles de l'espece de modulation qu'indiquent les accens, & que cette sorte de modification est très-différente de l'explosion désignée par les consonnes. Mais ce que la grammaire greque nomme esprit se trouve quelquefois sur les voyelles & quelquefois sur des consonnes. Voyez Esprit.
Dans le premier cas, il en est de l'esprit sur la voyelle, comme de la consonne qui la précede ; & l'on voit en effet que l'esprit se transforme en une consonne, ou la consonne en un esprit, dans le passage d'une langue à une autre ; le ?? grec devient ver en latin ; le fabulari latin devient hablar en espagnol. On n'a pas d'exemple d'accens transformés en consonnes, ni de consonnes métamorphosées en accens.
Dans le second cas, il est encore bien plus évident que ce qu'indique l'esprit est de même nature que ce dont la consonne est le signe. L'esprit & la consonne ne sont associés que parce que chacun de ces caracteres représente une articulation, & l'union des deux signes est alors le symbole de l'union des deux causes d'explosion sur le même son. Ainsi le son ? de la premiere syllabe du mot grec ??? est articulé comme le même son e dans la premiere syllabe du mot latin creo : ce son dans les deux langues est précédé d'une double articulation ; ou, si l'on veut, l'explosion de ce son y a deux causes.
Non-seulement les Grecs ont placé l'esprit rude sur des consonnes, ils ont encore introduit dans leur alphabet des caracteres représentatifs de l'union de cet esprit avec une consonne, de même qu'ils en ont admis d'autres qui représentent l'union de deux consonnes : ils donnent aux caracteres de la premiere espece le nom de consonnes aspirées, ?, ?, ?, & à ceux de la seconde le nom de consonnes doubles, ?, ?, ?. Comme les premieres sont nommées aspirées, parce que l'aspiration leur est commune & semble modifier la premiere des deux articulations, on pouvoit donner aux dernieres la dénomination de sifflantes, parce que le sifflement leur est commun & y modifie aussi la premiere articulation : mais les unes & les autres sont également doubles & se décomposent effectivement de la même maniere. De même que ? vaut ??, que ? vaut ??, & que ? vaut ?? ; ainsi ? vaut ??, ? vaut ??, & ? vaut ??.
Il paroît donc qu'attribuer l'introduction de la lettre h dans l'alphabet à la prétendue indolence des copistes, c'est une conjecture hasardée en faveur d'une opinion à laquelle on tient par habitude, ou contre un sentiment dont on n'avoit pas approfondi les preuves, mais dont le fondement se trouve chez les Grecs mêmes à qui l'on prête assez légerement des vûes tout opposées.
Quoi qu'il en soit, la lettre h a dans notre orthographe différens usages qu'il est essentiel d'observer.
I. Lorsqu'elle est seule avant une voyelle dans la même syllabe, elle est aspirée ou muette.
1°. Si elle est aspirée, elle donne au son de la voyelle suivante cette explosion marquée qui vient de l'augmentation de la force expulsive, & alors elle a les mêmes effets que les autres consonnes. Si elle commence le mot, elle empêche l'élision de la voyelle finale du mot précédent, ou elle en rend muette la consonne finale. Ainsi au lieu de dire avec élision funest' hasard en quatre syllabes, comme funest' ardeur, on dit funest-e-hasard en cinq syllabes, comme funest-e combat ; au contraire, au lieu de dire au pluriel funeste-s hasards comme funeste-s ardeurs, on prononce sans s funest' hasards, comme funeste' combats.
2°. Si la lettre h est muette, elle n'indique aucune explosion pour le son de la voyelle suivante, qui reste dans l'état naturel de simple émission de la voix ; dans ce cas, h n'a pas plus d'influence sur la prononciation que si elle n'étoit point écrite : ce n'est alors qu'une lettre purement étymologique, que l'on conserve comme une trace du mot radical où elle se trouvoit, plûtôt que comme le signe d'un élément réel du mot où elle est employée ; & si elle commence le mot, la lettre finale du mot précédent, soit voyelle, soit consonne, est réputée suivie immédiatement d'une voyelle. Ainsi au lieu de dire sans élision titr-e honorable, comme titr-e favorable, on dit titr' honorable avec élision, comme titr' onéreux : au contraire, au lieu de dire au pluriel titre' honorables, comme titre' favorables, on dit, en prononçant s, titre-s honorables, comme titre-s onéreux.
Notre distinction de l'h aspirée & de l'h muette répond à celle de l'esprit rude & de l'esprit doux des Grecs ; mais notre maniere est plus gauche que celle des Grecs, puisque leurs deux esprits avoient des signes différens, & que nos deux h sont indiscernables par la figure.
Il semble qu'il auroit été plus raisonnable de supprimer de notre orthographe tout caractere muet ; & celle des Italiens doit par-là même arriver plûtôt que la nôtre à son point de perfection, parce qu'ils ont la liberté de supprimer les h muettes ; nomo, homme ; uomini, hommes ; avere, avoir, &c.
Il seroit du-moins à souhaiter que l'on eût quelques regles générales pour distinguer les mots où l'on aspire h, de ceux où elle est muette : mais celles que quelques-uns de nos grammairiens ont imaginées sont trop incertaines, fondées sur des notions trop éloignées des connoissances vulgaires, & sujettes à trop d'exceptions : il est plus court & plus sûr de s'en rapporter à une liste exacte des mots où l'on aspire. C'est le parti qu'a pris M. l'abbé d'Olivet, dans son excellent Traité de la Prosodie françoise : le lecteur ne sauroit mieux faire que de consulter cet ouvrage, qui d'ailleurs ne peut être trop lû par ceux qui donnent quelque soin à l'étude de la langue françoise.
II. Lorsque la lettre h est précédée d'une consonne dans la même syllabe, elle est ou purement étymologique, ou purement auxiliaire, ou étymologique & auxiliaire tout à-la-fois. Elle est-étymologique, si elle entre dans le mot écrit par imitation du mot radical d'où il est dérivé ; elle est auxiliaire, si elle sert à changer la prononciation naturelle de la consonne précédente.
Les consonnes après lesquelles nous l'employons en françois sont c, l, p, r, t.
1°. Après la consonne c, la lettre h est purement auxiliaire, lorsqu'avec cette consonne elle devient le type de l'articulation forte dont nous représentons la foible par j, & qu'elle n'indique aucune aspiration dans le mot radical : telle est la valeur de h dans les mots chapeau, cheval chameau, chose, chûte, &c. L'orthographe allemande exprime cette articulation par sch, & l'orthographe angloise par sh.
Après c la lettre h est purement étymologique dans plusieurs mots qui nous viennent du grec ou de quelque langue orientale ancienne, parce qu'elle ne sert alors qu'à indiquer que les mots radicaux avoient un k aspiré, & que dans le mot dérivé elle laisse au c la prononciation naturelle du k, comme dans les mots, Achaïe, Chersonèse, Chiromancie, Chaldée, Nabuchodonosor, Achab, que l'on prononce comme s'il y avoit Akaie, Kersonèse, Kiromancie, Kaldée, Nabukodonosor, Akab.
Plusieurs mots de cette classe étant devenus plus communs que les autres parmi le peuple, se sont insensiblement éloignés de leur prononciation originelle, pour prendre celle du ch françois. Les fautes que le peuple commet d'abord par ignorance deviennent enfin usage à force de répétitions, & font loi, même pour les savans. On prononce donc aujourd'hui à la françoise, archevêque, archiépiscopal ; Achéron prédominera enfin, quoique l'opéra paroisse encore tenir pour Akéron. Dans ces mots la lettre h est auxiliaire & étymologique tout à-la-fois.
Dans d'autres mots de même origine, où elle n'étoit qu'étymologique, elle en a été supprimée totalement ; ce qui assûre la durée de la prononciation originelle & de l'orthographe analogique : tels sont les mots caractere, colere, colique, qui s'écrivoient autrefois charactere, cholere, cholique. Puisse l'usage amener insensiblement la suppression de tant d'autres lettres qui ne servent qu'à défigurer notre orthographe ou à l'embarrasser !
2°. Après la consonne l la lettre h est purement auxiliaire dans quelques noms propres, où elle donne à l la prononciation mouillée ; comme dans Milhaud (nom de ville), où la lettre l se prononce comme dans billot.
3°. H est tout à-la-fois auxiliaire & étymologique dans ph ; elle y est étymologique, puisqu'elle indique que le mot vient de l'hébreu ou du grec, & qu'il y a à la racine un p avec aspiration, c'est-à-dire un phé ?, ou un phi ? : mais cette lettre est en même tems auxiliaire, puisqu'elle indique un changement dans la prononciation originelle du p, & que ph est pour nous un autre symbole de l'articulation déjà désignée par s. Ainsi nous prononçons, Joseph, philosophe, comme s'il y avoit Josef, filosofe.
Les Italiens employent tout simplement f au lieu de ph ; en cela ils sont encore plus sages que nous, & n'en sont pas moins bons étymologistes.
4°. Après les consonnes r & t, la lettre h est purement étymologique ; elle n'a aucune influence sur la prononciation de la consonne précédente, & elle indique seulement que le mot est tiré d'un mot grec ou hébreu, où cette consonne étoit accompagnée de l'esprit rude, de l'aspiration, comme dans les mots rhapsodie, rhétorique, théologie, Thomas. On a retranché cette h étymologigue de quelques mots, & l'on a bien fait : ainsi l'on ecrit, trésor, trône, sans h ; & l'orthographe y a gagné un degré de simplification.
Qu'il me soit permis de terminer cet article par une conjecture sur l'origine du nom ache que l'on donne à la lettre h, au lieu de l'appeller simplement he en aspirant l'e muet, comme on devroit appeller be, pe, de, me, &c. les consonnes b, p, d, m, &c.
On distingue dans l'alphabet hébreu quatre lettres gutturales, ?, ? ,? ,?, aleph, hé, kheth, aïn, & on les nomme ahécha (Grammaire hébraïque par M. l'abbé Ladvocat, page 6.). Ce mot factice est évidemment résulté de la somme des quatre gutturales, dont la premiere est a, la seconde hé, la troisiéme kh ou ch, & la quatriéme a ou ha. Or ch, que nous prononçons quelquefois comme dans Chalcédoine, nous le prononçons aussi quelquefois comme dans chanoine ; & en le prononçant ainsi dans le mot factice des gutturales hébraïques, on peut avoir dit de notre h que c'étoit une lettre gutturale, une lettre ahécha, par contraction une acha, & avec une terminaison françoise, une ache. Combien d'étymologies reçûes qui ne sont pas fondées sur autant de vraissemblance ! (B. E. R. M.)
* h, (Ecriture.) Il y a dans l'Ecriture trois sortes d'h, l'italienne, la coulée, & la ronde : l'italienne se forme de la partie du milieu de l'f, de la premiere partie de l'x pour sa tête, avec la premiere & la septieme partie de l'o : la coulée a les mêmes racines, si l'on en excepte sa tête, qui se tire aussi des sixieme, septieme, huitieme, & premiere parties de l'o : la ronde est un assemblage des huitieme, premiere & seconde parties de l'o ; elle prend son milieu de l'f, & la partie inférieure de l'j consonne rond ; pour son extrémité supérieure, c'est la deuxieme partie de la courbe supérieure de la seconde partie de l'o. Ces trois h se forment toutes du mouvement mixte des doigts & du poignet. Voyez nos Planches d'Ecriture.
Wiktionnaire
Nom commun - français
h \??\ féminin, (Abréviation)
-
Heures, par exemple dans l'écriture de l'heure du jour (dans ce cas, précédé par un ou deux chiffres signifiant l'heure, et pouvant être suivi de deux chiffres signifiant les minutes).
- Ça me fait penser à allumer la téloche pour regarder les infos de 9 h. J'attrape la télécommande et je mets la dix. ? (Boris Tzaprenko, Noti Flap, vol.2 : Tribulations détectivesques méziguifères, (autoédition), 2013, page 96)
- Challengez-vous avec la randonnée (8h environ) autour de la rivière des Remparts qui relie le volcan à l'océan. ? (journal 20 minutes, 30 novembre 2018)
Trésor de la Langue Française informatisé
H, h, subst.
La huitième lettre de l'alphabet; exemplaire de cette lettre. On y rencontre fréquemment des K, des Y, des H et des W, quoiqu'il [l'auteur dans son ?uvre antérieure] n'ait jamais employé ces caractères romantiques qu'avec une extrême sobriété (Hugo, Han d'Isl.,1823, p. 6) :H, h, subst.
La huitième lettre de l'alphabet; exemplaire de cette lettre. On y rencontre fréquemment des K, des Y, des H et des W, quoiqu'il [l'auteur dans son ?uvre antérieure] n'ait jamais employé ces caractères romantiques qu'avec une extrême sobriété (Hugo, Han d'Isl.,1823, p. 6) :H au Scrabble
Le mot h vaut 4 points au Scrabble.
Informations sur le mot h - 1 lettres, 0 voyelles, 1 consonnes, 1 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot h au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
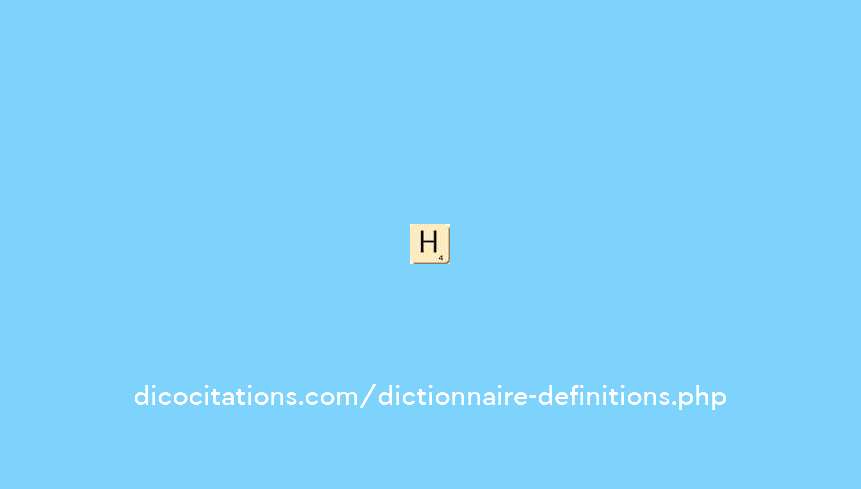
Les mots proches de H
H Ha Habchot Habile Habilement Habileté Habilitation Habilité Habilité, ée Habiliter Habillage Habillé, ée Habillement Habiller Habilleur Habit Habitable Habitacle Habitant, ante Habitat Habitateur Habitation Habité, ée Habiter Habituation Habitude Habituel, elle Habituellement Habituer Hâbler Hâblerie Hâbleur, euse Habous Habousant Habousé, ée Hachage Hache Haché, ée Hacher Hachereau Hacheron Hachette Hacheur Hachis Hachot Hadock ou hadot Hagard, arde Hagardement Hagiographe Hague H?dic H?nheim H?rdt ha ha Haacht Haaltert Haasdonk Haasrode habanera Habarcq Habas Habay Habay-la-Neuve Habay-la-Vieille Habère-Lullin Habère-Poche Habergy habile habilement habiles habileté habiletés habilitation habilitations habilite habilité habilité habilité habilitée habilitée habilitées habilitées habilités habilités habilités habilla habillage habillai habillaient habillais habillait habillâmes habillant habillas habillât habille habillé habillé habilléeMots du jour
Féminin, ine Égratigneur, euse Poncire Irréplicable Massacrant, ante Galamment Contrôler Loup-cervier Courante Catégoriser
Les citations avec le mot H
- L'effet des richesses d'un pays, c'est de mettre de l'ambition dans tous les coeurs. L'effet de la pauvreté est d'y faire naître le désespoir. La première s'irrite par le travail; l'autre se console par la paresse.Auteur : Charles de Secondat, baron de Montesquieu - Source : Sans référence
- La tragédie de l'humanité, prophétisait Shealtiel, n'est pas que les persécutés et les opprimés aspirent à s'affranchir et à redresser la tête. Non. Le pire est que les opprimés rêvent de devenir les bourreaux de ceux qui les oppriment. L'opprimé aspire à opprimer. L'esclave à devenir le maître. Comme dans le livre d'Esther.Auteur : Amos Oz - Source : Judas
- Car le b.a.-ba de l'humanisme, c'est de voir en chaque être humain une richesse pour le monde et non une bouche à nourrir, un tube qui produit du CO2, un ver intestinal de la nature.Auteur : Iegor Gran - Source : L'écologie en bas de chez moi (2011)
- L'agriculture est la base et la force de la prospérité du pays. L'industrie est l'aisance, le bonheur de la population.Auteur : Napoléon Bonaparte - Source : Cité par Las Cases dans le Mémorial de Sainte-Hélène.
- La formation c'est tout. La pêche a commencé par être une amande amère; le chou-fleur n'est jamais qu'un chou qui a été au collège.Auteur : Mark Twain - Source : Le Calendrier de Prudd'nhead Wilson
- Nous z'autres, en Algérie, sept langues faut qu'on tourne en même temps avant de bien parler pataouète! Le français naturel, l'espagnol, l'italien, le grec, le provençal, l'arabe et le judéo-arabe. Vous vous rendez compte cette richesse lingouistisque?Auteur : Roland Bacri - Source : Textes choisis (1976)
- Le monde aura beau changer, les chats ne pondront pas.Auteur : Proverbes africains - Source : Proverbe
- Il est impossible que deux têtes humaines conçoivent le même sujet absolument de la même manière.Auteur : Victor Hugo - Source : Littérature et philosophie mêlées (1834)
- M. Pericourt n'avait pas insisté, bataille perdue d'avance. Il s'était contenté, prudent, d'imposer des limites. Chez les bourgeois cela s'appelle un contrat de mariage.Auteur : Pierre Lemaitre - Source : Au revoir là-haut (2013)
- Il se laissa envahir par un sentiment de triomphe. Pour la première fois de sa vie il s'était montré digne de l'assertion première d'Isabelle : on ne peut pas tuer ce qui refuse de mourir.Auteur : Tristan Egolf - Source : Le Seigneur des porcheries (1998)
- L'amour est un dérèglement d'esprit qui nous entraîne vers un objet, et nous y attache malgré nous: c'est une maladie qui nous vient comme la rage aux animaux.Auteur : Alain René Lesage - Source : Histoire de Gil Blas de Santillane (1724)
- L'amour est la seule liberté qui soit au monde, car il élève si haut l'esprit que les hommes et les phénomènes de la nature ne peuvent altérer son cours.Auteur : Khalil Gibran - Source : L'oeil du prophète (1991)
- La mort a grimpé par nos fenêtres, - elle est entrée dans nos palais, - elle a fauché l'enfant dans la rue, - les jeunes gens sur les places.Auteur : La Bible - Source : Jérémie, IX, 20
- Docteur, je bafoue la science gentilhomme, je déchire mon nom prêtre, je fais du missel un oreiller de luxure, je crache au visage de mon Dieu ! Tout cela pour toi, enchanteresse ! Pour être plus digne de ton enfer : et tu ne veux pas du damné !Auteur : Victor Hugo - Source : Notre-Dame de Paris (1831)
- Les formes de la société sont comme les vêtements: elles servent à couvrir des défauts et des plaies secrètes qui restent cachées jusqu'à ce que l'intimité vienne à les découvrir; aussi l'homme sage ne la provoque-t-il pas légèrement.Auteur : Henri Beyle, dit Stendhal - Source : Lettres à Pauline, 4 juin 1810
- Il n'y a pas de repos pour les peuples libres; le repos, c'est une idée monarchique.Auteur : Georges Clemenceau - Source : A la Chambre, 1883
- C'est avec éclat - Que je veux aujourd'hui me venger au sénat.Auteur : Voltaire - Source : Catilina, ou Rome sauvée (1752), II, 3
- L’épidémie nous encourage à nous considérer comme les membres d’une collectivité. Elle nous oblige à accomplir un effort d’imagination auquel nous ne sommes pas accoutumés : voir que nous sommes inextricablement reliés les uns aux autres et tenir compte de la présence d’autrui dans nos choix individuels. Dans la contagion, nous sommes un organisme unique. Dans la contagion, nous redevenons une communauté. Auteur : Paolo Giordano - Source : Contagions (2020)
- Ta mère est tellement bête que quand elle joue avec le chien c'est elle qui va chercher la balle!Auteur : Jacques Essebag, dit Arthur - Source : Sans référence
- Je juge les régimes politiques à la quantité de nourriture qu'ils donnent à chacun, et lorsqu'ils y attachent un fil quelconque, lorsqu'ils y mettent des conditions, je les vomis : les hommes ont le droit de manger sans conditions.Auteur : Romain Gary - Source : La Promesse de l' aube (1960)
- Avec cent lapins on ne fabriquera jamais un cheval, avec cent soupçons on ne fabriquera jamais une preuve.Auteur : Fiodor Dostoïevski - Source : Crime et Châtiment (1866)
- On n'est jamais si malheureux qu'on croit, ni si heureux qu'on avait espéré.Auteur : François de La Rochefoucauld - Source : Maximes supprimées, 572
- Epoux: Individu à ne pas prendre homo.Auteur : Marc Escayrol - Source : Mots et Grumots (2003)
- Je pense qu'il est impossible d'être chef d'entreprise sans un minimum d'audace Auteur : Carlos Ghosn - Source : La Cité de la réussite 2014
- De rien je ne peux dire: «ceci m'appartient», dit Bouddha, et rien ne me permet de dire: «ça, c'est moi»Auteur : Jostein Gaarder - Source : Le monde de Sophie (1991)
Les citations du Littré sur H
- Il [le duc de Gesvres] fit partout dans le lit, tellement qu'il fallut passer une partie de la nuit à les torcher [lui et sa femme] et à changer de toutAuteur : SAINT-SIMON - Source : 141, 258
- Ils ne voudront pas m'empêcher d'être juste au rendez-vous que vous m'avez donnéAuteur : Madame de Sévigné - Source : 1er juill. 1685
- Si nous entendons du Messie ce grand passage où Isaïe nous représente si vivement l'homme de douleurs frappé pour nos péchés et défiguré comme un lépreuxAuteur : BOSSUET - Source : Hist. II, 10
- Ainçois l'en doit on bon gré savoir quant il esclarchissent les cozes que lor anchisseur tinrent orbementAuteur : BEAUMANOIR - Source : XXIV, 5
- Et lui portoient renommée ceux du pays qui le connaissoient [le roi de Portugal] que encore estoit-il caste et n'avoit oncques eu compagnie charnellement avec une femmeAuteur : Jean Froissard - Source : II, III, 56
- Que je hais ta vaine science et ta mauvaise subtilité, âme téméraire, qui prononces si hardiment : le péché que je commets est véniel !Auteur : BOSSUET - Source : Mar.-Thér.
- Cet esprit de prosélytisme que les Juifs ont pris des Égyptiens, et qui d'eux est passé, comme une maladie épidémique et populaire, aux mahométans et aux chrétiensAuteur : Montesquieu - Source : Lett. pers. 85
- Enfants d'un père charnel, nous naissons tous charnels comme luiAuteur : MASS. - Source : Carême, Culte.
- La faiblesse aux humains n'est que trop naturelleAuteur : Jean Racine - Source : Phèdre, IV, 6
- Licencié sous la cheminéeAuteur : COTGRAVE - Source :
- Bien des peintres sont tombés dans le défaut de mettre des contrastes partout et sans ménagement, de sorte que, lorsqu'on voit une figure, on devine d'abord la disposition de celles d'à côté ; cette continuelle diversité devient quelque chose de semblableAuteur : Montesquieu - Source : Goût, contrastes.
- La gloire des méchants en un moment s'éteint ; L'affreux tombeau pour jamais les dévoreAuteur : Jean Racine - Source : ib. II, 9
- Voyez si c'est vous rendre un fort méchant officeAuteur : Corneille - Source : Sophon. II, 3
- À la fin mon père envoya chercher ses provisions de grand écuyer ; elles n'étaient pas, disait-on, expédiéesAuteur : SAINT-SIMON - Source : 8, 103
- Et je ne pense pas que Satan en personne Puisse être si méchant qu'une telle friponneAuteur : Molière - Source : Éc. des mar. III, 10
- Persée estoit sur le haut de la roche, Ayant au poing sa cimiterre crocheAuteur : RONS. - Source : 612
- Le philosophe consume sa vie à observer les hommesAuteur : LA BRUY. - Source : I
- Le plus dangereux, le plus pernicieux de tous [les systèmes] est celui de Spinosa ; ... son système d'athéisme est mieux lié, mieux raisonné mille fois que ceux de Straton et d'ÉpicureAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Liberté d'imprimer.
- Ils trouvoient peu de bonnes eaux et de fresches pour temprer leur vin, ni eux rafreschirAuteur : Jean Froissard - Source : II, III, 82
- Ce que je dis ici, partout je le dirai, C'est que l'honneur, monsieur, vous fut toujours sacré, Et qu'en le proclamant par un public hommage Je venge la vertu dans sa plus noble imageAuteur : C. DELAV. - Source : la Popular. V, 6
- Le jour d'hier meurt en celuy du jour d'huy, et le jour d'huy mourra en celuy de demainAuteur : MONT. - Source : II, 378
- Voyez ces ajustements, jupes étroites, jupes en lanterne, coiffures en clocher, coiffures sur le nez, capuchon sur la tête, et toutes les modes les plus extravagantesAuteur : MARIV. - Source : la Double surprise de l'amour, I, 2
- Aussi y a il des pertes [défaites] triumphantes à l'envy des victoiresAuteur : MONT. - Source : I, 243
- Il ne les hausse pas jusqu'à la truculence en appuyant un croc de sanglier sur une lèvre calleuse, comme en ont les vieilles des Tentations de saint Antoine de TéniersAuteur : TH. GAUTIER - Source : Portraits contemp. Henri Monnier
- Il m'est plus indifférent que haïssableAuteur : SCARRON - Source : Rom. com. II, 19
Les mots débutant par H Les mots débutant par H
Une suggestion ou précision pour la définition de H ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 01h30
H
- Habit - Habitat - Habitude - Haine - Haïr - Hair - Hasard - Hate - Hebergement - Heresie - Heritage - Heroisme - Heros - Heure - Heure - Heureux - Hierarchie - Histoire - Homme - Homme femme - Homme heureux - Homosexualite - Honnête - Honnêteté - Honnêteté - Honneur - Honte - Horizon - Hote - Hotel - Humain - Humanisme - Humanite - Humeur - Humiliation - Humilité - Humilite - Humoristique - Humour - Hypocrisie
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur h
Poèmes h
Proverbes h
La définition du mot H est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot H sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification H présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
