La définition de Banque du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.
Banque
Nature : s. f.
Prononciation : ban-k'
Etymologie : Ital. banca ou banco, banque, proprement banc (voy. ), à cause du banc qu'avaient à l'origine, comme beaucoup d'autres marchands, ceux qui faisaient le commerce d'argent.
Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de banque de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.
Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec banque pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Banque ?
La définition de Banque
Originairement, commerce d'argent qu'on fait remettre de place en place, d'une ville à une autre, par le moyen des lettres de change ; établissement qui se chargeait de l'argent des particuliers pour le faire valoir à gros intérêts ou le mettre en sûreté. Faire la banque, faire ce genre de commerce.
Toutes les définitions de « banque »
Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition
Commerce qui consiste à recevoir des capitaux en compte courant avec ou sans intérêt; à échanger des effets ou à les escompter avec des espèces, à des taux et moyennant des commissions variables; à exécuter pour le compte de tiers toutes opérations de ce genre et à se charger de tous services financiers; à créer et à émettre des lettres de change; d'une façon générale, Commerce de l'argent, ainsi que des titres et valeurs. Ce négociant fait la banque, entend bien la banque. On disait de même autrefois Tenir la banque. Tenir banque ouverte. Il désigne particulièrement l'Établissement où se fait ce commerce. Maison de banque, ou simplement Banque, Maison où l'on fait le commerce de banque. La Banque de France, de Londres, de Bordeaux. Le directeur, les régents de la banque. Porter son argent à la banque. Action de la banque. Banques d'escompte, de dépôt et de virement. Banques agricoles, hypothécaires, foncières, mobilières, immobilières. Banques industrielles, populaires, coloniales. Les banques particulières et les banques publiques sont ordinairement sous la surveillance de l'autorité. Il se dit, par extension, des Négociants mêmes qui font ce commerce. Les frères Tels sont la meilleure maison de banque d'Amsterdam. Billet de banque, Billet à vue et au porteur émis par une banque dite : Banque d'émission. En France, la Banque de France a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque. Billet de banque de cinq cents francs, de mille francs. Avoir un compte en banque, Y avoir des fonds déposés et s'y faire créditer ou débiter. Il se dit aussi, dans certains corps de métiers, du Paiement qui se fait aux ouvriers, chaque semaine, ou tous les quinze jours, ordinairement le samedi. Jour de banque. Livre de banque. À certains jeux où une seule personne joue contre plusieurs, il se dit de la Somme que celui qui tient le jeu a devant lui pour payer ceux qui gagnent. La banque est considérable. Faire une bonne, une mauvaise banque, Gagner ou perdre en tenant le jeu. Faire sauter la banque, Gagner tout l'argent que le banquier a mis au jeu. Dans certains corps de métiers, il se dit de la Table devant laquelle ou du Siège sur lequel travaillent les ouvriers.
Littré
-
1Originairement, commerce d'argent qu'on fait remettre de place en place, d'une ville à une autre, par le moyen des lettres de change?; établissement qui se chargeait de l'argent des particuliers pour le faire valoir à gros intérêts ou le mettre en sûreté. Faire la banque, faire ce genre de commerce.
Celui-ci faisait la banque?; celui-là se donnait au commerce de la mer
, Montesquieu, Lett. pers. 115. -
2Aujourd'hui, entreprise commerciale dont les opérations consistent à recevoir, conserver, payer, emprunter et prêter les capitaux sous forme de monnaie métallique ou autre.
Commerce consistant à effectuer pour le compte d'autrui des payements et recettes, à faire l'escompte, à acheter et revendre soit des valeurs commerciales, lettres de change, billets de commerce, effets publics, actions d'entreprises industrielles et tous titres créés pour l'usage du crédit, soit des monnaies ou matières d'or et d'argent.
Plus spécialement, les établissements par actions qui se livrent à ces diverses opérations.
Maison de banque, maison qui s'occupe principalement des opérations de banque.
Banque, lieu où se font les opérations.
Banque de circulation, celle qui émet des billets dits de banque.
Banque de dépôt et de virement, celle qui reçoit des valeurs et les transfère par ses écritures.
Banque d'escompte, celle qui fait des avances sous forme d'escompte et de prêt direct.
Banque publique?: 1° celle qui fait ses opérations non avec des clients particuliers, mais avec le public en général, à des conditions réglées par des dispositions générales?; 2° institution de banque fondée, dirigée ou dotée par les États ou villes qui en sont le siége.
Banque agricole, celle qui fait des avances à l'agriculture.
Banque foncière, immobilière, territoriale, celle qui fait des prêts garantis par des immeubles.
Banque mobilière, celle qui fait des avances sur valeurs mobilières.
Banque hypothécaire, celle qui fait des prêts sur hypothèque.
- 3 Terme d'imprimerie. Payement fait aux ouvriers chaque semaine ou tous les quinze jours.
-
4 Terme de jeu. Somme qu'a devant lui le joueur qui tient contre tous les autres.
Faire sauter la banque, gagner tout l'argent de celui qui tient le jeu.
Fig.
Ces gens jouent contre le peuple, mais ils tiennent la banque contre lui
, Montesquieu, Esp. XXV, 6. - 5Au jeu du commerce, les cartes qui composent le talon.
-
6 Terme de métiers. Instrument qui porte les bobines du passementier.
Banc sur lequel travaille l'ouvrier en peignes.
Billot où est la meule d'acier sur laquelle se font les pointes d'épingles.
- 7 Terme de marine. Navire qui fait la pêche de la morue sur le banc de Terre-Neuve.
- 8 Populairement, les artifices des bateleurs, le charlatanisme.
HISTORIQUE
XVIe s. Le charlatan estoit monté sur un petit eschaffaut jouant des regales [sorte d'épinette] et tenant banque comme on en voit assez à Venise en la place St-Marc
, Sat. Mén. p. 3.
SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
BANQUE.Banque d'émission, banque qui émet des billets. En principe, les billets d'une banque d'émission devraient être représentés par son stock métallique et par son portefeuille exclusivement composé de bonnes lettres de change
, De Waru, Enquête sur la Banque, p. 205.
Je serai curieux de vous mander des nouvelles?, et je sais bien que je suis la meilleure banque d'où vous en sauriez avoir, Malherbe, Lexique, éd. L. Lalanne.
Encyclopédie, 1re édition
BANQUE, s. f. (Commerce.) nous réunirons sous ce titre plusieurs expressions & termes de commerce usités dans le trafic de la banque, comme avoir un compte en banque, avoir crédit en banque, ouvrir un compte en banque, donner crédit en banque, écrire une partie en banque, créditer quelqu'un en banque, écritures de banque.
Avoir un compte en banque, c'est y avoir des fonds & s'y faire créditer ou débiter, selon qu'on veut faire des payemens à ses créanciers en argent, ou en recevoir de ses débiteurs en argent de banque, c'est-à-dire, en billets ou écritures de banque.
Avoir crédit en banque, c'est être écrit sur les livres de la banque, comme son créancier ; & y avoir débit, c'est en être débiteur.
Ouvrir un compte en banque, c'est la premiere opération que font les teneurs de livres d'une banque, lorsque les particuliers y portent des fonds pour la premiere fois.
Donner crédit en banque ; c'est charger les livres de la banque des sommes qu'on y apporte, ensorte qu'on fait débiter sa caisse, c'est-à-dire, qu'on la rend débitrice à ceux qui y déposent leur fonds.
Ecrire une partie en banque ; c'est faire enregistrer dans les livres de la banque, le transport mutuel qui se fait par les créanciers & les débiteurs des sommes ou de portions des sommes qu'ils ont en banque, ce qu'on appelle virement de parties. Voyez Virement.
Créditer quelqu'un en banque, c'est le rendre créancier de la banque ; le débiter, c'est l'en rendre débiteur.
Ecritures de banque ; ce sont les diverses sommes pour lesquelles les particuliers, marchands, négocians & autres, se sont fait écrire en banque.
Banque d'emprunt, en Hollandois bankvanleeninge ; c'est une espece de mont de piété établi à Amsterdam, où l'on préte de l'argent aux particuliers qui en ont besoin, moyennant qu'ils y déposent des gages pour la surêté des sommes prêtées, & qu'ils payent l'intérêt reglé à tant par mois par les bourguemestres ou échevins ; c'est ce qu'on appelle plus communément la maison des lombards, ou le lombard. Voyez Lombard.
Banque (Commerce.) se dit encore de certaines sociétés, villes ou communautés, qui se chargent de l'argent des particuliers pour le leur faire valoir à gros intérêts, ou pour le mettre en sûreté.
Il y a plusieurs especes de banques etablies dans les plus grandes villes commerçantes de l'Europe, comme à Venise, Amsterdam, Rotterdam, Hambourg, Londres, Paris, &c.
On peut voir ce que nous avons dit sous le mot Banco, de celle de Venise, sur le modele de laquelle les autres ont été formées, & dans le Dictionnaire du Commerce, de Savary, les détails dans lesquels il entre sur les banques d'Amsterdam & de Hambourg, aussi-bien que sur celle qui fut érigée en France en 1716, par le sieur Law & compagnie, sous le nom de banque générale, convertie en banque royale en 1718, & dont les billets, qui avoient monté à la somme de deux milliards six cens quatre-vingts-seize millions quatre cents mille livres, furent supprimés par arrêt du conseil du 10 Octobre 1720. Nous ne parlerons ici que de la banque royale d'Angleterre & de la banque royale de Paris, sur le pié qu'elles subsistent aujourd'hui, & ce que nous en dirons est emprunté du même auteur.
Banque royale d'Angleterre ; elle a les mêmes officiers que l'échiquier. Voyez Echiquier. Le parlement en est garant ; c'est lui qui assigne les fonds nécessaires pour les emprunts qu'elle fait sur l'état.
Ceux qui veulent mettre leur argent à la banque en prennent des billets, dont les intérêts leur sont payés, jusqu'au jour du remboursement, à raison de six pour cent par an.
Les officiers de la banque royale font publier de tems en tems les payemens qu'ils doivent faire, & pour lors ceux qui ont besoin de leur argent le viennent recevoir. Il est cependant permis aux particuliers d'y laisser leurs fonds, s'ils le jugent à propos, & les intérêts leur en sont continués sur le même pié de six pour cent par an.
Comme il n'y a pas toûjours des fonds à la banque pour faire des payemens, ceux qui, dans le tems que la caisse de la banque est fermée, ont besoin de leur argent, négocient leurs billets à plus ou moins de perte, suivant le crédit que ces papiers ont dans le public, ce qui arrive ordinairement suivant les circonstances & le bon ou mauvais succès des affaires de l'état.
Banque royale de Paris est celle qui fut établie en cette ville par arrêt du conseil du 4 Décembre 1718, dont le fonds ne pouvoit passer six cens millions. On appelloit en France bureaux de la banque royale, les lieux où se faisoient les diverses opérations de cette banque, les payemens & les viremens de parties, soit en débit, soit en crédit, pour ceux qui y avoient des comptes ouverts. Les principaux de ces bureaux, après ceux de Paris, furent placés à Lyon, à la Rochelle, Tours, Orléans, & Amiens. Il y avoit deux caisses dans chaque bureau ; l'une en argent pour acquitter à vûe les billets, & l'autre en billets pour fournir de l'argent à ceux qui en demandoient.
« Dans les états qui font le commerce d'?conomie, dit l'auteur de l'esprit des Loix, on a heureusement établi des banques qui, par leur crédit, ont formé de nouveaux signes des valeurs : mais on auroit tort de les transporter dans les états qui font le commerce du luxe. Les mettre dans des pays gouvernés par un seul, c'est supposer l'argent d'un côté & de l'autre la puissance, c'est-à-dire, la faculté de tout avoir sans aucun pouvoir, & de l'autre le pouvoir sans aucune faculté ». Esprit des Loix, tom. II. pag. 7.
Les compagnies & les banques achevent d'avilir l'or & l'argent dans leur qualité de signe, en multipliant par de nouvelles fictions, les représentations des denrées.
Banque, trafic, commerce d'argent qu'on fait remettre de place en place, d'une ville à une autre, par des correspondans & commissionnaires, par le moyen des lettres de change.
Le mot banque vient de l'Italien banca, formé de l'Espagnol banco, un banc sur lequel étoient assis les changeurs, ou banquiers, dans les marchés ou places publiques, ou d'une table sur laquelle ils comptoient leur argent, & qu'on nomme aussi en Espagnol banco. Guichard fait venir le nom de banque du Latin abacus, table, buffet. Voyez Abaque.
Il n'est pas nécessaire en France, d'être marchand pour faire la banque ; elle est permise à toutes sortes de personnes, même aux étrangers. En Italie, le commerce de la banque ne déroge point à la noblesse, particulierement dans les républiques.
Un négociant qui fait la banque, & qui veut avoir de l'ordre, doit tenir deux livres principaux ; l'un, appellé livre des traites, pour écrire toutes les lettres de change qu'il tire sur ses correspondans ; & l'autre, nommé livre des acceptations, sur lequel il doit écrire par ordre de date, les lettres de change qu'il est obligé d'acquitter, en marquant le nom du tireur, la somme, le tems de l'échéance & les noms de ceux qui les lui ont présentées.
Banque, se dit aussi du lieu où les banquiers s'assemblent pour exercer leur trafic ou commerce ; on nomme ce lieu différemment, selon les pays : à Paris, c'est la place du change ; à Lyon, le change ; à Londres & à Rouen, la bourse ; à Marseille, la loge, &c. (G)
Banques à sel ; ce sont des greniers sur les frontieres de la Savoie, voisines de la France, où l'on débite du sel aux faux-sauniers François, à raison de quatre sous la livre, argent de France, poids de Geneve, qui est de dix-huit onces à la livre, pendant que les Savoyards le payent quatre sous de Piémont. La livre de Piémont n'est que de douze onces, ce qui fait neuf deniers de plus sur l'argent, & un tiers sur le poids, qui vaut un sou sept deniers, c'est-à-dire, deux sous quatre deniers sur le tout ; ainsi la différence est de plus de moitié. C'est une des suites des traités par lesquels la France s'est obligée à fournir à la Savoie jusqu'à la concurrence de 45 à 50 mille minots conduits & rendus dans les différens endroits indiqués par les traités.
La France fournit encore 5000 quintaux de sel de Peccais à la ville de Geneve, 6000 à la ville de Valais, & 1522 à la ville de Sion : mais aucun de ces pays ne fait, du bienfait du roi, un usage contraire à sa destination, & les quantités se consomment dans le pays, soit par besoin, soit par bonne-foi.
Banque, se dit chez les Imprimeurs, du payement qu'on fait du travail aux ouvriers de l'Imprimerie ; le jour de la banque est le samedi : on entend aussi par banque, la somme entiere que chaque ouvrier reçoit.
Banque, chez les Passementiers, est l'instrument propre à porter les rochets, ou bobines, pour ourdir : il y a des banques de plusieurs sortes ; les unes, outre cet usage, ont encore celui de pouvoir servir de plioir ; d'autres ressemblent assez à ces porte-vaisselles appellés dressoirs, & ont, ou peuvent avoir, double rang de broches ; les premieres auroient aussi cet avantage si on perçoit des trous paralleles dans la largeur des trois petites planchettes qui sont vûes droites dans nos planches de Passementerie, où sont représentées les deux sortes de banques dont nous venons de parler. En pratiquant ces trous paralleles, on auroit la facilité de mettre tant de rochets en banque que l'on voudroit. On a, dans les mêmes planches, une troisieme sorte de banque ; c'est une espece de poteau quarré dont la largeur n'est pas absolument déterminée, puisque si l'on vouloit y mettre deux rangs de broches, il faudroit qu'il fût plus épais que lorsqu'il n'y en auroit qu'un rang ; on fait entrer dans ce poteau le bout pointu de ces broches, de sorte qu'elles y demeurent invariables : on les place parallelement les unes aux autres ; on en peut mettre tant qu'il en pourra tenir, en laissant toutefois une distance telle que les bords des deux rochets ne se puissent toucher ; sans cette précaution ils s'empêcheroient mutuellement de se mouvoir, ou mettroient au moins les soies en danger de casser. Dans le cas où ces bords de rochets, ou bobines, se trouveroient trop hauts, & que ce frottement fût inévitable, il faudroit pour lors espacer davantage les broches les unes des autres, en laissant une place vuide entre deux, on trouveroit ainsi l'espace dont on avoit besoin : mais à quoi bon cette grande quantité de broches, dira-t-on ? lorsqu'on aura lû à l'article Ourdir, que l'on n'ourdissoit qu'avec seize rochets ; il ne faut donc, continuera-t-on, que seize broches, ou tout au plus trente-deux, ce qui n'exposera plus au frottement qu'on craignoit. Quoique la regle générale soit d'ourdir à seize rochets, ou tout au plus à trente-deux, comme le pratiquent plusieurs ouvriers qui par-là avancent plus vîte de moitié, façon de travailler qui doit être peu suivie, parce qu'il est bien plus difficile de veiller sur trente-deux rochets que sur seize, & par conséquent plus facile d'échapper un brin, ou même plusieurs qui viennent à casser : je n'en serai pas moins pour la quantité de broches à cette banque ; car au même article Ourdir, à l'endroit où il est question des rubans rayés, on voit qu'il faut, suivant le besoin, changer de couleur. En supposant qu'on eût quatre couleurs à employer, & qu'il y eut soixante-quatre broches à la banque, on auroit quatre couleurs sous la main toutes fois qu'il faudroit qu'on en changeât : d'abord deux sur la même face, ayant seize broches de chaque côté, puis en retournant la banque, encore deux autres. On voit que ces broches ne sont pas posées horisontalement, mais qu'au contraire le bout extérieur est plus élevé que l'autre, en voici la raison : si les broches étoient paralleles à l'horison, les rochets, par la vîtesse avec laquelle ils se meuvent, (car il faut qu'ils fassent bien des tours pendant que le moulin de l'ourdissoir n'en fait qu'un) seroient en danger de s'échapper des broches, inconvénient que l'on évite par l'inclinaison des broches : étant ainsi placées, il est bon d'ajuster à chacune un moule de bouton, qui, par sa convexité, empêchera que le rochet ne frotte en tant de parties contre la face platte du poteau ; la planche d'en bas, qui lui sert de base, est revêtue des quatre côtés de triangles, ce qui la rend propre à contenir les rochets, vuides ou pleins, qu'on y veut mettre.
Banque, partie du bois de métier d'étoffe de soie. C'est un plateau de noyer de deux pouces environ d'épaisseur, d'un pié de largeur, & deux piés de long, dans lequel est enclavé le pié de devant le métier ; ce plateau sert à reposer les navettes pendant que l'ouvrier cesse de travailler, & il retient le tenant de l'ensuple de devant. Voyez à l'article Velours cizelé, l'explication détaillée des pieces du métier.
Banque, (en terme de Tabletier Cornetier.) est une espece de banc triangulaire & à trois piés, sur lequel l'ouvrier en peignes travaille à califourchons, & qui a les mêmes parties, & le même usage que l'âne. Voyez Ane, machine, description & figure.
Banque, (Commerce.) c'est ainsi qu'on nomme à certains jeux, comme à celui du commerce, les cartes qui restent après qu'on en a donné à tous les joüeurs le nombre qu'exige le jeu. La banque s'appelle à d'autres jeux, talon, ou fond. Voyez Talon & Fond.
Wiktionnaire
Nom commun 2 - français
banque \b??k\ masculin
- (Vieilli) (Désuet) Variante de bangue, selon le Antoine de Rivarol, Dictionnaire classique de la langue française, 1827.
Nom commun 1 - français
banque \b??k\ féminin
-
Commerce qui consiste à recevoir des capitaux en compte courant avec ou sans intérêt ; à échanger des effets ou à les escompter avec des espèces, à des taux et moyennant des commissions variables ; à exécuter pour le compte de tiers toutes opérations de ce genre et à se charger de tous services financiers ; à créer et à émettre des lettres de change ; d'une façon générale, commercer de l'argent, ainsi que des titres et valeurs.
- Ce négociant fait la banque, entend bien la banque.
- Tenir banque ouverte.
-
(Par extension) Entreprise ou société qui fait ce commerce.
- Dans toutes les Bourses de la terre, ce fut une avalanche de titres que les porteurs voulaient vendre ; les banques suspendirent leurs paiements, les affaires furent paralysées et cessèrent ; [?]. ? (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 288 de l'édition de 1921)
- Il fut démontré qu'il avait touché pour ne rien dire des agissements d'une banque, laquelle, comme toutes les banques, des plus falotes aux plus omnipotentes, saignait cruellement le troupeau des épargnants cupides et malfaisants. ? (Victor Méric, Les Compagnons de l'Escopette, Éditions de l'Épi, Paris, 1930, page 32)
- Le crédit conso n'est plus en effet seulement l'affaire des filiales spécialisées des banques, des hypermarchés ou des constructeurs automobiles. De nouveaux acteurs sont apparus : les banques en ligne, notamment, qui désormais s'intéressent toutes à ce produit. ? (Éric Dumont, Assurance - Banque - Gestion de patrimoine : 6 cas de management stratégique, tome 2A, INSEEC U /La Charte, 2019)
-
(En particulier) Établissement où se fait ce commerce.
- Porter son argent à la banque. ?Action de la banque.
- Banques d'escompte, de dépôt et de virement. ? Banques agricoles, hypothécaires, foncières, mobilières, immobilières. ? Banques industrielles, populaires, coloniales.
- Les banques particulières et les banques publiques sont ordinairement sous la surveillance de l'autorité.
-
(Par extension) Négociants mêmes qui font ce commerce.
- Les frères Untels sont la meilleure maison de banque d'Amsterdam.
-
(Vieilli) Paiement qui se faisait aux ouvriers, chaque semaine, ou tous les quinze jours, ordinairement le samedi.
- Jour de banque. ? Livre de banque.
-
(Jeux) Somme que celui qui tient le jeu devant lui utilise pour payer ceux qui gagnent, en parlant de certains jeux où une seule personne joue contre plusieurs, ou personne qui gère cette somme.
- La banque est considérable.
- Faire une bonne, une mauvaise banque, gagner ou perdre en tenant le jeu.
- Faire sauter la banque, gagner tout l'argent que le banquier a mis au jeu.
- Le découragement qui n'est jamais de longue durée chez le joueur, a suscité l'idée de forcer la banque à paroliser en organisant contre elle des martingales. ? (La roulette et le trente-et-quarante, 1883, page 241)
-
(Cartes à jouer) Sorte de jeu de cartes.
- La Banque, qui à l'origine s'appelait Banco, est l'un des plus anciens jeux de cartes pratiqués en France, avant d'envahir l'Europe. Comme son nom l'indique, il est d'origine italienne et il pénétra en France sous Charles VIII, à la suite de guerres d'Italie. ? (Frans Gerver, Le guide Marabout de Tous les Jeux de Cartes, Verviers : Gérard & C°, 1966, page 45)
-
Table ou banc devant lesquels travaillent les ouvriers, dans certains corps de métiers.
- Angelo trouva un magasin de drapier ouvert. À travers la vitrine, il vit même un monsieur bien habillé, assis sur une banque à mesurer le drap. ? (Jean Giono, Le hussard sur le toit, 1951, réédition Folio Plus, page 210)
- (Régionalisme) Étal, comptoir chez un commerçant.
-
(Par extension) Endroit où l'on peut entreposer en toute sécurité, toute sorte de choses.
- Banque de sperme.
-
(Vieilli) Boniment, flatterie.
-
? Quel magnifique tableau !
? Nous le mettrons au musée?
? De Versailles ?
? Non, de Paris?
? Ah ! oui? à l'Exposition !
? Et nous inscrirons sur le livret cette notice?
? Non ! pas de banque ! pas de réclame ! ? (Eugène Labiche, Le Voyage de monsieur Perrichon, 1860, acte III, scène 8. L'édition de 1985 précise « Ce texte est conforme à l'édition originale ; cependant les graphies ont été modernisées. »)
-
? Quel magnifique tableau !
Trésor de la Langue Française informatisé
BANQUE1, subst. fém.
BANQUE2, subst. fém.
Banque au Scrabble
Le mot banque vaut 15 points au Scrabble.
Informations sur le mot banque - 6 lettres, 3 voyelles, 3 consonnes, 6 lettres uniques.
Quel nombre de points fait le mot banque au Scrabble ?
Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.
SCRABBLE © est une marque déposée. Tous les droits de propriété intellectuelle du jeu sont détenus aux Etats-Unis et au Canada par Hasbro Inc. et dans le reste du monde par J.W. Spear & Sons Limited de Maidenhead, Berkshire, Angleterre, une filiale de Mattel Inc. Mattel et Spear ne sont pas affiliés à Hasbro.
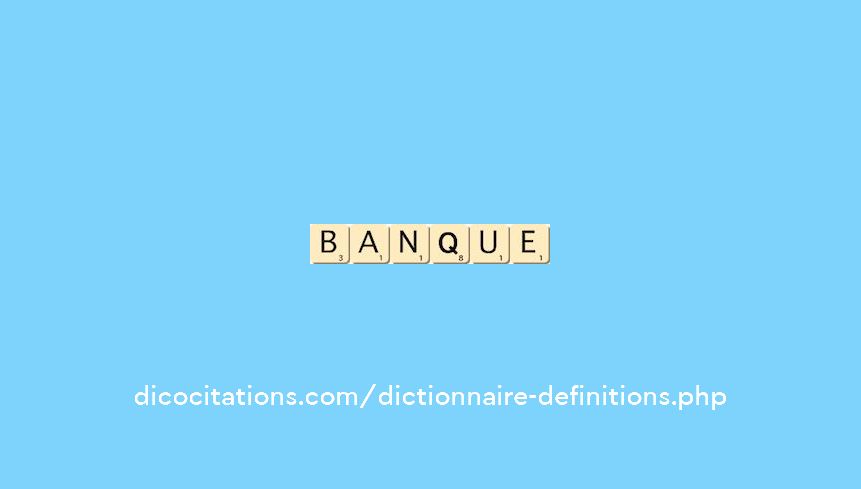
Les mots proches de Banque
Ban Banal, ale Banaliser Banalité Banane Banc Bancelle Bandage Bande Bande Bandé, ée Bandeau Bander Banderole Bandeur Bandière Bandiote Bandit Bandite Bandolier ou bandoulier Bandoulière Bang Banks Banlieue Banne Banneau Banneret Banneton Banni, ie Bannie Bannière Bannir Bannissable Bannissement Bannisseur Banque Banquereau Banqueroute Banqueroutier, ière Banquet Banqueter Banquette Banquier Banquière Banse Bantam Banteng ban Ban-de-Laveline Ban-de-Sapt Ban-Saint-Martin Ban-sur-Meurthe Ban-sur-Meurthe-Clefcy banal banale banalement banales banalisait banalisation banalise banalisé banalisée banalisées banalisent banaliser banalisés banalité banalités banals banana bananas banane bananer bananeraie bananes bananier bananier bananière bananiers bananiers Banassac Banat banaux banc banc-titre Banca bancaire bancaires bancal bancale bancales bancals banche Bancigny banco banco bancoMots du jour
-
dopais tolérante patouillard prévôt stalagmite contritions projette professa réglementairement gradué
Les citations avec le mot Banque
- Il est douloureux de voir un autre s'asseoir au banquet où l'on n'est pas invité, et coucher avec la femme qui n'a pas voulu de vous.Auteur : Théophile Gautier - Source : Mademoiselle de Maupin (1835)
- Elle avait conscience de ne pouvoir être pleinement heureuse hors d'une certaine conjonction de la banque et du lit.Auteur : Vladimir Nabokov - Source : Roi, dame, valet (1971)
- Ils avoient en abomination les banquets et yvrogneries qu'il faisoit ordinairement, à heure indeue.Auteur : Jacques Amyot - Source : Antonius, 12
- Les dévaluations sont aux démocraties ce que les banqueroutes étaient aux rois.Auteur : Paul Morand - Source : Journal inutile 1968-1972, 20 juillet 1968
- Les aveugles ont l'ouïe très développée. Un aveugle peut reconnaître si un billet de banque est faux rien qu'au bruit des menottes se refermant sur ses poignets.Auteur : François Cavanna - Source : Les Pensées de Cavanna
- Tout se liquide en perte dans la vie : mourir, c'est déposer son bilan. La mort n'est en réalité qu'une banqueroute définitive.
Auteur : Louise Ackermann - Source : Pensées d'une solitaire (1903)
- L'argent ! s'exclama Kompè. L'eau vous lave, l'argent vous rend propre. Mais je connais des gens que tout l'argent qui sommeille à la grande banque de Darako ne saurait débarrasser de leurs souillures.Auteur : Massa Makan Diabaté - Source : Le Coiffeur de Kouta (1980)
- Sur les banquettes autour de nous des festoyeurs un peu saouls dormaient déjà.Auteur : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline - Source : Voyage au bout de la nuit (1932)
- Je fais savoir à ma banque que pour mon découvert je viendrai les voir dimanche.Auteur : Michel Jonasz - Source : V'là le soleil qui se lève
- Le banquet ... dura quarante-huit heures. Il y fut bu quatre hectolitres d'un vin blanc du Nord, bon marché et âcre, mais riche en alcaloïdes qui excitent au plus haut point les nerfs moteurs.Auteur : Roger Vailland - Source : 325 000 francs (1955)
- Je chante le chien crotté, le chien pauvre, le chien sans domicile, le chien flâneur, le chien saltimbanque, le chien dont l'instinct, comme celui du pauvre, du bohémien et de l'histrion, est merveilleusement aiguillonné par la nécessité, cette si bonne mère, cette vraie patronne des intelligences !Auteur : Charles Baudelaire - Source : Les Bons Chiens
- Il eut un haut-le-corps devant le cadavre de Gaspard. Il avait encore banqueté trois jours auparavant avec lui chez Sauvecanne, au repas de Tousing Club. Même un médecin s'étonne toujours de la mort d'un mortel.Auteur : Pierre Magnan - Source : La Maison assassinée (1984)
- Etrangers, vous m'avez accueilli comme un frère, - Et fait asseoir dans vos banquets.Auteur : Victor Hugo - Source : Odes et Ballades (1826)
- Alors tout le monde se dressa et on leva les verres. A la plus haute période du banquet, il était de rigueur, chez nous, de brinder en faisant un voeu, puis d'échanger les coupes et de s'embrasser, garçons et filles.Auteur : Henri Bosco - Source : Le Mas Théotime (1945)
- N'aille an banquet, qui ne veut pas manger;
Ni sur la mer, qui a peur du danger;
Ni à la cour, qui dit tout ce qu'il pense;
Non plus au bal, qui n'aime pas la danse.Auteur : Proverbes français - Source : Proverbe - Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le retire dès qu'il se met à pleuvoir.Auteur : Jerome Klapka, dit Jerome K. Jerome - Source : Sans référence
- Dans un pays où tout le monde cherche à paraître, beaucoup de gens doivent croire, en effet, qu'il vaut mieux être banqueroutier que de n'être rien.Auteur : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort - Source : Pensées, Maximes et Anecdotes (1803)
- Le capitalisme est un monstre à deux têtes - la banque et le patronat.Auteur : Olivier Besancenot - Source : La conjuration des inégaux. La lutte des classes au XXIe siècle (2014)
- Là où est l'amour, là est le véritable banquet.Auteur : Armand Robin - Source : Le Temps qu'il fait (1942)
- Au banquet de la vie, infortuné convive, - J'apparus un jour, et je meurs: - Je meurs, et sur ma tombe, où lentement j'arrive - Nul ne viendra verser des pleurs.Auteur : Nicolas Joseph Laurent Gilbert - Source : Ode imitée de plusieurs psaumes
- Le banquet annuel des Evventualistes, sous la Haute-présidence du docteur Tribulat Bonhomet, s'achevait en toasts paisibles.Auteur : Auguste, comte de Villiers de l'Isle-Adam - Source : Tribulat Bonhomet (1887)
- A cette époque fatale pour la vertu de deux jeunes filles, tout leur manqua dans un seul jour: une banqueroute affreuse précipita leur père dans une situation si cruelle, qu'il en périt de chagrin.Auteur : Donatien Alphonse François, marquis de Sade - Source : Justine ou les Malheurs de la vertu (1791)
- Tout croulait, du moment que l'idée de liberté faisait banqueroute, que la liberté n'était plus l'unique bien, le fondement même de la république, qu'ils avaient si chèrement achetée, d'un si long effort.Auteur : Emile Zola - Source : Paris (1898)
- Ce matin, lorsque je suis arrivé à la banque, comme d'habitude, j'ai trouvé le patron dans cet état, et le coffre-fort ouvert... J'ai donné l'alarme. On a immédiatement pendu sept nègres, mais le coupable s'est enfui...Auteur : Georges Remi, dit Hergé - Source : Les Aventures de Tintin, 3. Tintin en Amérique (1932)
- Si le climat était une banque, les pays riches l'auraient déjà sauvé.Auteur : Hugo Rafael Chávez Frías, dit Hugo Chávez - Source : A Copenhague, Radio Nacional de Venezuela, Le Grand Soir, 18 décembre 2009.
Les citations du Littré sur Banque
- Avec terme plus propre nous ne pouvons nommer celui qui fait le banquet que festinantAuteur : PASQUIER - Source : Recherches, liv. VIII, p. 674, dans LACURNE
- Au banquet de la vie à peine commencé, Un instant seulement mes lèvres ont pressé La coupe en mes mains encor pleineAuteur : A. CHÉN. - Source : Jeune capt.
- Entre emporter le chat et faire un trou à la lune, les savants pourront trouver quelque différence ; ils diront qu'emporter le chat signifie simplement partir sans dire adieu, et faire un trou à la lune veut dire s'enfuir de nuit pour une mauvaise affaire ; un ami qui part le matin de la maison de campagne de son ami, a emporté le chat ; un banqueroutier qui s'est enfui a fait un trou à la lune ; l'étymologie est toute naturelle pour un homme qui s'est évadé de nuitAuteur : Voltaire - Source : Lett. Delisle, 15 déc. 1773
- Aucun dans le banquet ne veut l'abandonner [Jésus-Christ], Mais dedans le désert il est seul à jeûnerAuteur : Corneille - Source : Imit. II, 11
- Il desista d'aller aux banquets où l'on le convioitAuteur : AMYOT - Source : Péric. 12
- En sorte qu'il fût aisé de ne jamais faire banquerouteAuteur : FÉN. - Source : Tél. XII
- Je voudrais qu'à cet âge [la vieillesse] On sortît de la vie ainsi que d'un banquetAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. VIII, 1
- Si Lusignan ne rappelait à sa fille que les banquets et les joies de l'Olympe, cela serait d'un faible intérêt pour elleAuteur : CHATEAUBR. - Source : Génie, II, II, 5
- Comme celles qui, venant au banquet après avoir bien disné, font la petite bouche devant le mondeAuteur : YVER - Source : p. 562
- 12 février 1686 : ....une manière de loterie et de banque.... Mme de Béringhen eut le gros lot que le roi avait donné gratuitement, et Sa Majesté, qui avait des billets, en ayant trouvé un noir, l'envoya sur l'heure à Mlle de Rambures : c'était un miroir d'argent fort beauAuteur : DANGEAU - Source : p. 294
- Mon émerveillement dure toujours, que le fils de Samuel nous ait fait banqueroute six mois après nous avoir pris notre argent, et qu'il ait trouvé le secret de fricasser huit millions obscurément et sans plaisirAuteur : Voltaire - Source : Lett. d'Argental, 15 mai 1758
- Celui-ci faisait la banque ; celui-là se donnait au commerce de la merAuteur : Montesquieu - Source : Lett. pers. 115
- Pour moi, je ferai un mémoire sanglant contre les banqueroutiersAuteur : Voltaire - Source : Lett. Mme de Fontaine, 11 juin 1761
- Il se feit un banquet, auquel estans tous les chefs de l'armée conviez, il....Auteur : AMYOT - Source : Lysand. 29
- Il se trouve qu'à Tourney et à Ferney je nourris cent cinquante personnes ; on ne soutient pas cela avec des vers alexandrins et des banqueroutesAuteur : Voltaire - Source : Lett. d'Argental, 19 déc. 1766
- Car Dieu mit ces degrés aux fortunes humaines ; Les uns vont tout courbés sous le fardeau des peines ; Au banquet du bonheur bien peu sont conviésAuteur : Victor Hugo - Source : F. d'automne, 32
- La vie est chère à l'homme, entre les dons du ciel ; Nous bénissons toujours le Dieu qui nous convie Au banquet d'absinthe et de mielAuteur : Victor Hugo - Source : Odes, IV, 4
- Elle [la Banque] aurait de nombreux concurrents dans les disposeurs de capital qui escompteraient à un taux inférieur au sienAuteur : DE WARU - Source : Enquête sur la Banque, p. 105
- Oubliait-on qu'ici les déesses des morts Sont du dieu des banquets les compagnes cruelles ?Auteur : LEMERC. - Source : Agamemnon, IV, 5
- Entrez dans la bourse de Londres.... là le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion, et ne donnent le nom d'infidèles qu'à ceux qui font banquerouteAuteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Presbytérien.
- Je vois fuir aussitôt toute la nation Des lapins, qui, sur la bruyère, L'oeil éveillé, l'oreille au guet, S'égayaient, et de thym parfumaient leur banquetAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. x, 15
- La banque doit toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas dans son portefeuille de signatures collusoires, de ces signatures qu'on appelle du papier de circulationAuteur : A. DURAND - Source : Enq. sur la banq. 1867, p. 260
- [Après un coup de feu] Je vois fuir aussitôt toute la nation Des lapins qui, sur la bruyère, L'oeil éveillé, l'oreille au guet, S'égayaient et de thym parfumaient leur banquetAuteur : Jean de La Fontaine - Source : Fabl. x, 15
- Béni sois-tu, vin détestable ! Bien qu'au maître de ce banquet Des flatteurs vantent ton bouquetAuteur : BÉRANG. - Source : Les car.
- J'ai dit que c'était un mot [banqueroute] qu'on osait à peine prononcer devant une chambre aussi honnête que celle-ci et dans un siècle aussi honnête que le nôtre ; mais j'ai soutenu qu'on marchait vers l'inaccomplissement des engagementsAuteur : THIERS - Source : Journ. des Débats, 7 juin 1865
Les mots débutant par Ban Les mots débutant par Ba
Une suggestion ou précision pour la définition de Banque ? -
Mise à jour le samedi 7 février 2026 à 18h18
Dictionnaire des citations en B +
Liste des mots et définitions commençant par
Etendez votre recherche : Citation sur banque
Poèmes banque
Proverbes banque
La définition du mot Banque est issue du Dictionnaire français - La définition et la signification du mot Banque sont données à titre indicatif. Les réponses à votre question sur la signification Banque présentées sur ce site peuvent être complétées par vos commentaires.
